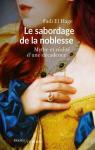Citations de Fadi El Hage (15)
Historien renommé, auteurs de nombreux ouvrages dont une Histoire des maréchaux de France à l'époque moderne couronnée en 2011 par le prix d'histoire militaire et qui fait autorité, Monsieur Fadi El Hage délaisse aujourd'hui les XVIIe et XVIIIe siècles qui étaient son domaine de prédilection et aborde un nouveau champ de recherche, fixant son attention et la nôtre sur un épisode clé de notre histoire : l'accession au trône de France d'Henri de Bourbon, roi de Navarre, à la suite de l'extinction en ligne masculine de la dynastie des Valois.
Préface de Bernard Barbiche, page 9.
Préface de Bernard Barbiche, page 9.
Il semble que les deux amants vivaient ensemble. La rumeur va plus loin, en évoquant un mariage secret. On retrouve l'information [...] dans le Journal du commissaire de police de Versailles, Pierre Narbonne : "Madame de Mazarin n'était pas riche, surtout après avoir eu la faiblesse de donner sa main à Monsieur Dumesnil, exempt des gardes, qui était accablé de dettes". [...]
En fait, la duchesse de Mazarin avait beaucoup à perdre en cas d'union officielle avec Dumesnil. Si elle l'avait épousé, elle n'aurait pas pu conserver son titre de duchesse [...], acquis par alliance. Elle aurait perdu son tabouret auprès de la reine.
Page 55-56.
En fait, la duchesse de Mazarin avait beaucoup à perdre en cas d'union officielle avec Dumesnil. Si elle l'avait épousé, elle n'aurait pas pu conserver son titre de duchesse [...], acquis par alliance. Elle aurait perdu son tabouret auprès de la reine.
Page 55-56.
La mort d'Henri IV semblait être arrivée à point nommé pour le royaume et pour la dynastie des Bourbons. Henri IV n'avait jamais fini d'incarner un paradoxe, de susciter quelques doutes. Sa foi catholique était-elle sincère ?
(Page 320)
(Page 320)
Henri IV fut le dernier roi de France à s'être impliqué personnellement dans un combat, au risque de sa vie. Il agit ainsi tant qu'il eut le sentiment de devoir conquérir sa légitimité. Il avait un courage personnel indéniable et ce coup d'œil qui permet de saisir opportunément un avantage pendant une bataille. En revanche, il n'était pas un stratège convaincant et ses compétences tactiques ne dépassaient pas le niveau d'un chef de parti voire d'un capitaine
(Page 211)
(Page 211)
L'Histoire ne se répète pas. Elle inspire. Au risque de vouloir imiter, pour ne pas dire singer. Mais elle inspire. L'impression de trouver des mécanismes ou de percevoir des similitudes, fait qu'on imite un processus passé, qui fait croire ensuite que l'Histoire se répète.
Introduction, page 16.
Introduction, page 16.
Henri III aspirait à repousser le retour de la guerre civile au sein même de Paris. Il voulait éviter une nouvelle Saint-Barthélémy, tout en soufflant le chaud et le froid entre les Ligueurs, le roi de Navarre et les "mignons".
(Page 88).
(Page 88).
L'ambassadeur espagnol[, Mendoza,] apprit la nouvelle de l'exécution des Guise à Saint-Dié, peut-être le jour même de l'événement. Le 27 décembre 1588, il exprima à Philippe II ses craintes quant à l'avenir de la Ligue :
"Enfin, il est mort, et à moins que Dieu n'accorde à son frère, le duc de Mayenne, et à Monsieur de La Châtre le moyen de parvenir à s'échapper, il n'y a plus de fondement à faire sur la Ligue".
(Page 151)
"Enfin, il est mort, et à moins que Dieu n'accorde à son frère, le duc de Mayenne, et à Monsieur de La Châtre le moyen de parvenir à s'échapper, il n'y a plus de fondement à faire sur la Ligue".
(Page 151)
Palma Cayet (passé du Protestantisme au Catholicisme en 1595) n'eut de cesse de suggérer dans sa Chronologie novenaire à quel point il doutait de la vocation religieuse de la Ligue [union de seigneurs de confession catholique rassemblés pour lutter contre le Protestantisme]. Il penchait plutôt vers l'idée que la motivation première était "l'intérêt particulier de tant de Grands qui prirent lors les armes". [...]. Un chroniqueur catholique anonyme du Bas-Poitou ne voyait pas ladite Ligue sous un jour positif. Il la décrit comme ayant été "formée par des Catholiques peu instruits ou fanatiques et dirigée autant contre l'autorité royale [des Valois sans avenir dynastique par la faute d'un Henri III peu empressé auprès de son épouse et peu porté à faire des enfants] que contre les Protestants".
(Page 65)
(Page 65)
Dumesnil se [mettait] bien avec les puissants et [savait] finalement mener sa barque opportunément. Un personnage le soutenant commençait à pâlir ? Dumesnil parvenait désormais à se maintenir à flot ! Durant toutes ces années, il avait appris à entretenir de solides amitiés, mais aussi à louvoyer, à préparer toujours un coup d'avance, comme dans une partie d'échecs, afin de ne pas avoir une seule personne protectrice avec qui il chuterait en cas de disgrâce. Ce fut justement l'écueil qu'il évita lors de la campagne de 1744.
(Page 82)
(Page 82)
Joachim obtint le rang de mestre de camp le 23 juillet 1730. En 1742, le cardinal de Fleury expliqua que "dans les Gardes du Corps (...), il fallait six ans d'ancienneté d'exempt pour avoir la commission". Joachim avait attendu un peu plus de quatre ans et demi. C'était un signe de faveur. Cette promotion avant l'âge de trente ans était essentielle, car il s'agissait de la dernière commission à obtenir avant d'espérer l'accession aux grades d'officiers généraux.
Page 44
Page 44
Les services de Dumesnil furent considérés comme méritants. En effet, dès le mois de mai 1735, il reçut enfin sa croix de chevalier de l'ordre de Saint-Louis pour laquelle il remercia le secrétaire d'État de la Guerre, Bauyn d'Angervilliers, dans une lettre citée plus haut. Le maréchal de Coigny exprima lui-même sa satisfaction, en affirmant l'année d'après : "Je ne puis rendre un trop bon témoignage de la manière dont a servi le sieur du Ménil [dans] cette campagne".
La perception unanime de Joachim comme un bel homme justifiait son surnom de "beau Dumesnil". Au physique agréable s'ajoutait l'éloquence et une belle voix, soulignée par Grandfontaine qui, dans son Éloge, évoque la "physionomie radieuse" de cet officier.
Polybe inaugure son propos avec la monarchie, système équilibré par le conseil des représentants intermédiaires, tempérant le pouvoir d'un seul homme. Or, quand le roi commence à prendre des décisions seul, sans en référer aux corps intermédiaires, le régime se mue en tyrannie, appelé aussi dans certaines traductions françaises "despotisme". Cet exercice personnel du pouvoir, sans contrôle où le roi décide seul ou avec quelques conseillers choisis en dehors de la tradition, aboutit finalement à son rejet, puis à l'installation d'une aristocratie. Dans sa définition originelle, ce désignait le « gouvernement des meilleurs », dans le sens des plus méritants. Seulement, à l'instar de l'ensemble des systèmes politiques, l'aristocratie laisse place à son avatar dégradé, l'oligarchie. Le pouvoir est alors entre les mains d'un petit nombre de personnes appartenant à un même groupe, social par exemple, sans que le mérite y joue le moindre rôle. Le renversement de l'oligarchie entraîne l'établissement de la démocratie, où le peuple se voit doté d'une capacité de décision en partie directe, mais essentiellement exercée par le biais de représentants collégiaux, afin qu'un seul n'ait pas trop de pouvoir décisionnaire. La démocratie elle-même succombe à un moment pour aboutir à une ochlocratie, dans laquelle la foule manipulée et excitée par des passions et rumeurs soutient des factions en lutte pour le gouvernement. L'épuisement mental et moral causé par l'ochlocratie incite à appeler un homme providentiel destiné à remettre de l'ordre dans la politique, pour mieux aboutir à un retour de la monarchie.
Pour Fénélon, redonner autorité à la noblesse, mais pas n'importe laquelle, était un garde-fou contre le despote, qui préférait s'appuyer sur des hommes nouveaux, de condition plus modeste. Le rang et l'ancienneté nobiliaires devinrent des obsessions, perceptibles chez Fénélon mais encore plus chez Saint-Simon, allant jusqu'à se montrer parfois antithétiques. Si Fénélon n'appréciait pas le maréchal de Villars pour son caractère, Saint-Simon lui reprochait également d'avoir été élevé au duché-pairie comme lui, d'avoir été revêtu du Saint-Esprit comme lui, alors que sa famille ne fut anoblie qu'à la fin du règne d'Henri III. Saint-Simon revendiquait une ascendance (bien qu'en ligne féminine) remontant aux comtes de Vermandois, eux-mêmes issus de Charlemagne. Comment un duc-pair plus récent, issu selon lui d'un « greffier de Condrieu », pouvait-il être revêtu d'honneurs similaires, voire supérieurs ?
L’oisiveté représentait un danger. Louis-Antoine Caraccioline dit rien d'autre dans son roman moraliste Les Derniers Adieux de la maréchale de *** à ses enfants (1769), dans lequel il lance un appel à la jeune noblesse d'épée :
Vous êtes les descendants d'une multitude d'aïeux que la Patrie compte au nombre de ses héros : leur sang ne circula dans leurs veines que pour se répandre et pour guérir les maux que l'ennemi faisait à l’État. C'est à ce prix qu'ils acquirent la noblesse dont vous jouissiez, et dont vous ne pouvez vous prévaloir qu'autant que vous les imiterez. On perd sa noblesse aux yeux de la raison et de la probité, quand on ne s'en sert que pour vivre dans le faste et dans la mollesse, que pour se donner des airs de hauteur et de fierté.
p.87
Vous êtes les descendants d'une multitude d'aïeux que la Patrie compte au nombre de ses héros : leur sang ne circula dans leurs veines que pour se répandre et pour guérir les maux que l'ennemi faisait à l’État. C'est à ce prix qu'ils acquirent la noblesse dont vous jouissiez, et dont vous ne pouvez vous prévaloir qu'autant que vous les imiterez. On perd sa noblesse aux yeux de la raison et de la probité, quand on ne s'en sert que pour vivre dans le faste et dans la mollesse, que pour se donner des airs de hauteur et de fierté.
p.87
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Editions Passés Composés
Sileva76
9 livres
Auteurs proches de Fadi El Hage
Quiz
Voir plus
En route avec James Stewart
Dans ce film, adaptation du roman de Lewis R. Foster, James Stewart joue en 1939 sous la direction de Frank Capra. Il entre en politique aux côtés des acteurs Claude Rains et Edward Arnold dans:
Monsieur Smith au Sénat
Monsieur Smith au Capitole
Monsieur Smith à la Maison Blanche
10 questions
32 lecteurs ont répondu
Thèmes :
acteur
, Acteurs de cinéma
, hollywood
, adapté au cinéma
, adaptation
, littérature
, romans policiers et polars
, roman noir
, culture généraleCréer un quiz sur cet auteur32 lecteurs ont répondu