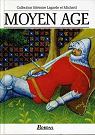Nationalité : France
Né(e) à : Saint-Étienne , le 16/01/1915
Mort(e) à : Paris , le 27/02/1984
Né(e) à : Saint-Étienne , le 16/01/1915
Mort(e) à : Paris , le 27/02/1984
Biographie :
Laurent Michard est un professeur et historien de la littérature française.
Il fait ses études secondaires au lycée de Saint-Étienne. Élève de l'École normale supérieure, où il entre en 1934, il est reçu à l'agrégation de lettres en 1937.
Il est nommé professeur de lettres en classes préparatoires au lycée de garçons de Toulouse, où il a ensuite comme collègue André Lagarde (1912-2001).
Professeur de lettres supérieures, puis de première supérieure au lycée Henri-IV dans les années 1950-1960, Laurent Michard fut avec André Lagarde, professeur de lettres supérieures au lycée Louis-le-Grand, l'auteur de manuels scolaires connus sous le nom de Lagarde et Michard, recueils de textes choisis, présentés et commentés des auteurs français, qui servaient de base à l'enseignement de la littérature française dans les lycées.
L’Académie française leur décerne le prix Bordin en 1961 pour "Les grands auteurs français".
Il devint ensuite inspecteur général de l'instruction publique.
+ Voir plusLaurent Michard est un professeur et historien de la littérature française.
Il fait ses études secondaires au lycée de Saint-Étienne. Élève de l'École normale supérieure, où il entre en 1934, il est reçu à l'agrégation de lettres en 1937.
Il est nommé professeur de lettres en classes préparatoires au lycée de garçons de Toulouse, où il a ensuite comme collègue André Lagarde (1912-2001).
Professeur de lettres supérieures, puis de première supérieure au lycée Henri-IV dans les années 1950-1960, Laurent Michard fut avec André Lagarde, professeur de lettres supérieures au lycée Louis-le-Grand, l'auteur de manuels scolaires connus sous le nom de Lagarde et Michard, recueils de textes choisis, présentés et commentés des auteurs français, qui servaient de base à l'enseignement de la littérature française dans les lycées.
L’Académie française leur décerne le prix Bordin en 1961 pour "Les grands auteurs français".
Il devint ensuite inspecteur général de l'instruction publique.
Source : Wikipédia
Ajouter des informations
étiquettes
Citations et extraits (18)
Voir plus
Ajouter une citation
Le XIXè siècle est traversé par trois grands courants littéraires, le romantisme, le réalisme et le symbolisme. Ils ont donné naissance à trois écoles, à trois conceptions de l'art, mais chacun d'entre eux correspond, d'une façon beaucoup plus large, à une vue originale sur l'homme et sur le monde.
[François Coppée] L'allée est droite et longue, et sur le ciel d'hiver
Se dressent hardiment les grands arbres de fer
Se dressent hardiment les grands arbres de fer
J'ai vécu d'aimer, j'ai donc vécu de larmes
(Marceline Desbordes-Valmore)
(Marceline Desbordes-Valmore)
[Heredia] L'horizon tout entier s'enveloppe dans l'ombre
Et le soleil mourant, sur un ciel riche et sombre,
Ferme les branches d'or de son rouge éventail.
Et le soleil mourant, sur un ciel riche et sombre,
Ferme les branches d'or de son rouge éventail.
La littérature française du XVIe siècle, considérée dans son ensemble, laisse avant tout l'impression d'un prodigieux foisonnement, d'une richesse et d'une variété étonnantes : la richesse et et la variété de la vie qui n'est jamais identique à elle-même. Car cette littérature est d'abord un hymne à la vie, qui donne au mot Renaissance sa signification la plus belle et la plus profonde ; c'est le naturalisme de Rabelais, l'épicurisme de Ronsard, l'animisme d'Agrippa d'Aubigné. "Pour moi donc j'aime la vie", conclut Montaigne, ou encore : "Nature est un doux guide". Il y a là un enthousiasme communicatif, un élan exaltant, une sève débordante qui confère à la langue même saveur et vigueur.
Ce torrent à tant de force que son cours n'est pas toujours limpide : les qualités grecques de mesure et d'harmonie font parfois défaut aux œuvres les plus représentatives. Écrivains et poètes sont en général des tempéraments puissants qui se livrent à leur verve, et Ronsard divinise l'inspiration. Le XIVe siècle ressemble un peu à une forêt vierge, si on le compare au jardin à la française qu'est le XVIIe.
Ce torrent à tant de force que son cours n'est pas toujours limpide : les qualités grecques de mesure et d'harmonie font parfois défaut aux œuvres les plus représentatives. Écrivains et poètes sont en général des tempéraments puissants qui se livrent à leur verve, et Ronsard divinise l'inspiration. Le XIVe siècle ressemble un peu à une forêt vierge, si on le compare au jardin à la française qu'est le XVIIe.
Chrétien de Troyes n'a pas le sens du mystère, mais en revanche il excelle à peindre la vie matérielle. Dans l'irréel des légendes bretonnes et l'artifice de ses intrigues, cet observateur a su insérer beaucoup de la réalité de son temps. Il sait voir et décrire tout l'extérieur de la vie : châteaux, vêtements, meubles, cérémonies, tournois, coutumes, tout un aspect documentaire de la vie raffinée qui devait ravir les lecteurs contemporains.
L'erreur longtemps commise a été de rejeter en bloc une période aussi longue et aussi complexe. Sans doute certains traits se perpétuent tout au long du Moyen Age : c'est une époque de foi, c'est l'âge de la féodalité ; c'est pour notre langue, notre littérature, une période de croissance, d'instabilité : l'enfance et la jeunesse avant la maturité classique.
L' Albatros Baudelaire
L'idée initiale de ce poème, paru seulement en 1859, remonterait à un incident du voyage à La Réunion (1841). Pour symboliser le poète, Baudelaire ne songe ni à l'aigle royal des romantiques ni à la solitude orgueilleuse du condor, décrite par Leconte de Lisle.
Il choisit un symbole plus douloureux : l'albatros représente la dualité de l'homme cloué au sol et aspirant à l'infini : il représente surtout le poète, cet incompris, celui qui, dans le poème en prose intitulé l'Etranger, répond aux hommes surpris de voir qu'il n'aime rien ici-bas : "j'aime les nuages...Les nuages qui passent...là-bas, là-bas...Les merveilleux nuages ! "
L'idée initiale de ce poème, paru seulement en 1859, remonterait à un incident du voyage à La Réunion (1841). Pour symboliser le poète, Baudelaire ne songe ni à l'aigle royal des romantiques ni à la solitude orgueilleuse du condor, décrite par Leconte de Lisle.
Il choisit un symbole plus douloureux : l'albatros représente la dualité de l'homme cloué au sol et aspirant à l'infini : il représente surtout le poète, cet incompris, celui qui, dans le poème en prose intitulé l'Etranger, répond aux hommes surpris de voir qu'il n'aime rien ici-bas : "j'aime les nuages...Les nuages qui passent...là-bas, là-bas...Les merveilleux nuages ! "
Toujours draps de soie tisserons
Jamais n'en serons mieux vêtues.
Toujours seront pauvres et nues
Et toujours faim et soif aurons ;
(p.69)
Complainte des tisseuses de soie, Chrétien de Troyes
Jamais n'en serons mieux vêtues.
Toujours seront pauvres et nues
Et toujours faim et soif aurons ;
(p.69)
Complainte des tisseuses de soie, Chrétien de Troyes
[Heredia]
Ils allaient conquérir le fabuleux métal
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes
Aux bords mystérieux du monde occidental.
Ils allaient conquérir le fabuleux métal
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes
Aux bords mystérieux du monde occidental.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Lire le Moyen-Age
Henri-l-oiseleur
18 livres
Auteurs proches de Laurent Michard
Lecteurs de Laurent Michard (331)Voir plus
Quiz
Voir plus
Chaos ou Karma ?
Rouge XXX Jean-Christophe Grangé
chaos
karma
12 questions
65 lecteurs ont répondu
Thèmes :
romans policiers et polars
, humour
, chaos
, karmaCréer un quiz sur cet auteur65 lecteurs ont répondu