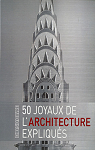Nationalité : Royaume-Uni
Biographie :
Philip Wilkinson est l'auteur d'ouvrages documentaires pour enfants et adultes. Il a fait ses études à Corpus Christi College, Oxford. Il a travaillé comme éditeur avant d'écrire lui-même. Il a édrit plus de quarante livres sur l'histoire, l'art, la religion et l'architecture.
Philip Wilkinson est l'auteur d'ouvrages documentaires pour enfants et adultes. Il a fait ses études à Corpus Christi College, Oxford. Il a travaillé comme éditeur avant d'écrire lui-même. Il a édrit plus de quarante livres sur l'histoire, l'art, la religion et l'architecture.
Source : Wikipédia
Ajouter des informations
étiquettes
Citations et extraits (19)
Voir plus
Ajouter une citation
Les architectes conçoivent souvent un bâtiment à construire comme une série d'espaces : ils commencent par les fonctions que ledit bâtiment doit remplir, puis ils définissent les espaces au moyen de murs, de baies et de toits. le caractère d'un intérieur varie très fortement d'un édifice à un autre.
Alors que le confucianisme s'intéresse à la famille ou à l'État, le taoïsme se concentre sur l'individu.
Façonné par un artisan de génie, l’aléthiomètre est un objet magnifique. Le boîtier en or de l’instrument resplendir de gravures complexes, et les minuscules rouages de son mécanisme sont visibles à travers une ouverture au centre du cadran. A l’intérieur du couvercle sont gravés les tours et les clochers de la ville médiévale de Prague, où l’aléthiomètre a vu le jour.
Chaque culture a sa mythologie, ses divinités, ses héros, ses grands récits cosmiques. Les mythes sont une réponse aux questions les plus fondamentales : l'origine de l'univers et de l'humanité, la nature des dieux et des esprits, le devenir de l'homme après sa mort, la fin du monde. Ils mettent en scène l'amour et la jalousie, la guerre et la paix, le bien et le mal, autant de thèmes abordés à travers des intrigues complexes, des personnages hauts en couleur, des épisodes mémorables, et des concepts en phase avec nos émotions les plus intimes.
C'est pourquoi la fascination qu'ils exercent se révèle intemporelle.
(page 6)
C'est pourquoi la fascination qu'ils exercent se révèle intemporelle.
(page 6)
C’est à Wuhan que Mao Tsé-toung revint sur le Yang Tseu Kiang en 1956, vingt et un ans après l’avoir traversé lors de la Longue Marche. En 1935, la traversée du fleuve avec la longue colonne de ses partisans avait été une épreuve et un symbole : Mao avait pu réquisitionner une flotte entière pour faire passer ses hommes et établir son quartier général dans le Sichuan …/…
Mao voyait donc dans ces forces élémentaires une puissance qu’il fallait maîtriser et, fier de sa forme physique et de ses qualités d’athlète, il pensa pouvoir dominer le fleuve en le traversant à la nage. Il s’exposait à des risques divers, notamment la traîtrise des courants, la morsure des serpents ou la parasite de la bilharziose. Mais c’était là le but recherché : plus grand était le danger, plus grand serait le triomphe.
Il avait d’autres raisons de vouloir montrer sa force en public. En 1956, tout n’allait pas pour le mieux pour le président chinois. Les grands du Parti se querellaient. L’opposition aux réformes se développait en divers lieux, notamment à Wuhan. Sept ans après la création de la République populaire, l’engouement du peuple pour le Grand Timonier commençait à tiédir …
Mao voyait donc dans ces forces élémentaires une puissance qu’il fallait maîtriser et, fier de sa forme physique et de ses qualités d’athlète, il pensa pouvoir dominer le fleuve en le traversant à la nage. Il s’exposait à des risques divers, notamment la traîtrise des courants, la morsure des serpents ou la parasite de la bilharziose. Mais c’était là le but recherché : plus grand était le danger, plus grand serait le triomphe.
Il avait d’autres raisons de vouloir montrer sa force en public. En 1956, tout n’allait pas pour le mieux pour le président chinois. Les grands du Parti se querellaient. L’opposition aux réformes se développait en divers lieux, notamment à Wuhan. Sept ans après la création de la République populaire, l’engouement du peuple pour le Grand Timonier commençait à tiédir …
L’origine du Gange
Pour les hindouistes, le Gange est un fleuve sacré associé à la déesse Ganga, personnification de ses eaux.
Un mythe particulièrement populaire raconte qu’il coulait à l’origine au paradis, et que les dieux lui permirent de descendre sur terre pour irriguer la région qui allait devenir l’Inde.
Aux yeux des hindouistes, ses eaux ont le pouvoir de laver tous les péchés.
(page 208)
Pour les hindouistes, le Gange est un fleuve sacré associé à la déesse Ganga, personnification de ses eaux.
Un mythe particulièrement populaire raconte qu’il coulait à l’origine au paradis, et que les dieux lui permirent de descendre sur terre pour irriguer la région qui allait devenir l’Inde.
Aux yeux des hindouistes, ses eaux ont le pouvoir de laver tous les péchés.
(page 208)
Grace à ses eaux très poissonneuses, à son limon fertilisant et à son cours inférieur qui est une voie de communication essentielle, le Yang Tseu Kiang joue un rôle dans l’histoire de la Chine depuis des millénaires. C’est non loin du fleuve que furent découverts des restes humains parmi les plus anciens de Chine.
Depuis des temps immémoriaux, les peuples du monde se transmettent des mythes, récits à la fois fabuleux et familiers. Avant l'avènement de l'électricité, de la radio et de la télévision, seule leur narration permettait de meubler régulièrement les longues veillées.
Belenos, Bélénus, Bel, Belus : tous ces noms, qui désignent un seul et même dieu, signifient « brillant », « éclatant ».
Belenos était vénéré dans toute l’Europe celtique : des sanctuaires lui étaient dédiés sur les îles Britanniques, en Autriche ou encore en Italie.
Associé au soleil et à la lumière, mais aussi à la santé, il fut considéré comme l’équivalent celtique de l’Apollon grec.
Il était souvent vénéré près de sources dont les eaux revêtaient selon ses fidèles des vertus curatives.
La fête printanière de Beltaine marquant pour les Celtes (notamment les Bretons) le retour des beaux jours était peut-être liée au culte de Belenos.
(page 115)
Belenos était vénéré dans toute l’Europe celtique : des sanctuaires lui étaient dédiés sur les îles Britanniques, en Autriche ou encore en Italie.
Associé au soleil et à la lumière, mais aussi à la santé, il fut considéré comme l’équivalent celtique de l’Apollon grec.
Il était souvent vénéré près de sources dont les eaux revêtaient selon ses fidèles des vertus curatives.
La fête printanière de Beltaine marquant pour les Celtes (notamment les Bretons) le retour des beaux jours était peut-être liée au culte de Belenos.
(page 115)
Les mythes et légendes matérialisent un lien intime entre les hommes et les mondes naturel et spirituel, lien qui peine à perdurer dans nos sociétés modernes. Situés aux confins de la réalité et de l'imaginaire le plus fantaisiste, ils célèbrent l'étrange et l'incertain et décrivent les terrifiantes forces cosmiques. Mais ils parlent aussi à la passion et à l'inspiration des hommes. Leur pouvoir de fasciation tient à leur aptitude à entrer en résonance avec ce qui existe en nous de plus profondément intime.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Philip Wilkinson
Lecteurs de Philip Wilkinson (239)Voir plus
Quiz
Voir plus
Friedrich NIETZSCHE (1844 -1900)
Lequel de ces livres fut le premier ouvrage de NIETZSCHE
La généalogie de la morale
La naissance de la tragédie
Ainsi Parlait Zarathoustra
Le gai savoir
7 questions
50 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur50 lecteurs ont répondu