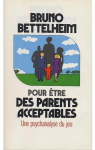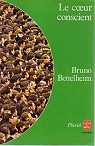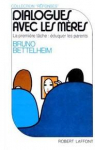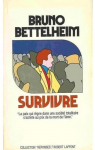Citations sur Psychanalyse des contes de fées (52)
L’enfant pré pubertaire ou adolescent peut se dire : « Je n’entre pas en rivalité avec mes parents, je suis déjà bien meilleur qu’eux ; ce sont eux qui entrent en rivalité avec moi. » Malheureusement, il existe aussi des parents qui veulent convaincre leurs enfants adolescents qu’ils leur sont supérieurs ; il y a beaucoup de chances pour qu’ils le soient à certains égards, mais, pour la sécurité de leurs enfants, ; ils feraient mieux de garder pour eux cette réalité. Le pire est qu’il existe des parents qui veulent valoir mieux, sur tous les plans, que leurs enfants adolescents ; c’est par exemple, le père qui tente de se maintenir à la hauteur de la force juvénile et des prouesses sexuelles de ses fils ; ou la mère qui veut par son allure, sa façon de s’habiller et son comportement, paraitre aussi jeune que sa fille. L’ancienneté du thème de « Blanche-neige » prouve qu’il s’agit d’un phénomène vieux comme le monde. Mais la rivalité parents-enfants rend la vie insupportable aux uns comme aux autres. Placé dans de telles conditions, l’enfant veut se libérer et se débarrasser de celui de ses parents qui veut l’obliger à rivaliser ou à se soumettre. Ce désir de se débarrasser du père ou de la mère éveille un fort sentiment de culpabilité bien que ce désir soit justifié si on observe objectivement la position de l’enfant. Ainsi, par un renversement qui élimine le sentiment de culpabilité, ce désir, lui aussi, est transféré sur les parents. C’est pourquoi nous trouvons dans les contes de fées des parents qui essaient de se débarrasser de leur enfant, comme la reine de « Blanche-Neige ».
Le Petit Chaperon Rouge a perdu son innocence enfantine en rencontrant les dangers qui existent en elle et dans le monde, et elle l’a échangée contre une sagesse que seul peut posséder celui qui « est né deux fois » ; celui qui non seulement est venu à bout d’une crise existentielle, mais qui est aussi devenu conscient que c’est sa propre nature qui l’a plongé dans cette crise. La naïveté enfantine du Petit Chaperon Rouge cesse d’exister au moment où le loup se montre sous son vrai jour et la dévore. Quand le chasseur ouvre le ventre du loup et la libère, elle renaît à un plan supérieur d’existence ; capable d’entretenir des relations positives avec ses parents, elle cesse d’être une enfant et renaît à la vie en tant que jeune fille.
L’enfant comprend aussi que ce qui « meurt » vraiment chez le Petit Chaperon Rouge, c’est la petite fille qui s’est laissé tenter par le loup ; et que lorsqu’elle bondit hors du ventre de l’animal, c’est une personne tout à fait différente qui revient à la vie. Si cette péripétie est nécessaire, c’est que l’enfant comprend facilement qu’une chose soit remplacée par une autre (la gentille mère par la vilaine marâtre), tout en étant incapable de savoir ce que peuvent être ces transformations profondes. C’est pourquoi les contes de fées ont le grand mérite, parmi tant d’autres, de faire croire à l’enfant que ces transformations sont possibles.
Le comportement du loup commence à prendre un sens dans la version des frères Grimm si nous présumons que pour disposer du Petit Chaperon Rouge le loup doit d’abord se débarrasser de la grand-mère. Tant que la (grand-)mère est dans les parages, la petite fille ne sera pas à lui. Mais une fois que la (grand-)mère a disparu, il est libre d’agir selon ses désirs qui, en attendant, doivent être refoulés. L’histoire, sur ce plan, s’occupe du désir inconscient de l’enfant d’être séduite par son père (le loup).
Les figures maternelles de la mère elle-même et de la sorcière, si importantes dans « Jeannot et Margot », deviennent insignifiantes dans « Le Petit Chaperon Rouge » où la mère et la grand-mère ne font rien : elles ne protègent pas, ne menacent pas. L’homme, au contraire, tient une place capitale sous ses deux aspects opposés : le dangereux séducteur qui se fait le meurtrier de la bonne mère-grand et de la petite fille, et le chasseur, qui représente la figure paternelle forte, responsable, et qui sauve l’enfant.
L’histoire de « Jeannot et Margot » donne corps aux angoisses et à l’apprentissage nécessaire de l’enfant qui doit surmonter et sublimer ses désirs primitifs qui l’enferment en lui-même et sont donc de nature destructive. L’enfant doit savoir que, s’il ne s’en libère pas, ses parents ou la société l’obligeront à le faire contre sa volonté, comme le fit précédemment sa mère en le sevrant quand elle estima le moment venu. Le conte exprime symboliquement ces expériences internes reliées directement à la mère. Le père, tout au long de l’histoire, peut donc rester un personnage falot, inefficace, ce qu’il est en réalité pour l’enfant pendant les premiers temps de sa vie, quand sa mère et seule importante, qu’elle lui apparaisse bonne ou menaçante.
La mère, pour l’enfant, étant la dispensatrice de toute nourriture, c’est elle qui est censée l’abandonner, comme si elle le laissait seul au milieu du désert.
Le conte de fées folklorique, même si on le prend à ce niveau apparent, exprime une vérité importante et désagréable : que la pauvreté et les privations n’améliorent pas les caractère de l’homme, mais qu’elles le rendent plus égoïstes, moins sensible aux souffrances des autres et enclin, par conséquent, à se lancer dans de mauvaises actions.
"Physiologiquement parlant, les parents conçoivent l'enfant, mais c'est le fait de la naissance qui oblige le couple à vraiment devenir des parents. C'est donc l'enfant qui crée les problèmes parentaux, auxquels s'ajoutent ceux qu'il apporte lui-même."
"Ce sont les parents les plus narcissiques qui se sentent les plus menacés par la croissance de leur enfant. Celui-ci leur montre, en prenant de l’âge, qu’ils vieillissent. Tant que l’enfant est totalement dépendant, il continue, pour ainsi dire, de faire partie du père et surtout de la mère. Mais quand, mûrissant, il tend vers son indépendance, il est ressenti comme une menace, et c’est ce qui arrive à la reine dans « Blanche-neige »."
Les Dernières Actualités
Voir plus

Les 60 ans de Pocket
MaggyM
61 livres

Il était une fois ...
Tagrawla
35 livres
Autres livres de Bruno Bettelheim (21)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Freud et les autres...
Combien y a-t-il de leçons sur la psychanalyse selon Freud ?
3
4
5
6
10 questions
439 lecteurs ont répondu
Thèmes :
psychologie
, psychanalyse
, sciences humainesCréer un quiz sur ce livre439 lecteurs ont répondu