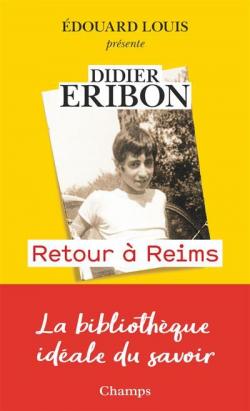Citations sur Retour à Reims (198)
Mais ma vie n’est pas seulement hantée par l’avenir : elle l’est aussi par les fantômes de mon propre passé, qui surgirent dès après le décès de celui qui incarnait tout ce que j’avais voulu quitter, tout ce avec quoi j’avais voulu rompre, et qui, assurément, avait constitué pour moi une sorte de modèle social négatif, un contre-repère dans le travail que j’avais accompli pour me créer moi-même.
Je vins voir ma mère. Ce fut le début d’une réconciliation avec elle. Ou, plus exactement, d’une réconciliation avec moi-même, avec toute une part de moi-même que j’avais refusée, rejetée, reniée.
Extrait des questions à Edouard Louis en introduction du livre :
La vie du père ou de la mère de Didier Eribon dans Retour à Reims, et tant d'autres vies, sont la preuve que nous ne sommes pas ce que nous faisons, mais qu'au contraire nous sommes ce que nous n'avons pas fait, parce que la société nous en empêchés ; à cause de notre place au monde : parce que ce que Didier appelle les verdicts -femme, pauvre, noir, arabe, gay, trans, etc- se sont abattus sur nous et nous ont rendu certaines expériences et certaines vies impossibles. Les individus ne sont pas définis par ce qu'ils ont fait mais par ce qu'ils n'ont pas fait, parce qu'ils n'ont pas pu le faire.
La vie du père ou de la mère de Didier Eribon dans Retour à Reims, et tant d'autres vies, sont la preuve que nous ne sommes pas ce que nous faisons, mais qu'au contraire nous sommes ce que nous n'avons pas fait, parce que la société nous en empêchés ; à cause de notre place au monde : parce que ce que Didier appelle les verdicts -femme, pauvre, noir, arabe, gay, trans, etc- se sont abattus sur nous et nous ont rendu certaines expériences et certaines vies impossibles. Les individus ne sont pas définis par ce qu'ils ont fait mais par ce qu'ils n'ont pas fait, parce qu'ils n'ont pas pu le faire.
J'imagine que l'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent de manière si tenace à leurs haines, c'est qu'ils sentent bien que, une fois la haine disparue, ils se retrouveront confrontés à la douleur".
L'élimination scolaire passe souvent par l'autoélimination, et par la revendication de celle-ci comme s'il s'agissait d'un choix : la scolarité longue, c'est pour les autres, ceux "qui ont les moyens" et qui se trouvent être les mêmes que ceux à qui "ça plaît". Le champ des possibles -- et même celui des possibles simplement envisageables, sans parler de celui des possibles réalisables -- est étroitement circonscrit par la position de classe. C'est comme s'il y avait une étanchéité presque totale entre les mondes sociaux. Les frontières qui séparent ces mondes définissent, à l'intérieure de chacun d'eux, des perceptions radicalement différentes de c qu'il est imaginable d'être et de devenir, de ce à quoi on peut aspirer ou non : on sait que, ailleurs, il en va autrement, mais cela se passe dans un univers inaccessible et lointain, et l'on ne se sent donc ni exclu ni même privé de quoi que ce soit lorsqu'on n'a pas accès à ce qui constitue dans ces régions sociales éloignées la règle tout aussi évidente. C'est l'ordre des choses, voilà tout. Et l'on ne voit pas comment fonctionne cet ordre, car cela nécessiterait de pouvoir se regarder soi-même de l'extérieur, d'adopter une vue en surplomb sur sa propre vie et sur celle des autres. Il faut être passé, comme ce fut mon cas, d'un côté à l'autre de la ligne de démarcation pour échapper à l'implacable logique de ce qui va de soi et apercevoir la terrible injustice de cette distribution inégalitaire des chances et des possibles. Cela n'a guère changé, d'ailleurs : l'âge de l'exclusion scolaire s'est déplacé, mais la barrière sociale entre les classes reste la même. (p. 51)
En classe de sixième, un enseignant me déclara : " Vous n'irez pas plus loin que la seconde. " Ce jugement m'effraya jusqu'à ce que j'atteigne et dépasse cette classe. Mais, au fond, cet imbécile avait fait preuve d'une certaine lucidité ; j'étais promis à ne pas aller plus loin, et sans doute à ne pas aller jusque-là.
Etudiant, je contrevins encore plus aux représentations qui étaient les siennes. Le choix de la philosophie dut lui paraître saugrenu. Elle resta interloquée lorsque je le lui annonçai. Elle aurait préféré que je m'inscrive en anglais ou en espagnol (médecine ou droit n'entraînent pas dans ses horizons, ni dans les miens, mais s'orienter vers l'étude des langues constituait peut-être le meilleur moyen de s'assurer un avenir en devenant professeur de lycée). Elle percevait surtout qu'un fossé se creusait entre nous. Ce que j'étais lui devenait incompréhensible, et elle disait volontiers que j'étais « excentrique ». Je devais en effet lui paraitre étrange, bizarre... Je me situais de plus en plus en dehors de ce qui, à ses yeux, constituait le monde normal, la vie normale. «C'est quand même pas normal de... » est une phrase qui revenait souvent à mon propos dans sa bouche comme dans celle de mon père.
Tout conspire donc à installer un sentiment de non-appartenance et d'extériorité dans la conscience de ceux qui rencontrent des difficultés pour se plier à cette injonction sociale que le système scolaire, à travers chacun de ses rouages, adresse à ses usagers. En réalité, deux voies se présentaient à moi : poursuivre cette résistance spontanée, non thématisée comme telle, qui s’exprimait dans tout un ensemble d'attitudes rétives, d'inadaptations, d'inadéquations, de dégoûts et de ricanements, de refus obstinés, et finir par me retrouver expulsé sans bruit de ce système, comme tant d'autres, par la force des choses, mais, en apparence, comme une simple conséquence de mon comportement individuel, ou bien me plier peu à peu aux exigences de l'école, m'adapter à elle, accepter ce qu'elle demande, et parvenir ainsi à me maintenir à l'intérieur de ses murs. Résister, c'était me perdre. Me soumettre, me sauver.
Combien de fois, au cours de ma vie ultérieure de personne « cultivée », ai-je constaté en visitant une exposition ou en assistant à un concert ou à une représentation à l’opéra à quel point les gens qui s’adonnent aux pratiques culturelles les plus « hautes » semblent tirer de ces activités une sorte de contentement de soi et un sentiment de supériorité se lisant dans le discret sourire dont ils ne se départent jamais, dans le maintien de leur corps, dans leur manière de parler en connaisseurs, d’afficher leur aisance… tout cela exprimant la joie sociale de correspondre à ce qu’il convient d’être, d’appartenir au monde privilégié de ceux qui peuvent se flatter de goûter les arts « raffinés ». Cela m’intimida toujours, mais j’essayai néanmoins de leur ressembler, d’agir comme si j’étais né comme eux, de manifester la même décontraction qu’eux dans la situation esthétique.
Et si j'étais marxiste, je dois avouer que le marxisme auquel j'adhérais pendant mes années d'études, comme mon engagement gauchiste, n'étaient peut-être qu'une façon d'idéaliser la classe ouvrière, de la transformer en une entité mythique en regard de laquelle la vie de mes parents m'apparaissait bien condamnable. Ils désiraient ardemment posséder tous les biens de consommation courants et je voyais dans la triste réalité de leur existence quotidienne, dans leurs aspirations à un confort dont ils avaient été si longtemps privés, le signe à la fois
de leur « alienation » sociale et de leur « embourgeoisement ».
de leur « alienation » sociale et de leur « embourgeoisement ».
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Didier Eribon (24)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1754 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1754 lecteurs ont répondu