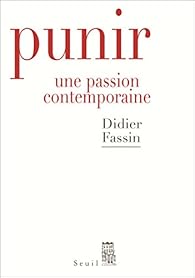Citations sur Punir (18)
Le basculement [...] qui a fait passer d'une économie affective de la dette, dans laquelle les sentiments de vengeance se trouvaient le plus souvent canalisés dans des dispositifs de restitution et de compensation, à une économie morale du châtiment, dans laquelle la commission d'un péché appelait une punition du coupable dans l'objectif de le rédimer, est le fait majeur qui permet de penser la centralité de la souffrance dans l'acte de punir.
D'un côté, les individus s'avèrent de moins en moins tolérants à ce qui trouble leur existence. Des incivilités, des menaces proférées, des agressions verbales, des rixes entre voisins, des altercations au sein de couples, toute une série de conflits interpersonnels qui pouvaient trouver des solutions empiriques locales passent désormais par la police, souvent la justice, parfois la prison.
[...]
La fraude fiscale est généralement mieux tolérée que le vol à l'étalage.
[...]
La fraude fiscale est généralement mieux tolérée que le vol à l'étalage.
Par exemple, pourquoi le meurtre est-il « universellement regardé comme le plus grand des crimes », alors qu'« une crise économique, un coup de Bourse, une faillite même », dont les conséquences peuvent être bien plus graves qu'un homicide, ne soulèvent pas la même indignation ? La gravité du crime ne suffit pas à expliquer les différences de châtiment. Mais le sociologue ne se demande pas si la hiérarchie des actes est indicative d'une hiérarchie des acteurs.
En mettant [...] l'individu seul face à son acte, la société s'exonère elle-même de sa responsabilité dans la production et la construction sociales des illégalismes, si l'on entend par production la façon dont les contextes et les situations les favorisent et par construction la manière de les distinguer et de les réprimer. Que la répartition des richesses, des ressources et des populations dans l'espace social contribue à une différenciation des délits et des crimes, que la reconnaissance et la sanction sélectives de ces délits et de ces crimes participent d'une inégale distribution des peines, qu'enfin ces processus débouchent sur la détermination d'infractions condamnables et de sujets punissables se trouve non seulement ignoré mais également nié. (p. 145)
Si elle permet théoriquement au juge d'apprécier la situation personnelle de l'accusé, l'individualisation de la peine, telle qu'elle est concrètement mise en œuvre dans les tribunaux, tend à accentuer les disparités des décisions de justice, non seulement parce que, par définition, elle singularise chaque cas, mais surtout parce que les éléments du contexte social qui sont présentés lors du procès sont, le plus souvent, utilisés à charge. En particulier, l'enquête sociale rapide, qui complète le dossier pénal et les divers procès-verbaux, sert surtout aux magistrats à évaluer le risque de récidive ou, en cas de report d'audience, la garantie de représentation, plutôt qu'à fournir des circonstances atténuantes en fonction, par exemple, d'une histoire familiale troublée ou de conditions de vie difficiles. (p. 142-143)
La présence de la police et son mode opératoire ne sont pas distribués aléatoirement. Les forces de l'ordre se focalisent sur certains territoires et certaines populations, et cette concentration tient moins à l'incidence des infractions qu'à des logiques de contrôle et de performance qui déterminent certaines pratiques qu'elles ne se permettraient pas ailleurs : vis-à-vis des habitants des quartiers populaires, il s'agit avant tout d'imposer et de manifester un ordre social, les vérifications d'identité et les fouilles au corps servant avant tout à "leur rappeler leur place" dans la société en testant leur docilité, ainsi que l'écrit Richard Ericson. (p. 138-139)
Punir n'est pas simplement rendre un mal pour un mal ; c'est produire une souffrance gratuite, qui s'ajoute à la sanction, pour la seule satisfaction de savoir que le coupable souffre. Il y a donc dans l'acte de punir quelque chose qui résiste à l'examen rationnel ou, plus exactement, qui résiste à sa description comme un fait rationnel : une pulsion, plus ou moins refoulée, dont la société délègue les effets à certaines institutions et professions. (p. 106)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Didier Fassin (31)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )
Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "
amoureux
positiviste
philosophique
20 questions
859 lecteurs ont répondu
Thèmes :
essai
, essai de société
, essai philosophique
, essai documentCréer un quiz sur ce livre859 lecteurs ont répondu