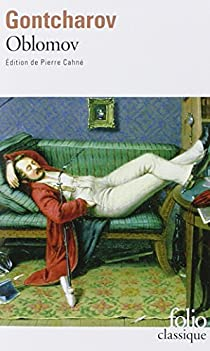Citations sur Oblomov (154)
L’été bat son plein, juillet passe, le temps est superbe. Oblomov ne quitte presque plus Olga. Quand les jours sont clairs, on les trouve dans le parc ; quand midi brûle et s’appesantit, ils s’enfoncent dans les bois, sous les pins. Assis aux pieds d’Olga, Oblomov lui fait la lecture, et elle, pendant ce temps, brode, brode…
En eux aussi règne l’été brûlant. Parfois des nuages accourent, mais ils s’enfuient très vite.
Entre Oblomov et Olga se sont établis des rapports imperceptibles pour les autres : un regard, une parole insignifiante dite en présence d’ « étrangers », avait pour eux un sens très distinct. Ils découvraient partout des signes, des allusions à leurs amours.
Et Olga rougissait lorsqu’on racontait à table l’histoire d’un quelconque amour qui ressemblait tant soit peu au leur. Et comme toutes les histoires d’amour se ressemblent, elle rougissait souvent.
En eux aussi règne l’été brûlant. Parfois des nuages accourent, mais ils s’enfuient très vite.
Entre Oblomov et Olga se sont établis des rapports imperceptibles pour les autres : un regard, une parole insignifiante dite en présence d’ « étrangers », avait pour eux un sens très distinct. Ils découvraient partout des signes, des allusions à leurs amours.
Et Olga rougissait lorsqu’on racontait à table l’histoire d’un quelconque amour qui ressemblait tant soit peu au leur. Et comme toutes les histoires d’amour se ressemblent, elle rougissait souvent.
— Pourtant, Olga, si je dis vrai ? Si j’ai raison ? Si votre amour n’est qu’une erreur ? Si vous devez en aimer un autre plus tard, et rougir en pensant à moi…
— Et après ? demanda-t-elle, fixant sur lui un regard à la fois ironique et perçant qui le troubla.
« Elle veut tirer quelque chose de moi », se dit-il. « Tiens bon, Ilia Ilitch ! »
— Comment, « et après » ? répéta-t-il machinalement, ne devinant pas la pensée qui germait dans sa tête et se demandant comment elle allait justifier ce « et après ? »
Elle le regarda tranquillement, posément, comme seule regarde une personne qui domine ses pensées.
— Vous craignez, dit-elle, — de tomber « au fond de l’abîme ». L’idée que je pourrais cesser de vous aimer vous effraye. Vous m’écrivez « vous aurez mal »…
Il ne comprenait toujours pas.
— Mais voyons, je n’aurai pas mal, je serai même très bien, si j’en aime un autre. Oui, très bien, je dirais même heureuse. Et vous, vous dites que vous prévoyez mon bonheur futur et que vous êtes prêt à tout sacrifier pour moi, même la vie. Alors ?
Il ne la quittait pas des yeux.
— J’avoue que je ne m’attendais pas à cette logique, murmura-t-il.
Elle le regarda méchamment de la tête au pied.
— Et ce bonheur qui vous rendait fou ? poursuivit-elle. — Et ces matinées, et ces soirs, et mes « je vous aime », alors tout cela ne vaut rien, aucun prix, aucun sacrifice, aucune douleur ?
« Si seulement je pouvais disparaître sous terre ! » songeait-il.
Plus la pensée d’Olga lui devenait claire, plus ses tortures augmentaient.
— Et si, poursuivit-elle avec fougue, vous alliez vous fatiguer de mon amour, comme vous vous êtes fatigué de vos livres, de votre service et de la société ? Si, avec le temps, et sans même qu’il y ait aucune rivale, aucun autre amour, vous vous endormiez à mes côtés, sur un divan, comme chez vous, et que ma voix elle-même ne parvienne plus à vous réveiller ? Si enfin votre robe de chambre – je dis bien votre robe de chambre, et non une autre femme – vous devenait plus chère que moi ?
— Olga, c’est impossible ! l’interrompit-il, mécontent et s’éloignant d’un pas.
— Pourquoi impossible ? Vous dites que je me trompe, que j’en aimerai un autre, eh bien moi, je pense tout simplement que vous cesserez de m’aimer. Et que se passera-t-il alors ? Comment justifierai-je alors ce que je fais à présent ? Moi aussi, mes pensées m’empêchent de dormir, mais je ne vous tourmente pas avec cela. En moi le besoin de bonheur domine toutes les craintes. Moi, j’accorde du prix à cette flamme que je vois s’allumer dans vos yeux quand vous me cherchez, quand vous grimpez sur les rochers, quand, oubliant votre paresse et la chaleur, vous vous précipitez pour me donner un livre ou un bouquet… quand enfin je parviens à vous faire sourire ou désirer très fort la vie. Moi, je ne cherche qu’une chose : le bonheur, et quand je crois l’avoir trouvé je n’en demande pas davantage. Si je me trompe, s’il est vrai que je doive plus tard pleurer sur mon erreur, du moins je sens ici – elle mit la main sur son cœur – que je n’en suis pas responsable. Et je n’ai pas peur des larmes futures, je ne les verserai pas en vain, j’aurai déjà bénéficié de quelque chose. J’étais si bien… si bien… ajouta-t-elle.
— Soyez bien, de nouveau ! supplia Oblomov.
— Mais vous, vous ne voyez jamais que des ombres dans l’avenir ; le bonheur vous importe peu. Je n’appelle pas cela de l’amour, de l’ingratitude plutôt.
— Non, de l’égoïsme ! cria Oblomov.
Il n’osait plus regarder Olga, il n’osait plus parler, il n’osait même plus implorer son pardon.
— Allez ! dit-elle doucement. — Allez là où vous deviez aller.
Il la regarda enfin. Les yeux de la jeune fille étaient secs à présent. La tête baissée, elle faisait de petits dessins sur le sable avec le bout de son ombrelle.
— Couchez-vous de nouveau sur le dos, dit-elle ; comme cela vous ne commettrez pas d’erreurs et vous ne tomberez plus dans l’abîme.
— Je me suis empoisonné et je vous ai empoisonnée, au lieu d’être heureux tout simplement, tout bonnement, murmura-t-il, pris de remords.
— Buvez plutôt du kwass. Au moins le kwass n’empoisonne pas.
— Olga ! Ce n’est pas bien ! Alors que je me torture…
— Oui, oui, vous vous torturez, vous donnez « la moitié de votre vie », vous vous « jetez dans l’abîme », mais tout cela n’en finit pas moins par de petits attendrissements sur vous-même.
— Et après ? demanda-t-elle, fixant sur lui un regard à la fois ironique et perçant qui le troubla.
« Elle veut tirer quelque chose de moi », se dit-il. « Tiens bon, Ilia Ilitch ! »
— Comment, « et après » ? répéta-t-il machinalement, ne devinant pas la pensée qui germait dans sa tête et se demandant comment elle allait justifier ce « et après ? »
Elle le regarda tranquillement, posément, comme seule regarde une personne qui domine ses pensées.
— Vous craignez, dit-elle, — de tomber « au fond de l’abîme ». L’idée que je pourrais cesser de vous aimer vous effraye. Vous m’écrivez « vous aurez mal »…
Il ne comprenait toujours pas.
— Mais voyons, je n’aurai pas mal, je serai même très bien, si j’en aime un autre. Oui, très bien, je dirais même heureuse. Et vous, vous dites que vous prévoyez mon bonheur futur et que vous êtes prêt à tout sacrifier pour moi, même la vie. Alors ?
Il ne la quittait pas des yeux.
— J’avoue que je ne m’attendais pas à cette logique, murmura-t-il.
Elle le regarda méchamment de la tête au pied.
— Et ce bonheur qui vous rendait fou ? poursuivit-elle. — Et ces matinées, et ces soirs, et mes « je vous aime », alors tout cela ne vaut rien, aucun prix, aucun sacrifice, aucune douleur ?
« Si seulement je pouvais disparaître sous terre ! » songeait-il.
Plus la pensée d’Olga lui devenait claire, plus ses tortures augmentaient.
— Et si, poursuivit-elle avec fougue, vous alliez vous fatiguer de mon amour, comme vous vous êtes fatigué de vos livres, de votre service et de la société ? Si, avec le temps, et sans même qu’il y ait aucune rivale, aucun autre amour, vous vous endormiez à mes côtés, sur un divan, comme chez vous, et que ma voix elle-même ne parvienne plus à vous réveiller ? Si enfin votre robe de chambre – je dis bien votre robe de chambre, et non une autre femme – vous devenait plus chère que moi ?
— Olga, c’est impossible ! l’interrompit-il, mécontent et s’éloignant d’un pas.
— Pourquoi impossible ? Vous dites que je me trompe, que j’en aimerai un autre, eh bien moi, je pense tout simplement que vous cesserez de m’aimer. Et que se passera-t-il alors ? Comment justifierai-je alors ce que je fais à présent ? Moi aussi, mes pensées m’empêchent de dormir, mais je ne vous tourmente pas avec cela. En moi le besoin de bonheur domine toutes les craintes. Moi, j’accorde du prix à cette flamme que je vois s’allumer dans vos yeux quand vous me cherchez, quand vous grimpez sur les rochers, quand, oubliant votre paresse et la chaleur, vous vous précipitez pour me donner un livre ou un bouquet… quand enfin je parviens à vous faire sourire ou désirer très fort la vie. Moi, je ne cherche qu’une chose : le bonheur, et quand je crois l’avoir trouvé je n’en demande pas davantage. Si je me trompe, s’il est vrai que je doive plus tard pleurer sur mon erreur, du moins je sens ici – elle mit la main sur son cœur – que je n’en suis pas responsable. Et je n’ai pas peur des larmes futures, je ne les verserai pas en vain, j’aurai déjà bénéficié de quelque chose. J’étais si bien… si bien… ajouta-t-elle.
— Soyez bien, de nouveau ! supplia Oblomov.
— Mais vous, vous ne voyez jamais que des ombres dans l’avenir ; le bonheur vous importe peu. Je n’appelle pas cela de l’amour, de l’ingratitude plutôt.
— Non, de l’égoïsme ! cria Oblomov.
Il n’osait plus regarder Olga, il n’osait plus parler, il n’osait même plus implorer son pardon.
— Allez ! dit-elle doucement. — Allez là où vous deviez aller.
Il la regarda enfin. Les yeux de la jeune fille étaient secs à présent. La tête baissée, elle faisait de petits dessins sur le sable avec le bout de son ombrelle.
— Couchez-vous de nouveau sur le dos, dit-elle ; comme cela vous ne commettrez pas d’erreurs et vous ne tomberez plus dans l’abîme.
— Je me suis empoisonné et je vous ai empoisonnée, au lieu d’être heureux tout simplement, tout bonnement, murmura-t-il, pris de remords.
— Buvez plutôt du kwass. Au moins le kwass n’empoisonne pas.
— Olga ! Ce n’est pas bien ! Alors que je me torture…
— Oui, oui, vous vous torturez, vous donnez « la moitié de votre vie », vous vous « jetez dans l’abîme », mais tout cela n’en finit pas moins par de petits attendrissements sur vous-même.
Que s’était-il passé ? Quel vent tout à coup soufflait sur Oblomov ? Et quels nuages apportait-il ? Hier encore, pourtant, Ilia Ilitch lisait dans l’âme d’Olga et y découvrait un monde clair, un destin éclatant. Que s’était-il donc passé ?
Peut-être avait-il soupé trop copieusement, ou était-il trop longtemps resté couché sur le dos, de telle sorte qu’à son humeur poétique ne pouvaient que se substituer de monstrueuses lubies.
Mais il arrive aussi qu’on s’endorme un soir d’été, par un ciel serein et étoilé, et qu’on se réjouisse à l’idée de voir le lendemain les champs parés des riches couleurs du soleil ; comme il serait doux de s’enfoncer dans la forêt, de s’y abriter de la chaleur ! Et voilà que tout à coup on s’éveille au bruit de la pluie, sous des nuages gris et lourds. Et il fait froid, humide, maussade…
Le soir, selon son habitude, Oblomov écouta battre son cœur, le tâta, puis s’enfonça dans l’analyse de son bonheur. Seulement une goutte d’amertume s’y glissa, et il en fut empoisonné.
Le poison agit vite et fort. Il revécut en esprit toute sa vie. Pour la centième fois, le regret et le repentir l’étreignirent. Il s’imagina ce qu’il aurait pu être aujourd’hui si seulement il avait marché de l’avant avec allégresse. Comme si sa vie eût alors été belle, et pleine, et variée ! De là, il en vint à se poser la question de savoir ce qu’il était à présent, et comment et pourquoi Olga avait pu l’aimer.
« Je dois me tromper. » Cette pensée traversa son esprit comme un éclair, et cet éclair le frappa en plein cœur, lui brisa le cœur. Il gémit : « Oui, je me trompe, c’est une erreur… bien sûr, une erreur ! »
Le « je vous aime, je vous aime, je vous aime » retentit alors une fois de plus dans son souvenir, et son cœur commença à se réchauffer, mais très vite il se glaça de nouveau. Ce triple « je vous aime », qu’était-ce ? Une erreur d’optique, sans doute, le chuchotement d’une âme encore oisive, le pressentiment de l’amour dans le meilleur des cas, mais en aucun cas de l’amour.
Un jour, oui, la voix d’Olga s’élèvera très fort, résonnera d’un accord si puissant que l’univers entier en sera remué. Et ce jour-là, sa tante et le baron sauront, et pas seulement eux ; l’écho se propagera loin, très loin. Il ne se faufilera pas doucement, comme un ruisseau qui se cache dans l’herbe, avec un murmure à peine perceptible ; ce jour-là l’écho tonnera. Mais aujourd’hui, elle aime comme elle brode sur le canevas ; elle trace son dessin doucement, paresseusement, et elle le déroule plus doucement, plus mollement encore ; puis, après l’avoir admiré, elle le dépose dans un coin où elle l’oublie. Oblomov n’était que le premier homme tombé sous sa main, il lui avait paru convenir à l’expérience…
Et enfin, n’était-ce pas le seul hasard qui les avait fait se rencontrer, se rapprocher ? En d’autres circonstances, elle ne l’eût même pas remarqué. Seulement voilà, Stolz était là, et il avait enflammé de sa sollicitude le jeune cœur impressionnable d’Olga, il avait fait naître en elle le sentiment de la compassion, et stimulé aussi l’amour-propre de la jeune fille, fière de pouvoir secouer le sommeil d’une âme paresseuse, quitte ensuite à ne plus s’occuper de pareilles vétilles…
« Oui, c’est ça, c’est bien ça ! » se dit-il avec effroi en se levant de son lit pour allumer une bougie d’une main tremblante. « Oui, c’est ça, et rien que ça ! Elle était prête à recevoir l’amour, son cœur en éveil l’attendait, et là-dessus je l’ai rencontrée, et par erreur son amour m’est échu. Seulement il suffira qu’un autre surgisse pour que très vite elle s’aperçoive de cette erreur, et s’effraye, s’affole. Comme elle me regardera alors ! J’ai dérobé ce qui ne m’appartient pas. Je suis un voleur. Qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce que je fais ? Comme je me suis aveuglé, mon Dieu ! »
Il se regarda dans la glace. « Les hommes comme moi, on ne les aime pas », pensa-t-il.
Et il se recoucha, enfouit sa tête dans les oreillers.
« Adieu, Olga, sois heureuse ! » conclut-il en gémissant.
Peut-être avait-il soupé trop copieusement, ou était-il trop longtemps resté couché sur le dos, de telle sorte qu’à son humeur poétique ne pouvaient que se substituer de monstrueuses lubies.
Mais il arrive aussi qu’on s’endorme un soir d’été, par un ciel serein et étoilé, et qu’on se réjouisse à l’idée de voir le lendemain les champs parés des riches couleurs du soleil ; comme il serait doux de s’enfoncer dans la forêt, de s’y abriter de la chaleur ! Et voilà que tout à coup on s’éveille au bruit de la pluie, sous des nuages gris et lourds. Et il fait froid, humide, maussade…
Le soir, selon son habitude, Oblomov écouta battre son cœur, le tâta, puis s’enfonça dans l’analyse de son bonheur. Seulement une goutte d’amertume s’y glissa, et il en fut empoisonné.
Le poison agit vite et fort. Il revécut en esprit toute sa vie. Pour la centième fois, le regret et le repentir l’étreignirent. Il s’imagina ce qu’il aurait pu être aujourd’hui si seulement il avait marché de l’avant avec allégresse. Comme si sa vie eût alors été belle, et pleine, et variée ! De là, il en vint à se poser la question de savoir ce qu’il était à présent, et comment et pourquoi Olga avait pu l’aimer.
« Je dois me tromper. » Cette pensée traversa son esprit comme un éclair, et cet éclair le frappa en plein cœur, lui brisa le cœur. Il gémit : « Oui, je me trompe, c’est une erreur… bien sûr, une erreur ! »
Le « je vous aime, je vous aime, je vous aime » retentit alors une fois de plus dans son souvenir, et son cœur commença à se réchauffer, mais très vite il se glaça de nouveau. Ce triple « je vous aime », qu’était-ce ? Une erreur d’optique, sans doute, le chuchotement d’une âme encore oisive, le pressentiment de l’amour dans le meilleur des cas, mais en aucun cas de l’amour.
Un jour, oui, la voix d’Olga s’élèvera très fort, résonnera d’un accord si puissant que l’univers entier en sera remué. Et ce jour-là, sa tante et le baron sauront, et pas seulement eux ; l’écho se propagera loin, très loin. Il ne se faufilera pas doucement, comme un ruisseau qui se cache dans l’herbe, avec un murmure à peine perceptible ; ce jour-là l’écho tonnera. Mais aujourd’hui, elle aime comme elle brode sur le canevas ; elle trace son dessin doucement, paresseusement, et elle le déroule plus doucement, plus mollement encore ; puis, après l’avoir admiré, elle le dépose dans un coin où elle l’oublie. Oblomov n’était que le premier homme tombé sous sa main, il lui avait paru convenir à l’expérience…
Et enfin, n’était-ce pas le seul hasard qui les avait fait se rencontrer, se rapprocher ? En d’autres circonstances, elle ne l’eût même pas remarqué. Seulement voilà, Stolz était là, et il avait enflammé de sa sollicitude le jeune cœur impressionnable d’Olga, il avait fait naître en elle le sentiment de la compassion, et stimulé aussi l’amour-propre de la jeune fille, fière de pouvoir secouer le sommeil d’une âme paresseuse, quitte ensuite à ne plus s’occuper de pareilles vétilles…
« Oui, c’est ça, c’est bien ça ! » se dit-il avec effroi en se levant de son lit pour allumer une bougie d’une main tremblante. « Oui, c’est ça, et rien que ça ! Elle était prête à recevoir l’amour, son cœur en éveil l’attendait, et là-dessus je l’ai rencontrée, et par erreur son amour m’est échu. Seulement il suffira qu’un autre surgisse pour que très vite elle s’aperçoive de cette erreur, et s’effraye, s’affole. Comme elle me regardera alors ! J’ai dérobé ce qui ne m’appartient pas. Je suis un voleur. Qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce que je fais ? Comme je me suis aveuglé, mon Dieu ! »
Il se regarda dans la glace. « Les hommes comme moi, on ne les aime pas », pensa-t-il.
Et il se recoucha, enfouit sa tête dans les oreillers.
« Adieu, Olga, sois heureuse ! » conclut-il en gémissant.
Oblomov était comme cet homme qui, un jour d'été, suivant du regard le soleil couchant, ne peut s'arracher au spectacle de la partie embrasée du ciel, et ne voit pas derrière lui l'ombre qui va de plus en plus s'étendre. Comment la verrait-il ? Il ne songe qu'au matin, au retour de la lumière et de la chaleur.
— Pourquoi n’êtes-vous pas gai ? dit-elle soudain.
— Je ne sais pas, Olga Sergueïevna. — Et puis pourquoi m’égayer ? Et comment ?
— Occupez-vous, voyez davantage de gens.
— M’occuper ! On peut s’occuper, bien sûr, mais quand on a un but. Or je n’en ai pas, vraiment pas.
— Le seul but, c’est de vivre.
— Quand on ne sait pas pourquoi on vit, on vit n’importe comment, au jour le jour ; on se réjouit de voir la nuit tomber et de pouvoir noyer dans le sommeil la question insidieuse des raisons pour lesquelles on a vécu, douze ou vingt-quatre heures durant ; et aussi cette autre question : pourquoi vivre le lendemain ?
Elle l’écoutait, silencieuse, le regard sévère, les sourcils froncés. Dans le pli de ses lèvres glissaient, comme un serpent, l’incrédulité et le mépris.
— Pourquoi vivre ? répéta-t-elle. — Comme si la vie de qui que ce soit pouvait être inutile !
— Oui, elle le peut. Regardez ma vie, dit-il.
— Vous ne savez donc pas jusqu’à présent quel est le but de votre vie ? demanda-t-elle en s’arrêtant. — Eh bien, je ne peux pas vous croire. Vous vous calomniez, c’est tout. Sinon vous ne mériteriez pas de vivre.
— J’ai déjà dépassé le stade où le but doit être fixé, et dans l’avenir je ne vois rien…
Il soupira, elle sourit.
— Rien, vraiment ? dit-elle, interrogative mais vivement, joyeusement, et tout en riant comme si elle ne le croyait pas, comme si au contraire il voyait très bien toutes choses devant lui.
— Riez si vous voulez, dit-il. — De toute manière, ce que je vous ai dit est la vérité.
Elle avançait, baissant la tête.
— Pourquoi, pour qui vivrais-je ? murmura-t-il en la suivant. — Et que chercher ? Où diriger mes pensées, sur quoi fonder mes projets ? La fleur de ma vie s’est effeuillée, seules me restent les ronces.
Ils marchaient à pas lents. Elle l’écoutait, distraite, puis de nouveau elle arracha une branche de lilas sur son passage et, sans même le regarder, la lui tendit.
— Qu’est-ce que c’est ? demanda-t-il abasourdi.
— Vous le voyez bien, une branche.
— Quelle branche ? dit-il, la dévorant du regard.
— Une branche de lilas.
— Je sais… mais que signifie-t-elle ?
— La fleur de la vie et…
Il s’arrêta, elle aussi.
— Et ?
— Mon dépit, dit-elle, le regardant fixement avec un sourire qui disait : je sais ce que je fais.
— Cela signifie-t-il que je peux espérer ?… s’écria-t-il, rempli d’une joie soudaine.
— Oui, mais…
Elle se tut.
Et lui, soudain, ressuscitait. À son tour Olga ne reconnut plus Oblomov. Son visage brumeux était maintenant tout autre, des couleurs surgissaient sur ses joues, ses yeux étincelaient de désir, de volonté. Elle comprit que maintenant il avait un but.
— La vie, la vie s’ouvre de nouveau devant moi, cria-t-il ; la voici dans vos yeux, dans votre sourire, dans cette branche… Oui, oui, tout est là.
Elle hocha la tête.
— Non, pas tout, seulement la moitié.
— La meilleure !
— Peut-être.
— Et l’autre ?
— Cherchez !
— Pourquoi ?
— Pour ne pas perdre la première, conclut-elle.
— Je ne sais pas, Olga Sergueïevna. — Et puis pourquoi m’égayer ? Et comment ?
— Occupez-vous, voyez davantage de gens.
— M’occuper ! On peut s’occuper, bien sûr, mais quand on a un but. Or je n’en ai pas, vraiment pas.
— Le seul but, c’est de vivre.
— Quand on ne sait pas pourquoi on vit, on vit n’importe comment, au jour le jour ; on se réjouit de voir la nuit tomber et de pouvoir noyer dans le sommeil la question insidieuse des raisons pour lesquelles on a vécu, douze ou vingt-quatre heures durant ; et aussi cette autre question : pourquoi vivre le lendemain ?
Elle l’écoutait, silencieuse, le regard sévère, les sourcils froncés. Dans le pli de ses lèvres glissaient, comme un serpent, l’incrédulité et le mépris.
— Pourquoi vivre ? répéta-t-elle. — Comme si la vie de qui que ce soit pouvait être inutile !
— Oui, elle le peut. Regardez ma vie, dit-il.
— Vous ne savez donc pas jusqu’à présent quel est le but de votre vie ? demanda-t-elle en s’arrêtant. — Eh bien, je ne peux pas vous croire. Vous vous calomniez, c’est tout. Sinon vous ne mériteriez pas de vivre.
— J’ai déjà dépassé le stade où le but doit être fixé, et dans l’avenir je ne vois rien…
Il soupira, elle sourit.
— Rien, vraiment ? dit-elle, interrogative mais vivement, joyeusement, et tout en riant comme si elle ne le croyait pas, comme si au contraire il voyait très bien toutes choses devant lui.
— Riez si vous voulez, dit-il. — De toute manière, ce que je vous ai dit est la vérité.
Elle avançait, baissant la tête.
— Pourquoi, pour qui vivrais-je ? murmura-t-il en la suivant. — Et que chercher ? Où diriger mes pensées, sur quoi fonder mes projets ? La fleur de ma vie s’est effeuillée, seules me restent les ronces.
Ils marchaient à pas lents. Elle l’écoutait, distraite, puis de nouveau elle arracha une branche de lilas sur son passage et, sans même le regarder, la lui tendit.
— Qu’est-ce que c’est ? demanda-t-il abasourdi.
— Vous le voyez bien, une branche.
— Quelle branche ? dit-il, la dévorant du regard.
— Une branche de lilas.
— Je sais… mais que signifie-t-elle ?
— La fleur de la vie et…
Il s’arrêta, elle aussi.
— Et ?
— Mon dépit, dit-elle, le regardant fixement avec un sourire qui disait : je sais ce que je fais.
— Cela signifie-t-il que je peux espérer ?… s’écria-t-il, rempli d’une joie soudaine.
— Oui, mais…
Elle se tut.
Et lui, soudain, ressuscitait. À son tour Olga ne reconnut plus Oblomov. Son visage brumeux était maintenant tout autre, des couleurs surgissaient sur ses joues, ses yeux étincelaient de désir, de volonté. Elle comprit que maintenant il avait un but.
— La vie, la vie s’ouvre de nouveau devant moi, cria-t-il ; la voici dans vos yeux, dans votre sourire, dans cette branche… Oui, oui, tout est là.
Elle hocha la tête.
— Non, pas tout, seulement la moitié.
— La meilleure !
— Peut-être.
— Et l’autre ?
— Cherchez !
— Pourquoi ?
— Pour ne pas perdre la première, conclut-elle.
— Sais-tu, Andreï, que jamais dans ma vie aucun feu ne s’est allumé, ni bienfaisant ni destructeur, aucun. Ma vie n’a pas connu ce matin sur lequel peu à peu tombent les lumières et les couleurs, et qui, ensuite, se transforme en jour et flambe dans la grande chaleur. Oui, tout alors flambe, tout scintille, tout éclate. Avant que la douceur et la pâleur ne viennent… et c’est alors le soir, l’extinction… Chez les autres les choses se passent ainsi, mais ma vie, à moi, a commencé par cette extinction, bizarre mais vraie ! Dès les premiers instants où j’ai pris conscience de moi-même, j’ai senti déjà que je m’éteignais. Je m’éteignais quand je rédigeais mes rapports au bureau, je m’éteignais quand je trouvais dans les livres des vérités dont je ne savais que faire. Je m’éteignais parmi mes camarades quand j’écoutais leurs ragots, leurs bavardages méchants et plats, je m’éteignais en voyant l’amitié faussement entretenue par des réunions sans cordialité, je m’éteignais, et je gaspillais mes dernières forces avec Minna, m’imaginant l’aimer parce que je lui donnais plus de la moitié de mes revenus. Et je m’éteignais aussi dans ces promenades si mornes, si lentes, le long de la Perspective Nevski, parmi toutes ces pelisses de castor et ces cols d’astrakan, et je m’éteignais dans toutes ces soirées, dans toutes ces réceptions où l’on me recevait à bras ouverts (forcément, le fiancé possible ! ) Et je m’éteignais enfin à monnayer ma vie et mon intelligence en allant sans cesse de la ville à la campagne, de telle ou telle villégiature à Gorokhovaïa, sachant seulement que c’était le printemps à cause de l’arrivée des langoustes et des homards, l’automne et l’été à cause des fêtes champêtres… L’amour-propre lui-même, à quoi le dépensais-je ? À commander simplement mes vêtements chez un tailleur à la mode, à être reçu dans une maison notoire, à serrer la main du prince P… Et pourtant, l’amour-propre, c’est le sel de la vie. Seulement voilà, je n’ai pas compris la vie. Toi, tu apparaissais, tu disparaissais comme une sorte de météore éclatant, vertigineux, et moi, pendant ce temps, je m’éteignais.
Déjà un aimable engourdissement s’emparait de tous ses membres ; déjà le sommeil commençait à engourdir doucement ses sens, comme les premières gelées embrument, timides, la surface des eaux. Encore une minute, et déjà son esprit se serait envolé Dieu sait où. Seulement Ilia Ilitch se réveilla tout à coup, et ouvrit les yeux.
« Mais je ne me suis même pas lavé ! Comment est-ce possible ? Oui, je n’ai rien fait du tout, murmura-t-il. Je voulais coucher mon plan sur le papier, et puis… et puis… Et enfin, je n’ai même pas écrit au commissaire, pas plus, du reste, qu’au gouverneur. J’ai bien commencé une lettre au propriétaire, mais je ne l’ai pas achevée ; et je n’ai pas non plus vérifié les factures, je n’ai pas non plus donné d’argent à Zakhar. Toute ma matinée a été perdue ! »
Et il devint songeur.
« Qu’est-ce qui se passe ? Un autre aurait-il fait tout cela à ma place ? se demanda-t-il soudain. Un autre, un autre… Qu’est-ce don qu’un autre ? »
Il se mit à réfléchir, et voici que se forma en lui une idée tout autre que celle qu’il avait exposée à Zakhar à propos des autres.
Il dut admettre qu’un autre aurait eu le temps d’écrire toutes ses lettres, sans être heurté par aucun petit mot, qu’un autre aurait aussi déménagé, qu’un autre aurait aussi réalisé ce plan, et inspecté le domaine par surcroît…
« Et moi aussi, j’aurais pu faire tout cela », songea-t-il. « Je sais tout de même écrire, il m’est tout de même arrivé d’écrire, et autre chose que des lettres. Alors ? Où sont partis ces dons ? Et puis, est-ce un tel drame de déménager ? Il suffirait peut-être d’accepter, de vouloir. Un autre ne passe pas sa vie en robe de chambre, un autre – et là-dessus il bâilla – ne dort pas la plus grande partie du temps, un autre profite de la vie, va partout, examine tout, s’intéresse à tout… Et moi ? Moi, moi, je ne suis pas un autre, évidemment », se dit-il avec tristesse, submergé par ces profondes réflexions. Il sortit même sa tête de dessous les couvertures.
Ce fut là une minute claire, lucide, dans la vie d’Oblomov.
Mais il s’effraya très vite du parallèle qui s’imposait entre la vie telle qu’elle aurait dû être et sa vie à lui, et les questions se mirent à voler en désordre comme des oiseaux peureux réveillés par un rayon de soleil inattendu, surprenant, dans l’ombre des ruines endormies.
Il s’attrista, il souffrir de constater son manque de développement, l’arrêt de ses forces spirituelles, la lourdeur qui l’empêchait d’agir. Et une jalousie lui vint à l’idée que les autres, pendant ce temps, vivaient d’une vie pleine et large, alors qu’une lourde pierre avait été jetée à travers le sentier étroit et pitoyable de son existence.
Dans son âme timorée, naissait une conscience douloureuse, il se mettait à comprendre que plusieurs aspects de sa nature ne s’étaient encore jamais éveillés, et que d’autres l’étaient si peu, éveillés… Alors que tout cet or, depuis longtemps, eût dû être changé en monnaie courante…
Il constatait soudain que toutes les phases de sa vie s’étaient rétrécies jusqu’à de pauvres et microscopiques dimensions, et cette confession silencieuse engendrait en lui une cruelle amertume. Les regrets stériles, les reproches de sa conscience l’ulcéraient ; il cherchait de toutes ses forces à jeter bas ce fardeau, à trouver hors de lui-même quelqu’un contre qui se tourner. Mais qui ?
« Tout ça, c’est la faute de Zakhar ! » chuchota-t-il.
Il se rappela les détails de son dialogue avec Zakhar, et sa figure, pourtant, s’embrasa de honte.
« Si quelqu’un avait pu m’entendre ! » songea-t-il, comme pétrifié. « Dieu merci, il n’y avait personne. Et Zakhar est tout à fait incapable de le raconter à qui que ce soit. Et quand même il en serait capable, on ne le croirait pas, Dieu merci ! »
Il soupirait, se maudissait, se tournait d’un côté sur l’autre, cherchait un coupable et ne le trouvait pas. Ses gémissements et ses soupirs parvinrent aux oreilles de Zakhar.
— Ah, comme ça le travaille ! grogna Zakhar avec humeur.
« Mais pourquoi suis-je comme je suis ? » se demandait pendant ce temps Oblomov, presque en pleurant. Et il cacha sa tête sous la couverture.
Ayant vainement cherché le principe hostile qui l’empêchait de vivre de la manière qu’il fallait, comme vivent les autres, Oblomov soupira une fois de plus, abaissa ses paupières et quelques minutes plus tard s’assoupit.
« Pourtant, moi aussi… je voudrais… » dit-il, clignant des yeux avec effort. « Vraiment, est-ce que la nature m’aurait défavorisé à ce point ?... Mais non, Dieu merci, je n’ai pas à me plaindre… »
Là-dessus il fit entendre un soupir apaisé. Il revenait de l’exaltation à son état normal, le calme, l’apathie. « C’est mon destin, évidemment, qu’y faire ? » chuchota-t-il, déjà vaincu par le sommeil.
— Deux milles roubles de revenu en mois… dit-il brusquement à voix haute. Tout de suite, tout de suite, attends…
Et il se réveilla à moitié.
— Quand même… Je serais curieux de savoir pourquoi je suis come je suis, répéta-t-il, mais cette fois dans un chuchotement, tandis que ses paupières se fermaient. — Oui, pourquoi ? Sans doute est-ce parce que… parce que… voulut-il encore prononcer, mais il ne prononça rien du tout.
Ainsi, il n’arriva pas à démêler les causes de son infortune. Sa langue s’arrêtait, ses lèvres se figeaient et demeuraient entrouvertes. Et à la place des paroles, on entendit encore un soupir, puis le ronflement égal de l’homme qui dort paisiblement.
« Mais je ne me suis même pas lavé ! Comment est-ce possible ? Oui, je n’ai rien fait du tout, murmura-t-il. Je voulais coucher mon plan sur le papier, et puis… et puis… Et enfin, je n’ai même pas écrit au commissaire, pas plus, du reste, qu’au gouverneur. J’ai bien commencé une lettre au propriétaire, mais je ne l’ai pas achevée ; et je n’ai pas non plus vérifié les factures, je n’ai pas non plus donné d’argent à Zakhar. Toute ma matinée a été perdue ! »
Et il devint songeur.
« Qu’est-ce qui se passe ? Un autre aurait-il fait tout cela à ma place ? se demanda-t-il soudain. Un autre, un autre… Qu’est-ce don qu’un autre ? »
Il se mit à réfléchir, et voici que se forma en lui une idée tout autre que celle qu’il avait exposée à Zakhar à propos des autres.
Il dut admettre qu’un autre aurait eu le temps d’écrire toutes ses lettres, sans être heurté par aucun petit mot, qu’un autre aurait aussi déménagé, qu’un autre aurait aussi réalisé ce plan, et inspecté le domaine par surcroît…
« Et moi aussi, j’aurais pu faire tout cela », songea-t-il. « Je sais tout de même écrire, il m’est tout de même arrivé d’écrire, et autre chose que des lettres. Alors ? Où sont partis ces dons ? Et puis, est-ce un tel drame de déménager ? Il suffirait peut-être d’accepter, de vouloir. Un autre ne passe pas sa vie en robe de chambre, un autre – et là-dessus il bâilla – ne dort pas la plus grande partie du temps, un autre profite de la vie, va partout, examine tout, s’intéresse à tout… Et moi ? Moi, moi, je ne suis pas un autre, évidemment », se dit-il avec tristesse, submergé par ces profondes réflexions. Il sortit même sa tête de dessous les couvertures.
Ce fut là une minute claire, lucide, dans la vie d’Oblomov.
Mais il s’effraya très vite du parallèle qui s’imposait entre la vie telle qu’elle aurait dû être et sa vie à lui, et les questions se mirent à voler en désordre comme des oiseaux peureux réveillés par un rayon de soleil inattendu, surprenant, dans l’ombre des ruines endormies.
Il s’attrista, il souffrir de constater son manque de développement, l’arrêt de ses forces spirituelles, la lourdeur qui l’empêchait d’agir. Et une jalousie lui vint à l’idée que les autres, pendant ce temps, vivaient d’une vie pleine et large, alors qu’une lourde pierre avait été jetée à travers le sentier étroit et pitoyable de son existence.
Dans son âme timorée, naissait une conscience douloureuse, il se mettait à comprendre que plusieurs aspects de sa nature ne s’étaient encore jamais éveillés, et que d’autres l’étaient si peu, éveillés… Alors que tout cet or, depuis longtemps, eût dû être changé en monnaie courante…
Il constatait soudain que toutes les phases de sa vie s’étaient rétrécies jusqu’à de pauvres et microscopiques dimensions, et cette confession silencieuse engendrait en lui une cruelle amertume. Les regrets stériles, les reproches de sa conscience l’ulcéraient ; il cherchait de toutes ses forces à jeter bas ce fardeau, à trouver hors de lui-même quelqu’un contre qui se tourner. Mais qui ?
« Tout ça, c’est la faute de Zakhar ! » chuchota-t-il.
Il se rappela les détails de son dialogue avec Zakhar, et sa figure, pourtant, s’embrasa de honte.
« Si quelqu’un avait pu m’entendre ! » songea-t-il, comme pétrifié. « Dieu merci, il n’y avait personne. Et Zakhar est tout à fait incapable de le raconter à qui que ce soit. Et quand même il en serait capable, on ne le croirait pas, Dieu merci ! »
Il soupirait, se maudissait, se tournait d’un côté sur l’autre, cherchait un coupable et ne le trouvait pas. Ses gémissements et ses soupirs parvinrent aux oreilles de Zakhar.
— Ah, comme ça le travaille ! grogna Zakhar avec humeur.
« Mais pourquoi suis-je comme je suis ? » se demandait pendant ce temps Oblomov, presque en pleurant. Et il cacha sa tête sous la couverture.
Ayant vainement cherché le principe hostile qui l’empêchait de vivre de la manière qu’il fallait, comme vivent les autres, Oblomov soupira une fois de plus, abaissa ses paupières et quelques minutes plus tard s’assoupit.
« Pourtant, moi aussi… je voudrais… » dit-il, clignant des yeux avec effort. « Vraiment, est-ce que la nature m’aurait défavorisé à ce point ?... Mais non, Dieu merci, je n’ai pas à me plaindre… »
Là-dessus il fit entendre un soupir apaisé. Il revenait de l’exaltation à son état normal, le calme, l’apathie. « C’est mon destin, évidemment, qu’y faire ? » chuchota-t-il, déjà vaincu par le sommeil.
— Deux milles roubles de revenu en mois… dit-il brusquement à voix haute. Tout de suite, tout de suite, attends…
Et il se réveilla à moitié.
— Quand même… Je serais curieux de savoir pourquoi je suis come je suis, répéta-t-il, mais cette fois dans un chuchotement, tandis que ses paupières se fermaient. — Oui, pourquoi ? Sans doute est-ce parce que… parce que… voulut-il encore prononcer, mais il ne prononça rien du tout.
Ainsi, il n’arriva pas à démêler les causes de son infortune. Sa langue s’arrêtait, ses lèvres se figeaient et demeuraient entrouvertes. Et à la place des paroles, on entendit encore un soupir, puis le ronflement égal de l’homme qui dort paisiblement.
— En effet, on ne voit pas de livres chez vous, dit Penkine. Mais je vous en supplie, lisez quand même quelque chose ! Il va sortir incessamment un poème vraiment magnifique : « L’amour d’un concussionnaire pour une femme déchue ». Je ne peux pas vous dire le nom de l’auteur, c’est encore un secret.
— Et de quoi s’agit-il ?
— On y découvre tous les mécanismes de la société, et sous des couleurs poétiques. Oui, tous les ressorts sont démontés, et tous les échelons de l’échelle sociale impitoyablement passés en revue. L’auteur y cite, comme devant un tribunal, aussi bien le dignitaire, faible, vieux, mais inconscient, que tout l’essaim des concussionnaires qui le trompent sciemment et… et… toutes les catégories de femmes déchues… françaises, allemandes, finoises… Et le tout avec une vérité surprenante. J’en ai entendu des passages. Génial, ce poète ! C’est tantôt du Dante et tantôt du Shakespeare !
— Ça ! dit Oblomov, si accablé qu’un peu plus il se serait soulevé sur son divan.
Penkine se tut tout à coup, voyant qu’il était allé trop loin.
— Enfin, vous le lirez et vous jugerez, ajouta-t-il avec moins d’exaltation.
— Non, Penkine, je ne le lirai pas.
— Mais pourquoi ? Tout le monde en parle et…
— Grand bien leur fasse à tous ! Il y a des gens qui n’ont rien d’autre à faire que de parler. C’est une vocation comme une autre.
— Mais lisez ce poème, ne serait-ce que par curiosité.
— Qu’est-ce que j’y trouverai ? dit Oblomov.
— Et la vérité, la vérité, ce n’est rien, peut-être ? Oui, c’est vrai jusqu’à en être presque comique ! Des portraits vivants ! Que ce soit le marchant, le fonctionnaire, l’officier, le veilleur de nuit, ils sont… comme imprimés vivants !
— Mais pourquoi tous ces créateurs se démènent-ils ainsi ? Affaire de se faire plaisir à soi-même en se disant que le modèle importe peu si le portrait est vivant ? Seulement voilà, la vie manque à tous ces écrits. Il n’y a en eux ni compréhension, ni sympathie pour les êtres vivants, ni même ce que vous appelez, vous autres, « humanitarisme ». Rien, il n’y a en eux rien que de l’amour-propre. Quand ils décrivent des voleurs, des femmes déchues, c’est exactement comme s’ils les surprenaient, les attrapaient en pleine rue et les menaient finalement en prison. Dans leurs récits, on ne voit jamais couler « les larmes invisibles », on entend seulement ricaner et rire, grossièrement, méchamment, cruellement.
— Et que vous faut-il de plus ? Vous vous êtes très bien exprimé : c’est la peinture méchante de la méchanceté, le réquisitoire bilieux du vice, c’est enfin le rictus de mépris devant la créature déchue… Tout est là, il me semble…
— Eh bien non, tout n’est pas là ! cria Oblomov, s’échauffant soudain. — Je veux bien que l’on dépeigne un voleur, une femme déchue, un imbécile berné, pourquoi pas ? Mais qu’on n’oublie pas, au milieu de tout cela, l’homme ! Où est l’humanité, en l’occurrence ? Vous n’écrivez, tous, qu’avec votre intellect ! Vous croyez sans doute que la pensée exclut les mouvements du cœur. Je regrette de vous contredire, mais la pensée ne peut être fécondée que par l’amour. Tendez la main à l’homme déchu pour le relever, pleurez sur lui s’il vient à périr, mais ne vous en gaussez pas sans cesse comme vous le faites ! Aimez-le, sauvez-vous de vous-mêmes en l’observant, et traitez-le comme vous auriez voulu que l’on vous traitât vous-mêmes ; alors, je vous lirai, et non seulement je voulais mais je m’inclinerai devant vous, dit Oblomov, soudain un peu plus calme, et tout en se recouchant confortablement sur son divan. — Oui, reprit-il, vous représentez le voleur, la femme déchue, mais vous oubliez tout simplement l’homme ; l’homme, vous ne savez pas le dépeindre. Est-ce de l’art, cela ? Des couleurs poétiques ?... Vraiment, je ne crois pas ! Dénoncer le vice, la boue, dénoncez-les tant que vous voulez, mais de grâce, ne prétendez pas en même temps à la poésie.
— Quoi ! Vous voudriez peut-être que l’on découvre encore la nature, que l’on montre des roses, un rossignol, ou même un matin de gel, alors qu’autour de nous tout bouillonne, tout bouge ! Nous avons besoin d’une sèche physiologie de la société, le temps des chansons est passé.
— Donnez-moi l’homme, l’homme ! dit Oblomov. — Et aimez-le !
— Aimer l’usurier, le pleurnicheur, le fonctionnaire obtus et malhonnête ! Et quoi encore ? On voit bien que vous ne vous occupez pas de littérature ! s’écria Penkine. Non, il faut au contraire châtier ces gens, et les exclure de la société.
— Les exclure de la société ! dit soudain, dans un grand soupir, Oblomov en se dressant face à Penkine. Mais c’est oublier la présence d’un principe suprême, même dans ce qu’il existe de plus médiocre. Oui, c’est oublier que l’homme perverti est quand même un homme, est quand même vous !... Exclure ! Et comment, comme l’exclurez-vous du cercle des hommes, du sein de la nature, de la charité divine ? cria presque Oblomov, dont les yeux lançaient des flammes.
— Et de quoi s’agit-il ?
— On y découvre tous les mécanismes de la société, et sous des couleurs poétiques. Oui, tous les ressorts sont démontés, et tous les échelons de l’échelle sociale impitoyablement passés en revue. L’auteur y cite, comme devant un tribunal, aussi bien le dignitaire, faible, vieux, mais inconscient, que tout l’essaim des concussionnaires qui le trompent sciemment et… et… toutes les catégories de femmes déchues… françaises, allemandes, finoises… Et le tout avec une vérité surprenante. J’en ai entendu des passages. Génial, ce poète ! C’est tantôt du Dante et tantôt du Shakespeare !
— Ça ! dit Oblomov, si accablé qu’un peu plus il se serait soulevé sur son divan.
Penkine se tut tout à coup, voyant qu’il était allé trop loin.
— Enfin, vous le lirez et vous jugerez, ajouta-t-il avec moins d’exaltation.
— Non, Penkine, je ne le lirai pas.
— Mais pourquoi ? Tout le monde en parle et…
— Grand bien leur fasse à tous ! Il y a des gens qui n’ont rien d’autre à faire que de parler. C’est une vocation comme une autre.
— Mais lisez ce poème, ne serait-ce que par curiosité.
— Qu’est-ce que j’y trouverai ? dit Oblomov.
— Et la vérité, la vérité, ce n’est rien, peut-être ? Oui, c’est vrai jusqu’à en être presque comique ! Des portraits vivants ! Que ce soit le marchant, le fonctionnaire, l’officier, le veilleur de nuit, ils sont… comme imprimés vivants !
— Mais pourquoi tous ces créateurs se démènent-ils ainsi ? Affaire de se faire plaisir à soi-même en se disant que le modèle importe peu si le portrait est vivant ? Seulement voilà, la vie manque à tous ces écrits. Il n’y a en eux ni compréhension, ni sympathie pour les êtres vivants, ni même ce que vous appelez, vous autres, « humanitarisme ». Rien, il n’y a en eux rien que de l’amour-propre. Quand ils décrivent des voleurs, des femmes déchues, c’est exactement comme s’ils les surprenaient, les attrapaient en pleine rue et les menaient finalement en prison. Dans leurs récits, on ne voit jamais couler « les larmes invisibles », on entend seulement ricaner et rire, grossièrement, méchamment, cruellement.
— Et que vous faut-il de plus ? Vous vous êtes très bien exprimé : c’est la peinture méchante de la méchanceté, le réquisitoire bilieux du vice, c’est enfin le rictus de mépris devant la créature déchue… Tout est là, il me semble…
— Eh bien non, tout n’est pas là ! cria Oblomov, s’échauffant soudain. — Je veux bien que l’on dépeigne un voleur, une femme déchue, un imbécile berné, pourquoi pas ? Mais qu’on n’oublie pas, au milieu de tout cela, l’homme ! Où est l’humanité, en l’occurrence ? Vous n’écrivez, tous, qu’avec votre intellect ! Vous croyez sans doute que la pensée exclut les mouvements du cœur. Je regrette de vous contredire, mais la pensée ne peut être fécondée que par l’amour. Tendez la main à l’homme déchu pour le relever, pleurez sur lui s’il vient à périr, mais ne vous en gaussez pas sans cesse comme vous le faites ! Aimez-le, sauvez-vous de vous-mêmes en l’observant, et traitez-le comme vous auriez voulu que l’on vous traitât vous-mêmes ; alors, je vous lirai, et non seulement je voulais mais je m’inclinerai devant vous, dit Oblomov, soudain un peu plus calme, et tout en se recouchant confortablement sur son divan. — Oui, reprit-il, vous représentez le voleur, la femme déchue, mais vous oubliez tout simplement l’homme ; l’homme, vous ne savez pas le dépeindre. Est-ce de l’art, cela ? Des couleurs poétiques ?... Vraiment, je ne crois pas ! Dénoncer le vice, la boue, dénoncez-les tant que vous voulez, mais de grâce, ne prétendez pas en même temps à la poésie.
— Quoi ! Vous voudriez peut-être que l’on découvre encore la nature, que l’on montre des roses, un rossignol, ou même un matin de gel, alors qu’autour de nous tout bouillonne, tout bouge ! Nous avons besoin d’une sèche physiologie de la société, le temps des chansons est passé.
— Donnez-moi l’homme, l’homme ! dit Oblomov. — Et aimez-le !
— Aimer l’usurier, le pleurnicheur, le fonctionnaire obtus et malhonnête ! Et quoi encore ? On voit bien que vous ne vous occupez pas de littérature ! s’écria Penkine. Non, il faut au contraire châtier ces gens, et les exclure de la société.
— Les exclure de la société ! dit soudain, dans un grand soupir, Oblomov en se dressant face à Penkine. Mais c’est oublier la présence d’un principe suprême, même dans ce qu’il existe de plus médiocre. Oui, c’est oublier que l’homme perverti est quand même un homme, est quand même vous !... Exclure ! Et comment, comme l’exclurez-vous du cercle des hommes, du sein de la nature, de la charité divine ? cria presque Oblomov, dont les yeux lançaient des flammes.
Quand on ne sait pas pourquoi on vit, on vit n'importe comment, au jour le jour ; on se réjouit de voir la nuit tomber et de pouvoir noyer dans le sommeil la question insidieuse des raisons pour lesquelles on a vécu, douze ou vingt-quatre heures durant ; et aussi cette autre question : pourquoi vivre le lendemain ?
La fleur de ma vie s'est effeuillée, seules me restent les ronces.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Ivan Gontcharov (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
La littérature russe
Lequel de ses écrivains est mort lors d'un duel ?
Tolstoï
Pouchkine
Dostoïevski
10 questions
437 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature russeCréer un quiz sur ce livre437 lecteurs ont répondu