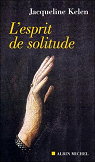Citations sur Impatience de l'Absolu: Face au genre inhumain (12)
Une véritable intelligence rassemble l'intellect (penser, comprendre), la sensibilité (éprouver, être touché), et l'intuition (accueillir, fulgurer).
Lorsque, une fois de plus, je constate que bien des méchants, des crapules, voire des monstres mènent une existence pépère en toute impunité, je repense au traité de Plutarque qui déjà s'interrogeait sur "les délais de la justice divine."
Il est d’une grande sagesse de laisser reposer une relation pénible ou conflictuelle, plutôt que de l’agiter sous prétexte de s’expliquer et de ressasser l’incompréhension. La clarification advient lorsqu’on cesse d’agiter le mélange, mais il faut faire preuve de patience et aussi d’un certain renoncement. Renoncer à savoir tout de suite, à obtenir des résultats, à être capable de transformer les êtres et les choses, bref , renoncer aux nombreuses prétentions du moi .
La différence est grande entre fragilité et sensibilité. La sensibilité aime frémir, vibrer, s’exalter. La fragilité a peur de se briser.
Quelqu'un de fragile craint d’être fragilisé davantage : il faut donc le ménager, le rassurer, l’entourer. Un être sensible ne cherche nullement à se protéger, il reçoit en permanence tous les souffles de vie.
La fragilité rêve de solidité. La sensibilité déploie sa musicalité.
Assurément, l’espèce humaine est précaire, et le genre humain particulièrement insensible. Mais l’être spirituel s’avère puissant : éminemment sensible, non point fragile.
Quelqu'un de fragile craint d’être fragilisé davantage : il faut donc le ménager, le rassurer, l’entourer. Un être sensible ne cherche nullement à se protéger, il reçoit en permanence tous les souffles de vie.
La fragilité rêve de solidité. La sensibilité déploie sa musicalité.
Assurément, l’espèce humaine est précaire, et le genre humain particulièrement insensible. Mais l’être spirituel s’avère puissant : éminemment sensible, non point fragile.
On entend beaucoup parler, depuis les dernières décennies, du réchauffement de la planète et des conséquences désastreuses qu'il entraîne, mais on n'évoque guère le refroidissement des cœurs : indifférence générale et insensibilité à autrui comme gages de tranquillité et de préservation de soi. Pourtant, c'est par là que la catastrophe se produit, sourdement, au quotidien, bien loin de survenir un jour de grand fracas.
On entend répéter qu’il faut « faire confiance », s’abandonner, lâcher prise. La confiance est même le maître mot de la démarche religieuse, synonyme de foi en Dieu, en sa miséricorde et sa providence.
Autant le « lâcher-prise » m’insupporte – et je lui tords le cou –, autant la confiance me questionne. À vrai dire, je ne la conçois pas sans alliance avec le discernement.
C’est toujours le même refrain : les chrétiens répètent que Dieu est Amour et ils omettent le fait que Dieu est également Justice. Ou encore on parle du chevalier médiéval comme d’un homme vaillant qui défend le pauvre, la veuve et l’orphelin, mais on oublie de dire qu’il est tout autant celui qui fait justice, qui redresse les torts et pourfend méchants et félons.
La juste attitude est bien celle d’une confiance où ne sombre pas le discernement, d’un abandon qui n’est pas faiblesse et lâcheté, d’une foi qui n’est pas facilité mais quête ardente et périlleuse de la Vérité.
L’attitude du chat est pleine d’enseignement. Même s’il vit dans la compagnie humaine et semble apprivoisé, il demeure un petit félin : toujours sur ses gardes, il ne dort que d’un œil, bondit sur ses pattes au moindre bruit inquiétant, sort ses griffes, tout en acceptant par ailleurs des caresses et s’y abandonnant. Un chat est toujours vigilant, prêt à se défendre ou se sauver. Loin de se méfier de tout, il rappelle aux hommes qui apprécient sa présence que la confiance n’est pas une abdication, une torpeur, qu’elle est toujours soumise à caution et précaution.
Au fond, ceux qui ne cessent d’invoquer la confiance – les politiciens, les gurus, les thérapeutes et autres bonnes âmes – y trouvent leur intérêt : ils encouragent une mentalité passive, une conscience endormie, une attitude obéissante, voire résignée. « Faites-moi confiance », disent-ils. À ces mots, un individu sain d’esprit devrait fuir immédiatement. Parce que c’est la porte ouverte à la tromperie et à la soumission.
Je ne suis pas sûre du tout que la confiance soit la qualité première requise par et pour le combat spirituel. La force, oui, la justice, bien sûr, et tout ce qui va de pair, le courage, la hardiesse, le défi, la persévérance…
Lorsqu’un chevalier engage un combat ou doit repousser des assaillants, il ne pense pas en premier à la confiance (confiance en soi, en ses ressources, confiance en Dieu qui mène à bien la bataille, en la Justice finale), et, bien sûr, il n’imagine nullement s’abandonner ni lâcher prise. Il se bat au nom de la justice, de la beauté, de l’amour, il se bat pour l’honneur, pour la fierté d’être une âme libre, à jamais insoumise. La valeur du combat tient en cet engagement. Entrer dans l’arène, monter au créneau, prendre les armes, se présenter face à l’adversaire… autant d’expressions qui désignent une âme héroïque.
Ces chevaliers ne triomphent pas nécessairement, ils ne viennent pas à bout de tous leurs ennemis, ils se retrouvent blessés, ils sont trahis, moqués aussi, mais ils ne renoncent pas, ils se relèvent et persistent jusqu’au trépas. Nulle trace de confiance béate ou d’abandon. Nulle vanité personnelle non plus. D’une âme libre, d’une âme noble, on peut dire seulement : en ce monde elle a bien combattu.
Parce qu’une grande âme ne peut rien faire d’autre en ce monde mensonger et factice, promis à la mort, voué aux multiples séductions démoniaques. Elle ne peut ni se taire ni adhérer. Ni se réfugier au fond d’un ermitage ni se contenter de faire du bien à autrui. Elle n’a en ce monde aucun lieu où se reposer parce qu’elle n’est pas de ce monde, parce qu’en celui-ci elle ne se fie pas, elle ne se fixe pas. Son seul destin est de combattre, de témoigner sans relâche du Royaume de lumière, de repousser ou abattre les puissances ténébreuses – et d’abord les démasquer. Elle se doit donc d’être aux aguets, sur ses gardes, tel un félin. La confiance suave ici n’est pas de mise puisque l’issue du combat métaphysique est incertaine. Ce n’est pas, comme le disent benoîtement les religieux, le Bien (alias l’amour, le pardon, la miséricorde) qui triomphera et sauvera tous les humains indistinctement. Non, l’issue finale n’est pas assurée, et peut-être que le combat continuera éternellement (quelle vision éreintante !) dans les cieux et en d’autres mondes.
Dans cette perspective, l’humour est requis ainsi qu’une légèreté certaine : ils s’avèrent bien plus précieux qu’une confiance naïve. Le guerrier spirituel n’a rien d’un Goliath, il est souple et non pas monolithique, bardé de certitudes et de technologies. Il doit aller au combat avec ardeur et finesse, de tout son être, mais sans jamais se prendre pour un héros ni pour le sauveur du monde. Au fond, c’est sa nature, il est fait pour cela : moins pour terrasser dragons et ennemis que pour rappeler à ses pleutres contemporains qu’une âme digne de ce nom n’est jamais assagie et qu’elle veille toujours.
Autant le « lâcher-prise » m’insupporte – et je lui tords le cou –, autant la confiance me questionne. À vrai dire, je ne la conçois pas sans alliance avec le discernement.
C’est toujours le même refrain : les chrétiens répètent que Dieu est Amour et ils omettent le fait que Dieu est également Justice. Ou encore on parle du chevalier médiéval comme d’un homme vaillant qui défend le pauvre, la veuve et l’orphelin, mais on oublie de dire qu’il est tout autant celui qui fait justice, qui redresse les torts et pourfend méchants et félons.
La juste attitude est bien celle d’une confiance où ne sombre pas le discernement, d’un abandon qui n’est pas faiblesse et lâcheté, d’une foi qui n’est pas facilité mais quête ardente et périlleuse de la Vérité.
L’attitude du chat est pleine d’enseignement. Même s’il vit dans la compagnie humaine et semble apprivoisé, il demeure un petit félin : toujours sur ses gardes, il ne dort que d’un œil, bondit sur ses pattes au moindre bruit inquiétant, sort ses griffes, tout en acceptant par ailleurs des caresses et s’y abandonnant. Un chat est toujours vigilant, prêt à se défendre ou se sauver. Loin de se méfier de tout, il rappelle aux hommes qui apprécient sa présence que la confiance n’est pas une abdication, une torpeur, qu’elle est toujours soumise à caution et précaution.
Au fond, ceux qui ne cessent d’invoquer la confiance – les politiciens, les gurus, les thérapeutes et autres bonnes âmes – y trouvent leur intérêt : ils encouragent une mentalité passive, une conscience endormie, une attitude obéissante, voire résignée. « Faites-moi confiance », disent-ils. À ces mots, un individu sain d’esprit devrait fuir immédiatement. Parce que c’est la porte ouverte à la tromperie et à la soumission.
Je ne suis pas sûre du tout que la confiance soit la qualité première requise par et pour le combat spirituel. La force, oui, la justice, bien sûr, et tout ce qui va de pair, le courage, la hardiesse, le défi, la persévérance…
Lorsqu’un chevalier engage un combat ou doit repousser des assaillants, il ne pense pas en premier à la confiance (confiance en soi, en ses ressources, confiance en Dieu qui mène à bien la bataille, en la Justice finale), et, bien sûr, il n’imagine nullement s’abandonner ni lâcher prise. Il se bat au nom de la justice, de la beauté, de l’amour, il se bat pour l’honneur, pour la fierté d’être une âme libre, à jamais insoumise. La valeur du combat tient en cet engagement. Entrer dans l’arène, monter au créneau, prendre les armes, se présenter face à l’adversaire… autant d’expressions qui désignent une âme héroïque.
Ces chevaliers ne triomphent pas nécessairement, ils ne viennent pas à bout de tous leurs ennemis, ils se retrouvent blessés, ils sont trahis, moqués aussi, mais ils ne renoncent pas, ils se relèvent et persistent jusqu’au trépas. Nulle trace de confiance béate ou d’abandon. Nulle vanité personnelle non plus. D’une âme libre, d’une âme noble, on peut dire seulement : en ce monde elle a bien combattu.
Parce qu’une grande âme ne peut rien faire d’autre en ce monde mensonger et factice, promis à la mort, voué aux multiples séductions démoniaques. Elle ne peut ni se taire ni adhérer. Ni se réfugier au fond d’un ermitage ni se contenter de faire du bien à autrui. Elle n’a en ce monde aucun lieu où se reposer parce qu’elle n’est pas de ce monde, parce qu’en celui-ci elle ne se fie pas, elle ne se fixe pas. Son seul destin est de combattre, de témoigner sans relâche du Royaume de lumière, de repousser ou abattre les puissances ténébreuses – et d’abord les démasquer. Elle se doit donc d’être aux aguets, sur ses gardes, tel un félin. La confiance suave ici n’est pas de mise puisque l’issue du combat métaphysique est incertaine. Ce n’est pas, comme le disent benoîtement les religieux, le Bien (alias l’amour, le pardon, la miséricorde) qui triomphera et sauvera tous les humains indistinctement. Non, l’issue finale n’est pas assurée, et peut-être que le combat continuera éternellement (quelle vision éreintante !) dans les cieux et en d’autres mondes.
Dans cette perspective, l’humour est requis ainsi qu’une légèreté certaine : ils s’avèrent bien plus précieux qu’une confiance naïve. Le guerrier spirituel n’a rien d’un Goliath, il est souple et non pas monolithique, bardé de certitudes et de technologies. Il doit aller au combat avec ardeur et finesse, de tout son être, mais sans jamais se prendre pour un héros ni pour le sauveur du monde. Au fond, c’est sa nature, il est fait pour cela : moins pour terrasser dragons et ennemis que pour rappeler à ses pleutres contemporains qu’une âme digne de ce nom n’est jamais assagie et qu’elle veille toujours.
Nous sommes entourés, assaillis, par des gens qui à longueur de temps broient du noir – soit en ressassant leurs misères personnelles, soit en colportant des nouvelles affreuses.
L’être spirituel est celui qui, en toutes circonstances et face au plus grand péril, broie de la lumière.
L’être spirituel est celui qui, en toutes circonstances et face au plus grand péril, broie de la lumière.
Il est bon de rappeler, y compris aux chrétiens, ce que signifie exactement la spiritualité, sauf à vouloir étendre son acception à un domaine vague et flou et ainsi tromper les gens.
Une vie spirituelle se fonde sur l’attestation des réalités célestes, invisibles, et sur la reconnaissance en l’être humain d’un principe supérieur, divin, que l’on appelle esprit (pneuma en grec, spiritus en latin) ou encore étincelle, fond de l’âme, fine pointe de l’âme. C’est par l’esprit que l’homme peut entrer en communication avec le divin, en recevoir les lumières et les grâces, et aussi connaître l’expérience mystique de l’union divine. C’est l’esprit qui le fait aspirer à une vie supérieure, éternelle, et à des biens immatériels.
Ainsi, un athée matérialiste, niant tout principe supérieur, ne peut pas et ne devrait pas revendiquer une dimension spirituelle qui se trouve en totale contradiction avec sa philosophie. Mais, bien sûr, il peut mener une vie intellectuelle, une vie morale et même témoigner d’une sagesse puisque celles-ci ne requièrent nulle transcendance et nulle dimension pneumatique en l’homme.
Une vie spirituelle ne se réduit pas à une morale. Celle-ci concerne la conduite sur terre et demeure à niveau d’homme, là où la vie spirituelle s’élève vers le divin, au risque parfois de transgresser la morale commune et de bousculer les conventions sociales. Pour vivre en ce monde et vivre en société d’une façon acceptable, la morale et l’éthique sont indispensables. Mais pour atteindre les niveaux supérieurs de l’être humain, pour goûter à la vie parfaite, seule la démarche spirituelle est requise – non pas contre la morale ni en se débarrassant d’elle, mais en allant plus haut qu’elle.
Sans aucun doute le terme même d’« esprit » dans la langue française peut porter à confusion. Quelqu'un peut avoir de l’esprit, faire de l’esprit, être un bel esprit, sans être le moins du monde relié à Dieu ni préoccupé des fins dernières. Parmi les langues anciennes, le grec et le latin maintiennent une distinction entre les facultés intellectuelles (noûs, mens) et ce qui est proprement spirituel (pneuma, spiritus). Le Saint-Esprit est désigné par Pneuma, ou Sanctus Spiritus.
Un intellectuel a une vie de l’esprit au sens où il exerce sa faculté de penser, raisonne, réfléchit, se questionne, manie des concepts. Mais pour un être spirituel, la vie de l’esprit résonne différemment, elle fait appel à d’autres sens et d’autres ressources, à un entendement subtil, à une intelligence du cœur : cette vie-là est inspirée et illuminée par l’Esprit.
Cela ne veut pas dire qu’à un intellectuel est refusée toute vie spirituelle. Mais à un intellectuel faisant profession d’athéisme est réservée, au mieux, une sagesse.
Plus un être est libre, plus il participe de la vie de l’Esprit. Et plus un être est spiritualisé, plus il manifeste en tout une immense liberté. En ce sens, parler d’un « esprit libre » est une tautologie.
L’esprit en l’être humain se caractérise par la clarté, la liberté et la joie ; il s’avère inattaquable, indestructible, il n’est jamais malade. C’est ainsi qu’à l’Esprit-Saint correspond à l’esprit sain.
Une vie spirituelle se fonde sur l’attestation des réalités célestes, invisibles, et sur la reconnaissance en l’être humain d’un principe supérieur, divin, que l’on appelle esprit (pneuma en grec, spiritus en latin) ou encore étincelle, fond de l’âme, fine pointe de l’âme. C’est par l’esprit que l’homme peut entrer en communication avec le divin, en recevoir les lumières et les grâces, et aussi connaître l’expérience mystique de l’union divine. C’est l’esprit qui le fait aspirer à une vie supérieure, éternelle, et à des biens immatériels.
Ainsi, un athée matérialiste, niant tout principe supérieur, ne peut pas et ne devrait pas revendiquer une dimension spirituelle qui se trouve en totale contradiction avec sa philosophie. Mais, bien sûr, il peut mener une vie intellectuelle, une vie morale et même témoigner d’une sagesse puisque celles-ci ne requièrent nulle transcendance et nulle dimension pneumatique en l’homme.
Une vie spirituelle ne se réduit pas à une morale. Celle-ci concerne la conduite sur terre et demeure à niveau d’homme, là où la vie spirituelle s’élève vers le divin, au risque parfois de transgresser la morale commune et de bousculer les conventions sociales. Pour vivre en ce monde et vivre en société d’une façon acceptable, la morale et l’éthique sont indispensables. Mais pour atteindre les niveaux supérieurs de l’être humain, pour goûter à la vie parfaite, seule la démarche spirituelle est requise – non pas contre la morale ni en se débarrassant d’elle, mais en allant plus haut qu’elle.
Sans aucun doute le terme même d’« esprit » dans la langue française peut porter à confusion. Quelqu'un peut avoir de l’esprit, faire de l’esprit, être un bel esprit, sans être le moins du monde relié à Dieu ni préoccupé des fins dernières. Parmi les langues anciennes, le grec et le latin maintiennent une distinction entre les facultés intellectuelles (noûs, mens) et ce qui est proprement spirituel (pneuma, spiritus). Le Saint-Esprit est désigné par Pneuma, ou Sanctus Spiritus.
Un intellectuel a une vie de l’esprit au sens où il exerce sa faculté de penser, raisonne, réfléchit, se questionne, manie des concepts. Mais pour un être spirituel, la vie de l’esprit résonne différemment, elle fait appel à d’autres sens et d’autres ressources, à un entendement subtil, à une intelligence du cœur : cette vie-là est inspirée et illuminée par l’Esprit.
Cela ne veut pas dire qu’à un intellectuel est refusée toute vie spirituelle. Mais à un intellectuel faisant profession d’athéisme est réservée, au mieux, une sagesse.
Plus un être est libre, plus il participe de la vie de l’Esprit. Et plus un être est spiritualisé, plus il manifeste en tout une immense liberté. En ce sens, parler d’un « esprit libre » est une tautologie.
L’esprit en l’être humain se caractérise par la clarté, la liberté et la joie ; il s’avère inattaquable, indestructible, il n’est jamais malade. C’est ainsi qu’à l’Esprit-Saint correspond à l’esprit sain.
Il est des maux de l'être humain (je ne dis pas "maladies") que ni la psychologie ni même la médecine ne peuvent comprendre et soigner, mais dont la philosophie peut rendre compte et que la connaissance de la vie spirituelle est capable d'éclairer, d'apaiser.
L'homme rêve de changement : dans ses relations, dans son travail, dans la société, dans le monde... Il veut transformer son corps, changer de vie. Mais tout cela demeure purement illusoire. C'est encore la manifestation de son moi égocentrique qui tient à perdurer et à se conserver sous d'autres apparences, en d'autres circonstances
Le "moi tyrannique" a deux possibilités pour se maintenir solide : soit ne jamais changer et surtout ne rien changer autour de lui (certitudes et habitudes qu'il appelle fidélité et traditions ) ; soit rêver de changements (superficiels) , imaginer des jours meilleurs, une vie plus belle, un gouvernement idéal, une jeunesse éternelle, une santé sans accrocs.
Un être spirituel se montre peu préoccupé de changement : celui-ci a toujours à voir avec la surface des choses, avec les vêtements de l'âme. Il ne cherche ni à changer le monde, ni à tout garder intact. L'Esprit n'est pas assujetti à la temporalité, il n'est donc pas soumis aux variations et demeure éternel. Immuable, mais cependant immensément fluide et dynamique, il prend mille et une formes, mille et un chemins, des visages divers, pour se manifester à ce monde et lui insuffler la vie. Merveilleusement vif, libre et fulgurant, l'Esprit ne change pas mais il transfigure tout.
Un être spirituel n'a pas pour dessein de changer le monde, mais il désire changer de monde : aller plus loin, plus haut, quitter l'étroite geôle que tous s'emploient à décorer et consolider puisqu'ils la prennent pour leur seule résidence.
Le "moi tyrannique" a deux possibilités pour se maintenir solide : soit ne jamais changer et surtout ne rien changer autour de lui (certitudes et habitudes qu'il appelle fidélité et traditions ) ; soit rêver de changements (superficiels) , imaginer des jours meilleurs, une vie plus belle, un gouvernement idéal, une jeunesse éternelle, une santé sans accrocs.
Un être spirituel se montre peu préoccupé de changement : celui-ci a toujours à voir avec la surface des choses, avec les vêtements de l'âme. Il ne cherche ni à changer le monde, ni à tout garder intact. L'Esprit n'est pas assujetti à la temporalité, il n'est donc pas soumis aux variations et demeure éternel. Immuable, mais cependant immensément fluide et dynamique, il prend mille et une formes, mille et un chemins, des visages divers, pour se manifester à ce monde et lui insuffler la vie. Merveilleusement vif, libre et fulgurant, l'Esprit ne change pas mais il transfigure tout.
Un être spirituel n'a pas pour dessein de changer le monde, mais il désire changer de monde : aller plus loin, plus haut, quitter l'étroite geôle que tous s'emploient à décorer et consolider puisqu'ils la prennent pour leur seule résidence.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jacqueline Kelen (58)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )
Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "
amoureux
positiviste
philosophique
20 questions
861 lecteurs ont répondu
Thèmes :
essai
, essai de société
, essai philosophique
, essai documentCréer un quiz sur ce livre861 lecteurs ont répondu