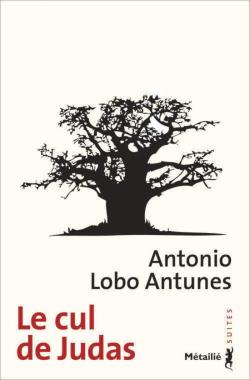>
Critique de HundredDreams
Je découvre depuis peu la littérature portugaise.
Après José Saramago et le titre « L'aveuglement » qui lui a valu le prix Nobel de littérature, j'ai eu envie de lire António Lobo Antunes, l'auteur préféré d'une amie sur Babelio. Je remercie mes ami.es Babelionautes pour cette lecture partagée riche d'échanges constructifs.
*
« le cul de Judas » est une oeuvre poignante qui sonne tellement juste que je suis allée voir lire très succinctement la biographie de l'auteur : j'ai appris que António Lobo Antunes avait suivi des études de médecine avec une spécialisation en psychiatrie avant de débuter une carrière d'écrivain. Dans les années 70, il a été envoyé en Angola en tant que médecin et cette expérience de la guerre lui a servi de base pour plusieurs de ces romans, dont « le cul de Judas » publié en 1979.
Dans un style sombre et douloureux, morcelé et écorché, Antonio Lobo Antunes raconte les souvenirs de la guerre coloniale en Angola du point de vue d'un ancien médecin militaire portugais venu y faire son service militaire entre 1971 et 1973.
Le narrateur rencontre une femme dans un bar à Lisbonne et durant toute la nuit, entre boissons et sexe dénué de sens, il décrit la violence meurtrière dont il a été témoin : la souffrance et l'agonie des blessés, les relations détachées et froides avec les autres soldats, l'abus d'alcool, ses liens avec la population locale, avec les femmes.
« Attendez encore un peu, laissez-moi vous enlacer lentement, sentir le battement de vos veines sur mon ventre, la croissance de la vague de désir qui se répand sur notre peau et qui chante, les jambes qui pédalent sur les draps et qui attendent, anxieuses. Laissez la chambre se peupler des sons ténus des gémissements qui cherchent une bouche pour s'y ancrer. Laissez-moi revenir d'Afrique et me sentir heureux, presque heureux, vous caressant les fesses, le dos, l'intérieur frais et doux des jambes, à la fois tendre et ferme comme un fruit. Laissez-moi oublier en vous regardant bien, ce que je n'arrive pas à oublier : la violence meurtrière sur la terre enceinte de l'Afrique, et prenez-moi dans vous quand du cercle de mes prunelles étonnées, tachées du désir de vous dont je suis fait maintenant, surgiront les orbites concaves de faim des enfants des villages noirs, suspendus aux barbelés, tendant vers vos seins blancs, dans le matin de Lisbonne, leurs boîtes en fer rouillées. »
Dans ce long monologue intérieur de 200 pages, il remonte également dans des souvenirs plus lointains, ceux de son enfance et de sa jeunesse dans la Lisbonne salazariste.
« … il pleuvait, et nous allions mourir, nous allions mourir et il pleuvait, il pleuvait, et assis dans la cabine de la camionnette, à côté du chauffeur, le béret sur les yeux, la vibration d'une cigarette infinie à la main, j'ai commencé mon douloureux apprentissage de l'agonie. »
*
En ouvrant la première page du livre, c'est une phrase immense qui m'a cueillie, un flot de mots qui s'écoule et serpente comme un long fleuve impétueux et puissant. J'ai été emportée par sa force, attirée dans les profondeurs de son lit, ballottée dans ses courants qui s'inversent et bondissent sans cesse entre passé et présent, entre l'Angola et Lisbonne.
Ce roman m'a donné l'impression d'être enfermée dans un huis-clos à ciel ouvert : je me suis sentie oppressée par les souvenirs obsessionnels et traumatisants de son personnage que la guerre a détruits ; par ses états d'âme et sa conscience ; par ses valeurs brisées dans la violence sourde, en suspension ; par l'inquiétude et la solitude ambiantes qui posent leur chape de plomb.
L'atmosphère est lourde, dense, tellement immersive que c'est comme si j'entendais le bruit des armes, le silence révolté des morts ; c'est comme si je sentais les odeurs corporelles, celle des corps en décomposition ; c'est comme si je voyais l'inexprimable misère des Angolais ; c'est comme si je me sentais également prisonnière des barbelés du camp militaire, naufragée de mon histoire, engluée dans l'inquiétude et la monotonie de jours sans fin.
Et en même temps, très étrangement, l'écriture de l'auteur, riche en métaphores et figures de style, saturée de couleurs, d'odeurs et de sonorités, crée une ambiance poétique, onirique presque irréelle. Réalité et fantasmes, poésie et macabre, ombre et lumière, sexe et corps suppliciés se mélangent dans de magnifiques flux de conscience.
Mais malgré la beauté du texte, je garde cette impression de pessimisme, de tristesse, de résignation. Dans ce monde, la réalité est angoissante, vertigineuse, cauchemardesque. Il n'y a pas d'espoir, seulement des désillusions et de l'amertume, seulement une béance, un vide.
Vide de sens. Vide d'amour. Vide de sentiments.
« Là, pendant un an, nous sommes morts, non pas de la mort de la guerre qui nous dépeuple soudain le crâne dans un fracas fulminant et laisse autour de soi un désert désarticulé de gémissements et une confusion de panique et de coups de feu, mais de la lente, angoissante, torturante agonie de l'attente, l'attente des mois, l'attente des mines sur la piste, l'attente du paludisme, l'attente du chaque-fois-plus-improbable retour avec famille et amis à l'aéroport ou sur le quai, l'attente du courrier, l'attente de la jeep de la PIDE qui passait hebdomadairement en allant vers les informateurs de la frontière, et qui transportait trois ou quatre prisonniers qui creusaient leur propre fosse, s'y tassaient, fermaient les yeux avec force, et s'écroulaient après la balle comme un soufflé qui s'affaisse, une fleur rouge de sang ouvrant ses pétales sur leur front… »
*
En effet, le style d'Antonio Lobo Antunes est très original et m'a particulièrement plu. Je dirais même que j'ai eu un coup de coeur pour cette écriture très sensorielle, intimiste, violente, crue qui s'affranchit de la syntaxe et de la ponctuation.
Pourtant, ce récit non linéaire et fragmenté m'a demandé des efforts de concentration et un temps d'adaptation. Mais, comme bien souvent, ce sont les livres complexes qui au final se révèlent les plus beaux. J'ai réussi à trouver un rythme, une musicalité dans cette narration inhabituelle faite de longues phrases libres de la ponctuation, d'images et de personnifications, de sauts dans le temps et dans la pensée.
*
Le titre reprend une expression très familière, voire vulgaire, pour évoquer l'Angola et cette région perdue au milieu de nulle part où le narrateur a vécu pendant vingt-cinq mois.
Il fait aussi référence aux sentiments de cet homme qui s'est senti abandonné, isolé, perdu, trahi.
« J'en avais marre, Sofia, et tout mon corps implorait le calme que l'on ne rencontre que dans les corps sereins des femmes, dans la courbure des épaules des femmes où nous pouvons reposer notre désespoir et notre peur, dans la tendresse sans sarcasme des femmes, dans leur douce générosité, concave comme un berceau pour mon angoisse d'homme, mon angoisse chargée de la haine de l'homme seul, le poids insupportable de ma propre mort sur le dos. »
Ainsi, le roman explore la mémoire à travers les souvenirs indélébiles et traumatisants du narrateur, l'identité et la condition humaine, l'isolement et l'aliénation, l'absurdité de la guerre.
L'auteur exprime sa rancoeur face à l'indifférence des politiciens portugais qui n'ont pas hésité à envoyer à la guerre de jeunes soldats tout juste sortis de l'adolescence et à en faire de la chair à canon.
Mais face à l'homme qu'il est devenu, il ne cache pas non plus sa honte, sa culpabilité, son dénuement. Dans un jeu de miroir, l'homme se met littéralement à nu et montre combien il se sent seul, faible, torturé, lâche, médiocre, soumis, démuni face à l'inhumanité, aux maladies, à l'ennui du quotidien qui tuent autant que les combats.
« … nous promenions sur la piste de sable autour de la caserne nos rêves incommunicables, notre angoisse sans forme, nos passés vus par le petit bout de la lorgnette que sont les lettres et les photos gardées au fond des valises, sous le lit : vestiges préhistoriques, à partir desquels nous pouvions concevoir, tel un biologiste examinant une phalange, le monstrueux squelette de notre amertume. »
*
J'ai été sensible aux nombreuses références artistiques et littéraires, Dali, Chagall, Vermeer, Magritte, Bosch, Matisse, … Les images évoquées par les tableaux servent les propos de l'auteur avec justesse.
« … seriez-vous capable de respirer dans un tableau de Bosch, en suffoquant sous les démons, les lézards, les gnomes nés de coquilles d'oeuf, les orbites gélatineuses et effrayées ? »
*
Pour conclure, « le cul de Judas », par sa structure narrative fragmentée, par son style unique, est une expérience littéraire marquante.
Même si ce roman n'a pas été une lecture facile tant par la forme que par les émotions qu'il véhicule, j'ai aimé l'atmosphère intense et introspective, l'écriture visuelle et sensorielle, poétique et imagée.
Une jolie découverte qui donne envie d'aller plus loin et de découvrir ses autres romans pour y retrouver cette puissance narrative.
Après José Saramago et le titre « L'aveuglement » qui lui a valu le prix Nobel de littérature, j'ai eu envie de lire António Lobo Antunes, l'auteur préféré d'une amie sur Babelio. Je remercie mes ami.es Babelionautes pour cette lecture partagée riche d'échanges constructifs.
*
« le cul de Judas » est une oeuvre poignante qui sonne tellement juste que je suis allée voir lire très succinctement la biographie de l'auteur : j'ai appris que António Lobo Antunes avait suivi des études de médecine avec une spécialisation en psychiatrie avant de débuter une carrière d'écrivain. Dans les années 70, il a été envoyé en Angola en tant que médecin et cette expérience de la guerre lui a servi de base pour plusieurs de ces romans, dont « le cul de Judas » publié en 1979.
Dans un style sombre et douloureux, morcelé et écorché, Antonio Lobo Antunes raconte les souvenirs de la guerre coloniale en Angola du point de vue d'un ancien médecin militaire portugais venu y faire son service militaire entre 1971 et 1973.
Le narrateur rencontre une femme dans un bar à Lisbonne et durant toute la nuit, entre boissons et sexe dénué de sens, il décrit la violence meurtrière dont il a été témoin : la souffrance et l'agonie des blessés, les relations détachées et froides avec les autres soldats, l'abus d'alcool, ses liens avec la population locale, avec les femmes.
« Attendez encore un peu, laissez-moi vous enlacer lentement, sentir le battement de vos veines sur mon ventre, la croissance de la vague de désir qui se répand sur notre peau et qui chante, les jambes qui pédalent sur les draps et qui attendent, anxieuses. Laissez la chambre se peupler des sons ténus des gémissements qui cherchent une bouche pour s'y ancrer. Laissez-moi revenir d'Afrique et me sentir heureux, presque heureux, vous caressant les fesses, le dos, l'intérieur frais et doux des jambes, à la fois tendre et ferme comme un fruit. Laissez-moi oublier en vous regardant bien, ce que je n'arrive pas à oublier : la violence meurtrière sur la terre enceinte de l'Afrique, et prenez-moi dans vous quand du cercle de mes prunelles étonnées, tachées du désir de vous dont je suis fait maintenant, surgiront les orbites concaves de faim des enfants des villages noirs, suspendus aux barbelés, tendant vers vos seins blancs, dans le matin de Lisbonne, leurs boîtes en fer rouillées. »
Dans ce long monologue intérieur de 200 pages, il remonte également dans des souvenirs plus lointains, ceux de son enfance et de sa jeunesse dans la Lisbonne salazariste.
« … il pleuvait, et nous allions mourir, nous allions mourir et il pleuvait, il pleuvait, et assis dans la cabine de la camionnette, à côté du chauffeur, le béret sur les yeux, la vibration d'une cigarette infinie à la main, j'ai commencé mon douloureux apprentissage de l'agonie. »
*
En ouvrant la première page du livre, c'est une phrase immense qui m'a cueillie, un flot de mots qui s'écoule et serpente comme un long fleuve impétueux et puissant. J'ai été emportée par sa force, attirée dans les profondeurs de son lit, ballottée dans ses courants qui s'inversent et bondissent sans cesse entre passé et présent, entre l'Angola et Lisbonne.
Ce roman m'a donné l'impression d'être enfermée dans un huis-clos à ciel ouvert : je me suis sentie oppressée par les souvenirs obsessionnels et traumatisants de son personnage que la guerre a détruits ; par ses états d'âme et sa conscience ; par ses valeurs brisées dans la violence sourde, en suspension ; par l'inquiétude et la solitude ambiantes qui posent leur chape de plomb.
L'atmosphère est lourde, dense, tellement immersive que c'est comme si j'entendais le bruit des armes, le silence révolté des morts ; c'est comme si je sentais les odeurs corporelles, celle des corps en décomposition ; c'est comme si je voyais l'inexprimable misère des Angolais ; c'est comme si je me sentais également prisonnière des barbelés du camp militaire, naufragée de mon histoire, engluée dans l'inquiétude et la monotonie de jours sans fin.
Et en même temps, très étrangement, l'écriture de l'auteur, riche en métaphores et figures de style, saturée de couleurs, d'odeurs et de sonorités, crée une ambiance poétique, onirique presque irréelle. Réalité et fantasmes, poésie et macabre, ombre et lumière, sexe et corps suppliciés se mélangent dans de magnifiques flux de conscience.
Mais malgré la beauté du texte, je garde cette impression de pessimisme, de tristesse, de résignation. Dans ce monde, la réalité est angoissante, vertigineuse, cauchemardesque. Il n'y a pas d'espoir, seulement des désillusions et de l'amertume, seulement une béance, un vide.
Vide de sens. Vide d'amour. Vide de sentiments.
« Là, pendant un an, nous sommes morts, non pas de la mort de la guerre qui nous dépeuple soudain le crâne dans un fracas fulminant et laisse autour de soi un désert désarticulé de gémissements et une confusion de panique et de coups de feu, mais de la lente, angoissante, torturante agonie de l'attente, l'attente des mois, l'attente des mines sur la piste, l'attente du paludisme, l'attente du chaque-fois-plus-improbable retour avec famille et amis à l'aéroport ou sur le quai, l'attente du courrier, l'attente de la jeep de la PIDE qui passait hebdomadairement en allant vers les informateurs de la frontière, et qui transportait trois ou quatre prisonniers qui creusaient leur propre fosse, s'y tassaient, fermaient les yeux avec force, et s'écroulaient après la balle comme un soufflé qui s'affaisse, une fleur rouge de sang ouvrant ses pétales sur leur front… »
*
En effet, le style d'Antonio Lobo Antunes est très original et m'a particulièrement plu. Je dirais même que j'ai eu un coup de coeur pour cette écriture très sensorielle, intimiste, violente, crue qui s'affranchit de la syntaxe et de la ponctuation.
Pourtant, ce récit non linéaire et fragmenté m'a demandé des efforts de concentration et un temps d'adaptation. Mais, comme bien souvent, ce sont les livres complexes qui au final se révèlent les plus beaux. J'ai réussi à trouver un rythme, une musicalité dans cette narration inhabituelle faite de longues phrases libres de la ponctuation, d'images et de personnifications, de sauts dans le temps et dans la pensée.
*
Le titre reprend une expression très familière, voire vulgaire, pour évoquer l'Angola et cette région perdue au milieu de nulle part où le narrateur a vécu pendant vingt-cinq mois.
Il fait aussi référence aux sentiments de cet homme qui s'est senti abandonné, isolé, perdu, trahi.
« J'en avais marre, Sofia, et tout mon corps implorait le calme que l'on ne rencontre que dans les corps sereins des femmes, dans la courbure des épaules des femmes où nous pouvons reposer notre désespoir et notre peur, dans la tendresse sans sarcasme des femmes, dans leur douce générosité, concave comme un berceau pour mon angoisse d'homme, mon angoisse chargée de la haine de l'homme seul, le poids insupportable de ma propre mort sur le dos. »
Ainsi, le roman explore la mémoire à travers les souvenirs indélébiles et traumatisants du narrateur, l'identité et la condition humaine, l'isolement et l'aliénation, l'absurdité de la guerre.
L'auteur exprime sa rancoeur face à l'indifférence des politiciens portugais qui n'ont pas hésité à envoyer à la guerre de jeunes soldats tout juste sortis de l'adolescence et à en faire de la chair à canon.
Mais face à l'homme qu'il est devenu, il ne cache pas non plus sa honte, sa culpabilité, son dénuement. Dans un jeu de miroir, l'homme se met littéralement à nu et montre combien il se sent seul, faible, torturé, lâche, médiocre, soumis, démuni face à l'inhumanité, aux maladies, à l'ennui du quotidien qui tuent autant que les combats.
« … nous promenions sur la piste de sable autour de la caserne nos rêves incommunicables, notre angoisse sans forme, nos passés vus par le petit bout de la lorgnette que sont les lettres et les photos gardées au fond des valises, sous le lit : vestiges préhistoriques, à partir desquels nous pouvions concevoir, tel un biologiste examinant une phalange, le monstrueux squelette de notre amertume. »
*
J'ai été sensible aux nombreuses références artistiques et littéraires, Dali, Chagall, Vermeer, Magritte, Bosch, Matisse, … Les images évoquées par les tableaux servent les propos de l'auteur avec justesse.
« … seriez-vous capable de respirer dans un tableau de Bosch, en suffoquant sous les démons, les lézards, les gnomes nés de coquilles d'oeuf, les orbites gélatineuses et effrayées ? »
*
Pour conclure, « le cul de Judas », par sa structure narrative fragmentée, par son style unique, est une expérience littéraire marquante.
Même si ce roman n'a pas été une lecture facile tant par la forme que par les émotions qu'il véhicule, j'ai aimé l'atmosphère intense et introspective, l'écriture visuelle et sensorielle, poétique et imagée.
Une jolie découverte qui donne envie d'aller plus loin et de découvrir ses autres romans pour y retrouver cette puissance narrative.