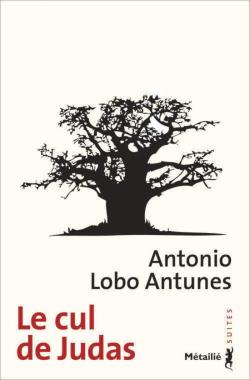Cela faisait longtemps que j'avais envie de découvrir ce livre. Je n'en avais entendu parler qu'en bien ; aussi, mesurerez-vous mieux toute l'étendue de ma déception quand je vous confierai que cette lecture a été un vrai calvaire pour moi. le livre est petit (environ deux cents pages) et pourtant je ne compte plus les fois où j'ai failli le refermer définitivement et à jamais avant d'en avoir atteint la fin.
Il convient, je pense, de préciser que ce que j'exprime ici n'est évidemment que mon avis et ne répond qu'à mes propres critères d'appréciation. Je ne prétends pas qu'ils soient ni fiables ni généralisables. Toutefois, je tiens à distinguer très nettement mes ressentis à propos de la forme et du fond.
Le fond m'a paru extrêmement intéressant et fort : guerre de décolonisation dans un pays d'Afrique au début des années 1970, en l'espèce, l'Angola ; sachant que le pays colonisateur est lui-même un pays dictatorial à l'époque, en l'espèce, le Portugal du non regretté António de Oliveira Salazar (ou tout simplement Salazar) et de son non regretté mais regrettable Estado Novo.
L'auteur fait un portrait féroce, désabusé et violemment anti-dictatorial et anti-colonial. Il dénonce sans ambages la guerre coloniale et le traitement de semi esclavage qui était réservé aux populations angolaises. Il dénonce également l'embrigadement de force de la jeunesse non dorée portugaise dans cette guerre à laquelle les jeunes Portugais ne comprennent pas grand-chose et au nom d'intérêts qui les dépassent. Ils sont amenés à vivre l'enfer et les affres de la boucherie, à se faire exploser sur des mines posées par les rebelles ou tomber sous leurs balles ou encore à crever des suites d'une maladie tropicale bien ragoûtante.
Sur ce plan, ce livre est un modèle du genre, qui se veut probablement, par la vigueur de sa verve et par son ton pessimiste et désabusé, dans la lignée de Voyage Au Bout de la Nuit. Il met aussi le doigt sur le traumatisme et l'inadaptation à la vie normale de ceux qui ont vécu ces années d'atrocités. Sur ce point, le livre m'a rappelé des témoignages que j'ai pu lire ou entendre de vive voix de ceux qui ont vécu le génocide au Rwanda dans la première moitié des années 1990.
Là-dessus, le livre est irréprochable. Il est criant de vérité et il ne fait pas de doute que l'auteur est allé abondamment puiser dans ce qu'il a lui-même vécu en tant que médecin envoyé d'office au front. Mais en ce qui concerne la forme, mes aïeux ! que c'est mal écrit mes pauvres amis ! que c'est pénible et quasi illisible ! Si l'on considère le chemin entre une idée et son expression littéraire comme un fil tendu, alors António Lobo Antunes le tord, l'épaissit, le ramifie, accroche des tas de trucs pelucheux dessus et ça devient un gros boa aux couleurs criardes enroulé au cou de l'idée qu'il prétend véhiculer. Bref, une vraie géhenne pour qui se soucie tant soit peu du style.
Je vais tenter une illustration grammaticale de mon point de vue. Quand vous considérez le nom du groupe sujet, vous lui collez systématiquement à la super glue LOCTITE un adjectif derrière ; ça, à la limite, c'est courant, mais vous lui en adjoignez un aussi devant — question d'équilibre, sans doute ; puis vous n'oubliez surtout pas d'accrocher à cette locomotive ALSTOM un complément du nom, lequel sera également et invariablement lesté d'un ou plusieurs adjectifs qualificatifs. Ensuite vous embrayez deux fois par phrase au moins sur une comparaison avec un quartier de Lisbonne ou un poète portugais du XIXe que vous ne connaissez pas ou des références pléthoriques, inutiles et/ou mal amenées de tableaux de maître, de films muets, de chansons américaines citées in extenso, de sigles propres au régime salazariste ou de noms de maladies longues comme une famille de ténia, et alors, alors seulement, si vous avez de la chance et si l'absence de ponctuation façon Saramago ne vous a pas totalement asphyxié, alors vous risquez de tomber sur le verbe de la phrase. Il faudra ensuite reprendre un peu haleine en haut de l'Alpe d'Huez avant d'aborder le complément d'objet, direct ou indirect, qui vous attend avec quelques dizaines de litres de sauce aux lipides façon HEINZ. (Vous aurez compris que ce paragraphe est une tentative allégée de reconstitution du style de l'auteur.)
En somme, voilà !, c'est ça le style « flamboyant, torrentueux » de Lobo Antunes selon Télérama comme le précise la quatrième de couverture. Moi j'appelle ça juste « mal écrit » et des maladresses d'auteur débutant qu'un éditeur digne de ce nom aurait dû conseiller pour permettre de livrer le véritable potentiel littéraire de cet auteur qui a, je n'en doute pas, de vrais trésors de formule enfouis parmi toute cette poix. Et comme si l'épaisseur de la mélasse n'était pas suffisante, l'auteur utilise un procédé littéraire inutile et lourdingue de pseudo confession à une femme rencontrée dans un bar et qu'il cherche à tout prix à emmener dans son lit.
En fait, j'ai eu l'impression de revivre les affres du Max Havelaar de Multatuli qui lui aussi avait des choses intéressantes et fortes à dire mais qui a utilisé la pire des formes littéraires pour les exprimer. Je ne doute pas, également, que bon nombre des références utilisées par l'auteur perdront leur sens à mesure qu'on avancera dans le temps. (Par exemple, au moment de la sortie du livre, beaucoup de gens connaissaient les chansons de Paul Simon mais je doute que cette référence fasse encore sens longtemps dans de larges portions de la population mondiale. Or, l'auteur nous inflige une page et demie de citation complète et non traduite de ladite chanson ; à mon sens, c'est une faiblesse d'écriture et rien d'autre.)
Donc, j'ai une impression composite à propos de cette oeuvre. Sur le fond, un livre fort et dérangeant qui ne mâche pas ses mots. Sur la forme, un style rococo + + + absolument imbuvable. Si vous aimez l'épure, passez votre chemin. J'imagine que je ne couperai pas aux remarques du genre : « Ouais mais faut le lire en portugais pour pouvoir juger. T'as lu une traduction, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. » etc., etc.
Certes, l'argument vaut ce qu'il vaut ; mais je doute qu'un traducteur, qui plus est en travaillant pour l'éditeur Métailié qui s'est fait une manière de spécialité dans le domaine des auteurs latinos, se permettrait de son propre chef de rendre un style aussi lourd et d'accoler une telle proportion d'adjectifs, sans parler des comparaisons qui n'ont probablement pas été inventées par le traducteur. Je constate également que le portugais est l'une des langues qui se traduit le mieux et le plus fidèlement en français. (Cf. les traductions françaises de Pessoa qui ont obtenu des récompenses portugaises pour leur rendu et leur grande qualité.)
Bref, outre son côté un brin déprimant, à vous de voir si stylistiquement ce livre peut vous convenir. Personnellement, je n'avais lu que des avis positifs et dithyrambiques. J'imagine que, statistiquement, il doit bien y avoir deux ou trois personnes qui ont à peu près la même sensibilité littéraire que moi : elles pourront désormais lire un avis un peu alternatif mais qui, j'en ai bien conscience, ne représente pas grand-chose, un cul de Judas, et encore…
Il convient, je pense, de préciser que ce que j'exprime ici n'est évidemment que mon avis et ne répond qu'à mes propres critères d'appréciation. Je ne prétends pas qu'ils soient ni fiables ni généralisables. Toutefois, je tiens à distinguer très nettement mes ressentis à propos de la forme et du fond.
Le fond m'a paru extrêmement intéressant et fort : guerre de décolonisation dans un pays d'Afrique au début des années 1970, en l'espèce, l'Angola ; sachant que le pays colonisateur est lui-même un pays dictatorial à l'époque, en l'espèce, le Portugal du non regretté António de Oliveira Salazar (ou tout simplement Salazar) et de son non regretté mais regrettable Estado Novo.
L'auteur fait un portrait féroce, désabusé et violemment anti-dictatorial et anti-colonial. Il dénonce sans ambages la guerre coloniale et le traitement de semi esclavage qui était réservé aux populations angolaises. Il dénonce également l'embrigadement de force de la jeunesse non dorée portugaise dans cette guerre à laquelle les jeunes Portugais ne comprennent pas grand-chose et au nom d'intérêts qui les dépassent. Ils sont amenés à vivre l'enfer et les affres de la boucherie, à se faire exploser sur des mines posées par les rebelles ou tomber sous leurs balles ou encore à crever des suites d'une maladie tropicale bien ragoûtante.
Sur ce plan, ce livre est un modèle du genre, qui se veut probablement, par la vigueur de sa verve et par son ton pessimiste et désabusé, dans la lignée de Voyage Au Bout de la Nuit. Il met aussi le doigt sur le traumatisme et l'inadaptation à la vie normale de ceux qui ont vécu ces années d'atrocités. Sur ce point, le livre m'a rappelé des témoignages que j'ai pu lire ou entendre de vive voix de ceux qui ont vécu le génocide au Rwanda dans la première moitié des années 1990.
Là-dessus, le livre est irréprochable. Il est criant de vérité et il ne fait pas de doute que l'auteur est allé abondamment puiser dans ce qu'il a lui-même vécu en tant que médecin envoyé d'office au front. Mais en ce qui concerne la forme, mes aïeux ! que c'est mal écrit mes pauvres amis ! que c'est pénible et quasi illisible ! Si l'on considère le chemin entre une idée et son expression littéraire comme un fil tendu, alors António Lobo Antunes le tord, l'épaissit, le ramifie, accroche des tas de trucs pelucheux dessus et ça devient un gros boa aux couleurs criardes enroulé au cou de l'idée qu'il prétend véhiculer. Bref, une vraie géhenne pour qui se soucie tant soit peu du style.
Je vais tenter une illustration grammaticale de mon point de vue. Quand vous considérez le nom du groupe sujet, vous lui collez systématiquement à la super glue LOCTITE un adjectif derrière ; ça, à la limite, c'est courant, mais vous lui en adjoignez un aussi devant — question d'équilibre, sans doute ; puis vous n'oubliez surtout pas d'accrocher à cette locomotive ALSTOM un complément du nom, lequel sera également et invariablement lesté d'un ou plusieurs adjectifs qualificatifs. Ensuite vous embrayez deux fois par phrase au moins sur une comparaison avec un quartier de Lisbonne ou un poète portugais du XIXe que vous ne connaissez pas ou des références pléthoriques, inutiles et/ou mal amenées de tableaux de maître, de films muets, de chansons américaines citées in extenso, de sigles propres au régime salazariste ou de noms de maladies longues comme une famille de ténia, et alors, alors seulement, si vous avez de la chance et si l'absence de ponctuation façon Saramago ne vous a pas totalement asphyxié, alors vous risquez de tomber sur le verbe de la phrase. Il faudra ensuite reprendre un peu haleine en haut de l'Alpe d'Huez avant d'aborder le complément d'objet, direct ou indirect, qui vous attend avec quelques dizaines de litres de sauce aux lipides façon HEINZ. (Vous aurez compris que ce paragraphe est une tentative allégée de reconstitution du style de l'auteur.)
En somme, voilà !, c'est ça le style « flamboyant, torrentueux » de Lobo Antunes selon Télérama comme le précise la quatrième de couverture. Moi j'appelle ça juste « mal écrit » et des maladresses d'auteur débutant qu'un éditeur digne de ce nom aurait dû conseiller pour permettre de livrer le véritable potentiel littéraire de cet auteur qui a, je n'en doute pas, de vrais trésors de formule enfouis parmi toute cette poix. Et comme si l'épaisseur de la mélasse n'était pas suffisante, l'auteur utilise un procédé littéraire inutile et lourdingue de pseudo confession à une femme rencontrée dans un bar et qu'il cherche à tout prix à emmener dans son lit.
En fait, j'ai eu l'impression de revivre les affres du Max Havelaar de Multatuli qui lui aussi avait des choses intéressantes et fortes à dire mais qui a utilisé la pire des formes littéraires pour les exprimer. Je ne doute pas, également, que bon nombre des références utilisées par l'auteur perdront leur sens à mesure qu'on avancera dans le temps. (Par exemple, au moment de la sortie du livre, beaucoup de gens connaissaient les chansons de Paul Simon mais je doute que cette référence fasse encore sens longtemps dans de larges portions de la population mondiale. Or, l'auteur nous inflige une page et demie de citation complète et non traduite de ladite chanson ; à mon sens, c'est une faiblesse d'écriture et rien d'autre.)
Donc, j'ai une impression composite à propos de cette oeuvre. Sur le fond, un livre fort et dérangeant qui ne mâche pas ses mots. Sur la forme, un style rococo + + + absolument imbuvable. Si vous aimez l'épure, passez votre chemin. J'imagine que je ne couperai pas aux remarques du genre : « Ouais mais faut le lire en portugais pour pouvoir juger. T'as lu une traduction, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. » etc., etc.
Certes, l'argument vaut ce qu'il vaut ; mais je doute qu'un traducteur, qui plus est en travaillant pour l'éditeur Métailié qui s'est fait une manière de spécialité dans le domaine des auteurs latinos, se permettrait de son propre chef de rendre un style aussi lourd et d'accoler une telle proportion d'adjectifs, sans parler des comparaisons qui n'ont probablement pas été inventées par le traducteur. Je constate également que le portugais est l'une des langues qui se traduit le mieux et le plus fidèlement en français. (Cf. les traductions françaises de Pessoa qui ont obtenu des récompenses portugaises pour leur rendu et leur grande qualité.)
Bref, outre son côté un brin déprimant, à vous de voir si stylistiquement ce livre peut vous convenir. Personnellement, je n'avais lu que des avis positifs et dithyrambiques. J'imagine que, statistiquement, il doit bien y avoir deux ou trois personnes qui ont à peu près la même sensibilité littéraire que moi : elles pourront désormais lire un avis un peu alternatif mais qui, j'en ai bien conscience, ne représente pas grand-chose, un cul de Judas, et encore…
« On entre chez António Lobo Antunes comme on rentre en religion ».
Cette lecture commune fut une belle découverte et je remercie ici notre petite communauté de Babelpotes sans laquelle l'auteur serait resté pour moi un illustre inconnu. « le cul de Judas » reste une lecture difficile dans son approche, dans ses mots, dans son histoire. Ce roman dénonce l'enrôlement de l'auteur comme jeune appelé médecin durant le conflit colonial qui opposa jusqu'en 1975 le Portugal du dictateur Salazar aux velléités d'indépendance de l'Angola.
Le style d'Antonio Lobo Antunes est noir et brut de décoffrage. Il nous jette en pleine figure ses deux années de service militaire dans un pays africain aux moeurs et à la culture bien opposés au jeune bourgeois portugais qu'il est, habitué aux douceurs de vie de sa capitale Lisbonne où il vit encore chez ses parents. C'est lors d'une rencontre d'un soir, lors d'une de ses beuveries habituelles, qu'il va s'épancher sur ses souvenirs de guerre. Il le fera en compagnie d'une femme rencontrée dans un bar, de la nuit à l'aube. Ce dialogue deviendra rapidement un monologue de 200 pages débordant de souvenirs sanguinolents, d'une violence exceptionnelle, avec des relents fétides de mort et de corps déchiquetés. Un monologue où il sera à la fois narrateur mais aussi héros malgré lui du drame angolais.
Les images d'horreur se mêlant aux odeurs nauséabondes et répugnantes des combats, le flot des mots nous emporte dans un tourbillon d'épouvante et de cruauté. L'ambiance du récit est lourde de vérité, on entend le cri des blessés, l'explosion des combats, les hurlements des femmes violées. On se trouve plongé au fond de l'enfer. António Lobo Antunes avec sa plume devient comme Jérôme Bosch dans son jugement dernier ou Picasso dans son Guernica avec leurs pinceaux, un artiste engagé dans cette quête qui dénonce la brutalité de la guerre dans toutes ses formes qu'elle soit divine ou humaine. L'auteur fait souvent référence à ces peintres de l'impossible à qui l'on peut ajouter les Chagall, Dali et autres Magritte.
Le Cul de Judas est aussi le parcours initiatique d'un jeune homme qui doit au cours de ses deux années de service militaire en Angola devenir un homme comme le pense l'ensemble de sa famille. du zoo de son enfance symbole de son innocence à son retour à Lisbonne comme vétéran traumatisé d'une guerre qu'il n'a pas voulu et surtout qu'il n'a pas eu le courage de dénoncer, on assiste à une métamorphose ratée. le cri du soldat « Putain, putain et putain » repris ensuite par le narrateur tout au long du roman, montre son impuissance à atteindre cette soi-disant forme de maturité humaine. Ce cinglant échec, on le retrouvera dans toutes les guerres qui ont utilisé des jeunes hommes comme chair à canon et qu'on appellera pudiquement pour les militaires revenants d'une confrontation brutale avec la mort : syndrome de stress post-traumatique.
On ne peut pas terminer avec António Lobo Antunes sans parler de cette musicalité qu'il met dans sa prose. Ce léger bruissement donne du rythme à ses mots et nous permet de supporter le chaos des images causé par son éprouvant témoignage. Cette étrange mélodie pourrait presque nous aider à transformer cette laideur en une certaine beauté mais sans tomber dans une fausse ingénuité. Cette musique n'est là que pour nous aider à supporter ce monologue nocturne sorti du cul de judas.
« le Vietnam est une guerre où l'Homme Blanc envoie l'Homme Noir tuer l'Homme Jaune pour garder la terre qu'il a volé à l'Homme Rouge ! »
Citation de Forrest dans Forrest Gump le film (1994)
Cette lecture commune fut une belle découverte et je remercie ici notre petite communauté de Babelpotes sans laquelle l'auteur serait resté pour moi un illustre inconnu. « le cul de Judas » reste une lecture difficile dans son approche, dans ses mots, dans son histoire. Ce roman dénonce l'enrôlement de l'auteur comme jeune appelé médecin durant le conflit colonial qui opposa jusqu'en 1975 le Portugal du dictateur Salazar aux velléités d'indépendance de l'Angola.
Le style d'Antonio Lobo Antunes est noir et brut de décoffrage. Il nous jette en pleine figure ses deux années de service militaire dans un pays africain aux moeurs et à la culture bien opposés au jeune bourgeois portugais qu'il est, habitué aux douceurs de vie de sa capitale Lisbonne où il vit encore chez ses parents. C'est lors d'une rencontre d'un soir, lors d'une de ses beuveries habituelles, qu'il va s'épancher sur ses souvenirs de guerre. Il le fera en compagnie d'une femme rencontrée dans un bar, de la nuit à l'aube. Ce dialogue deviendra rapidement un monologue de 200 pages débordant de souvenirs sanguinolents, d'une violence exceptionnelle, avec des relents fétides de mort et de corps déchiquetés. Un monologue où il sera à la fois narrateur mais aussi héros malgré lui du drame angolais.
Les images d'horreur se mêlant aux odeurs nauséabondes et répugnantes des combats, le flot des mots nous emporte dans un tourbillon d'épouvante et de cruauté. L'ambiance du récit est lourde de vérité, on entend le cri des blessés, l'explosion des combats, les hurlements des femmes violées. On se trouve plongé au fond de l'enfer. António Lobo Antunes avec sa plume devient comme Jérôme Bosch dans son jugement dernier ou Picasso dans son Guernica avec leurs pinceaux, un artiste engagé dans cette quête qui dénonce la brutalité de la guerre dans toutes ses formes qu'elle soit divine ou humaine. L'auteur fait souvent référence à ces peintres de l'impossible à qui l'on peut ajouter les Chagall, Dali et autres Magritte.
Le Cul de Judas est aussi le parcours initiatique d'un jeune homme qui doit au cours de ses deux années de service militaire en Angola devenir un homme comme le pense l'ensemble de sa famille. du zoo de son enfance symbole de son innocence à son retour à Lisbonne comme vétéran traumatisé d'une guerre qu'il n'a pas voulu et surtout qu'il n'a pas eu le courage de dénoncer, on assiste à une métamorphose ratée. le cri du soldat « Putain, putain et putain » repris ensuite par le narrateur tout au long du roman, montre son impuissance à atteindre cette soi-disant forme de maturité humaine. Ce cinglant échec, on le retrouvera dans toutes les guerres qui ont utilisé des jeunes hommes comme chair à canon et qu'on appellera pudiquement pour les militaires revenants d'une confrontation brutale avec la mort : syndrome de stress post-traumatique.
On ne peut pas terminer avec António Lobo Antunes sans parler de cette musicalité qu'il met dans sa prose. Ce léger bruissement donne du rythme à ses mots et nous permet de supporter le chaos des images causé par son éprouvant témoignage. Cette étrange mélodie pourrait presque nous aider à transformer cette laideur en une certaine beauté mais sans tomber dans une fausse ingénuité. Cette musique n'est là que pour nous aider à supporter ce monologue nocturne sorti du cul de judas.
« le Vietnam est une guerre où l'Homme Blanc envoie l'Homme Noir tuer l'Homme Jaune pour garder la terre qu'il a volé à l'Homme Rouge ! »
Citation de Forrest dans Forrest Gump le film (1994)
Le Cul de Judas eut une portée retentissante à sa sortie en 1979 dans le Portugal post-Salazar. Il raconte en effet avec force le cauchemar que constitua la guerre coloniale (1961-1974) pour le pays. Antonio Lobo Antunes alors tout jeune psychiatre fraîchement marié passa vingt-sept mois de service militaire en Angola comme médecin militaire. Il revint traumatisé dans un pays qui avait entre-temps changé.
le narrateur est dans un bar, ivre d'alcool, de rage et de désespoir. Il raconte à une inconnue le voyage au coeur des ténèbres que fut pour lui son service en Angola. On peut penser à Conrad ou à Céline mais la langue d'Antunes n'a pas d'équivalent et fait toute la puissance du livre. Les phrases sont longues, riches et denses, gorgées d'images saisissantes qui vous embarquent complètement. La réalité crue est transfigurée par une créativité débordante. le ton irrévérencieux, aigre ou cynique traduit sa rage, son mépris et sa solitude.
le roman est un monologue constitué de 23 chapitres intitulés par une lettre de l'alphabet portugais. le narrateur raconte à sa confidente sa guerre de A à Z telle qu'elle lui vient par vagues successives qu'il ressasse. Sa famille confite dans les traditions militaires et le catholicisme ; ses femmes (le mariage à la va vite, la petite fille qui ne le reconnait pas, Sofia une Africaine pleine de vie) ; sa guerre dans toute son horreur vécue comme médecin : les corps torturés, piétinés, amputés, les cadavres amoncelés, les hurlements. Il tourne en dérision les corps vivants déjà morts, celui de sa confidente qui deviendra grosse, le sien futur gros chat châtré. Il parle de ce retour impossible et désespérant dans ce Portugal étroit, figé et poussiéreux qu'il oppose à l'immensité et à la beauté naturelle de l'Angola. le cul de Judas c'est bien sûr le trou pourri dans lequel on l'a jeté mais c'est aussi le cul bien gras de la Mère patrie qui l'a trahi.
Merci Chrystèle de m'avoir fait découvrir Antonio Lobo Antunes.
le narrateur est dans un bar, ivre d'alcool, de rage et de désespoir. Il raconte à une inconnue le voyage au coeur des ténèbres que fut pour lui son service en Angola. On peut penser à Conrad ou à Céline mais la langue d'Antunes n'a pas d'équivalent et fait toute la puissance du livre. Les phrases sont longues, riches et denses, gorgées d'images saisissantes qui vous embarquent complètement. La réalité crue est transfigurée par une créativité débordante. le ton irrévérencieux, aigre ou cynique traduit sa rage, son mépris et sa solitude.
le roman est un monologue constitué de 23 chapitres intitulés par une lettre de l'alphabet portugais. le narrateur raconte à sa confidente sa guerre de A à Z telle qu'elle lui vient par vagues successives qu'il ressasse. Sa famille confite dans les traditions militaires et le catholicisme ; ses femmes (le mariage à la va vite, la petite fille qui ne le reconnait pas, Sofia une Africaine pleine de vie) ; sa guerre dans toute son horreur vécue comme médecin : les corps torturés, piétinés, amputés, les cadavres amoncelés, les hurlements. Il tourne en dérision les corps vivants déjà morts, celui de sa confidente qui deviendra grosse, le sien futur gros chat châtré. Il parle de ce retour impossible et désespérant dans ce Portugal étroit, figé et poussiéreux qu'il oppose à l'immensité et à la beauté naturelle de l'Angola. le cul de Judas c'est bien sûr le trou pourri dans lequel on l'a jeté mais c'est aussi le cul bien gras de la Mère patrie qui l'a trahi.
Merci Chrystèle de m'avoir fait découvrir Antonio Lobo Antunes.
La guerre en fera un homme. C'est sur ces mots qu'un jeune médecin part pout l'Angola.
27 mois plus tard, le voici qui descend d'avion, poignée de main à ses compagnons d'arme, retour à la vie normale, c'est fini. Mais ou est l'interrupteur ? Comment oublier ?
« … j'aurais voulu ne pas être né pour ne pas assister à cela, à l'idiote et colossale de cela… »
La guerre s'est encastrée, incorporée, imbriquée, incrustée en lui.
« … j'ai vu la misère et la méchanceté de la guerre, l'inutilité de la guerre dans les yeux d'oiseaux blessés des militaires, dans leur découragement et leur abandon… »
Les nuits sont longues, alors reste l'alcool, le sexe pour fuir le cortège des horreurs vécues : membres éparpillés, longues agonies des blessés, morts dans les champs, odeurs, maladies, peur, la colère envers ceux qui décident depuis le Portugal.
« … les soldats me croyaient capable de les accompagner et de lutter pour eux, de m'unir à leur haine ingénue contre les seigneurs de Lisbonne qui tiraient contre nous les balles empoisonnées de leurs discours patriotiques… »
Un texte qui vous donne la nausée, un texte lu avec des pauses, je croyais tout savoir de cette guerre mais en fait il n'y a que le narrateur et ses réflexions. Pourtant je l'ai lu pour son auteur Antonio Lobo Antunes dont l'écriture est magnifique : une pépite. Il est l'architecte des phrases longues, des figures de style. Il joue avec les mots s'en sert à des moments inattendus, c'est un cours magistral.
Et pourtant je ne mets que trois étoiles car c'est trop cru, trop noir, trop laid, tout simplement pas pour moi, même si j'y ai trouvé un très beau passage.
« Vous pouvez éteindre la lumière : je n'en ai plus besoin. Quand je pense à Isabelle je cesse d'avoir peur du noir, une clarté ambrée revêt les objets de la sérénité complice des matins de juillet qui me faisaient toujours l'effet de disposer devant moi, avec leur soleil enfantin, les matériaux nécessaires pour construire quelque chose d'ineffablement agréable que je n'arriverai jamais à élucider. »
Antonio Lobo Antunes m'a donné la clef qui m'a permis d'apprécier, de comprendre mon malaise vis-à-vis de cette lecture poursuivie cahin-caha
« Vous, par exemple, vous qui offrez l'aspect aseptisé, compétent et sans pellicules des secrétaires de direction, seriez-vous capables de respirer dans un tableau de Bosch, en suffoquant sous les démons, les lézards, les gnomes nés de coquilles d'oeufs, les orbites gélatineuses et effrayées ? »
27 mois plus tard, le voici qui descend d'avion, poignée de main à ses compagnons d'arme, retour à la vie normale, c'est fini. Mais ou est l'interrupteur ? Comment oublier ?
« … j'aurais voulu ne pas être né pour ne pas assister à cela, à l'idiote et colossale de cela… »
La guerre s'est encastrée, incorporée, imbriquée, incrustée en lui.
« … j'ai vu la misère et la méchanceté de la guerre, l'inutilité de la guerre dans les yeux d'oiseaux blessés des militaires, dans leur découragement et leur abandon… »
Les nuits sont longues, alors reste l'alcool, le sexe pour fuir le cortège des horreurs vécues : membres éparpillés, longues agonies des blessés, morts dans les champs, odeurs, maladies, peur, la colère envers ceux qui décident depuis le Portugal.
« … les soldats me croyaient capable de les accompagner et de lutter pour eux, de m'unir à leur haine ingénue contre les seigneurs de Lisbonne qui tiraient contre nous les balles empoisonnées de leurs discours patriotiques… »
Un texte qui vous donne la nausée, un texte lu avec des pauses, je croyais tout savoir de cette guerre mais en fait il n'y a que le narrateur et ses réflexions. Pourtant je l'ai lu pour son auteur Antonio Lobo Antunes dont l'écriture est magnifique : une pépite. Il est l'architecte des phrases longues, des figures de style. Il joue avec les mots s'en sert à des moments inattendus, c'est un cours magistral.
Et pourtant je ne mets que trois étoiles car c'est trop cru, trop noir, trop laid, tout simplement pas pour moi, même si j'y ai trouvé un très beau passage.
« Vous pouvez éteindre la lumière : je n'en ai plus besoin. Quand je pense à Isabelle je cesse d'avoir peur du noir, une clarté ambrée revêt les objets de la sérénité complice des matins de juillet qui me faisaient toujours l'effet de disposer devant moi, avec leur soleil enfantin, les matériaux nécessaires pour construire quelque chose d'ineffablement agréable que je n'arriverai jamais à élucider. »
Antonio Lobo Antunes m'a donné la clef qui m'a permis d'apprécier, de comprendre mon malaise vis-à-vis de cette lecture poursuivie cahin-caha
« Vous, par exemple, vous qui offrez l'aspect aseptisé, compétent et sans pellicules des secrétaires de direction, seriez-vous capables de respirer dans un tableau de Bosch, en suffoquant sous les démons, les lézards, les gnomes nés de coquilles d'oeufs, les orbites gélatineuses et effrayées ? »
À Lisbonne, une nuit, dans un bar, un homme parle à une femme qui lui était jusqu'alors inconnue... Nous allons suivre ce narrateur omniscient dans les méandres d'un long soliloque nocturne et éthylique.
Le titre en dit déjà long... Sans avoir versé dans les saintes écritures des Évangiles, j'avais déjà une vague idée de ce versant retors de l'humanité, voilà qu'une métaphore anatomique vient préciser l'endroit où veut nous entraîner l'auteur et nous donne ainsi le ton.
Entrer dans le cul de Judas, - pardonnez-moi l'expression imagée, c'est comme entrer dans un tableau de Jérôme Bosch avec les odeurs et les effluves qui viennent jusqu'à vous et vous emportent jusqu'au bout de la nuit.
Cet homme a besoin de parler, c'est comme une catharsis. Évoquer son séjour comme médecin en Angola. Parler de ses souvenirs, c'est comme évoquer un cauchemar horrible et destructeur dont on ne revient jamais indemne. Alors il invite cette femme, son interlocutrice d'un soir, dans un voyage à la fois cru et onirique, dans cette tendresse désespérée de la nuit où nous nous apprêtons à écouter son monologue comme des passagers clandestins.
Il n'est pas besoin d'aller chercher très loin la source qui a inspiré ce livre : António Lobo Antunes a écrit le cul de Judas au cours des années qui ont suivi son retour, en 1973, de la guerre coloniale en Angola. Il y a passé vingt-sept mois, tout comme le narrateur, « vingt-sept mois d'esclavage sanglant », il en est revenu vieilli, cynique, désabusé, peut-être mort aussi, en tous cas naufragé à jamais, revenu d'une Afrique mise à feu et à sang, jeté ce soir sur le rivage de ce bar où l'alcool l'aide à délier cette parole vitale comme on tient debout, survivant parmi les cadavres en putréfaction au milieu d'un charnier.
Est-ce ainsi que les hommes rêvent d'amour, apprivoisent le désir, rencontrent le sexe et les guerres puis en reviennent avec comme seul bagage la folie avant d'être anéantis par la mort ?
Le narrateur évoque l'horreur d'un monde, mais le monde n'est pas laid, ce sont les hommes qui s'en arrangent... À quoi tient la fabrique irrationnelle des dictatures, tandis que certains s'y soumettent de bonne grâce ?
Le cul de Judas, c'est la métamorphose d'un homme dans ce monde à la dérive. Un homme qui fut enfant, qui rêva devant les animaux d'un jardin zoologique de Benfica, peut-être fuyait-il déjà les injonctions de ses tantes lui intimant de devenir un homme, un vrai, grandir, partir là-bas jeté dans la poudrière de l'Angola, découvrir les lépreux, les ventres gonflés de faim des enfants immobiles, entrevoir le silence humide des cases, rêver aux corps d'autres femmes, se saigner les doigts sur des barbelés sanglants, enjamber les membres déchiquetés par les mines, être oublié avec les siens, trahi, se sentir passif, résigné, fautif peut-être...
Tout d'abord c'est une écriture au service d'une sidération, une écriture qui m'a envoûté.
C'est une écriture imbibée d'alcools, jonchée de plaies et de furoncles nauséabonds, qui traverse les nuits putrides et tente de comprendre la cruelle inutilité de la souffrance.
Cette écriture, c'est la langue d'António Lobo Antunes, âpre, baroque, sensuelle. Dans chaque mot j'ai senti le sang battre à mes tempes. J'ai vu des processions de fantômes se lever devant moi, des spectres couverts de gangrènes qui revenaient de ce trou perdu, là-bas, oubliés. J'ai entendu les plaintes des soldats agonisants qui reviennent comme des fantômes. J'ai deviné des ténèbres inhabitées, l'insomnie des morts, la peur et le dégoût, le rire répugnant des défunts qui continuera de poursuivre le narrateur du soir au matin jusque dans ses rêves. J'ai entrevu le désir dans des chambres sordides, des lits comme des naufrages, l'abandon des corps comme un remède fugitif à la douleur inexorable qui ne se refermera jamais...
Cette écriture m'a fait penser à celle de Faulkner, de Giono, de Louis-Ferdinand Céline...
Le cul de Judas, c'est une plongée en apnée.
C'est une écriture qui dit la misère et méchanceté obstinée de la guerre, la révolte qui dénonce les exactions d'un régime colonial, c'est une écriture tordue de douleurs, de résignation mais aussi d'indignation, c'est une écriture qui dit aussi l'impossibilité d'aimer.
J'ai vu cet homme d'un soir accroché au bastingage du comptoir, comme un naufragé bousculé par les tangages de sa mémoire, si incertain d'être encore en vie.
Et puis j'ai vu brusquement cette femme africaine, Sofia, qui se tenait debout devant lui, debout parmi les morts et les survivants, comme un soleil d'Afrique, ultime rêve d'un soir, d'une passion brûlée, anéantie, ensevelie dans les décombres du temps.
Cette écriture, comme un long poème en prose, est autant traversée de rage que de lumières.
Entrer dans le cul de Judas, c'est accepter de se perdre dans l'étrange labyrinthe du passé d'un homme qui n'en est jamais revenu.
J'y ai vu un magnifique plaidoyer contre les guerres, les régimes coloniaux, contre la bêtise humaine qui fabrique les dictatures, mais c'est aussi un hymne à l'amour dans cette Afrique miraculeuse, ardente et sacrifiée.
Le cul de Judas, c'est un cri.
Le titre en dit déjà long... Sans avoir versé dans les saintes écritures des Évangiles, j'avais déjà une vague idée de ce versant retors de l'humanité, voilà qu'une métaphore anatomique vient préciser l'endroit où veut nous entraîner l'auteur et nous donne ainsi le ton.
Entrer dans le cul de Judas, - pardonnez-moi l'expression imagée, c'est comme entrer dans un tableau de Jérôme Bosch avec les odeurs et les effluves qui viennent jusqu'à vous et vous emportent jusqu'au bout de la nuit.
Cet homme a besoin de parler, c'est comme une catharsis. Évoquer son séjour comme médecin en Angola. Parler de ses souvenirs, c'est comme évoquer un cauchemar horrible et destructeur dont on ne revient jamais indemne. Alors il invite cette femme, son interlocutrice d'un soir, dans un voyage à la fois cru et onirique, dans cette tendresse désespérée de la nuit où nous nous apprêtons à écouter son monologue comme des passagers clandestins.
Il n'est pas besoin d'aller chercher très loin la source qui a inspiré ce livre : António Lobo Antunes a écrit le cul de Judas au cours des années qui ont suivi son retour, en 1973, de la guerre coloniale en Angola. Il y a passé vingt-sept mois, tout comme le narrateur, « vingt-sept mois d'esclavage sanglant », il en est revenu vieilli, cynique, désabusé, peut-être mort aussi, en tous cas naufragé à jamais, revenu d'une Afrique mise à feu et à sang, jeté ce soir sur le rivage de ce bar où l'alcool l'aide à délier cette parole vitale comme on tient debout, survivant parmi les cadavres en putréfaction au milieu d'un charnier.
Est-ce ainsi que les hommes rêvent d'amour, apprivoisent le désir, rencontrent le sexe et les guerres puis en reviennent avec comme seul bagage la folie avant d'être anéantis par la mort ?
Le narrateur évoque l'horreur d'un monde, mais le monde n'est pas laid, ce sont les hommes qui s'en arrangent... À quoi tient la fabrique irrationnelle des dictatures, tandis que certains s'y soumettent de bonne grâce ?
Le cul de Judas, c'est la métamorphose d'un homme dans ce monde à la dérive. Un homme qui fut enfant, qui rêva devant les animaux d'un jardin zoologique de Benfica, peut-être fuyait-il déjà les injonctions de ses tantes lui intimant de devenir un homme, un vrai, grandir, partir là-bas jeté dans la poudrière de l'Angola, découvrir les lépreux, les ventres gonflés de faim des enfants immobiles, entrevoir le silence humide des cases, rêver aux corps d'autres femmes, se saigner les doigts sur des barbelés sanglants, enjamber les membres déchiquetés par les mines, être oublié avec les siens, trahi, se sentir passif, résigné, fautif peut-être...
Tout d'abord c'est une écriture au service d'une sidération, une écriture qui m'a envoûté.
C'est une écriture imbibée d'alcools, jonchée de plaies et de furoncles nauséabonds, qui traverse les nuits putrides et tente de comprendre la cruelle inutilité de la souffrance.
Cette écriture, c'est la langue d'António Lobo Antunes, âpre, baroque, sensuelle. Dans chaque mot j'ai senti le sang battre à mes tempes. J'ai vu des processions de fantômes se lever devant moi, des spectres couverts de gangrènes qui revenaient de ce trou perdu, là-bas, oubliés. J'ai entendu les plaintes des soldats agonisants qui reviennent comme des fantômes. J'ai deviné des ténèbres inhabitées, l'insomnie des morts, la peur et le dégoût, le rire répugnant des défunts qui continuera de poursuivre le narrateur du soir au matin jusque dans ses rêves. J'ai entrevu le désir dans des chambres sordides, des lits comme des naufrages, l'abandon des corps comme un remède fugitif à la douleur inexorable qui ne se refermera jamais...
Cette écriture m'a fait penser à celle de Faulkner, de Giono, de Louis-Ferdinand Céline...
Le cul de Judas, c'est une plongée en apnée.
C'est une écriture qui dit la misère et méchanceté obstinée de la guerre, la révolte qui dénonce les exactions d'un régime colonial, c'est une écriture tordue de douleurs, de résignation mais aussi d'indignation, c'est une écriture qui dit aussi l'impossibilité d'aimer.
J'ai vu cet homme d'un soir accroché au bastingage du comptoir, comme un naufragé bousculé par les tangages de sa mémoire, si incertain d'être encore en vie.
Et puis j'ai vu brusquement cette femme africaine, Sofia, qui se tenait debout devant lui, debout parmi les morts et les survivants, comme un soleil d'Afrique, ultime rêve d'un soir, d'une passion brûlée, anéantie, ensevelie dans les décombres du temps.
Cette écriture, comme un long poème en prose, est autant traversée de rage que de lumières.
Entrer dans le cul de Judas, c'est accepter de se perdre dans l'étrange labyrinthe du passé d'un homme qui n'en est jamais revenu.
J'y ai vu un magnifique plaidoyer contre les guerres, les régimes coloniaux, contre la bêtise humaine qui fabrique les dictatures, mais c'est aussi un hymne à l'amour dans cette Afrique miraculeuse, ardente et sacrifiée.
Le cul de Judas, c'est un cri.
Après le pâté en croûte, la tourte aux patates, la tartiflette, la saucisse- aligot, vous reprendrez bien une part de kouign-amann avec une bonne louche de crème fraîche ?
Pour qualifier une telle succession de plats au demeurant goûteux, le premier terme me venant à l'esprit est indigeste.
C'est aussi celui qui s'impose à moi après avoir - très péniblement et laborieusement- avalé la dernière page du livre.
Mon taux de cholesterolitteraire vient d'en prendre un coup, il me faut d'urgence le faire redescendre avec une ordonnance d'une histoire bien ficelée, simple, distanciée et second degré, tel un San Antonio par exemple.
Cet ouvrage est lourdement verbeux, ou plutôt adjectiveux, le challenge devait être d'en placer un minimum de 150 par page, et de caser un maximum d'images comparatives bancales.
Avec ce roman quasi-illisible, l'auteur fait partie de ceux que je qualifie d'écrivain qui aime s'écouter écrire.
En convoquant régulièrement de grands auteurs et pléthore de poètes connus dans leur rue, Lobo Antunes étale bien sa culture et alourdit encore son oeuvre.
Il doit aussi avoir été payé par le syndicat d'initiative de Lisbonne vu les très nombreuses références et descriptions de la ville et des alentours.
Après la forme, le fond.
L'idée de départ est originale, un long monologue de sa vie comme plan drague. Ceci dit les passages des scènes de sexe et les descriptions "littérateuses" des organes en question sont ennuyeuses à souhait.
Sa vie reste marquée par son expérience de jeune médecin envoyé de longs mois au front de la dernière sale guerre coloniale européenne en Angola dans les années 1970.
Lobo Antunes puise dans cette période traumatisante autobiographique des passages descriptifs très réalistes et puissants d'une guerre peu médiatique voire oubliée, ou tout au moins poussée sous le tapis.
Malheureusement le style surchargé et illisible rend le message inaudible.Un peu de sobriété n'aurait pas fait de mal pour appréhender pleinement le fond du roman.
Il semble que l'auteur n'était satisfait d'aucune des traductions française de ses oeuvres. Par respect de son avis je n'achèterai ni ne lirai plus aucune d'elles.
...Rarement été autant déçu d'un livre, survendu au demeurant...
Ce n'est pas parce qu' un roman évoque une expérience guerrière qu'il est forcément intouchable.
Je découvre depuis peu la littérature portugaise.
Après José Saramago et le titre « L'aveuglement » qui lui a valu le prix Nobel de littérature, j'ai eu envie de lire António Lobo Antunes, l'auteur préféré d'une amie sur Babelio. Je remercie mes ami.es Babelionautes pour cette lecture partagée riche d'échanges constructifs.
*
« le cul de Judas » est une oeuvre poignante qui sonne tellement juste que je suis allée voir lire très succinctement la biographie de l'auteur : j'ai appris que António Lobo Antunes avait suivi des études de médecine avec une spécialisation en psychiatrie avant de débuter une carrière d'écrivain. Dans les années 70, il a été envoyé en Angola en tant que médecin et cette expérience de la guerre lui a servi de base pour plusieurs de ces romans, dont « le cul de Judas » publié en 1979.
Dans un style sombre et douloureux, morcelé et écorché, Antonio Lobo Antunes raconte les souvenirs de la guerre coloniale en Angola du point de vue d'un ancien médecin militaire portugais venu y faire son service militaire entre 1971 et 1973.
Le narrateur rencontre une femme dans un bar à Lisbonne et durant toute la nuit, entre boissons et sexe dénué de sens, il décrit la violence meurtrière dont il a été témoin : la souffrance et l'agonie des blessés, les relations détachées et froides avec les autres soldats, l'abus d'alcool, ses liens avec la population locale, avec les femmes.
« Attendez encore un peu, laissez-moi vous enlacer lentement, sentir le battement de vos veines sur mon ventre, la croissance de la vague de désir qui se répand sur notre peau et qui chante, les jambes qui pédalent sur les draps et qui attendent, anxieuses. Laissez la chambre se peupler des sons ténus des gémissements qui cherchent une bouche pour s'y ancrer. Laissez-moi revenir d'Afrique et me sentir heureux, presque heureux, vous caressant les fesses, le dos, l'intérieur frais et doux des jambes, à la fois tendre et ferme comme un fruit. Laissez-moi oublier en vous regardant bien, ce que je n'arrive pas à oublier : la violence meurtrière sur la terre enceinte de l'Afrique, et prenez-moi dans vous quand du cercle de mes prunelles étonnées, tachées du désir de vous dont je suis fait maintenant, surgiront les orbites concaves de faim des enfants des villages noirs, suspendus aux barbelés, tendant vers vos seins blancs, dans le matin de Lisbonne, leurs boîtes en fer rouillées. »
Dans ce long monologue intérieur de 200 pages, il remonte également dans des souvenirs plus lointains, ceux de son enfance et de sa jeunesse dans la Lisbonne salazariste.
« … il pleuvait, et nous allions mourir, nous allions mourir et il pleuvait, il pleuvait, et assis dans la cabine de la camionnette, à côté du chauffeur, le béret sur les yeux, la vibration d'une cigarette infinie à la main, j'ai commencé mon douloureux apprentissage de l'agonie. »
*
En ouvrant la première page du livre, c'est une phrase immense qui m'a cueillie, un flot de mots qui s'écoule et serpente comme un long fleuve impétueux et puissant. J'ai été emportée par sa force, attirée dans les profondeurs de son lit, ballottée dans ses courants qui s'inversent et bondissent sans cesse entre passé et présent, entre l'Angola et Lisbonne.
Ce roman m'a donné l'impression d'être enfermée dans un huis-clos à ciel ouvert : je me suis sentie oppressée par les souvenirs obsessionnels et traumatisants de son personnage que la guerre a détruits ; par ses états d'âme et sa conscience ; par ses valeurs brisées dans la violence sourde, en suspension ; par l'inquiétude et la solitude ambiantes qui posent leur chape de plomb.
L'atmosphère est lourde, dense, tellement immersive que c'est comme si j'entendais le bruit des armes, le silence révolté des morts ; c'est comme si je sentais les odeurs corporelles, celle des corps en décomposition ; c'est comme si je voyais l'inexprimable misère des Angolais ; c'est comme si je me sentais également prisonnière des barbelés du camp militaire, naufragée de mon histoire, engluée dans l'inquiétude et la monotonie de jours sans fin.
Et en même temps, très étrangement, l'écriture de l'auteur, riche en métaphores et figures de style, saturée de couleurs, d'odeurs et de sonorités, crée une ambiance poétique, onirique presque irréelle. Réalité et fantasmes, poésie et macabre, ombre et lumière, sexe et corps suppliciés se mélangent dans de magnifiques flux de conscience.
Mais malgré la beauté du texte, je garde cette impression de pessimisme, de tristesse, de résignation. Dans ce monde, la réalité est angoissante, vertigineuse, cauchemardesque. Il n'y a pas d'espoir, seulement des désillusions et de l'amertume, seulement une béance, un vide.
Vide de sens. Vide d'amour. Vide de sentiments.
« Là, pendant un an, nous sommes morts, non pas de la mort de la guerre qui nous dépeuple soudain le crâne dans un fracas fulminant et laisse autour de soi un désert désarticulé de gémissements et une confusion de panique et de coups de feu, mais de la lente, angoissante, torturante agonie de l'attente, l'attente des mois, l'attente des mines sur la piste, l'attente du paludisme, l'attente du chaque-fois-plus-improbable retour avec famille et amis à l'aéroport ou sur le quai, l'attente du courrier, l'attente de la jeep de la PIDE qui passait hebdomadairement en allant vers les informateurs de la frontière, et qui transportait trois ou quatre prisonniers qui creusaient leur propre fosse, s'y tassaient, fermaient les yeux avec force, et s'écroulaient après la balle comme un soufflé qui s'affaisse, une fleur rouge de sang ouvrant ses pétales sur leur front… »
*
En effet, le style d'Antonio Lobo Antunes est très original et m'a particulièrement plu. Je dirais même que j'ai eu un coup de coeur pour cette écriture très sensorielle, intimiste, violente, crue qui s'affranchit de la syntaxe et de la ponctuation.
Pourtant, ce récit non linéaire et fragmenté m'a demandé des efforts de concentration et un temps d'adaptation. Mais, comme bien souvent, ce sont les livres complexes qui au final se révèlent les plus beaux. J'ai réussi à trouver un rythme, une musicalité dans cette narration inhabituelle faite de longues phrases libres de la ponctuation, d'images et de personnifications, de sauts dans le temps et dans la pensée.
*
Le titre reprend une expression très familière, voire vulgaire, pour évoquer l'Angola et cette région perdue au milieu de nulle part où le narrateur a vécu pendant vingt-cinq mois.
Il fait aussi référence aux sentiments de cet homme qui s'est senti abandonné, isolé, perdu, trahi.
« J'en avais marre, Sofia, et tout mon corps implorait le calme que l'on ne rencontre que dans les corps sereins des femmes, dans la courbure des épaules des femmes où nous pouvons reposer notre désespoir et notre peur, dans la tendresse sans sarcasme des femmes, dans leur douce générosité, concave comme un berceau pour mon angoisse d'homme, mon angoisse chargée de la haine de l'homme seul, le poids insupportable de ma propre mort sur le dos. »
Ainsi, le roman explore la mémoire à travers les souvenirs indélébiles et traumatisants du narrateur, l'identité et la condition humaine, l'isolement et l'aliénation, l'absurdité de la guerre.
L'auteur exprime sa rancoeur face à l'indifférence des politiciens portugais qui n'ont pas hésité à envoyer à la guerre de jeunes soldats tout juste sortis de l'adolescence et à en faire de la chair à canon.
Mais face à l'homme qu'il est devenu, il ne cache pas non plus sa honte, sa culpabilité, son dénuement. Dans un jeu de miroir, l'homme se met littéralement à nu et montre combien il se sent seul, faible, torturé, lâche, médiocre, soumis, démuni face à l'inhumanité, aux maladies, à l'ennui du quotidien qui tuent autant que les combats.
« … nous promenions sur la piste de sable autour de la caserne nos rêves incommunicables, notre angoisse sans forme, nos passés vus par le petit bout de la lorgnette que sont les lettres et les photos gardées au fond des valises, sous le lit : vestiges préhistoriques, à partir desquels nous pouvions concevoir, tel un biologiste examinant une phalange, le monstrueux squelette de notre amertume. »
*
J'ai été sensible aux nombreuses références artistiques et littéraires, Dali, Chagall, Vermeer, Magritte, Bosch, Matisse, … Les images évoquées par les tableaux servent les propos de l'auteur avec justesse.
« … seriez-vous capable de respirer dans un tableau de Bosch, en suffoquant sous les démons, les lézards, les gnomes nés de coquilles d'oeuf, les orbites gélatineuses et effrayées ? »
*
Pour conclure, « le cul de Judas », par sa structure narrative fragmentée, par son style unique, est une expérience littéraire marquante.
Même si ce roman n'a pas été une lecture facile tant par la forme que par les émotions qu'il véhicule, j'ai aimé l'atmosphère intense et introspective, l'écriture visuelle et sensorielle, poétique et imagée.
Une jolie découverte qui donne envie d'aller plus loin et de découvrir ses autres romans pour y retrouver cette puissance narrative.
Après José Saramago et le titre « L'aveuglement » qui lui a valu le prix Nobel de littérature, j'ai eu envie de lire António Lobo Antunes, l'auteur préféré d'une amie sur Babelio. Je remercie mes ami.es Babelionautes pour cette lecture partagée riche d'échanges constructifs.
*
« le cul de Judas » est une oeuvre poignante qui sonne tellement juste que je suis allée voir lire très succinctement la biographie de l'auteur : j'ai appris que António Lobo Antunes avait suivi des études de médecine avec une spécialisation en psychiatrie avant de débuter une carrière d'écrivain. Dans les années 70, il a été envoyé en Angola en tant que médecin et cette expérience de la guerre lui a servi de base pour plusieurs de ces romans, dont « le cul de Judas » publié en 1979.
Dans un style sombre et douloureux, morcelé et écorché, Antonio Lobo Antunes raconte les souvenirs de la guerre coloniale en Angola du point de vue d'un ancien médecin militaire portugais venu y faire son service militaire entre 1971 et 1973.
Le narrateur rencontre une femme dans un bar à Lisbonne et durant toute la nuit, entre boissons et sexe dénué de sens, il décrit la violence meurtrière dont il a été témoin : la souffrance et l'agonie des blessés, les relations détachées et froides avec les autres soldats, l'abus d'alcool, ses liens avec la population locale, avec les femmes.
« Attendez encore un peu, laissez-moi vous enlacer lentement, sentir le battement de vos veines sur mon ventre, la croissance de la vague de désir qui se répand sur notre peau et qui chante, les jambes qui pédalent sur les draps et qui attendent, anxieuses. Laissez la chambre se peupler des sons ténus des gémissements qui cherchent une bouche pour s'y ancrer. Laissez-moi revenir d'Afrique et me sentir heureux, presque heureux, vous caressant les fesses, le dos, l'intérieur frais et doux des jambes, à la fois tendre et ferme comme un fruit. Laissez-moi oublier en vous regardant bien, ce que je n'arrive pas à oublier : la violence meurtrière sur la terre enceinte de l'Afrique, et prenez-moi dans vous quand du cercle de mes prunelles étonnées, tachées du désir de vous dont je suis fait maintenant, surgiront les orbites concaves de faim des enfants des villages noirs, suspendus aux barbelés, tendant vers vos seins blancs, dans le matin de Lisbonne, leurs boîtes en fer rouillées. »
Dans ce long monologue intérieur de 200 pages, il remonte également dans des souvenirs plus lointains, ceux de son enfance et de sa jeunesse dans la Lisbonne salazariste.
« … il pleuvait, et nous allions mourir, nous allions mourir et il pleuvait, il pleuvait, et assis dans la cabine de la camionnette, à côté du chauffeur, le béret sur les yeux, la vibration d'une cigarette infinie à la main, j'ai commencé mon douloureux apprentissage de l'agonie. »
*
En ouvrant la première page du livre, c'est une phrase immense qui m'a cueillie, un flot de mots qui s'écoule et serpente comme un long fleuve impétueux et puissant. J'ai été emportée par sa force, attirée dans les profondeurs de son lit, ballottée dans ses courants qui s'inversent et bondissent sans cesse entre passé et présent, entre l'Angola et Lisbonne.
Ce roman m'a donné l'impression d'être enfermée dans un huis-clos à ciel ouvert : je me suis sentie oppressée par les souvenirs obsessionnels et traumatisants de son personnage que la guerre a détruits ; par ses états d'âme et sa conscience ; par ses valeurs brisées dans la violence sourde, en suspension ; par l'inquiétude et la solitude ambiantes qui posent leur chape de plomb.
L'atmosphère est lourde, dense, tellement immersive que c'est comme si j'entendais le bruit des armes, le silence révolté des morts ; c'est comme si je sentais les odeurs corporelles, celle des corps en décomposition ; c'est comme si je voyais l'inexprimable misère des Angolais ; c'est comme si je me sentais également prisonnière des barbelés du camp militaire, naufragée de mon histoire, engluée dans l'inquiétude et la monotonie de jours sans fin.
Et en même temps, très étrangement, l'écriture de l'auteur, riche en métaphores et figures de style, saturée de couleurs, d'odeurs et de sonorités, crée une ambiance poétique, onirique presque irréelle. Réalité et fantasmes, poésie et macabre, ombre et lumière, sexe et corps suppliciés se mélangent dans de magnifiques flux de conscience.
Mais malgré la beauté du texte, je garde cette impression de pessimisme, de tristesse, de résignation. Dans ce monde, la réalité est angoissante, vertigineuse, cauchemardesque. Il n'y a pas d'espoir, seulement des désillusions et de l'amertume, seulement une béance, un vide.
Vide de sens. Vide d'amour. Vide de sentiments.
« Là, pendant un an, nous sommes morts, non pas de la mort de la guerre qui nous dépeuple soudain le crâne dans un fracas fulminant et laisse autour de soi un désert désarticulé de gémissements et une confusion de panique et de coups de feu, mais de la lente, angoissante, torturante agonie de l'attente, l'attente des mois, l'attente des mines sur la piste, l'attente du paludisme, l'attente du chaque-fois-plus-improbable retour avec famille et amis à l'aéroport ou sur le quai, l'attente du courrier, l'attente de la jeep de la PIDE qui passait hebdomadairement en allant vers les informateurs de la frontière, et qui transportait trois ou quatre prisonniers qui creusaient leur propre fosse, s'y tassaient, fermaient les yeux avec force, et s'écroulaient après la balle comme un soufflé qui s'affaisse, une fleur rouge de sang ouvrant ses pétales sur leur front… »
*
En effet, le style d'Antonio Lobo Antunes est très original et m'a particulièrement plu. Je dirais même que j'ai eu un coup de coeur pour cette écriture très sensorielle, intimiste, violente, crue qui s'affranchit de la syntaxe et de la ponctuation.
Pourtant, ce récit non linéaire et fragmenté m'a demandé des efforts de concentration et un temps d'adaptation. Mais, comme bien souvent, ce sont les livres complexes qui au final se révèlent les plus beaux. J'ai réussi à trouver un rythme, une musicalité dans cette narration inhabituelle faite de longues phrases libres de la ponctuation, d'images et de personnifications, de sauts dans le temps et dans la pensée.
*
Le titre reprend une expression très familière, voire vulgaire, pour évoquer l'Angola et cette région perdue au milieu de nulle part où le narrateur a vécu pendant vingt-cinq mois.
Il fait aussi référence aux sentiments de cet homme qui s'est senti abandonné, isolé, perdu, trahi.
« J'en avais marre, Sofia, et tout mon corps implorait le calme que l'on ne rencontre que dans les corps sereins des femmes, dans la courbure des épaules des femmes où nous pouvons reposer notre désespoir et notre peur, dans la tendresse sans sarcasme des femmes, dans leur douce générosité, concave comme un berceau pour mon angoisse d'homme, mon angoisse chargée de la haine de l'homme seul, le poids insupportable de ma propre mort sur le dos. »
Ainsi, le roman explore la mémoire à travers les souvenirs indélébiles et traumatisants du narrateur, l'identité et la condition humaine, l'isolement et l'aliénation, l'absurdité de la guerre.
L'auteur exprime sa rancoeur face à l'indifférence des politiciens portugais qui n'ont pas hésité à envoyer à la guerre de jeunes soldats tout juste sortis de l'adolescence et à en faire de la chair à canon.
Mais face à l'homme qu'il est devenu, il ne cache pas non plus sa honte, sa culpabilité, son dénuement. Dans un jeu de miroir, l'homme se met littéralement à nu et montre combien il se sent seul, faible, torturé, lâche, médiocre, soumis, démuni face à l'inhumanité, aux maladies, à l'ennui du quotidien qui tuent autant que les combats.
« … nous promenions sur la piste de sable autour de la caserne nos rêves incommunicables, notre angoisse sans forme, nos passés vus par le petit bout de la lorgnette que sont les lettres et les photos gardées au fond des valises, sous le lit : vestiges préhistoriques, à partir desquels nous pouvions concevoir, tel un biologiste examinant une phalange, le monstrueux squelette de notre amertume. »
*
J'ai été sensible aux nombreuses références artistiques et littéraires, Dali, Chagall, Vermeer, Magritte, Bosch, Matisse, … Les images évoquées par les tableaux servent les propos de l'auteur avec justesse.
« … seriez-vous capable de respirer dans un tableau de Bosch, en suffoquant sous les démons, les lézards, les gnomes nés de coquilles d'oeuf, les orbites gélatineuses et effrayées ? »
*
Pour conclure, « le cul de Judas », par sa structure narrative fragmentée, par son style unique, est une expérience littéraire marquante.
Même si ce roman n'a pas été une lecture facile tant par la forme que par les émotions qu'il véhicule, j'ai aimé l'atmosphère intense et introspective, l'écriture visuelle et sensorielle, poétique et imagée.
Une jolie découverte qui donne envie d'aller plus loin et de découvrir ses autres romans pour y retrouver cette puissance narrative.
J'ai d'abord vu ce texte - en fait un long monologue éthylique et halluciné- au théâtre.Quand il est dit par un acteur extraordinaire, un texte paraît toujours extraordinaire. On est donc parfois déçu quand on le lit: ce n'était que cela? la magie du jeu ou de la mise en scène, nous a fait prendre des vessies pour des lanternes. J'ai donc acheté le cul de Judas, et l'ai lu, d'une traite, comme on plonge, sur un coup de tête, d'un rocher très haut, très tourmenté, sans voir s'il y a du fond...ou des récifs...
Plongeon en apnée, plongeon en eau profonde, tourbillon de sensations fortes...j'ai dû palmer très fort pour remonter de ce gouffre-là (oui, je sais, elle est con, ma métaphore, on ne plonge pas avec des palmes, mais vous avez compris! )
Toute l'horreur de la colonisation dans les remugles de l'alcool et du dégoût de soi...
Le Narrateur, ancien médecin aux armées, parle à une inconnue,un soir, dans un bar, et , entre deux bouteilles de whisky, il lui dit son désespoir, son enfer dans ce "cul de Judas", le bourbier angolais où s'est enferrée l'armée coloniale portugaise au début des années 1970.
Il a tenté d'exercer la médecine et d'oublier la femme qu'il a aimée et perdue, se sent rempli de honte devant les peuples misérables auxquels eux, les colons, n'ont apporté que le malheur et la déchéance...
C'est toute la colonisation qui se trouve ici mise en accusation et vomie dans un torrent de paroles pleines de boue et d'injure.
On ne sort pas indemne de cette lecture-là, pas plus qu'on ne sort indemne du spectacle bouleversant qu'en a tiré le comédien François Duval...
Plongeon en apnée, plongeon en eau profonde, tourbillon de sensations fortes...j'ai dû palmer très fort pour remonter de ce gouffre-là (oui, je sais, elle est con, ma métaphore, on ne plonge pas avec des palmes, mais vous avez compris! )
Toute l'horreur de la colonisation dans les remugles de l'alcool et du dégoût de soi...
Le Narrateur, ancien médecin aux armées, parle à une inconnue,un soir, dans un bar, et , entre deux bouteilles de whisky, il lui dit son désespoir, son enfer dans ce "cul de Judas", le bourbier angolais où s'est enferrée l'armée coloniale portugaise au début des années 1970.
Il a tenté d'exercer la médecine et d'oublier la femme qu'il a aimée et perdue, se sent rempli de honte devant les peuples misérables auxquels eux, les colons, n'ont apporté que le malheur et la déchéance...
C'est toute la colonisation qui se trouve ici mise en accusation et vomie dans un torrent de paroles pleines de boue et d'injure.
On ne sort pas indemne de cette lecture-là, pas plus qu'on ne sort indemne du spectacle bouleversant qu'en a tiré le comédien François Duval...
Merci à Nastasia-B et mcd30 de m'avoir fait connaître cet auteur même si nos avis peuvent différer du tout au tout.
Dès la première phrase, les mots, telle une jungle de plantes exotiques, de sombres algues ou de solides lianes, s'élèvent inexorablement depuis le sol narratif pour enlacer nos membres, nos bras, nos mains qui s'accrochent désespérément aux pages du livre, et nous plongent sans remords dans l'atmosphère lourde de la dictature de Salazar, l'étouffante absurdité de la colonisation, dans la sanglante horreur de la répression de cette guerre d'indépendance angolaise.
Avec le jeune et encore naïf narrateur-médecin, nous tâchons, comme de proto-amphibiens qui se débattent pour atteindre la terre ferme et son air purificateur, de survivre à l'absurdité quotidienne de la guerre, nous nous débattons dans le cauchemar de ces bourreaux de l'Afrique et leurs victimes. Tout cela nous est raconté, des années plus tard, par ce même narrateur, rescapé de l'horreur et définitivement blasé, dans un monologue débité à une femme dans un bar en guise de discours de séduction.
Si le narrateur parvient à ses fins dans son effort de charmer, ce ne peut être que métaphore de notre parcours paradoxal, à nous lecteurs, captivés par le style baroque de l'écriture mais honteux de l'implacable horreur de notre passé colonial: nous restons fascinés-prisonniers de la logique absurde de ce récit comme ces animaux du jardin zoologique de Lisbonne évoqués dès la première page.
En effet, cette guerre coloniale ne peut que briser les âmes des jeunes recrues et ne leur laisser que peu de chances de revenir intacts et se bâtir un avenir paisible dans leur pays natal. Tout définitivement, chaque regard, chaque pas, chaque rencontre désormais, pour le narrateur aura cet aspect délabré, cette odeur oxydée, cette atmosphère sclérosée d'un destin brisé.
"J'écouterai à nouveau la fermentation du réfrigérateur qui ronronne de son sommeil de mammouth, les gouttes qui s'échappent du bord des robinets comme les larmes des vieux, lourdes d'une conjonctivite rouillée." nous raconte-t-il en guise de seule évocation du retour à son quotidien occidental.
Lire Lobo Antunes, c'est donc être prêt à affronter un réalisme violent tissé de perles hyper-allégoriques où s'enfilent les comparaisons et les métaphores, toujours plus étourdissantes mais sordides.
"Tout est réel : je passe ma main sur mon visage et le papier de verre de ma barbe me hérisse la peau, la vessie pleine enfle mon ventre de son liquide tiède, lourde comme foetus rond qui gémit."
Qui comparerait sa vessie à un foetus ? Quel autre écrivain ose user d'un tel réalisme pourtant si imagé ? Qui intitulerait son roman le Cul de Judas? Dites-le moi!
Comme ces colonnes de style manuélin du couvent des hiéronymes, les somptueuses phrases en volutes de Lobo Antunes nous enracinent dans cette terre féconde de brutalité pour enfin, plus que tout, nous inspirer la plus noble des empathies pour ceux des humains broyés par l'histoire, la guerre, l'impardonnable torture mentale et physique du fascisme et du pouvoir aveugle en général.
À la fin du récit, nous lecteurs, tout autant perturbés sinon brisés que le narrateur par son récit de guerre, nous ne levons plus les yeux sur notre quotidien, ne portons plus le même regard sur notre histoire mais tentons désormais de nous éveiller d'une parole qui plus que la vérité crue a su nous bouleverser.
Adieu ces souvenirs de Lisboa, adieu ces paysages du Douro. Adieu aussi ma nostalgie de la Belgique de mon enfance, tout cela repose sur un terreau de cruauté et de violence !
Dès la première phrase, les mots, telle une jungle de plantes exotiques, de sombres algues ou de solides lianes, s'élèvent inexorablement depuis le sol narratif pour enlacer nos membres, nos bras, nos mains qui s'accrochent désespérément aux pages du livre, et nous plongent sans remords dans l'atmosphère lourde de la dictature de Salazar, l'étouffante absurdité de la colonisation, dans la sanglante horreur de la répression de cette guerre d'indépendance angolaise.
Avec le jeune et encore naïf narrateur-médecin, nous tâchons, comme de proto-amphibiens qui se débattent pour atteindre la terre ferme et son air purificateur, de survivre à l'absurdité quotidienne de la guerre, nous nous débattons dans le cauchemar de ces bourreaux de l'Afrique et leurs victimes. Tout cela nous est raconté, des années plus tard, par ce même narrateur, rescapé de l'horreur et définitivement blasé, dans un monologue débité à une femme dans un bar en guise de discours de séduction.
Si le narrateur parvient à ses fins dans son effort de charmer, ce ne peut être que métaphore de notre parcours paradoxal, à nous lecteurs, captivés par le style baroque de l'écriture mais honteux de l'implacable horreur de notre passé colonial: nous restons fascinés-prisonniers de la logique absurde de ce récit comme ces animaux du jardin zoologique de Lisbonne évoqués dès la première page.
En effet, cette guerre coloniale ne peut que briser les âmes des jeunes recrues et ne leur laisser que peu de chances de revenir intacts et se bâtir un avenir paisible dans leur pays natal. Tout définitivement, chaque regard, chaque pas, chaque rencontre désormais, pour le narrateur aura cet aspect délabré, cette odeur oxydée, cette atmosphère sclérosée d'un destin brisé.
"J'écouterai à nouveau la fermentation du réfrigérateur qui ronronne de son sommeil de mammouth, les gouttes qui s'échappent du bord des robinets comme les larmes des vieux, lourdes d'une conjonctivite rouillée." nous raconte-t-il en guise de seule évocation du retour à son quotidien occidental.
Lire Lobo Antunes, c'est donc être prêt à affronter un réalisme violent tissé de perles hyper-allégoriques où s'enfilent les comparaisons et les métaphores, toujours plus étourdissantes mais sordides.
"Tout est réel : je passe ma main sur mon visage et le papier de verre de ma barbe me hérisse la peau, la vessie pleine enfle mon ventre de son liquide tiède, lourde comme foetus rond qui gémit."
Qui comparerait sa vessie à un foetus ? Quel autre écrivain ose user d'un tel réalisme pourtant si imagé ? Qui intitulerait son roman le Cul de Judas? Dites-le moi!
Comme ces colonnes de style manuélin du couvent des hiéronymes, les somptueuses phrases en volutes de Lobo Antunes nous enracinent dans cette terre féconde de brutalité pour enfin, plus que tout, nous inspirer la plus noble des empathies pour ceux des humains broyés par l'histoire, la guerre, l'impardonnable torture mentale et physique du fascisme et du pouvoir aveugle en général.
À la fin du récit, nous lecteurs, tout autant perturbés sinon brisés que le narrateur par son récit de guerre, nous ne levons plus les yeux sur notre quotidien, ne portons plus le même regard sur notre histoire mais tentons désormais de nous éveiller d'une parole qui plus que la vérité crue a su nous bouleverser.
Adieu ces souvenirs de Lisboa, adieu ces paysages du Douro. Adieu aussi ma nostalgie de la Belgique de mon enfance, tout cela repose sur un terreau de cruauté et de violence !
Lors d'une rencontre (plusieurs rencontres ?) avec une femme (plusieurs femmes ?) devant un verre (plusieurs !) à Lisbonne, le narrateur raconte ses années en Angola comme médecin militaire, pendant la guerre d'indépendance.
Le titre vous a déjà renseigné : il fait très sombre dans ce roman.
Pas au début : le narrateur est alors jeune, avec une certaine candeur, une certaine innocence il se remémore la Lisbonne de son enfance, ou bien le salon de ses tantes plein de bibelots et de napperons crochetés.
Mais au retour, finie l'innocence. Ce qu'il rapporte de la guerre, c'est une lucidité désespérée, "la lucidité sans illusions des ivrognes d'Hemingway qui sont passés, gorgée par gorgée, de l'autre côté de l'angoisse."
Lucidité face à l'inanité de cette guerre, de ces morts "au nom d'idéaux cyniques auxquels personne ne croit, un bataillon ravagé d'avoir défendu l'argent des trois ou quatre familles qui soutiennent le régime."
Son impuissance de médecin à sauver des vies. Sa honte, sa culpabilité. Et puis l'impossibilité de retrouver sa place dans le monde, le vieillissement, la solitude.
Et puis il y a l'écriture.
L'écriture de Lobo Antunes !
Vous savez, ces phrases sur lesquelles on tombe, parfois, si belles qu'on a aussitôt envie de les mettre en citation ? Dans ce roman, c'est chaque phrase qui déclenche ce sentiment ; chaque phrase, chacune d'entre elles.
Ces images saisissantes : "...des édifices de cent étages que les ascenseurs, comme des pommes d'Adam, parcourent continuellement de bas en haut en déglutitions incessantes."
Ce "délire contrôlé", évoquant un Claude Simon qui serait atteint de stress post-traumatique.
C'est seulement son deuxième roman, le délire est encore contrôlé, pas aussi halluciné que dans les romans plus tardifs ; il utilise encore la ponctuation, même.
(La première fois que j'avais lu Lobo Antunes, je m'étais dit, je m'en souviens, "ça devrait être interdit d'écrire comme ça !" Et j'en avais aussitôt, fascinée, lu un autre.)
La traduction de Pierre Léglise-Costa est très bien malgré quelques fautes d'orthographe.
Et merci à tou·tes les participant·es de cette si belle lecture commune.
Challenge gourmand (Baba au rhum : le personnage principal a un problème avec l'alcool)
Le titre vous a déjà renseigné : il fait très sombre dans ce roman.
Pas au début : le narrateur est alors jeune, avec une certaine candeur, une certaine innocence il se remémore la Lisbonne de son enfance, ou bien le salon de ses tantes plein de bibelots et de napperons crochetés.
Mais au retour, finie l'innocence. Ce qu'il rapporte de la guerre, c'est une lucidité désespérée, "la lucidité sans illusions des ivrognes d'Hemingway qui sont passés, gorgée par gorgée, de l'autre côté de l'angoisse."
Lucidité face à l'inanité de cette guerre, de ces morts "au nom d'idéaux cyniques auxquels personne ne croit, un bataillon ravagé d'avoir défendu l'argent des trois ou quatre familles qui soutiennent le régime."
Son impuissance de médecin à sauver des vies. Sa honte, sa culpabilité. Et puis l'impossibilité de retrouver sa place dans le monde, le vieillissement, la solitude.
Et puis il y a l'écriture.
L'écriture de Lobo Antunes !
Vous savez, ces phrases sur lesquelles on tombe, parfois, si belles qu'on a aussitôt envie de les mettre en citation ? Dans ce roman, c'est chaque phrase qui déclenche ce sentiment ; chaque phrase, chacune d'entre elles.
Ces images saisissantes : "...des édifices de cent étages que les ascenseurs, comme des pommes d'Adam, parcourent continuellement de bas en haut en déglutitions incessantes."
Ce "délire contrôlé", évoquant un Claude Simon qui serait atteint de stress post-traumatique.
C'est seulement son deuxième roman, le délire est encore contrôlé, pas aussi halluciné que dans les romans plus tardifs ; il utilise encore la ponctuation, même.
(La première fois que j'avais lu Lobo Antunes, je m'étais dit, je m'en souviens, "ça devrait être interdit d'écrire comme ça !" Et j'en avais aussitôt, fascinée, lu un autre.)
La traduction de Pierre Léglise-Costa est très bien malgré quelques fautes d'orthographe.
Et merci à tou·tes les participant·es de cette si belle lecture commune.
Challenge gourmand (Baba au rhum : le personnage principal a un problème avec l'alcool)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Antonio Lobo Antunes (33)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Titres d'oeuvres célèbres à compléter
Ce conte philosophique de Voltaire, paru à Genève en 1759, s'intitule : "Candide ou --------"
L'Ardeur
L'Optimisme
10 questions
1294 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature française
, roman
, culture générale
, théâtre
, littérature
, livresCréer un quiz sur ce livre1294 lecteurs ont répondu