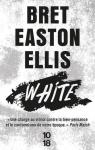Léon de Montesquiou/5
1 notes
Résumé :
Après Les raisons du nationalisme, voici un autre texte fondamental de Léon de Montesquiou. Fidèle à sa méthode habituelle de travail, il a lu et décortiqué l’œuvre du philosophe contre-révolutionnaire Louis de Bonald pour en faire un exposé pédagogique qui permet au lecteur d’entrer dans l’immense édifice de la pensée traditionnaliste. Les grands thèmes de la tradition, de la famille, de l’autorité, de la noblesse, de l’individu, etc. y sont abordés à la lumière de... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Louis-Ambroise de Bonald, bien peu connu ; Léon de Montesquiou, aussi peu. Ainsi aura-t-il fallu attendre que la Délégation des siècles choisisse de faire remonter « le réalisme de Bonald » des profondeurs historiques des derniers siècles pour que d'un coup, nous redécouvrions à la fois Bonald et à la fois Montesquiou. le premier a abondamment publié des textes complexes témoignant d'une pensée foisonnante et peu aisée à ordonnancer selon les propos mêmes De Montesquiou, le second, qui se dévoua pour présenter la substantifique moelle de l'oeuvre de Bonald dans un ouvrage rompu en sept grands chapitres thématiques. « Et le travail [...] que je veux tenter, c'est d'extraire, encadrer, faire ressortir un certain nombre des belles pages de Bonald, qui se trouvent perdues dans des livres où il est probable que peu iront les chercher. » Montesquiou cherchera à révéler, derrière le langage souvent métaphysicien de Bonald, le réalisme qui sous-tend sa conception du politique et à travers lequel s'établit la conformité de la religion chrétienne à la raison.
Les pages de Bonald, comme celles De Montesquiou, s'établissent contre les principes révolutionnaires dont ils pressentent déjà la force dissolvante. La Révolution française, écrivait d'ailleurs Bonald, est « un appel fait à toutes les passions par toutes les erreurs ».
Contre l'individualisme, qui finit par laisser l'homme seul face à un État de plus en plus totalitaire, ramifié en des branches sans cesse plus fines qui s'insinuent en toutes les sinuosités de la vie privée – contre l'individualisme qui est au politique ce que le protestantisme est au religieux – contre l'individualisme, donc, qui ressuscitera pendant des siècles et des siècles sous les formes variées du « libre-examen », Bonald rappelle tout ce que l'établissement d'un homme dans son être doit à la société, en quoi il ne peut que nourrir un fantasme d'indépendance et d'autonomie mais ne jamais l'être, en quoi il ne croit choisir les règles qu'il pense vouloir qu'à condition de se méprendre sur les raisons qui le meuvent vraiment.
Contre le républicanisme, qui joue de la confusion entre liberté et libre-arbitre pour dissoudre toute constitution hiérarchisante et donc structurante de la société, Bonald explique que la liberté ne peut se déployer que dans l'obéissance consentie et reconnaissante aux lois naturelles et nécessaires tandis que le libre-arbitre n'est qu'une liberté restreinte à la possibilité de choisir entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre le vrai et l'erreur, celle-ci s'opposant à la conservation de l'être.
Contre les caprices de l'humeur passionnelle, favorisés par les principes révolutionnaires comme adjudant à la dissolution des structures fondamentales de la société – ici la famille –, autrement dit contre le divorce qui traduit la profonde méconnaissance de lui-même dans laquelle l'homme a chu, puisque le divorce l'encourage à s'éprendre des illusions qui deviendront les nouvelles chaînes du lendemain, Bonald rappelle les vertus du mariage qui apprennent à l'homme que la paix conjugale s'obtient par la sagesse de la conduite et la modération des humeurs, et que l'intégration des malheurs parfois insurmontables du lien conjugal s'obtient par la juste abnégation du soi mis au service d'une oeuvre supérieure.
Contre la démocratie qui joue de la confusion entre liberté et libre-arbitre, qui confond vouloir et désirer, et qui pense toujours vouloir ce qu'elle désire et désirer ce qu'elle veut, ne comprenant qu'après-coup son erreur en étudiant les conséquences désastreuses qui se déploient à partir de sa désinvolture – contre la démocratie qui ne témoigne que du laxisme gouvernemental, les dirigeants républicains se gardant bien de concevoir des principes de gouvernement justes, puisqu'ils pourront toujours accuser le peuple d'avoir voulu n'importe quoi si les choses vont mal, Bonald rappelle les vertus d'un pouvoir absolu qui s'exercerait indépendamment de ses sujets, selon des principes et des préceptes qui ne concernent pas l'immédiat de la jouissance des biens, mais qui assurent la continuité d'une civilisation des temps anciens aux temps futurs.
Contre l'égalitarisme qui rompt également le lien de continuité d'une génération à l'autre en dilapidant le fruit des efforts des aïeux par la répartition proportionnelle entre les descendants, et par la taxation, Bonald rappelle, puisque nous l'avons oublié, que la noblesse n'était pas qu'une classe de prélats s'amusant au jet-ski l'été mais qu'elle était constituée de personnes appartenant à une famille sociale, redevables envers celle-ci, et chargées moins de droits que de devoirs. Les avantages associés à la noblesse n'étaient alors, dans la société consciente de la portée de ses actes, que des moyens accordés pour l'accomplissement des devoirs, et non pas une rétribution de jouissance pour un statut imaginaire.
Enfin, contre la primauté donnée à l'instruction selon les principes seuls de la raison, animée par l'esprit de doute et la volonté de s'émanciper des autorités, Bonald réhabilite l'éducation, soit l'apprentissage des préceptes du coeur, rappelant que toute méthodologie, même scientifique, ne s'établit jamais sur autre chose qu'une croyance, et donc sur une confiance en une autorité, serait-elle invisible, serait-elle dite « objective ». Éducation qui, pour s'accomplir, pour trouver sa place, devrait idéalement trouver son répondant en les valeurs d'une société exemplaire et dotée de consistance référentielle. Une telle société n'existe cependant plus, après la Révolution, et les meilleurs principes éducatifs, ceux-là mêmes qui se trouvent dans ce livre, par exemple, pourraient-ils être massivement répandus qu'ils ne trouveraient que peu de répondant puisque la société propose à ses actuels sujets le fantasme d'une auto-institution émancipée de l'allégeance à toute autorité. Abandonnant leurs devoirs pour jouir uniquement de leurs privilèges, les dirigeants républicains se reposent sur le pouvoir du démos : peuple, nous vous laissons choisir, mais choisissez mal, s'il vous plaît. Peuple, nous ne te jugeons pas, mais jugez-vous les uns les autres, amen. « [...] partout où la petite morale tue la grande, et où les gouvernements, par de fausses idées d'humanité, abjurent le pouvoir qu'ils tiennent de Dieu même, et le devoir qu'il leur prescrit, de réprimer et de punir, il arrive infailliblement que la grande morale tue la petite, et que le particulier se ressaisit du droit de se rendre à lui-même la justice que le gouvernement lui refuse. »
Léon de Montesquiou ne cache pas ses intentions : « Tout ce que j'ai exposé de Bonald vise un but pratique : restaurer dans les esprits les institutions monarchiques qui ont fait la grandeur de la France et dont dépend sa grandeur dans l'avenir. » Mais ce but pratique lutte contre une force d'inertie extrême : celle de la société instituée par le régime républicain. Bientôt, les seules armes de la rhétorique et de la raison alliée au principe cordial ne suffiront plus. Ainsi, et enfin, contre la non-violence hallucinatoire gandhique et contre la dictature de la tolérance à tous les égarements, Léon de Montesquiou, anachroniquement, réenchante les valeurs de la violence : « [...] toute violence qui vise à détruire le régime républicain et à le remplacer par la monarchie est douceur, par tous les maux qu'elle tend à éviter ; toute douceur, qui consolide ce régime destructeur est violence, par tous les maux qu'elle prépare. »
Après des siècles de républicanisme, il serait évidemment impossible de rétablir une monarchie digne de ce nom. Mais Bonald et Montesquiou n'imaginaient sans doute pas que le républicanisme durerait aussi longtemps. Aussi nous réjouissons-nous, une fois de plus, de ce que l'homme est mortel, et ne puisse contempler les ravages de l'avenir. Ainsi en soit-il, pour nous aussi.
Les pages de Bonald, comme celles De Montesquiou, s'établissent contre les principes révolutionnaires dont ils pressentent déjà la force dissolvante. La Révolution française, écrivait d'ailleurs Bonald, est « un appel fait à toutes les passions par toutes les erreurs ».
Contre l'individualisme, qui finit par laisser l'homme seul face à un État de plus en plus totalitaire, ramifié en des branches sans cesse plus fines qui s'insinuent en toutes les sinuosités de la vie privée – contre l'individualisme qui est au politique ce que le protestantisme est au religieux – contre l'individualisme, donc, qui ressuscitera pendant des siècles et des siècles sous les formes variées du « libre-examen », Bonald rappelle tout ce que l'établissement d'un homme dans son être doit à la société, en quoi il ne peut que nourrir un fantasme d'indépendance et d'autonomie mais ne jamais l'être, en quoi il ne croit choisir les règles qu'il pense vouloir qu'à condition de se méprendre sur les raisons qui le meuvent vraiment.
Contre le républicanisme, qui joue de la confusion entre liberté et libre-arbitre pour dissoudre toute constitution hiérarchisante et donc structurante de la société, Bonald explique que la liberté ne peut se déployer que dans l'obéissance consentie et reconnaissante aux lois naturelles et nécessaires tandis que le libre-arbitre n'est qu'une liberté restreinte à la possibilité de choisir entre le bien et le mal, c'est-à-dire entre le vrai et l'erreur, celle-ci s'opposant à la conservation de l'être.
Contre les caprices de l'humeur passionnelle, favorisés par les principes révolutionnaires comme adjudant à la dissolution des structures fondamentales de la société – ici la famille –, autrement dit contre le divorce qui traduit la profonde méconnaissance de lui-même dans laquelle l'homme a chu, puisque le divorce l'encourage à s'éprendre des illusions qui deviendront les nouvelles chaînes du lendemain, Bonald rappelle les vertus du mariage qui apprennent à l'homme que la paix conjugale s'obtient par la sagesse de la conduite et la modération des humeurs, et que l'intégration des malheurs parfois insurmontables du lien conjugal s'obtient par la juste abnégation du soi mis au service d'une oeuvre supérieure.
Contre la démocratie qui joue de la confusion entre liberté et libre-arbitre, qui confond vouloir et désirer, et qui pense toujours vouloir ce qu'elle désire et désirer ce qu'elle veut, ne comprenant qu'après-coup son erreur en étudiant les conséquences désastreuses qui se déploient à partir de sa désinvolture – contre la démocratie qui ne témoigne que du laxisme gouvernemental, les dirigeants républicains se gardant bien de concevoir des principes de gouvernement justes, puisqu'ils pourront toujours accuser le peuple d'avoir voulu n'importe quoi si les choses vont mal, Bonald rappelle les vertus d'un pouvoir absolu qui s'exercerait indépendamment de ses sujets, selon des principes et des préceptes qui ne concernent pas l'immédiat de la jouissance des biens, mais qui assurent la continuité d'une civilisation des temps anciens aux temps futurs.
Contre l'égalitarisme qui rompt également le lien de continuité d'une génération à l'autre en dilapidant le fruit des efforts des aïeux par la répartition proportionnelle entre les descendants, et par la taxation, Bonald rappelle, puisque nous l'avons oublié, que la noblesse n'était pas qu'une classe de prélats s'amusant au jet-ski l'été mais qu'elle était constituée de personnes appartenant à une famille sociale, redevables envers celle-ci, et chargées moins de droits que de devoirs. Les avantages associés à la noblesse n'étaient alors, dans la société consciente de la portée de ses actes, que des moyens accordés pour l'accomplissement des devoirs, et non pas une rétribution de jouissance pour un statut imaginaire.
Enfin, contre la primauté donnée à l'instruction selon les principes seuls de la raison, animée par l'esprit de doute et la volonté de s'émanciper des autorités, Bonald réhabilite l'éducation, soit l'apprentissage des préceptes du coeur, rappelant que toute méthodologie, même scientifique, ne s'établit jamais sur autre chose qu'une croyance, et donc sur une confiance en une autorité, serait-elle invisible, serait-elle dite « objective ». Éducation qui, pour s'accomplir, pour trouver sa place, devrait idéalement trouver son répondant en les valeurs d'une société exemplaire et dotée de consistance référentielle. Une telle société n'existe cependant plus, après la Révolution, et les meilleurs principes éducatifs, ceux-là mêmes qui se trouvent dans ce livre, par exemple, pourraient-ils être massivement répandus qu'ils ne trouveraient que peu de répondant puisque la société propose à ses actuels sujets le fantasme d'une auto-institution émancipée de l'allégeance à toute autorité. Abandonnant leurs devoirs pour jouir uniquement de leurs privilèges, les dirigeants républicains se reposent sur le pouvoir du démos : peuple, nous vous laissons choisir, mais choisissez mal, s'il vous plaît. Peuple, nous ne te jugeons pas, mais jugez-vous les uns les autres, amen. « [...] partout où la petite morale tue la grande, et où les gouvernements, par de fausses idées d'humanité, abjurent le pouvoir qu'ils tiennent de Dieu même, et le devoir qu'il leur prescrit, de réprimer et de punir, il arrive infailliblement que la grande morale tue la petite, et que le particulier se ressaisit du droit de se rendre à lui-même la justice que le gouvernement lui refuse. »
Léon de Montesquiou ne cache pas ses intentions : « Tout ce que j'ai exposé de Bonald vise un but pratique : restaurer dans les esprits les institutions monarchiques qui ont fait la grandeur de la France et dont dépend sa grandeur dans l'avenir. » Mais ce but pratique lutte contre une force d'inertie extrême : celle de la société instituée par le régime républicain. Bientôt, les seules armes de la rhétorique et de la raison alliée au principe cordial ne suffiront plus. Ainsi, et enfin, contre la non-violence hallucinatoire gandhique et contre la dictature de la tolérance à tous les égarements, Léon de Montesquiou, anachroniquement, réenchante les valeurs de la violence : « [...] toute violence qui vise à détruire le régime républicain et à le remplacer par la monarchie est douceur, par tous les maux qu'elle tend à éviter ; toute douceur, qui consolide ce régime destructeur est violence, par tous les maux qu'elle prépare. »
Après des siècles de républicanisme, il serait évidemment impossible de rétablir une monarchie digne de ce nom. Mais Bonald et Montesquiou n'imaginaient sans doute pas que le républicanisme durerait aussi longtemps. Aussi nous réjouissons-nous, une fois de plus, de ce que l'homme est mortel, et ne puisse contempler les ravages de l'avenir. Ainsi en soit-il, pour nous aussi.
Citations et extraits (21)
Voir plus
Ajouter une citation
« Les lois sont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des êtres. » [Montesquieu]
Il y a, dans cette définition adoptée par Bonald, un mot, le mot nature que l’on retrouve souvent dans le vocabulaire révolutionnaire, et notamment chez Rousseau. Mais ce mot a chez Rousseau et chez Bonald des acceptions absolument différentes, et même contradictoires.
[...] J.-J. Rousseau, « le romancier de l’état sauvage, le détracteur de l’état civilisé », écrit Bonald, « place l’état naturel de l’homme individu ou social, dans l’état natif ou imparfait. De là sa prédilection affectée pour les enfants, au moins pour ceux d’autrui, et son admiration insensée pour l’état sauvage. »
Pour Bonald, au contraire, l’état naturel est opposé à l’état natif ou imparfait, l’état naturel est l’état parfait, et l’état parfait est l’état de société.
Il y a, dans cette définition adoptée par Bonald, un mot, le mot nature que l’on retrouve souvent dans le vocabulaire révolutionnaire, et notamment chez Rousseau. Mais ce mot a chez Rousseau et chez Bonald des acceptions absolument différentes, et même contradictoires.
[...] J.-J. Rousseau, « le romancier de l’état sauvage, le détracteur de l’état civilisé », écrit Bonald, « place l’état naturel de l’homme individu ou social, dans l’état natif ou imparfait. De là sa prédilection affectée pour les enfants, au moins pour ceux d’autrui, et son admiration insensée pour l’état sauvage. »
Pour Bonald, au contraire, l’état naturel est opposé à l’état natif ou imparfait, l’état naturel est l’état parfait, et l’état parfait est l’état de société.
La philosophie révolutionnaire isole, abstrait l’homme de la société, et c’est sur cette abstraction qu’elle raisonne. [...]
L’homme se fait lui-même, déclare l’individualisme. La société fait l’homme, riposte Bonald. Tels sont les axiomes de la philosophie de l’anarchie et de la philosophie de l’ordre. [...]
Prétendre que l’homme se fait lui-même, c’est prétendre que ce qu’on trouve chez lui de bien moral, il le tient de lui-même, que ce bien existe naturellement en lui. C’est là la pensée de tous les révolutionnaires. Mais si le bien existe naturellement dans l’homme, d’où lui vient le mal ? Le mal lui vient du dehors, il lui vient de la société. [...] La conséquence logique d’un tel axiome, c’est la haine, le dénigrement, la destruction recherchée de la société. [...]
Nous sommes mauvais par nature, bons par la société. C’est la thèse de l’ordre. Elle aboutit, en effet, logiquement, à la recherche de la consolidation et du perfectionnement de la société.
L’homme se fait lui-même, déclare l’individualisme. La société fait l’homme, riposte Bonald. Tels sont les axiomes de la philosophie de l’anarchie et de la philosophie de l’ordre. [...]
Prétendre que l’homme se fait lui-même, c’est prétendre que ce qu’on trouve chez lui de bien moral, il le tient de lui-même, que ce bien existe naturellement en lui. C’est là la pensée de tous les révolutionnaires. Mais si le bien existe naturellement dans l’homme, d’où lui vient le mal ? Le mal lui vient du dehors, il lui vient de la société. [...] La conséquence logique d’un tel axiome, c’est la haine, le dénigrement, la destruction recherchée de la société. [...]
Nous sommes mauvais par nature, bons par la société. C’est la thèse de l’ordre. Elle aboutit, en effet, logiquement, à la recherche de la consolidation et du perfectionnement de la société.
Le gouvernement le plus en harmonie avec la philosophie révolutionnaire est la République démocratique, qui prétend remettre une part du pouvoir à chaque individu. Au contraire le gouvernement en harmonie avec la philosophie sociale de Bonald est la monarchie héréditaire. Cette philosophie considère, en effet, la société comme un corps général dont l’existence embrasse le passé, le présent, l’avenir. L’homme meurt ; la société vit et se maintient à travers les générations qui se succèdent. Or seule la monarchie héréditaire offre ce caractère de durée, d’immortalité.
Dans la république démocratique, au contraire, la société n’est plus un corps général, mais simplement une réunion d’individus ; la volonté en général n’est qu’une somme de volontés particulières. En un mot tout s’y individualise, tout s’y restreint et s’y concentre dans le présent, d’accord en cela avec la doctrine révolutionnaire.
Dans la république démocratique, au contraire, la société n’est plus un corps général, mais simplement une réunion d’individus ; la volonté en général n’est qu’une somme de volontés particulières. En un mot tout s’y individualise, tout s’y restreint et s’y concentre dans le présent, d’accord en cela avec la doctrine révolutionnaire.
Bonald pose d’abord en principe – principe dont l’expérience des siècles a démontré la justesse – que le mariage est la société naturelle la plus favorable à la propagation de l’espèce humaine. Il déclare ensuite qu’il n’y a de mariage véritable que là où il y a union indissoluble, et que cette condition est si essentielle que de la dissolubilité du lien conjugal ou de son indissolubilité dépend en France et partout le sort de la famille, de la religion et de l’État.
[...] il [Bonald] a versé dans une certaine mesure, à un moment de sa vie, dans la Révolution. Je veux parler de cette approbation du gallicanisme que nous trouvons dans ses premiers ouvrages, approbation où l’a sans doute entraîné sa grande admiration pour Bossuet. Dans sa Théorie du pouvoir, nous le voyons notamment déclarer que « le pape a au-dessus de lui une autorité extérieure, celle du concile général ; » que « ce n’est pas au pape, mais à l’Église en corps qu’appartient l’infaillibilité ». Ceci ne cadre pas avec tout le reste de son œuvre. Il est d’ailleurs nécessaire de remarquer qu’il est revenu plus tard de son erreur, et je croirais assez que la lecture de Joseph de Maistre n’a pas été étrangère à ce revirement.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Léon de Montesquiou (5)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quel froid !
Que signifie l'expression "jeter un froid" ?
Provoquer une situation désagréable de gêne où les personnes présentes ne savent pas comment réagir
Etre en désaccord ou avoir un conflit avec quelqu'un
Lancer des boules de neige sur quelqu'un
12 questions
767 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, écrivain
, roman
, politiqueCréer un quiz sur ce livre767 lecteurs ont répondu