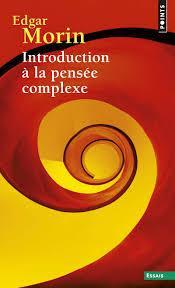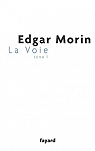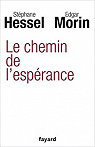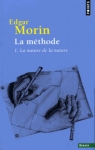Citations sur Introduction à la pensée complexe (59)
C’est avec Wiener, Ashby, les fondateurs de la cybernétique, que la complexité entre véritablement en scène dans la science. C'est avec von Neumann que, pour la première fois, le caractère fondamental du concept de complexité apparaît dans la liaison avec les phénomènes d'auto-organisation.
Qu'est-ce que la complexité ? À première vue, c'est un phénomène quantitatif, l'extrême quantité d'interactions et d'interférences entre un très grand nombre d'unités. En fait, tout système auto-organisateur (vivant), même le plus simple, combine un très grand nombre d'unités de l'ordre de milliards, soit de molécules dans une cellule, soit de cellules dans l'organisme (plus de 10 milliards de cellules pour le cerveau humain, plus de 30 milliards pour l'organisme).
Mais la complexité ne comprend pas seulement des quantités d'unités et interactions qui défient nos possibilités de calcul ; elle comprend aussi des incertitudes, des indéterminations, des phénomènes aléatoires. La complexité dans un sens a toujours affaire avec le hasard.
Ainsi, la complexité coïncide avec une part d'incertitude, soit tenant aux limites de notre entendement, soit inscrite dans les phénomènes. Mais la complexité ne se réduit pas à l'incertitude, c'est l'incertitude au sein de systèmes richement organisés. Elle concerne des systèmes semi-aléatoires dont l'ordre est inséparable des aléas qui les concernent. La complexité est donc liée à un certain mélange d'ordre et de désordre, mélange intime, ...
Qu'est-ce que la complexité ? À première vue, c'est un phénomène quantitatif, l'extrême quantité d'interactions et d'interférences entre un très grand nombre d'unités. En fait, tout système auto-organisateur (vivant), même le plus simple, combine un très grand nombre d'unités de l'ordre de milliards, soit de molécules dans une cellule, soit de cellules dans l'organisme (plus de 10 milliards de cellules pour le cerveau humain, plus de 30 milliards pour l'organisme).
Mais la complexité ne comprend pas seulement des quantités d'unités et interactions qui défient nos possibilités de calcul ; elle comprend aussi des incertitudes, des indéterminations, des phénomènes aléatoires. La complexité dans un sens a toujours affaire avec le hasard.
Ainsi, la complexité coïncide avec une part d'incertitude, soit tenant aux limites de notre entendement, soit inscrite dans les phénomènes. Mais la complexité ne se réduit pas à l'incertitude, c'est l'incertitude au sein de systèmes richement organisés. Elle concerne des systèmes semi-aléatoires dont l'ordre est inséparable des aléas qui les concernent. La complexité est donc liée à un certain mélange d'ordre et de désordre, mélange intime, ...
Nous demandons à la pensée qu'elle dissipe les brouillards et les obscurités, qu'elle mette de l'ordre et de la clarté dans le réel, qu'elle révèle les lois qui le gouvernent. Le mot de complexité, lui, ne peut qu'exprimer notre embarras, notre confusion, notre incapacité à définir de façon simple, à nommer de façon claire, à ordonner nos idées. Sa définition première ne peut fournir aucune élucidation : est complexe ce qui ne peut se résumer en un maître mot, ce qui ne peut se ramener à une loi ni se réduire à une idée simple. La complexité est un mot problème et non un mot solution.
[...] tout système de pensée est ouvert et comporte une brèche, une lacune dans son ouverture même. Mais nous avons la possibilité d'avoir des méta-points de vue. Le méta-points de vue n'est possible que si l'observateur s'intègre dans l'observation et dans la conception.
Être sujet, c'est se mettre au centre de son propre monde, c'est occuper le site du "je". [...] Etre sujet, c'est être autonome tout en étant dépendant. C'est être quelqu'un de provisoire, de clignotant, d'incertain, c'est être presque tout pour soi, et presque rien pour l'univers.
Le mot de sujet est un des mots les plus difficiles, les plus malentendus qui puissent être. Pourquoi ? Parce que dans la vision traditionnelle de la science où tout est déterminisme, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'autonomie.
On a beau savoir que tout ce qui s'est passé d'important dans l'histoire mondiale ou dans notre vie était totalement inattendu, on continue à agir comme si rien d'inattendu ne devrait désormais arriver. Secouer cette paresse d'esprit, c'est une leçon que donne la pensée complexe.
A de nombreuses reprises, il m'est apparu qu'on avait de moi la vision d'un esprit se voulant synthétique, se voulant systématique, se voulant global, se voulant intégratif, se voulant unifiant, se voulant affirmatif et se voulant suffisant. On a l'impression que je suis quelqu'un qui a élaboré un paradigme qu'il sort de sa poche en disant : « Voilà ce qu'il faut adorer, et brûlez les anciennes tables de la Loi. » Ainsi, à plusieurs reprises, on m'a attribué la conception d'une complexité parfaite que j'opposerai à la simplification absolue. Or, l'idée même de complexité comporte en elle l'impossibilité d'unifier, l'impossibilité d'achèvement, une part d'incertitude, une part d'indécidabilité et la reconnaissance du tête-à-tête final avec l'indicible. Cela ne veut pas dire pour autant que la complexité dont je parle se confond avec le relativisme absolu, le scepticisme du type Feyerabend.
Si je commence par m'auto-analyser, il y a en moi une tension soit pathétique, soit ridicule entre deux pulsions intellectuelles contraires. C'est, d'une part, l'effort infatigable pour articuler les savoirs dispersés, l'effort vers le remembrement et, d'autre part, en même temps, le contre-mouvement qui détruit cela. À de nombreuses reprises, et depuis très longtemps, j'ai cité cette phrase d'Adorno, que je re-cite en préface à Science avec conscience : « La totalité est la non-vérité », parole merveilleuse venant de quelqu'un qui s'est formé évidemment dans la pensée hegelienne, c'est-à-dire mû par l'aspiration à la totalité. (p. 127)
Si je commence par m'auto-analyser, il y a en moi une tension soit pathétique, soit ridicule entre deux pulsions intellectuelles contraires. C'est, d'une part, l'effort infatigable pour articuler les savoirs dispersés, l'effort vers le remembrement et, d'autre part, en même temps, le contre-mouvement qui détruit cela. À de nombreuses reprises, et depuis très longtemps, j'ai cité cette phrase d'Adorno, que je re-cite en préface à Science avec conscience : « La totalité est la non-vérité », parole merveilleuse venant de quelqu'un qui s'est formé évidemment dans la pensée hegelienne, c'est-à-dire mû par l'aspiration à la totalité. (p. 127)
On peut diagnostiquer, dans l'histoire occidentale, la domination d'un paradigme qu'a formulé Descartes. Descartes a disjoint d'un côté le domaine du sujet, réservé à la philosophie, à la méditation intérieure et, d'autre part, le domaine de la chose dans l'étendue, domaine de la connaissance scientifique, de la mesure et de la précision. Descartes a très bien formulé ce principe de disjonction, et cette disjonction a régné dans notre univers. Elle a séparé de plus en plus science et philosophie. Elle a séparé la culture qu'on appelle humaniste, celle de la littérature, de la poésie, des arts et de la culture scientifique. La première culture fondée sur la réflexion ne peut plus s'alimenter aux sources du savoir objectif. La seconde culture, fondée sur la spécialisation du savoir, ne peut se réfléchir ni se penser elle-même.
Le paradigme de simplification (disjonction et réduction) domine notre -culture aujourd'hui et c'est aujourd'hui que commence la réaction contre son emprise. (p. 103)
Le paradigme de simplification (disjonction et réduction) domine notre -culture aujourd'hui et c'est aujourd'hui que commence la réaction contre son emprise. (p. 103)
Les philosophes du xviii siècle, au nom de la raison, avaient une vue assez peu rationnelle de ce qu'étaient les mythes et de ce qu'était la religion. Ils croyaient que les religions et les dieux avaient été inventés par les prêtres pour tromper les gens. Ils ne se rendaient pas compte de la profondeur et de la réalité de la puissance religieuse et mythologique dans l'être humain. Par là même, ils avaient glissé dans la rationalisation, c'est-à-dire dans l'explication simpliste de ce que leur raison n'arrivait pas à comprendre. Il a fallu de nouveaux développements de la raison pour commencer à comprendre le mythe. Il a fallu pour ceci que la raison critique devienne autocritique. Nous devons sans cesse lutter contre la déification de la Raison qui est pourtant notre seul instrument de connaissance fiable, à condition d'être non seulement critique mais autocritique. (pp. 95-96)
Il y a une telle complexité dans l'univers, il est apparu une telle série de contradictions que certains scientifiques croient dépasser cette contradiction, dans ce qu'on peut appeler une nouvelle métaphysique. Ces nouveaux métaphysiciens cherchent dans les mystiques, notamment extrêmes-orientales, et notamment bouddhistes, l'expérience du vide qui est tout et du tout qui n'est rien. Ils perçoivent là une sorte d'unité fondamentale, où tout est relié, tout est harmonie, en quelque sorte, et ils ont une vision réconciliée, je dirais euphorique, du monde.
Ce faisant, ils échappent à mon avis à la complexité. Pourquoi ? Parce que la complexité est là où l'on ne peut surmonter une contradiction voire une tragédie. Sous certains aspects, la physique actuelle découvre que quelque chose échappe au temps et à l'espace, mais cela n'annule pas le fait qu'en même temps nous sommes incontestablement dans le temps et dans l'espace.
On ne peut réconcilier ces deux idées. Devons-nous les accepter telles quelles ? L'acceptation de la complexité, c'est l'acceptation d'une contradiction, et l'idée que l'on ne peut pas escamoter les contradictions dans une vision euphorique du monde.
Bien entendu, notre monde comporte de l'harmonie, mais cette harmonie est liée à de la dysharmonie. C'est exactement ce que disait Héraclite : il y a de l'harmonie dans la dysharmonie, et vice versa. (pp. 86-87)
Ce faisant, ils échappent à mon avis à la complexité. Pourquoi ? Parce que la complexité est là où l'on ne peut surmonter une contradiction voire une tragédie. Sous certains aspects, la physique actuelle découvre que quelque chose échappe au temps et à l'espace, mais cela n'annule pas le fait qu'en même temps nous sommes incontestablement dans le temps et dans l'espace.
On ne peut réconcilier ces deux idées. Devons-nous les accepter telles quelles ? L'acceptation de la complexité, c'est l'acceptation d'une contradiction, et l'idée que l'on ne peut pas escamoter les contradictions dans une vision euphorique du monde.
Bien entendu, notre monde comporte de l'harmonie, mais cette harmonie est liée à de la dysharmonie. C'est exactement ce que disait Héraclite : il y a de l'harmonie dans la dysharmonie, et vice versa. (pp. 86-87)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Edgar Morin (133)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
445 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre445 lecteurs ont répondu