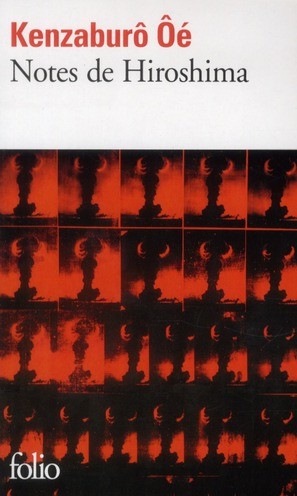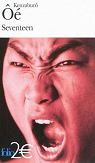Critiques filtrées sur 3 étoiles
A presque 30 ans, le jeune Kenzaburo Oé, acclamé pour ses premières oeuvres littéraires, se rend à Hiroshima presque vingt ans après le largage de la bombe atomique par les Américains. Au départ observateur journalistique qui couvre la 9ème conférence annuelle de partis divers qui débattent sur l'après de ce jour funeste, Oé va finir par revenir chaque année, touché par les témoignages toujours plus nombreux des victimes oubliées aussi bien du monde que du gouvernement japonais...
Ces notes de voyages, d'interviews et de rencontres ont l'intérêt marqué de donner une voix internationale aux oubliés d'Hiroshima : les victimes, passées, présentes et futures. Plusieurs éléments montrent à quel point ces dernières sont passées au second plan pendant de trop longues années :
- les Etats-Unis ont décrété à tort et sans expérience en 1945 que toutes les morts qu'il devait y avoir suite à l'attaque nucléaire avaient eu lieu ;
- le monde s'est concentré sur la puissance de l'objet, son pouvoir d'annihilation et de dissuasion, pas sur ses retombées médicales au-delà de celles qui sont immédiates ;
- le nombre de victimes n'a jamais vraiment pu être déterminé correctement vu le nombre de morts qu'on ne savait vraiment attribuer ou non aux radiations, voire la non prise en compte de tous les suicides des victimes qui ont choisi de ne pas mourir à petit feu ;
- le gouvernement n'a pas su mettre en place/autoriser l'envoi de médecins dans des régions reculées comme Okinawa où de nombreuses victimes étaient rentrées après l'attaque et de nombreuses victimes sont restées sans traitement approprié ;
- le pays s'est plus ou moins muré dans un silence pendant dix ans avant même d'organiser des cérémonies du souvenir et des conférences pour mettre en place des aides financières et médicales aux victimes ;
- aucune réelle occasion n'a été donnée aux victimes de pouvoir vraiment s'exprimer, pour celles d'ailleurs qui le souhaitaient alors que beaucoup ne voulaient que passer à autre chose le plus vite possible...
Les destins terribles de nombreuses victimes sont abordés, des histoires sordides et tristes, amères et toujours fatales, développés dans le concept de dignité propre au pays, d'entraide et aussi un peu d'espoir.
En fond, ce livre est plus ou moins aussi un appel à l'abolition des armes nucléaires ou du moins à leur régulation, que réclament chaque année les victimes. La politique, encore une fois, fait beaucoup traîner les choses. On le voit dès le premier chapitre qui montre des partis politiques divers incapables de s'entendre sur de la rhétorique et du vocabulaire, laissant mariner sous un soleil de plomb des manifestants pacifiques qui veulent simplement qu'une chose pareille ne se reproduise jamais.
Doit-on d'ailleurs rappeler qu'il aura fallu attendre 1968, 23 ans après les faits, pour que la majorité des pays à l'exception d'Israël, de l'Inde, du Pakistan et du Soudan signent un traité de non-prolifération de l'arme nucléaire ? Et, encore pire, qu'il aura fallu attendre 2017 soit 72 ans, sept décennies !!, pour la signature par 70 pays (sur 194 !!) d'un traité qui interdit l'arme nucléaire mais ratifié pour l'instant que par 24 ? Sachant que les pays qui la détiennent n'ont même pas signé ce dernier traité d'ailleurs. Évidemment. "Je suis un pays qui a l'arme nucléaire, c'est pas bien, faut pas qu'elle prolifère ailleurs, mais je la garde, hein ??" Hypocrisie quand tu nous tiens, va...
Pour en revenir à nos moutons, si la cause est légitime, la parole donnée justice et le témoignage de l'atrocité toujours en cours nécessaire, Oé fait preuve de tellement de répétitions que c'en devient très vite lassant. On comprend très vite le courage, l'abnégation, la dignité (notion longuement développée) des victimes et de leurs médecins qui ne savent plus quoi faire ; on intègre très vite tous ces destins meurtris qui se ressemblent, les décisions de vie ou de mort, la tentative de continuer malgré la maladie, le handicap, la mort qui plane constamment au-dessus des têtes. Au bout d'un moment c'est tellement tout le temps la même chose, avec une succession de témoignages et d'hommages aux médecins que c'est plus possible. C'est en ça que cet ouvrage peut décevoir, car il relate plus qu'il n'analyse voire critique ouvertement et vertement. En fait, ça manque d'implication et d'opinions personnelles.
En bref, le message passe mais la forme aurait pu être améliorée.
Lien : http://livriotheque.free.fr/..
Ces notes de voyages, d'interviews et de rencontres ont l'intérêt marqué de donner une voix internationale aux oubliés d'Hiroshima : les victimes, passées, présentes et futures. Plusieurs éléments montrent à quel point ces dernières sont passées au second plan pendant de trop longues années :
- les Etats-Unis ont décrété à tort et sans expérience en 1945 que toutes les morts qu'il devait y avoir suite à l'attaque nucléaire avaient eu lieu ;
- le monde s'est concentré sur la puissance de l'objet, son pouvoir d'annihilation et de dissuasion, pas sur ses retombées médicales au-delà de celles qui sont immédiates ;
- le nombre de victimes n'a jamais vraiment pu être déterminé correctement vu le nombre de morts qu'on ne savait vraiment attribuer ou non aux radiations, voire la non prise en compte de tous les suicides des victimes qui ont choisi de ne pas mourir à petit feu ;
- le gouvernement n'a pas su mettre en place/autoriser l'envoi de médecins dans des régions reculées comme Okinawa où de nombreuses victimes étaient rentrées après l'attaque et de nombreuses victimes sont restées sans traitement approprié ;
- le pays s'est plus ou moins muré dans un silence pendant dix ans avant même d'organiser des cérémonies du souvenir et des conférences pour mettre en place des aides financières et médicales aux victimes ;
- aucune réelle occasion n'a été donnée aux victimes de pouvoir vraiment s'exprimer, pour celles d'ailleurs qui le souhaitaient alors que beaucoup ne voulaient que passer à autre chose le plus vite possible...
Les destins terribles de nombreuses victimes sont abordés, des histoires sordides et tristes, amères et toujours fatales, développés dans le concept de dignité propre au pays, d'entraide et aussi un peu d'espoir.
En fond, ce livre est plus ou moins aussi un appel à l'abolition des armes nucléaires ou du moins à leur régulation, que réclament chaque année les victimes. La politique, encore une fois, fait beaucoup traîner les choses. On le voit dès le premier chapitre qui montre des partis politiques divers incapables de s'entendre sur de la rhétorique et du vocabulaire, laissant mariner sous un soleil de plomb des manifestants pacifiques qui veulent simplement qu'une chose pareille ne se reproduise jamais.
Doit-on d'ailleurs rappeler qu'il aura fallu attendre 1968, 23 ans après les faits, pour que la majorité des pays à l'exception d'Israël, de l'Inde, du Pakistan et du Soudan signent un traité de non-prolifération de l'arme nucléaire ? Et, encore pire, qu'il aura fallu attendre 2017 soit 72 ans, sept décennies !!, pour la signature par 70 pays (sur 194 !!) d'un traité qui interdit l'arme nucléaire mais ratifié pour l'instant que par 24 ? Sachant que les pays qui la détiennent n'ont même pas signé ce dernier traité d'ailleurs. Évidemment. "Je suis un pays qui a l'arme nucléaire, c'est pas bien, faut pas qu'elle prolifère ailleurs, mais je la garde, hein ??" Hypocrisie quand tu nous tiens, va...
Pour en revenir à nos moutons, si la cause est légitime, la parole donnée justice et le témoignage de l'atrocité toujours en cours nécessaire, Oé fait preuve de tellement de répétitions que c'en devient très vite lassant. On comprend très vite le courage, l'abnégation, la dignité (notion longuement développée) des victimes et de leurs médecins qui ne savent plus quoi faire ; on intègre très vite tous ces destins meurtris qui se ressemblent, les décisions de vie ou de mort, la tentative de continuer malgré la maladie, le handicap, la mort qui plane constamment au-dessus des têtes. Au bout d'un moment c'est tellement tout le temps la même chose, avec une succession de témoignages et d'hommages aux médecins que c'est plus possible. C'est en ça que cet ouvrage peut décevoir, car il relate plus qu'il n'analyse voire critique ouvertement et vertement. En fait, ça manque d'implication et d'opinions personnelles.
En bref, le message passe mais la forme aurait pu être améliorée.
Lien : http://livriotheque.free.fr/..
Après plusieurs passages à Hiroshima, lors des commémorations annuelles du 6 août 1945, l'auteur a écrit ce livre. Beaucoup de témoignages des rescapés, des malades pour qu'un tel drame, une telle horreur serve de leçon pour l'humanité entière et ne se reproduise plus jamais.
* Ce livre de 230 pages est constitué d'une préface, d'un prologue et d'un épilogue, encadrant sept longs articles que Kenzaburo Oé a écrits entre 1963 et 1965, lors de voyages à Hiroshima qu'il a effectués pour assister à – et rendre compte de – réunions politiques et de conférences organisées à la date anniversaire de l'explosion de la bombe A (6 août). Ces réunions internationales étaient supposées fédérer toutes les initiatives visant à s'opposer à la prolifération des armes nucléaires. Mais, regrette K. Oé, elles n'étaient que l'occasion de voir s'affronter plusieurs tendances fratricides de la gauche japonaise.
Parallèlement à ces réunions internationales, des conférences étaient organisées par des habitants d'Hiroshima pour faire pression sur les autorités nationales et régionales, afin qu'elles prennent en compte et en charge les hibakusha, ces victimes ayant survécu à l'explosion, et étant, depuis, tombées gravement malade, par exemple, de leucémie.
* Malgré tout l'intérêt que représente ces témoignages « à chaud », ces révélations sur une page dramatique de l'histoire du Japon, ce recueil peut décevoir, dans la mesure il contient de nombreuses répétitions d'un article à un autre, voire au sein d'un même article. Certains passages paraissent confus, et puis, K. Oé utilise un style tellement poli, tellement accommodant, qu'il pourra paraître complaisant vis-à-vis des autorités qui, de fait, sont responsables, par leur inaction, des conditions déplorables, misérables, dans lesquelles survivent les irradiés, les hibakusha. Pourquoi l'auteur ne se met-il pas en colère ? Pourquoi n'emploie-t-il pas un ton plus vindicatif ? Car ce sont bien les élites politiques japonaises qui, en envahissant leurs voisins, ont déclenché le déluge nucléaire. Ils mériteraient bien qu'on dénonce leur absence de remords, leur volonté de masquer les conséquences de leurs crimes passés. Or, le ton de l'auteur donne l'impression qu'il n'ose pas dire franchement ce qu'il pense. Comme s'il craignait les représailles de la censure, il utilise des euphémismes, des formules indirectes qui atténuent totalement l'ampleur du scandale que représente le mépris envers les victimes à long terme des radiations.
* Ceci dit, il faut reconnaître que ses articles contiennent un certain nombre d'informations utiles pour connaître l'histoire récente du Japon et remarquer que sa société n'est pas si éloignée de la nôtre, que des similitudes existent. On peut citer, par exemple, le fait que, dans les années 1950 et 1960, l'espace politique japonais était, comme le fût le nôtre, le lieu de grandes tensions entre trois courants de gauche : a) les prochinois opposé à la prolifération (la Chine n'a possédé l'arme nucléaire qu'à partir de 1964) ; b) les pro-soviétiques favorables à la prolifération (l'URSS possédait l'arme nucléaire depuis 1949, date de leur premier essai dans l'atmosphère) ; c) et les pro-américains qui essaient de nier l'existence, puis de minimiser l'importance des victimes de leurs bombardements. Pour K. Oé, ces partis et syndicats, irresponsables, cherchent à instrumentaliser les victimes à des fins purement politiciennes, dans la lutte qui les opposent pour la conquête du pouvoir.
L'auteur a beaucoup plus d'empathie pour les associations et les individus indépendants, parce qu'ils sont les seuls à vraiment comprendre ce que vivent les gens à Hiroshima, ou plus généralement, les hibakusha quand ces derniers ont fui la ville, mais n'en sont pas moins gravement malades, incapables de gagner leur vie. Les luttes politiques fratricides et les stratégies des états-majors ont longtemps empêché la prise en charge des patients, souffrant de maladies mal connues et du rejet de la part du reste de la population. Il faut ainsi attendre 1954 pour que les hibakusha aient le droit de s'exprimer publiquement sur leur vécu.
On apprend aussi le dévouement de certains médecins, eux-mêmes irradiés, qui s'activent, non seulement dans le domaine des soins, mais aussi pour faire reconnaître la nécessité d'aider collectivement les hibakusha. Par exemple, en proposant de mener une enquête scientifique auprès d'eux, dans une perspective de santé publique, pour mesurer objectivement l'ampleur du phénomène. À cela s'ajoutent ceux qui ne sont venus vivre à Hiroshima qu'après la fin de la guerre et qui ont tout de même été victimes de la radioactivité résiduelle. En réalité, les Américains, en lançant leur bombe, ignoraient tout des conséquences à moyen et long terme de la radioactivité sur la santé des êtres vivants et en particulier des humains. Ils préféraient se contenter de considérer que toutes les victimes directes de l'explosion étant décédées, il n'y avait plus de raison de s'en occuper.
* Dans un registre totalement différent, la préface, écrite en 1995, présente l'intérêt de brosser l'environnement personnel et professionnel dans lequel se trouvait l'auteur, au moment où il a accepté, en 1963, de réaliser son premier voyage à Hiroshima. On lui avait demandé de rédiger le compte rendu d'une réunion politique de dimension mondiale, visant à l'abolition des armes nucléaires. Il était déprimé, à un tournant de sa vie – il avait 28 ans. Son fils handicapé venait de naître et allait subir une opération dont il sortirait au mieux gravement attardé. Parallèlement, il commençait à avoir une certaine notoriété, ce qui exerçait une forte pression sur lui, alors qu'il se sentait à court d'inspiration. Plusieurs de ses amis ou connaissances venaient de se suicider. Yasuke Ryosuke, l'ami avec lequel il se rendait à Hiroshima, avait perdu sa fille. Ce premier voyage, dont il n'attendait au fond pas grand-chose, l'a complètement bouleversé. La rencontre avec les associations de défense des hibakusha l'a sauvé, l'a fait sortir du trou où lui et son ami étaient tombés. À la fois métamorphose et rémission.
« La façon de vivre, les pensées de ces gens si humains avaient produit en moi une très forte impression. le contact avec eux m'avait redonné courage, mais en même temps, j'éprouvais de la douleur à sentir qu'on arrachait du plus profond de moi les graines d'une sorte de névrose, les racines d'une déchéance vers laquelle je glissais dans la corrélation avec mon fils en couveuse. Et je sentais grandir en moi le désir de tester mon degré de ʺduretéʺ interne en la soumettant à l'épreuve de cette lime qu'étaient à mes yeux Hiroshima et ceux qui en incarnaient l'esprit » (p. 18).
* Au chapitre 4, il retrouve ces accents, parle plutôt de lui, de sa métamorphose face au courage d'une partie des habitants d'Hiroshima :
« leur dignité à tous, je la ressens comme la plus humaine qui soit. C'est celle à laquelle j'ai aspiré depuis l'enfance (...). Cette dignité, je l'ai découverte également chez le directeur de l'hôpital de la Bombe A, Shigeto, et elle venait évidemment pas du prestige lié à sa fonction (...). [Cette dignité], c'est celle de l'homme dans toute sa nudité, sans lien avec la moindre forme d'autorité » (p 124-125).
L'hôpital de la Bombe A, dirigé par le docteur Shigeto Fumio, lui-même irradié, a été créé par les habitants. Les médecins qui y travaillent sont seuls face aux traitements à inventer, aux maladies à identifier, ni les autorités japonaises ni celles d'occupation ne les aident.
« le docteur Shigeto et ses confrères n'ont pas capitulé. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Car l'ennemi dévoilait peu à peu le plus effrayant de ses visages : la leucémie. (...) Nulle perspective favorable, pourtant, ne les engageait à persister dans ce refus. (...) Même les troupes d'occupation américaines, en pénétrant dans Hiroshima, ignoraient comment saisir cet énorme monstre qu'elles avaient elles-mêmes lâché » (p. 162).
Ce que K. Oé appelle la dignité, c'est le fait que certains irradiés ont décidé de ne pas fuir, de rester à Hiroshima et d'affronter la réalité de l'explosion, certains pouvant tout de même fuir, mais en eux, en se murant dans le silence. Ceux qui restent, affrontent les dégâts, tentent d'agir ou agissent, ce sont tous ceux-là qui font oeuvre de dignité.
Parmi ces personnes dignes, il y a Miyamoto Sadao :
« lui a assumé de son plein grès Hiroshima. Il a eu le courage de se souvenir de l'abominable désastre, il a revécu cette expérience en l'évoquant par écrit, il en a parlé inlassablement aux étrangers qui venaient lui rendre visite et qui plus est, avec le sourire. Loin de fuir Hiroshima, il l'a acceptée. Pour qui a-t-il fait cela ? Pas pour lui, mais pour nous, pour tous les autres hommes qui resteraient après sa mort tragique. (...) Pour surmonter leur terreur de la fin misérable qui les attend, il faut que les survivants puissent croire en l'utilité de leur propre mort. Car c'est ainsi, comme part de l'existence des vivants qu'ils laissent après eux, que les défunts peuvent subsister. (...) D'où la peur qui soudain me saisit, face à cette question : ne sommes-nous pas en train de gâcher le pari fait par ces hommes ? » (p. 138-139).
En d'autres termes, en donnant à voir ces êtres dignes, en témoignant de leur lutte opiniâtre, humble mais décisive, K. Oé entend adresser une requête à la société de son temps : tant que vous regarderez ailleurs, tant que vous continuerez à feindre d'ignorer l'existence des victimes de la bombe A, non seulement vous serez responsables de la dégradation de leur état, mais vous détruirez ce qu'il reste d'authentiquement humain en vous. Au demeurant, si cette requête a été pensée dans le cadre très précis de la société japonaise, à propos des irradiés et de ceux qui luttent pour les aider, elle n'en contient pas moins une portée universelle, particulièrement pertinente dans le contexte mondial contemporain. La priorité de toutes les autorités du monde ne devrait-elle pas être de créer les conditions permettant d'aider ceux qui luttent pour humaniser les sociétés ? de les aider à triompher.
Parallèlement à ces réunions internationales, des conférences étaient organisées par des habitants d'Hiroshima pour faire pression sur les autorités nationales et régionales, afin qu'elles prennent en compte et en charge les hibakusha, ces victimes ayant survécu à l'explosion, et étant, depuis, tombées gravement malade, par exemple, de leucémie.
* Malgré tout l'intérêt que représente ces témoignages « à chaud », ces révélations sur une page dramatique de l'histoire du Japon, ce recueil peut décevoir, dans la mesure il contient de nombreuses répétitions d'un article à un autre, voire au sein d'un même article. Certains passages paraissent confus, et puis, K. Oé utilise un style tellement poli, tellement accommodant, qu'il pourra paraître complaisant vis-à-vis des autorités qui, de fait, sont responsables, par leur inaction, des conditions déplorables, misérables, dans lesquelles survivent les irradiés, les hibakusha. Pourquoi l'auteur ne se met-il pas en colère ? Pourquoi n'emploie-t-il pas un ton plus vindicatif ? Car ce sont bien les élites politiques japonaises qui, en envahissant leurs voisins, ont déclenché le déluge nucléaire. Ils mériteraient bien qu'on dénonce leur absence de remords, leur volonté de masquer les conséquences de leurs crimes passés. Or, le ton de l'auteur donne l'impression qu'il n'ose pas dire franchement ce qu'il pense. Comme s'il craignait les représailles de la censure, il utilise des euphémismes, des formules indirectes qui atténuent totalement l'ampleur du scandale que représente le mépris envers les victimes à long terme des radiations.
* Ceci dit, il faut reconnaître que ses articles contiennent un certain nombre d'informations utiles pour connaître l'histoire récente du Japon et remarquer que sa société n'est pas si éloignée de la nôtre, que des similitudes existent. On peut citer, par exemple, le fait que, dans les années 1950 et 1960, l'espace politique japonais était, comme le fût le nôtre, le lieu de grandes tensions entre trois courants de gauche : a) les prochinois opposé à la prolifération (la Chine n'a possédé l'arme nucléaire qu'à partir de 1964) ; b) les pro-soviétiques favorables à la prolifération (l'URSS possédait l'arme nucléaire depuis 1949, date de leur premier essai dans l'atmosphère) ; c) et les pro-américains qui essaient de nier l'existence, puis de minimiser l'importance des victimes de leurs bombardements. Pour K. Oé, ces partis et syndicats, irresponsables, cherchent à instrumentaliser les victimes à des fins purement politiciennes, dans la lutte qui les opposent pour la conquête du pouvoir.
L'auteur a beaucoup plus d'empathie pour les associations et les individus indépendants, parce qu'ils sont les seuls à vraiment comprendre ce que vivent les gens à Hiroshima, ou plus généralement, les hibakusha quand ces derniers ont fui la ville, mais n'en sont pas moins gravement malades, incapables de gagner leur vie. Les luttes politiques fratricides et les stratégies des états-majors ont longtemps empêché la prise en charge des patients, souffrant de maladies mal connues et du rejet de la part du reste de la population. Il faut ainsi attendre 1954 pour que les hibakusha aient le droit de s'exprimer publiquement sur leur vécu.
On apprend aussi le dévouement de certains médecins, eux-mêmes irradiés, qui s'activent, non seulement dans le domaine des soins, mais aussi pour faire reconnaître la nécessité d'aider collectivement les hibakusha. Par exemple, en proposant de mener une enquête scientifique auprès d'eux, dans une perspective de santé publique, pour mesurer objectivement l'ampleur du phénomène. À cela s'ajoutent ceux qui ne sont venus vivre à Hiroshima qu'après la fin de la guerre et qui ont tout de même été victimes de la radioactivité résiduelle. En réalité, les Américains, en lançant leur bombe, ignoraient tout des conséquences à moyen et long terme de la radioactivité sur la santé des êtres vivants et en particulier des humains. Ils préféraient se contenter de considérer que toutes les victimes directes de l'explosion étant décédées, il n'y avait plus de raison de s'en occuper.
* Dans un registre totalement différent, la préface, écrite en 1995, présente l'intérêt de brosser l'environnement personnel et professionnel dans lequel se trouvait l'auteur, au moment où il a accepté, en 1963, de réaliser son premier voyage à Hiroshima. On lui avait demandé de rédiger le compte rendu d'une réunion politique de dimension mondiale, visant à l'abolition des armes nucléaires. Il était déprimé, à un tournant de sa vie – il avait 28 ans. Son fils handicapé venait de naître et allait subir une opération dont il sortirait au mieux gravement attardé. Parallèlement, il commençait à avoir une certaine notoriété, ce qui exerçait une forte pression sur lui, alors qu'il se sentait à court d'inspiration. Plusieurs de ses amis ou connaissances venaient de se suicider. Yasuke Ryosuke, l'ami avec lequel il se rendait à Hiroshima, avait perdu sa fille. Ce premier voyage, dont il n'attendait au fond pas grand-chose, l'a complètement bouleversé. La rencontre avec les associations de défense des hibakusha l'a sauvé, l'a fait sortir du trou où lui et son ami étaient tombés. À la fois métamorphose et rémission.
« La façon de vivre, les pensées de ces gens si humains avaient produit en moi une très forte impression. le contact avec eux m'avait redonné courage, mais en même temps, j'éprouvais de la douleur à sentir qu'on arrachait du plus profond de moi les graines d'une sorte de névrose, les racines d'une déchéance vers laquelle je glissais dans la corrélation avec mon fils en couveuse. Et je sentais grandir en moi le désir de tester mon degré de ʺduretéʺ interne en la soumettant à l'épreuve de cette lime qu'étaient à mes yeux Hiroshima et ceux qui en incarnaient l'esprit » (p. 18).
* Au chapitre 4, il retrouve ces accents, parle plutôt de lui, de sa métamorphose face au courage d'une partie des habitants d'Hiroshima :
« leur dignité à tous, je la ressens comme la plus humaine qui soit. C'est celle à laquelle j'ai aspiré depuis l'enfance (...). Cette dignité, je l'ai découverte également chez le directeur de l'hôpital de la Bombe A, Shigeto, et elle venait évidemment pas du prestige lié à sa fonction (...). [Cette dignité], c'est celle de l'homme dans toute sa nudité, sans lien avec la moindre forme d'autorité » (p 124-125).
L'hôpital de la Bombe A, dirigé par le docteur Shigeto Fumio, lui-même irradié, a été créé par les habitants. Les médecins qui y travaillent sont seuls face aux traitements à inventer, aux maladies à identifier, ni les autorités japonaises ni celles d'occupation ne les aident.
« le docteur Shigeto et ses confrères n'ont pas capitulé. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Car l'ennemi dévoilait peu à peu le plus effrayant de ses visages : la leucémie. (...) Nulle perspective favorable, pourtant, ne les engageait à persister dans ce refus. (...) Même les troupes d'occupation américaines, en pénétrant dans Hiroshima, ignoraient comment saisir cet énorme monstre qu'elles avaient elles-mêmes lâché » (p. 162).
Ce que K. Oé appelle la dignité, c'est le fait que certains irradiés ont décidé de ne pas fuir, de rester à Hiroshima et d'affronter la réalité de l'explosion, certains pouvant tout de même fuir, mais en eux, en se murant dans le silence. Ceux qui restent, affrontent les dégâts, tentent d'agir ou agissent, ce sont tous ceux-là qui font oeuvre de dignité.
Parmi ces personnes dignes, il y a Miyamoto Sadao :
« lui a assumé de son plein grès Hiroshima. Il a eu le courage de se souvenir de l'abominable désastre, il a revécu cette expérience en l'évoquant par écrit, il en a parlé inlassablement aux étrangers qui venaient lui rendre visite et qui plus est, avec le sourire. Loin de fuir Hiroshima, il l'a acceptée. Pour qui a-t-il fait cela ? Pas pour lui, mais pour nous, pour tous les autres hommes qui resteraient après sa mort tragique. (...) Pour surmonter leur terreur de la fin misérable qui les attend, il faut que les survivants puissent croire en l'utilité de leur propre mort. Car c'est ainsi, comme part de l'existence des vivants qu'ils laissent après eux, que les défunts peuvent subsister. (...) D'où la peur qui soudain me saisit, face à cette question : ne sommes-nous pas en train de gâcher le pari fait par ces hommes ? » (p. 138-139).
En d'autres termes, en donnant à voir ces êtres dignes, en témoignant de leur lutte opiniâtre, humble mais décisive, K. Oé entend adresser une requête à la société de son temps : tant que vous regarderez ailleurs, tant que vous continuerez à feindre d'ignorer l'existence des victimes de la bombe A, non seulement vous serez responsables de la dégradation de leur état, mais vous détruirez ce qu'il reste d'authentiquement humain en vous. Au demeurant, si cette requête a été pensée dans le cadre très précis de la société japonaise, à propos des irradiés et de ceux qui luttent pour les aider, elle n'en contient pas moins une portée universelle, particulièrement pertinente dans le contexte mondial contemporain. La priorité de toutes les autorités du monde ne devrait-elle pas être de créer les conditions permettant d'aider ceux qui luttent pour humaniser les sociétés ? de les aider à triompher.
Des moments très poignants qui montrent toute l'horreur des armes nucléaires. A méditer au moment où le monde se déchire sur la problématique du nucléaire iranien !
Les Dernières Actualités
Voir plus

Le Japon en ses oeuvres
steka
144 livres

Le Japon
michelekastner
74 livres

Hiroshima
la_fleur_des_mots
20 livres
Autres livres de Kenzaburo Oé (17)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )
Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "
amoureux
positiviste
philosophique
20 questions
862 lecteurs ont répondu
Thèmes :
essai
, essai de société
, essai philosophique
, essai documentCréer un quiz sur ce livre862 lecteurs ont répondu