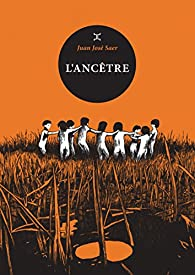>
Critique de Erik35
L'INCROYABLE HISTOIRE D'UN REFLET DANS L'EAU.
«A cette époque, la mode était aux Indes car cela faisait presque vingt ans qu'on avait découvert le pouvoir de les atteindre par le ponant.» C'est pour de telles raisons que, lorsqu'on est un gamin orphelin de l'Espagne du début du XVIème siècle, siècle que l'on surnommera bientôt "d'or", bien qu'il se construisit sur des monceaux de cadavres et la mise en coupe réglée des trésors découverts aux Amériques, on décide de s'embarquer comme mousse à bord d'une de ces caravelles, porteuses de rêve et de richesses. le navire va accoster dans cette Amérique latine encore presque parfaitement inconnue - 1492, c'était presque hier - dans le Cône sud plus précisément, entre les fleuves Paraná et Uruguay. A peine le capitaine et quelques-uns de ses hommes ont-ils mis le pied à terre qu'ils se font massacrer par une tribu d'indiens cannibales. Un seul en réchappe, le mousse Francisco del Puerto, 15 ans, qui, captif (mais est-il véritablement captif ?) vivra avec les indiens pendant dix ans avant d'être récupéré, avec l'aide des indiens eux-mêmes, par une nouvelle expédition. Un détail, cependant : Les Indiens, dans ce coin du Rio de la Plata, sont cannibales, mais ils ont pour habitude de laisser la vie sauve à l'un de leurs prisonniers, pris au hasard. C'est ce qui expliquera la raison de cette survie que le petit marin espagnol, qui fut malmené et violé par les hommes d'équipage lors de la traversée, ne parvient d'abord pas à comprendre.
De retour en Espagne, il apprendra à lire et à écrire dans un couvent, ayant la chance de croiser un clerc plus fin, plus intelligent et intègre que la majorité de ses semblables. À la mort de ce dernier - d'abus de boisson mais aussi d'un trop grand appétit de vivre - le jeune homme devient vagabond puis, un peu malgré lui et très fortuitement, membre d'une troupe de théâtre qui fini par s'enrichir en jouant sur scène une retranscription tellement libre qu'elle en devient aussi fausse que fantasmatique de sa vie chez les indiens de la pampa. La trajectoire du petit mousse est une ascension inespérée. Mais c'est aussi l'histoire d'un désenchantement que ce héros bien malgré lui nous conte, à la première personne, tandis qu'installé avec ses enfants adoptifs et ses petits enfants, il tâche de se souvenir et, entre les lignes, de comprendre ce parcours en tout point atypique, écartelé, déviant.
Quoi qu'assez bref, deux cent pages d'une impressionnante densité, et d'un style incroyable, sinueux, entrecoupé d'innombrables virgules-rizhomes, fluctuant, aussi méandreux que ces fleuves où Juan José Saer situe, de facto, l'origine du monde, de son monde et de l'Argentine, du centre épiphanique de l'univers possiblement, une plume qui semble, par moment, être susceptible de suspendre le temps, de l'incurver, le rendre à merci, lui donner de cette longueur, de cette trompeuse langueur que l'on retrouve peut-être parfois chez Marcel Proust même si pour pour d'autres raisons, ce bien qu'assez bref, disions-nous, les univers développés par l'auteur sont d'une richesse en tout point incalculable. le texte se divise, peu ou prou, en trois temps :
Le premier temps, sans doute le plus éprouvant mais aussi le plus fascinant, c'est celui de ces premières heures, celui du "def-ghi" qui n'a encore qu'une très mince conscience de ce qu'il est, qui va connaitre néanmoins une sorte de seconde naissance en assistant aux prémices préparatoires puis à l'accomplissement d'une monstrueuse scénographie orgiaque, dantesque, invraisemblable au cours de laquelle ses compagnons vont être patiemment préparés, désossés, assaisonnés puis cuits pour être consommés dans un moment de frénésie occulte durant lequel les acteurs sont tour à tour obnubilés puis abattus dans leur propre désir à dévorer sans fin - sans faim ? - ce repas incroyable. La suite sera plus licencieuse encore, dépravée même, sado-masochiste pourrions-nous préciser, - où s'entremêle onanisme débridé, homosexualité, mélangisme, inceste - n'était l'absence totale de volonté première, d'idée de faute ou d'interdit moral, pour s'adonner à des plaisirs illicites finalement très nôtres ; et puis les indiens semblent être alors sous le pouvoir d'une boisson fatale qui les met strictement hors d'eux-mêmes au point que d'aucuns en meurent, ne commandant plus rien de leurs actes, se perdant définitivement dans les marais, chutant lourdement, se blessant grièvement, finissant par tomber dans une espèce de catatonie. Cependant, nul jugement de la part de notre jeune homme, maintenant tout au long de cette orgasmique journée une imperturbable distance d'observateur pour ainsi dire anthropologique, une fois les premiers temps de la sidération passés, et comme si le voile d'incompréhension totale dans lequel il flottait l'empêchait d'éprouver le moindre sentiment tant à l'égard de ses compagnons massacrés puis engloutis que durant les scènes dionysiaques qui suivirent. Une fois cette imitation de nouvelle naissance accomplie, le narrateur exposera, dans ce journal qui n'en est pas un, l'essentiel de son existence chez ces amérindiens qui devienne dans leur quotidien et une fois leur monstrueuse agapè accomplie, l'antithèse absolue de ces heures folles.
Là, à rebours de ces bacchanales, leur vie est absolument strictement rangée - jusqu'à une maniaquerie certaine, qui les pousse à nettoyer, balayer, réparer, arranger sans cesse leur médiocre quotidien - , le sexe est alors banni de toute vie publique et semble n'être pratiqué que de la manière la plus fugace dans le privé. Ils s'avèrent par ailleurs d'une grande courtoisie, d'un calme que rien ne met en défaut, d'une solidarité permanente, d'une équanimité sans faille. Seulement, un fois l'an ou peu s'en faut, leurs hourvaris frénétiques les reprennent. Une chasse à l'homme est pratiquée auprès des tribus alentour. C'est d'ailleurs à cette occasion que l'ancien matelot comprendra peu à peu ce qu'il en est d'être un "def-ghi", puisqu'il s'en trouve un à chaque nouveau festin cérémoniel. Ceux-ci semblent d'ailleurs prendre leur rôle très à coeur avant que d'être renvoyés dans leurs pénates et finissent même souvent par toiser l'espagnol, pauvre "reflet" (c'est un des sens du mot) sans but... Voilà pour ce que c'est, avec tout l'incertain de l'exercice :
«On disait def-ghi des personnes absentes ou endormies ; des indiscrets qui, durant une visite, au lieu de rester chez l'autre un temps prudent, s'attardaient indéfiniment ; on appelait aussi def-ghi un oiseau à bec noir et au plumage jaune et vert, qu'on apprivoisait et qui faisait rire parce qu'il répétait, comme s'il eût parlé, les mots qu'on lui avait appris ; def-ghi, c'étaient aussi certains objets qu'on mettait à la place d'une personne absente et qui la représentaient dans les réunions […] ; de même façon on appelait def-ghi le reflet des choses dans l'eau ; une chose qui durait c'était def-ghi […]
Def-ghi, c'était tout cela et bien d'autres choses encore. Après de longues réflexions, je déduisis que, s'ils m'avaient donné ce nom, c'était parce qu'ils me rendaient solidaire de quelque essence commune à tout ce qu'ils nommaient ainsi. Ils attendaient de moi que je pusse dédoubler, ainsi que l'eau, l'image qu'ils donnaient d'eux-mêmes, répéter leurs gestes et leurs paroles, les représenter en leur absence et que je fusse capable, quand ils me rendraient à mes semblables, de faire comme l'espion ou l'éclaireur qui, après avoir été témoin de choses que la tribu n'a pu voir, revient sur ses pas pour raconter toutes choses en détails à tous. […] ils voulaient que de leur passage à travers ce mirage restât un témoin et un survivant qui fût, à la face du monde, leur narrateur.»
Le second temps est, dans une large mesure, plus rugueux. Plus sombre aussi, contre toute attente (après tout, ne rentre-t-il pas "chez lui" ?). Car le retour à la supposée civilisation n'est pas le moment attendu (y compris par le lecteur) des réjouissances, des retrouvailles avec un monde en absence. S'il rencontre un bon père qui comprend et son désarroi et ses capacités, c'est bien le seul qui s'interessera à lui, autrement que comme "celui qui était chez les sauvages". Par lui, il apprendra à lire et à écrire mais, plus que cela, il pourra envisager le recul lié à l'apprentissage du verbe vrai - par rapport à lui-même et, plus encore, vis à vis de ses contemporains - mais son maître disparaissant inopinément mais assez vite de la surface de la terre, notre homme va vivre une vie de vagabondage puis, par le hasard d'une rencontre, il va suivre et même donner la matière principale d'une pièce qui sera jouée dans l'Espagne toute entière puis dans le reste de l'Europe, mais une pièce qui n'a rien à voir avec ce qu'il a véritablement, fondamentalement vécu, éprouvé, une création où le sujet n'est pas son expérience ni même lui, mais la vision que ses contemporains immédiats ont de ces fameux sauvages. le retournement s'accompli lentement mais surement : cette supposée civilisation ne serait-elle en vérité que celle des sauvages que nous sommes ? Un monde de mensonge, d'imposture (à laquelle il prend part, par faiblesse, par facilité, par ennui de tout, par désenchantement), d'abus et d'intérêts vils, mesquins, sonnants et trébuchants. Voici ce qu'il dit des nouveaux sauvages qui l'entourent : «ces enveloppes vides qui prétendent s'appeler hommes» ou encore «depuis le jour où ils m'avaient renvoyé, je n'avais rencontré, à part le Père Quesada, que des êtres étranges et problématiques auxquels seule l'habitude ou la convention pouvait faire appliquer le nom d'hommes.» La messe est dite, et ce sont cinquante années qui vont défiler comme d'un rien, parce qu'en vérité, elles ne sont presque rien pour ce personnage ayant connu une sorte d'illumination, sans même qu'il s'en soit encore aperçu tout à fait.
C'est enfin un homme fait, globalement "achevé", dans le sens où il l'a réellement décidé, cette fois, plus qu'en raison de l'âge atteint, la soixantaine avancée, que l'on retrouve dans l'ultime partie - précisons que rien n'est aussi clairement délimité dans "L'ancêtre" qui ne connait ni chapitre ni franche disruption, à l'exception de deux ou trois événements fondateurs. Tout juste quelques changements de rythme bien souvent liés au changement de géographie personnelle du narrateur, plus qu'à des ruptures stylistiques ou narratives. A soixante ans passés, retiré de tout, le narrateur couche par écrit son interprétation – bien différente certainement de celle que tirerait la plupart de ses contemporains - du mode de vie des indiens et de leur conception du monde. Il se remémore, pour autant qu'il le peut, pour autant que SA vision puisse être LA vision de la réalité passée - Rien, chez Juan José Saer, ne laisse à penser qu'un témoignage puisse être véridique, objectif, universel. Rien moins que la réalité peut être réalité ! L'incertain, plus que l'incertitude, est de tous les instants, la réalité n'est pas en soi un mensonge mais le mensonge peut lui aussi s'avérer réalité. Ainsi, dans une certaine mesure, la mise en scène de son expérience sur les planches, tout maquillage fut-elle, devient-elle pourtant une certaine forme de réalité, au moins pour ceux qui l'on reçue, l'ont admise, l'ont souhaitée comme telle -. Cet homme devenu vieillard se remémore ainsi ces dix années passée aux côtés, souvent sans les comprendre, ou seulement après coup, ne serait-ce qu'en raison du verbe, de cette poignée d'indiens pour qui le centre de l'univers n'était autre qu'eux-mêmes et les quelques arpents de terres qu'ils ne voulaient abandonner pour rien au monde, ces rivages situés entre marais, fleuve et étendue morne. Il comprend, par un effort inouï de dépaysement, de décentrement de tout ce qui le constitue, à quel point ces supposés sauvages sont en réalité des civilisés accomplis tandis que nous sommes les sauvages - qui plus est, plutôt mauvais, idiots, ignorants et violents - ; il comprend peu à peu leur espèce de calme permanent, il envisage aussi que ce langage, qu'il a dû tâcher de comprendre difficultueusement tout au long de ces dix précieuses années de véritable re-naissance, avait tout autant valeur que celui qu'il tenait de sa mère - de ce point de vue, cet ouvrage est un exercice multiple et savamment enchevêtré autour de la langue, du langage, de son éthique, de sa philosophie, pour ainsi dire de la cosmogonie qui environne toute locution, en un mot, de toute sa magie, au sens ésotérique et mystique. Il a saisi toute la valeur de cette humanité dont il affirme que s'ils vivaient et «[...] agissaient de cette façon, c'est parce qu'ils avaient éprouvé, à quelque moment, avant de se sentir différents du monde, le poids du néant.»
D'une expérience incommunicable, le narrateur, dont on ne peut douter qu'il ne s'agisse pas de son créateur moderne, essaie de rendre compte des niveaux complexes que comporte toute réalité. Ce vieil homme, né par deux fois, et par deux fois dans la douleur mais par deux fois sans qu'il en résulte de souffrance directement éprouvée, dicible, aborde quelques unes des questions fondamentales qui traversent notre temps : La difficulté relative à tout langage, bien sûr, et, à travers le langage, à la possibilité même de rendre compte de ce qui est, de ce qui fut, de ce que l'on a éprouvé, vécu, à l'autre, l'autre fut-il soi-même ; L'impossibilité ontologique à comprendre parfaitement l'altérité, l'idée que nous sommes inclus dans nos propres exotismes, des étrangers - y compris à nous-mêmes - qui passons tout le temps possible à nous ignorer, à nous refuser, nous comprendre, les uns les autres, soi. Et puis, il y a ce complet désaxement voulu par Saer - qui plaçait le centre même de la civilisation argentine, pour ne pas dire la création du monde dans ces entrelacs de fleuves et de pampa -, ce renversement sidérant mais génial par lequel la civilisation la plus sensationnelle, la plus riche, la plus entière n'est pas la notre mais celle de ces amérindiens qui, pour autant, ont presque intégralement disparus de la cartographie humaine.
Que dire de plus qui ne l'a déjà été sur ce roman fleuve stricto sensu ? Que c'est un roman historique et que ce n'en est pas un... Que c'est un roman qui se situe dans la grande lignée des romans picaresques espagnols et latino-espagnols - il en respecte presque tous les codes : récit à la première personne, personnage d'humble extraction, initiation, le maître enfin trouvé à qui l'on doit tout, le picaro devenu vieux qui revient sur son passé, - pourtant c'est bien au-delà que ce situe aussi ce texte... Que c'est une fable philosophique, sans nul doute, mais alors d'une langue tellement personnelle et, par bien des aspects, poétique, qu'il est absolument incertain que le moindre philosophe s'y retrouve tout à fait... Juan José Saer, à qui l'argentine vient de dédié l'année 2017 (on n'ose imaginer une "année Perec", une "année Bataille" ou autre "année Calaferte" chez nous...) savait aussi bien transcender les genres que troubler les certitudes. Il démontrait, avec une rare intelligence, dans ce qui fut-là son sixième roman, à quel point il était encore possible de parvenir à cet impossible gageure de donner sens et vie à cette littérature contemporaine que l'on prétend souvent - pas forcément sans preuve ni raison - moribonde. Remercions aussi, au passage, l'idée excellente de cette jeune et belle maison d'édition - le tripode - d'avoir redonné visibilité à ce texte tout bonnement incroyable, et cette maison d'édition persiste et signe qui publie ces jours-ci une édition en format "semi-poche" plus économiquement accessible. Quant à la traduction, sans être hispanophone, celle reprise ici est à saluer sans nul doute. On pressent comme Laure Bataillon (qui reçut alors le prix de la meilleure traduction remis par la MEET, organisme qui décida plus tard de nommer ce prix du nom de cette traductrice de talent, en manière d'hommage après sa disparition) a dû batailler pour rendre dans notre langue un texte si complexe et si particulier. Et, avouons-le, plus de quinze jours après en avoir lu la dernière ligne, ce texte nous hante encore de sa puissance et de sa désarmante intranquilité existentielle, comme l'aurait pu exprimer son prédécesseur lusophone Fernando Pessoa. Il nous hante d'autant plus qu'une seule lecture ne semble en rien pouvoir le résoudre, le contraindre, le domestiquer tout à fait, laissant le lecteur non pas insatisfait - de savoir qu'il recèle encore bien des secrets - mais plus assurément qu'il lui ouvre des univers presque jamais entrevus et qui demandent à être parcourus. Ardemment.
Décidément, nous sommes bien les sauvages de ce monde : « On peut dire que, depuis que les Indiens ont été anéantis, l'univers entier est parti à la dérive dans le néant. Si cet univers si peu sûr avait, pour exister, quelque raison, cette raison c'était justement les Indiens qui, au milieu de tant d'incertitudes, étaient ce qui semblait le plus certain. Les appeler sauvages est une preuve d'ignorance ; on ne peut appeler sauvages des êtres qui assumaient un telle responsabilité.»
«A cette époque, la mode était aux Indes car cela faisait presque vingt ans qu'on avait découvert le pouvoir de les atteindre par le ponant.» C'est pour de telles raisons que, lorsqu'on est un gamin orphelin de l'Espagne du début du XVIème siècle, siècle que l'on surnommera bientôt "d'or", bien qu'il se construisit sur des monceaux de cadavres et la mise en coupe réglée des trésors découverts aux Amériques, on décide de s'embarquer comme mousse à bord d'une de ces caravelles, porteuses de rêve et de richesses. le navire va accoster dans cette Amérique latine encore presque parfaitement inconnue - 1492, c'était presque hier - dans le Cône sud plus précisément, entre les fleuves Paraná et Uruguay. A peine le capitaine et quelques-uns de ses hommes ont-ils mis le pied à terre qu'ils se font massacrer par une tribu d'indiens cannibales. Un seul en réchappe, le mousse Francisco del Puerto, 15 ans, qui, captif (mais est-il véritablement captif ?) vivra avec les indiens pendant dix ans avant d'être récupéré, avec l'aide des indiens eux-mêmes, par une nouvelle expédition. Un détail, cependant : Les Indiens, dans ce coin du Rio de la Plata, sont cannibales, mais ils ont pour habitude de laisser la vie sauve à l'un de leurs prisonniers, pris au hasard. C'est ce qui expliquera la raison de cette survie que le petit marin espagnol, qui fut malmené et violé par les hommes d'équipage lors de la traversée, ne parvient d'abord pas à comprendre.
De retour en Espagne, il apprendra à lire et à écrire dans un couvent, ayant la chance de croiser un clerc plus fin, plus intelligent et intègre que la majorité de ses semblables. À la mort de ce dernier - d'abus de boisson mais aussi d'un trop grand appétit de vivre - le jeune homme devient vagabond puis, un peu malgré lui et très fortuitement, membre d'une troupe de théâtre qui fini par s'enrichir en jouant sur scène une retranscription tellement libre qu'elle en devient aussi fausse que fantasmatique de sa vie chez les indiens de la pampa. La trajectoire du petit mousse est une ascension inespérée. Mais c'est aussi l'histoire d'un désenchantement que ce héros bien malgré lui nous conte, à la première personne, tandis qu'installé avec ses enfants adoptifs et ses petits enfants, il tâche de se souvenir et, entre les lignes, de comprendre ce parcours en tout point atypique, écartelé, déviant.
Quoi qu'assez bref, deux cent pages d'une impressionnante densité, et d'un style incroyable, sinueux, entrecoupé d'innombrables virgules-rizhomes, fluctuant, aussi méandreux que ces fleuves où Juan José Saer situe, de facto, l'origine du monde, de son monde et de l'Argentine, du centre épiphanique de l'univers possiblement, une plume qui semble, par moment, être susceptible de suspendre le temps, de l'incurver, le rendre à merci, lui donner de cette longueur, de cette trompeuse langueur que l'on retrouve peut-être parfois chez Marcel Proust même si pour pour d'autres raisons, ce bien qu'assez bref, disions-nous, les univers développés par l'auteur sont d'une richesse en tout point incalculable. le texte se divise, peu ou prou, en trois temps :
Le premier temps, sans doute le plus éprouvant mais aussi le plus fascinant, c'est celui de ces premières heures, celui du "def-ghi" qui n'a encore qu'une très mince conscience de ce qu'il est, qui va connaitre néanmoins une sorte de seconde naissance en assistant aux prémices préparatoires puis à l'accomplissement d'une monstrueuse scénographie orgiaque, dantesque, invraisemblable au cours de laquelle ses compagnons vont être patiemment préparés, désossés, assaisonnés puis cuits pour être consommés dans un moment de frénésie occulte durant lequel les acteurs sont tour à tour obnubilés puis abattus dans leur propre désir à dévorer sans fin - sans faim ? - ce repas incroyable. La suite sera plus licencieuse encore, dépravée même, sado-masochiste pourrions-nous préciser, - où s'entremêle onanisme débridé, homosexualité, mélangisme, inceste - n'était l'absence totale de volonté première, d'idée de faute ou d'interdit moral, pour s'adonner à des plaisirs illicites finalement très nôtres ; et puis les indiens semblent être alors sous le pouvoir d'une boisson fatale qui les met strictement hors d'eux-mêmes au point que d'aucuns en meurent, ne commandant plus rien de leurs actes, se perdant définitivement dans les marais, chutant lourdement, se blessant grièvement, finissant par tomber dans une espèce de catatonie. Cependant, nul jugement de la part de notre jeune homme, maintenant tout au long de cette orgasmique journée une imperturbable distance d'observateur pour ainsi dire anthropologique, une fois les premiers temps de la sidération passés, et comme si le voile d'incompréhension totale dans lequel il flottait l'empêchait d'éprouver le moindre sentiment tant à l'égard de ses compagnons massacrés puis engloutis que durant les scènes dionysiaques qui suivirent. Une fois cette imitation de nouvelle naissance accomplie, le narrateur exposera, dans ce journal qui n'en est pas un, l'essentiel de son existence chez ces amérindiens qui devienne dans leur quotidien et une fois leur monstrueuse agapè accomplie, l'antithèse absolue de ces heures folles.
Là, à rebours de ces bacchanales, leur vie est absolument strictement rangée - jusqu'à une maniaquerie certaine, qui les pousse à nettoyer, balayer, réparer, arranger sans cesse leur médiocre quotidien - , le sexe est alors banni de toute vie publique et semble n'être pratiqué que de la manière la plus fugace dans le privé. Ils s'avèrent par ailleurs d'une grande courtoisie, d'un calme que rien ne met en défaut, d'une solidarité permanente, d'une équanimité sans faille. Seulement, un fois l'an ou peu s'en faut, leurs hourvaris frénétiques les reprennent. Une chasse à l'homme est pratiquée auprès des tribus alentour. C'est d'ailleurs à cette occasion que l'ancien matelot comprendra peu à peu ce qu'il en est d'être un "def-ghi", puisqu'il s'en trouve un à chaque nouveau festin cérémoniel. Ceux-ci semblent d'ailleurs prendre leur rôle très à coeur avant que d'être renvoyés dans leurs pénates et finissent même souvent par toiser l'espagnol, pauvre "reflet" (c'est un des sens du mot) sans but... Voilà pour ce que c'est, avec tout l'incertain de l'exercice :
«On disait def-ghi des personnes absentes ou endormies ; des indiscrets qui, durant une visite, au lieu de rester chez l'autre un temps prudent, s'attardaient indéfiniment ; on appelait aussi def-ghi un oiseau à bec noir et au plumage jaune et vert, qu'on apprivoisait et qui faisait rire parce qu'il répétait, comme s'il eût parlé, les mots qu'on lui avait appris ; def-ghi, c'étaient aussi certains objets qu'on mettait à la place d'une personne absente et qui la représentaient dans les réunions […] ; de même façon on appelait def-ghi le reflet des choses dans l'eau ; une chose qui durait c'était def-ghi […]
Def-ghi, c'était tout cela et bien d'autres choses encore. Après de longues réflexions, je déduisis que, s'ils m'avaient donné ce nom, c'était parce qu'ils me rendaient solidaire de quelque essence commune à tout ce qu'ils nommaient ainsi. Ils attendaient de moi que je pusse dédoubler, ainsi que l'eau, l'image qu'ils donnaient d'eux-mêmes, répéter leurs gestes et leurs paroles, les représenter en leur absence et que je fusse capable, quand ils me rendraient à mes semblables, de faire comme l'espion ou l'éclaireur qui, après avoir été témoin de choses que la tribu n'a pu voir, revient sur ses pas pour raconter toutes choses en détails à tous. […] ils voulaient que de leur passage à travers ce mirage restât un témoin et un survivant qui fût, à la face du monde, leur narrateur.»
Le second temps est, dans une large mesure, plus rugueux. Plus sombre aussi, contre toute attente (après tout, ne rentre-t-il pas "chez lui" ?). Car le retour à la supposée civilisation n'est pas le moment attendu (y compris par le lecteur) des réjouissances, des retrouvailles avec un monde en absence. S'il rencontre un bon père qui comprend et son désarroi et ses capacités, c'est bien le seul qui s'interessera à lui, autrement que comme "celui qui était chez les sauvages". Par lui, il apprendra à lire et à écrire mais, plus que cela, il pourra envisager le recul lié à l'apprentissage du verbe vrai - par rapport à lui-même et, plus encore, vis à vis de ses contemporains - mais son maître disparaissant inopinément mais assez vite de la surface de la terre, notre homme va vivre une vie de vagabondage puis, par le hasard d'une rencontre, il va suivre et même donner la matière principale d'une pièce qui sera jouée dans l'Espagne toute entière puis dans le reste de l'Europe, mais une pièce qui n'a rien à voir avec ce qu'il a véritablement, fondamentalement vécu, éprouvé, une création où le sujet n'est pas son expérience ni même lui, mais la vision que ses contemporains immédiats ont de ces fameux sauvages. le retournement s'accompli lentement mais surement : cette supposée civilisation ne serait-elle en vérité que celle des sauvages que nous sommes ? Un monde de mensonge, d'imposture (à laquelle il prend part, par faiblesse, par facilité, par ennui de tout, par désenchantement), d'abus et d'intérêts vils, mesquins, sonnants et trébuchants. Voici ce qu'il dit des nouveaux sauvages qui l'entourent : «ces enveloppes vides qui prétendent s'appeler hommes» ou encore «depuis le jour où ils m'avaient renvoyé, je n'avais rencontré, à part le Père Quesada, que des êtres étranges et problématiques auxquels seule l'habitude ou la convention pouvait faire appliquer le nom d'hommes.» La messe est dite, et ce sont cinquante années qui vont défiler comme d'un rien, parce qu'en vérité, elles ne sont presque rien pour ce personnage ayant connu une sorte d'illumination, sans même qu'il s'en soit encore aperçu tout à fait.
C'est enfin un homme fait, globalement "achevé", dans le sens où il l'a réellement décidé, cette fois, plus qu'en raison de l'âge atteint, la soixantaine avancée, que l'on retrouve dans l'ultime partie - précisons que rien n'est aussi clairement délimité dans "L'ancêtre" qui ne connait ni chapitre ni franche disruption, à l'exception de deux ou trois événements fondateurs. Tout juste quelques changements de rythme bien souvent liés au changement de géographie personnelle du narrateur, plus qu'à des ruptures stylistiques ou narratives. A soixante ans passés, retiré de tout, le narrateur couche par écrit son interprétation – bien différente certainement de celle que tirerait la plupart de ses contemporains - du mode de vie des indiens et de leur conception du monde. Il se remémore, pour autant qu'il le peut, pour autant que SA vision puisse être LA vision de la réalité passée - Rien, chez Juan José Saer, ne laisse à penser qu'un témoignage puisse être véridique, objectif, universel. Rien moins que la réalité peut être réalité ! L'incertain, plus que l'incertitude, est de tous les instants, la réalité n'est pas en soi un mensonge mais le mensonge peut lui aussi s'avérer réalité. Ainsi, dans une certaine mesure, la mise en scène de son expérience sur les planches, tout maquillage fut-elle, devient-elle pourtant une certaine forme de réalité, au moins pour ceux qui l'on reçue, l'ont admise, l'ont souhaitée comme telle -. Cet homme devenu vieillard se remémore ainsi ces dix années passée aux côtés, souvent sans les comprendre, ou seulement après coup, ne serait-ce qu'en raison du verbe, de cette poignée d'indiens pour qui le centre de l'univers n'était autre qu'eux-mêmes et les quelques arpents de terres qu'ils ne voulaient abandonner pour rien au monde, ces rivages situés entre marais, fleuve et étendue morne. Il comprend, par un effort inouï de dépaysement, de décentrement de tout ce qui le constitue, à quel point ces supposés sauvages sont en réalité des civilisés accomplis tandis que nous sommes les sauvages - qui plus est, plutôt mauvais, idiots, ignorants et violents - ; il comprend peu à peu leur espèce de calme permanent, il envisage aussi que ce langage, qu'il a dû tâcher de comprendre difficultueusement tout au long de ces dix précieuses années de véritable re-naissance, avait tout autant valeur que celui qu'il tenait de sa mère - de ce point de vue, cet ouvrage est un exercice multiple et savamment enchevêtré autour de la langue, du langage, de son éthique, de sa philosophie, pour ainsi dire de la cosmogonie qui environne toute locution, en un mot, de toute sa magie, au sens ésotérique et mystique. Il a saisi toute la valeur de cette humanité dont il affirme que s'ils vivaient et «[...] agissaient de cette façon, c'est parce qu'ils avaient éprouvé, à quelque moment, avant de se sentir différents du monde, le poids du néant.»
D'une expérience incommunicable, le narrateur, dont on ne peut douter qu'il ne s'agisse pas de son créateur moderne, essaie de rendre compte des niveaux complexes que comporte toute réalité. Ce vieil homme, né par deux fois, et par deux fois dans la douleur mais par deux fois sans qu'il en résulte de souffrance directement éprouvée, dicible, aborde quelques unes des questions fondamentales qui traversent notre temps : La difficulté relative à tout langage, bien sûr, et, à travers le langage, à la possibilité même de rendre compte de ce qui est, de ce qui fut, de ce que l'on a éprouvé, vécu, à l'autre, l'autre fut-il soi-même ; L'impossibilité ontologique à comprendre parfaitement l'altérité, l'idée que nous sommes inclus dans nos propres exotismes, des étrangers - y compris à nous-mêmes - qui passons tout le temps possible à nous ignorer, à nous refuser, nous comprendre, les uns les autres, soi. Et puis, il y a ce complet désaxement voulu par Saer - qui plaçait le centre même de la civilisation argentine, pour ne pas dire la création du monde dans ces entrelacs de fleuves et de pampa -, ce renversement sidérant mais génial par lequel la civilisation la plus sensationnelle, la plus riche, la plus entière n'est pas la notre mais celle de ces amérindiens qui, pour autant, ont presque intégralement disparus de la cartographie humaine.
Que dire de plus qui ne l'a déjà été sur ce roman fleuve stricto sensu ? Que c'est un roman historique et que ce n'en est pas un... Que c'est un roman qui se situe dans la grande lignée des romans picaresques espagnols et latino-espagnols - il en respecte presque tous les codes : récit à la première personne, personnage d'humble extraction, initiation, le maître enfin trouvé à qui l'on doit tout, le picaro devenu vieux qui revient sur son passé, - pourtant c'est bien au-delà que ce situe aussi ce texte... Que c'est une fable philosophique, sans nul doute, mais alors d'une langue tellement personnelle et, par bien des aspects, poétique, qu'il est absolument incertain que le moindre philosophe s'y retrouve tout à fait... Juan José Saer, à qui l'argentine vient de dédié l'année 2017 (on n'ose imaginer une "année Perec", une "année Bataille" ou autre "année Calaferte" chez nous...) savait aussi bien transcender les genres que troubler les certitudes. Il démontrait, avec une rare intelligence, dans ce qui fut-là son sixième roman, à quel point il était encore possible de parvenir à cet impossible gageure de donner sens et vie à cette littérature contemporaine que l'on prétend souvent - pas forcément sans preuve ni raison - moribonde. Remercions aussi, au passage, l'idée excellente de cette jeune et belle maison d'édition - le tripode - d'avoir redonné visibilité à ce texte tout bonnement incroyable, et cette maison d'édition persiste et signe qui publie ces jours-ci une édition en format "semi-poche" plus économiquement accessible. Quant à la traduction, sans être hispanophone, celle reprise ici est à saluer sans nul doute. On pressent comme Laure Bataillon (qui reçut alors le prix de la meilleure traduction remis par la MEET, organisme qui décida plus tard de nommer ce prix du nom de cette traductrice de talent, en manière d'hommage après sa disparition) a dû batailler pour rendre dans notre langue un texte si complexe et si particulier. Et, avouons-le, plus de quinze jours après en avoir lu la dernière ligne, ce texte nous hante encore de sa puissance et de sa désarmante intranquilité existentielle, comme l'aurait pu exprimer son prédécesseur lusophone Fernando Pessoa. Il nous hante d'autant plus qu'une seule lecture ne semble en rien pouvoir le résoudre, le contraindre, le domestiquer tout à fait, laissant le lecteur non pas insatisfait - de savoir qu'il recèle encore bien des secrets - mais plus assurément qu'il lui ouvre des univers presque jamais entrevus et qui demandent à être parcourus. Ardemment.
Décidément, nous sommes bien les sauvages de ce monde : « On peut dire que, depuis que les Indiens ont été anéantis, l'univers entier est parti à la dérive dans le néant. Si cet univers si peu sûr avait, pour exister, quelque raison, cette raison c'était justement les Indiens qui, au milieu de tant d'incertitudes, étaient ce qui semblait le plus certain. Les appeler sauvages est une preuve d'ignorance ; on ne peut appeler sauvages des êtres qui assumaient un telle responsabilité.»