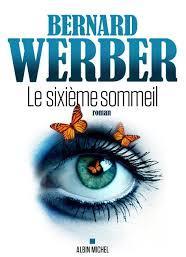>
Critique de hervethro
Après nous avoir fait découvrir le monde intriguant des fourmis et, par la même occasion, nous obliger à rester des heures à contempler les fourmilières de la forêt; après avoir voulu savoir ce qui ce cachait derrière cette porte qu'on ne franchit qu'une fois et qu'on appelle la mort; après s'être plongé dans les mystères du cerveau humain et enquêté sur les mécanismes du rire; après avoir joué aux Dieux comme dans un jeu vidéo, élaborant des ébauches de sociétés idéales; après être parti à la recherche du chainon manquant dans la fantastique évolution de l'homme et, inversement, après avoir imaginé le futur de l'humanité en mettant en scène une nouvelle espèce humaine, miniaturisée; après avoir traversé l'espace fuyant une Terre devenue inhabitable vers un monde inconnu, voici que Werber entend nous faire rêver…
J'entends par là nous emmener à comprendre pourquoi et comment nous rêvons.
C'est un sujet qui me passionne, à tel point que j'avais même imaginé qu'un jour pas si lointain, nous pourrions, nous autres humains, inventer le cinérêve : de longs métrages issus directement de l'onirisme de metteurs en scène un peu particulier. Et je découvre que mon idée a été lâchement volée par l'écrivain scientifique! En réalité, ce n'est que la preuve de l'existence de la Noosphère, concept décrit par Teillard de Chardin, expliquant une zone de pensée collective où les idées se répandent comme des têtards dans un étang : ce qui explique qu'une invention peut être découverte à plusieurs endroits à la fois, qu'un concept nait dans plusieurs cerveaux en même temps.
Comme toujours chez Werber, il y a un côté explorateur. Et, cette fois, c'est une fois de trop. On retrouve cette quête, cette conquête déjà mise en scène dans les Thanatonautes. Et c'est pesant. Loin des délires psychotiques à la Philip K. Dick, Werber traite le monde du rêve comme celui de la mort : des pionniers tentent d'aller voir ce qui se cache derrière…
Quiconque a déjà lu au moins un livre de l'auteur comprendra aisément que ça sent le réchauffé, d'autant que, en bon professeur, Werber n'hésite pas à ressasser ses leçons, à répéter à l'envi pour que le cours soit bien enregistré.
On pense aussi au Grand Bleu de Luc Besson; la plongée dans le sommeil et, accessoirement les rêves, est décrite comme une descente vers les abysses. du coup, le héros m'est apparu dès le départ sous les traits du jeune Jean Marc Barr (dont on peut noter quelques similitudes avec le profil de Werber - encore une conséquence de la fameuse Noosphère?). Trop mécanique, trop mathématique pour un domaine qui, justement, échappe à toute rationalité.
Bien évidemment, on ne peut parler de « style » Werber. Il est inexistant d'un point de vue purement littéraire. Mais les tics d'écriture rendent encore plus lourd, parfois ridicule, le propos. Ainsi « ils échangèrent leurs fluides vitaux » indique que le couple fait l'amour. Et puis il n'y a pas un seul bouquin de l'auteur dans lequel on n'entende pas le « Wish you were here » des Pink Floyd auquel il voue une passion sans limite. Lorsqu'il est question d'un journaliste, c'est forcément une jeune femme brune. Tous ces rictus qui devraient faire sourire et établir une complicité avec l'auteur, ne font qu'agacer le lecteur habitué.
Enfin, et c'est vraiment dommage pour des propos vaguement scientifiques, l'histoire est truffée d'invraisemblances. Ainsi le peuple Senoï, champions du sommeil, adeptes du rêve lucide (quand on peut diriger ses propres rêves) vivants sur une ile de Malaisie utilisent et jonglent avec nos concepts occidentaux avec une trop grande facilité. Comment une tribu aussi éloignée de nos moeurs et nos préoccupations pourrait saisir des notions aussi particulières que technologiques : télévision, circulation automobile, réseaux de communication…
Désabusé, j'ai alors mis la main sur l'excellent ouvrage d'Hervey de Saint-Denys (les rêves et les moyens de les diriger) paru en 1867, bien avant les découvertes liées au cerveau mais qui reste une bible pour quiconque a envie d'entrer dans son univers personnel, son inconscient. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, je renvoie aux publications de Michel Jouvet, le spécialiste de l'onirisme en France (je vous parlerai de ces deux ouvrages plus en détail).
Cette exploration du plus profond de soi-même laisse sur notre faim. Nulle part cette folie inhérente au domaine du rêve - justement, tout est permis - ni bouleversements ni revirements qui mettent la tête à l'envers et jouent avec notre entendement. Werber reste trop sage pour une fois, tente-t-il de jouer un brin avec le voyage dans le temps.
A côté de ça, on lui doit un nouveau mot dans la langue française : Jubjoter. Pour indiquer cette possibilité que possèdent quelques rares adeptes du rêve lucide à revenir à l'endroit même de son rêve précédent, comme on poursuit la vision d'un film ultérieurement. Jusqu'à ce qu'on parcourt la traditionnelle page des remerciements. Jubjoter n'est pas sorti des neurones de Werber mais du « Baleinié, dictionnaire des tracas » de Christine Murillo, Claude Leguay et Grégoire Oestermann.
Cependant, Werber vous incite à noter vos rêves en laissant une liasse de pages blanches à la fin du roman. Excellente idée. Car à l'intérieur de votre propre cerveau se cache peut-être, surement même, le plus inventif des romans, le plus sensationnel film que vous n'avez jamais lu ou vu.
Peut-être était-ce mon Werber de trop? Là où je m'émerveillais de trouvailles loufoques, je n'y ai vu cette fois que du rabâché, du ressassé, du réchauffé. Là où les rebondissements me donnaient le vertige, je n'ai pu que constater que les scènes d'action étaient bien plates et souvent pas du tout haletantes, comme si Werber avait hâte de passer à autre chose. Bref, je n'ai vu dans cette prose que les défauts. Désolé.
J'entends par là nous emmener à comprendre pourquoi et comment nous rêvons.
C'est un sujet qui me passionne, à tel point que j'avais même imaginé qu'un jour pas si lointain, nous pourrions, nous autres humains, inventer le cinérêve : de longs métrages issus directement de l'onirisme de metteurs en scène un peu particulier. Et je découvre que mon idée a été lâchement volée par l'écrivain scientifique! En réalité, ce n'est que la preuve de l'existence de la Noosphère, concept décrit par Teillard de Chardin, expliquant une zone de pensée collective où les idées se répandent comme des têtards dans un étang : ce qui explique qu'une invention peut être découverte à plusieurs endroits à la fois, qu'un concept nait dans plusieurs cerveaux en même temps.
Comme toujours chez Werber, il y a un côté explorateur. Et, cette fois, c'est une fois de trop. On retrouve cette quête, cette conquête déjà mise en scène dans les Thanatonautes. Et c'est pesant. Loin des délires psychotiques à la Philip K. Dick, Werber traite le monde du rêve comme celui de la mort : des pionniers tentent d'aller voir ce qui se cache derrière…
Quiconque a déjà lu au moins un livre de l'auteur comprendra aisément que ça sent le réchauffé, d'autant que, en bon professeur, Werber n'hésite pas à ressasser ses leçons, à répéter à l'envi pour que le cours soit bien enregistré.
On pense aussi au Grand Bleu de Luc Besson; la plongée dans le sommeil et, accessoirement les rêves, est décrite comme une descente vers les abysses. du coup, le héros m'est apparu dès le départ sous les traits du jeune Jean Marc Barr (dont on peut noter quelques similitudes avec le profil de Werber - encore une conséquence de la fameuse Noosphère?). Trop mécanique, trop mathématique pour un domaine qui, justement, échappe à toute rationalité.
Bien évidemment, on ne peut parler de « style » Werber. Il est inexistant d'un point de vue purement littéraire. Mais les tics d'écriture rendent encore plus lourd, parfois ridicule, le propos. Ainsi « ils échangèrent leurs fluides vitaux » indique que le couple fait l'amour. Et puis il n'y a pas un seul bouquin de l'auteur dans lequel on n'entende pas le « Wish you were here » des Pink Floyd auquel il voue une passion sans limite. Lorsqu'il est question d'un journaliste, c'est forcément une jeune femme brune. Tous ces rictus qui devraient faire sourire et établir une complicité avec l'auteur, ne font qu'agacer le lecteur habitué.
Enfin, et c'est vraiment dommage pour des propos vaguement scientifiques, l'histoire est truffée d'invraisemblances. Ainsi le peuple Senoï, champions du sommeil, adeptes du rêve lucide (quand on peut diriger ses propres rêves) vivants sur une ile de Malaisie utilisent et jonglent avec nos concepts occidentaux avec une trop grande facilité. Comment une tribu aussi éloignée de nos moeurs et nos préoccupations pourrait saisir des notions aussi particulières que technologiques : télévision, circulation automobile, réseaux de communication…
Désabusé, j'ai alors mis la main sur l'excellent ouvrage d'Hervey de Saint-Denys (les rêves et les moyens de les diriger) paru en 1867, bien avant les découvertes liées au cerveau mais qui reste une bible pour quiconque a envie d'entrer dans son univers personnel, son inconscient. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, je renvoie aux publications de Michel Jouvet, le spécialiste de l'onirisme en France (je vous parlerai de ces deux ouvrages plus en détail).
Cette exploration du plus profond de soi-même laisse sur notre faim. Nulle part cette folie inhérente au domaine du rêve - justement, tout est permis - ni bouleversements ni revirements qui mettent la tête à l'envers et jouent avec notre entendement. Werber reste trop sage pour une fois, tente-t-il de jouer un brin avec le voyage dans le temps.
A côté de ça, on lui doit un nouveau mot dans la langue française : Jubjoter. Pour indiquer cette possibilité que possèdent quelques rares adeptes du rêve lucide à revenir à l'endroit même de son rêve précédent, comme on poursuit la vision d'un film ultérieurement. Jusqu'à ce qu'on parcourt la traditionnelle page des remerciements. Jubjoter n'est pas sorti des neurones de Werber mais du « Baleinié, dictionnaire des tracas » de Christine Murillo, Claude Leguay et Grégoire Oestermann.
Cependant, Werber vous incite à noter vos rêves en laissant une liasse de pages blanches à la fin du roman. Excellente idée. Car à l'intérieur de votre propre cerveau se cache peut-être, surement même, le plus inventif des romans, le plus sensationnel film que vous n'avez jamais lu ou vu.
Peut-être était-ce mon Werber de trop? Là où je m'émerveillais de trouvailles loufoques, je n'y ai vu cette fois que du rabâché, du ressassé, du réchauffé. Là où les rebondissements me donnaient le vertige, je n'ai pu que constater que les scènes d'action étaient bien plates et souvent pas du tout haletantes, comme si Werber avait hâte de passer à autre chose. Bref, je n'ai vu dans cette prose que les défauts. Désolé.