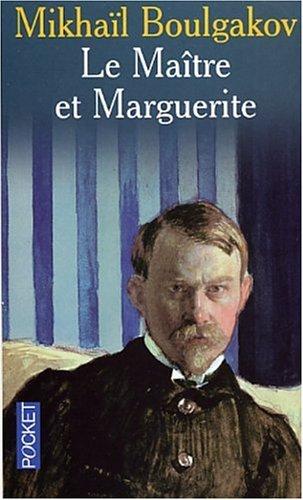>
Critique de AnnaCan
"Cet engouement débauché pour la force maligne, cette parenté avec Gogol par tant de traits et de parti pris du talent : ça venait d'où ? Ça s'expliquait comment ? Et quel étonnant traitement du récit évangélique avec cet abaissement du Christ, les yeux de Satan ! A quelle fin ? Comment le comprendre ?"
Alexandre Soljénitsyne
Cet engouement débauché pour le diable, cette parenté avec Gogol et aussi avec Molière que Boulgakov admirait passionnément et auquel il consacra un roman autobiographique, ça vient d'où, en effet ? de son goût immodéré pour le comique? Lui-même sorte de réflexe d'auto-défense face à l'absurdité totale dans laquelle plongea son existence à compter de 1917, date à laquelle sa ville natale, Kiev, devint le théâtre de sanglants combats pour finalement tomber, trois ans plus tard, entre les mains des soviétiques? Obligeant Boulgakov, non seulement à quitter Kiev, mais à tourner définitivement le dos à la médecine ainsi qu'à un passé hautement suspicieux de « blanc »? le fait est qu'il s'installa à Moscou où il devint journaliste satirique, puis dramaturge, tout en se mettant à écrire des nouvelles qui, très vite, lui valurent une pluie d'injures de la part des critiques inféodés au régime, maille à partir avec la censure et bien entendu, de graves ennuis avec les autorités.
Quand, exactement, prit forme dans l'esprit de Boulgakov l'idée d'un « roman sur le diable »? Nul ne le sait vraiment. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il commença à l'écrire à la toute fin des années vingt, et qu'au terme de dix années d'écriture et de remaniements, considérablement affaibli, malade et alité, il expira peu de temps après avoir écrit le mot Fin. Il avait quarante-huit ans. Ce qu'on sait également, c'est qu'à l'instar de tous les grands artistes de son temps et de tous les libre-penseurs, il fut harcelé, vilipendé, maltraité, espionné, menacé, empêché de travailler et d'écrire, et nul doute que dans un tel monde, les forces conjuguées de l'esprit malin et du rire lui furent d'une grande aide.
Son chef-d'oeuvre le Maître et Marguerite est au moins aussi fou que le régime, démoniaque et pervers, sous lequel Boulgakov eut la malchance de vivre, mais c'est une folie hautement cocasse et divertissante, et c'est là ce qui la différencie profondément du cauchemar bureaucratique au milieu duquel se débattaient les citoyens de l'Union soviétique.
Qu'est-ce au juste que ce livre? Difficile à dire tant il foisonne d'intrigues toutes plus extravagantes les unes que les autres dissimulant plusieurs niveaux de lecture, tant il recèle de références innombrables à la littérature, à la musique, au théâtre et au mythe (l'Évangile de Matthieu, Faust, la reine Margot…). Un roman inclassable dans lequel toutes les formes de comique, du burlesque à l'autodérision, côtoient le tragique, dans lequel le fantastique le plus débridé prend toujours appui sur une observation précise et rigoureuse du réel. Un roman allègre, jubilatoire qui procure un indicible plaisir à son lecteur, et aussi un roman profondément bouleversant qui lui broie le coeur. Satire politique et roman d'amour fou, méditation sur la création et sur l'Histoire, mise en abyme avec le roman dans le roman écrit par le Maître mettant en scène le dernier jour du Christ vu par les yeux de Ponce Pilate, c'est un livre qui manifeste une liberté absolue de la part d'un homme pourtant contraint de toutes parts et cerné par la mort.
C'est, à mon avis, cette liberté explosive qui, en se communiquant au lecteur, fait de cette lecture un moment extraordinaire et mémorable. Extraordinaire pour moi en tout cas, qui plaçai ce roman au sommet de mon Panthéon personnel, en compagnie des Mandarins de Simone de Beauvoir et de Quatre soeurs de Tanizaki. J'avais alors une vingtaine d'années et quand je rencontrai quelques années plus tard celui avec lequel j'allais partager le reste de ma vie, ce fut le livre que je lui remis entre les mains. Lui, en échange, m'offrit Hyperion de Dan Simmons, et je crois pouvoir dire que notre amour avait toutes les chances de s'épanouir joyeusement avec de pareils personnages comme parrains : le diable d'un côté, le Gritch de l'autre. Bien entendu, je mentirais en vous disant que, vingt-cinq ans plus tard, je me souvenais du Maître et Marguerite. Des flashes m'étaient restés : la belle Marguerite entièrement nue survolant Moscou sur son balai brosse, la séance inénarrable de magie noire au Théâtre des Variétés, le bal de Satan, dont l'iconographie semble emprunter à la fois à la légende de Dracula et à la reine Margot… Mais par-dessus tout, ce qui m'était resté en mémoire, c'est cette liberté incroyable, exubérante, dont j'ai parlé plus haut, et qui m'a de nouveau frappée lors de ma relecture.
Liberté exubérante, donc. Rien de très étonnant au fond quand le personnage principal est le diable en personne, à peine déguisé sous les traits d'un étranger nommé Woland « professeur de magie noire », quand un tel personnage ne se déplace pas sans sa suite, un aréopage baroque et fantasque comprenant un ancien chef de choeur à carreaux portant lorgnon, un chat noir énorme « aussi gros qu'un pourceau », un individu « petit mais de carrure athlétique, aux cheveux rouges comme le feu, une taie sur un oeil, une canine saillante », enfin une servante perpétuellement nue répondant au doux nom d'Ella, provoquant toutes sortes de prodiges plus ou moins néfastes, bousculant la morne existence des moscovites et mettant la milice sur les dents.
Car « il suffit, comme on le sait, que la sorcellerie commence pour que plus rien ne l'arrête. »
Les prodiges de Woland/Satan et de sa suite, pour drôles et cocasses qu'ils soient, sont surchargés de sens. Cela dit, il n'est pas nécessaire d'en comprendre tous les sens cachés pour se régaler à la lecture d'un livre qui reste avant tout terriblement divertissant et incroyablement drôle.
Ces prodiges, donc, peuvent être vus comme l'instrument de vengeance poétique de l'auteur, puisqu'ils s'exercent en premier lieu sur ses persécuteurs dans la vraie vie, les critiques vouant aux gémonies ses écrits (ces « tâcherons de l'écriture » comme les désignait Proust), et autres apparatchiks de la culture vendus au régime. Mais ils peuvent être également perçus comme une parodie des agissements du pouvoir stalinien, les disparitions inexplicables se succédant à un train d'enfer dans le roman.
Et pour complexifier encore les choses, Boulgakov fait de Satan l'intercesseur suprême dans l'amour qui lie le Maître à Marguerite, un amour passionné directement inspiré de celui qu'il voua jusqu'à sa mort à sa troisième épouse Elena Sergueïevna.
Mais cela n'est pas encore suffisant, et c'est comme si l'auteur avait voulu soustraire Satan à toute tentative d'interprétation, inévitablement réductrice, en faisant de Lui le protecteur ultime du roman dans le roman qu'il ressuscite de ses cendres devant les yeux ébahis du Maître en prononçant ces paroles inoubliables : « les manuscrits ne brûlent pas. » du reste, il en fait plus qu'un protecteur du roman écrit par le Maître, il en fait le garant de l'histoire qu'il contient, sorte d'évangile apocryphe centré sur le personnage de Ponce Pilate et sur les tourments de celui-ci après qu'il a, par lâcheté, ordonné l'exécution du philosophe vagabond Yeshua Ha-Nozri. C'est donc le diable qui certifie que l'histoire du dernier jour du Christ telle qu'elle figure dans le manuscrit du Maître est bien conforme à la réalité historique, car lui y était.
À l'interrogation de Soljénitsyne citée en préambule (« Et quel étonnant traitement du récit évangélique avec cet abaissement du Christ, les yeux de Satan ! A quelle fin ? Comment le comprendre ? »), je risquerais une explication : en rapprochant le créateur, l'artiste, du Christ qu'il désacralise au passage, Boulgakov en fait à la fois le sauveur du monde et la victime de la lâcheté ordinaire des hommes. Car si Boulgakov croit jusqu'à son dernier souffle au pouvoir rédempteur de l'Art, il sait aussi que l'artiste, le véritable artiste, sera toujours persécuté, maltraité, assassiné. Et s'il a insufflé une énergie galvanisante dans son roman, celui-ci est également empreint d'une immense fatigue, d'une lassitude personnelle et historique qui font doucement pencher le livre du côté de la tragédie. le Christ en son dernier jour est décrit comme un personnage au bord de l'épuisement, qui, du reste, ne tente rien, même pas d'attraper la main que lui tend Pilate pour inverser le cours de son destin. Pilate lui-même, en proie à une migraine atroce, abruti par la chaleur écrasante et par l'impitoyable soleil de Judée, est tellement las qu'il doit prodiguer des efforts surhumains pour articuler une parole audible. Si la suite de Woland, en particulier les deux infatigables compères Koroviev (l'ancien chef de choeur) et Béhémoth (le chat) regorgent de trouvailles pour semer la panique dans Moscou, le diable, lui, exhale le plus souvent un air d'ennui tenace. Quant au Maître, il est, à l'instar de son créateur, au bout du rouleau : persécuté, épuisé, au bord de la folie, bien que passionnément épris de Marguerite qui tente absolument tout pour ranimer en lui la flamme, il n'aspire qu'à une chose : le repos.
« Celui qui a erré dans ces brouillards, celui qui a beaucoup souffert avant de mourir, celui qui a volé au-dessus de cette terre en portant un fardeau trop lourd, celui-là sait ! Celui-là sait, qui est fatigué. Et c'est sans regret, alors, qu'il quitte les brumes de cette terre, ses rivières et ses étangs, qu'il s'abandonne d'un coeur léger entre les mains de la mort, sachant qu'elle — et elle seule — lui apportera la paix. »
Alexandre Soljénitsyne
Cet engouement débauché pour le diable, cette parenté avec Gogol et aussi avec Molière que Boulgakov admirait passionnément et auquel il consacra un roman autobiographique, ça vient d'où, en effet ? de son goût immodéré pour le comique? Lui-même sorte de réflexe d'auto-défense face à l'absurdité totale dans laquelle plongea son existence à compter de 1917, date à laquelle sa ville natale, Kiev, devint le théâtre de sanglants combats pour finalement tomber, trois ans plus tard, entre les mains des soviétiques? Obligeant Boulgakov, non seulement à quitter Kiev, mais à tourner définitivement le dos à la médecine ainsi qu'à un passé hautement suspicieux de « blanc »? le fait est qu'il s'installa à Moscou où il devint journaliste satirique, puis dramaturge, tout en se mettant à écrire des nouvelles qui, très vite, lui valurent une pluie d'injures de la part des critiques inféodés au régime, maille à partir avec la censure et bien entendu, de graves ennuis avec les autorités.
Quand, exactement, prit forme dans l'esprit de Boulgakov l'idée d'un « roman sur le diable »? Nul ne le sait vraiment. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il commença à l'écrire à la toute fin des années vingt, et qu'au terme de dix années d'écriture et de remaniements, considérablement affaibli, malade et alité, il expira peu de temps après avoir écrit le mot Fin. Il avait quarante-huit ans. Ce qu'on sait également, c'est qu'à l'instar de tous les grands artistes de son temps et de tous les libre-penseurs, il fut harcelé, vilipendé, maltraité, espionné, menacé, empêché de travailler et d'écrire, et nul doute que dans un tel monde, les forces conjuguées de l'esprit malin et du rire lui furent d'une grande aide.
Son chef-d'oeuvre le Maître et Marguerite est au moins aussi fou que le régime, démoniaque et pervers, sous lequel Boulgakov eut la malchance de vivre, mais c'est une folie hautement cocasse et divertissante, et c'est là ce qui la différencie profondément du cauchemar bureaucratique au milieu duquel se débattaient les citoyens de l'Union soviétique.
Qu'est-ce au juste que ce livre? Difficile à dire tant il foisonne d'intrigues toutes plus extravagantes les unes que les autres dissimulant plusieurs niveaux de lecture, tant il recèle de références innombrables à la littérature, à la musique, au théâtre et au mythe (l'Évangile de Matthieu, Faust, la reine Margot…). Un roman inclassable dans lequel toutes les formes de comique, du burlesque à l'autodérision, côtoient le tragique, dans lequel le fantastique le plus débridé prend toujours appui sur une observation précise et rigoureuse du réel. Un roman allègre, jubilatoire qui procure un indicible plaisir à son lecteur, et aussi un roman profondément bouleversant qui lui broie le coeur. Satire politique et roman d'amour fou, méditation sur la création et sur l'Histoire, mise en abyme avec le roman dans le roman écrit par le Maître mettant en scène le dernier jour du Christ vu par les yeux de Ponce Pilate, c'est un livre qui manifeste une liberté absolue de la part d'un homme pourtant contraint de toutes parts et cerné par la mort.
C'est, à mon avis, cette liberté explosive qui, en se communiquant au lecteur, fait de cette lecture un moment extraordinaire et mémorable. Extraordinaire pour moi en tout cas, qui plaçai ce roman au sommet de mon Panthéon personnel, en compagnie des Mandarins de Simone de Beauvoir et de Quatre soeurs de Tanizaki. J'avais alors une vingtaine d'années et quand je rencontrai quelques années plus tard celui avec lequel j'allais partager le reste de ma vie, ce fut le livre que je lui remis entre les mains. Lui, en échange, m'offrit Hyperion de Dan Simmons, et je crois pouvoir dire que notre amour avait toutes les chances de s'épanouir joyeusement avec de pareils personnages comme parrains : le diable d'un côté, le Gritch de l'autre. Bien entendu, je mentirais en vous disant que, vingt-cinq ans plus tard, je me souvenais du Maître et Marguerite. Des flashes m'étaient restés : la belle Marguerite entièrement nue survolant Moscou sur son balai brosse, la séance inénarrable de magie noire au Théâtre des Variétés, le bal de Satan, dont l'iconographie semble emprunter à la fois à la légende de Dracula et à la reine Margot… Mais par-dessus tout, ce qui m'était resté en mémoire, c'est cette liberté incroyable, exubérante, dont j'ai parlé plus haut, et qui m'a de nouveau frappée lors de ma relecture.
Liberté exubérante, donc. Rien de très étonnant au fond quand le personnage principal est le diable en personne, à peine déguisé sous les traits d'un étranger nommé Woland « professeur de magie noire », quand un tel personnage ne se déplace pas sans sa suite, un aréopage baroque et fantasque comprenant un ancien chef de choeur à carreaux portant lorgnon, un chat noir énorme « aussi gros qu'un pourceau », un individu « petit mais de carrure athlétique, aux cheveux rouges comme le feu, une taie sur un oeil, une canine saillante », enfin une servante perpétuellement nue répondant au doux nom d'Ella, provoquant toutes sortes de prodiges plus ou moins néfastes, bousculant la morne existence des moscovites et mettant la milice sur les dents.
Car « il suffit, comme on le sait, que la sorcellerie commence pour que plus rien ne l'arrête. »
Les prodiges de Woland/Satan et de sa suite, pour drôles et cocasses qu'ils soient, sont surchargés de sens. Cela dit, il n'est pas nécessaire d'en comprendre tous les sens cachés pour se régaler à la lecture d'un livre qui reste avant tout terriblement divertissant et incroyablement drôle.
Ces prodiges, donc, peuvent être vus comme l'instrument de vengeance poétique de l'auteur, puisqu'ils s'exercent en premier lieu sur ses persécuteurs dans la vraie vie, les critiques vouant aux gémonies ses écrits (ces « tâcherons de l'écriture » comme les désignait Proust), et autres apparatchiks de la culture vendus au régime. Mais ils peuvent être également perçus comme une parodie des agissements du pouvoir stalinien, les disparitions inexplicables se succédant à un train d'enfer dans le roman.
Et pour complexifier encore les choses, Boulgakov fait de Satan l'intercesseur suprême dans l'amour qui lie le Maître à Marguerite, un amour passionné directement inspiré de celui qu'il voua jusqu'à sa mort à sa troisième épouse Elena Sergueïevna.
Mais cela n'est pas encore suffisant, et c'est comme si l'auteur avait voulu soustraire Satan à toute tentative d'interprétation, inévitablement réductrice, en faisant de Lui le protecteur ultime du roman dans le roman qu'il ressuscite de ses cendres devant les yeux ébahis du Maître en prononçant ces paroles inoubliables : « les manuscrits ne brûlent pas. » du reste, il en fait plus qu'un protecteur du roman écrit par le Maître, il en fait le garant de l'histoire qu'il contient, sorte d'évangile apocryphe centré sur le personnage de Ponce Pilate et sur les tourments de celui-ci après qu'il a, par lâcheté, ordonné l'exécution du philosophe vagabond Yeshua Ha-Nozri. C'est donc le diable qui certifie que l'histoire du dernier jour du Christ telle qu'elle figure dans le manuscrit du Maître est bien conforme à la réalité historique, car lui y était.
À l'interrogation de Soljénitsyne citée en préambule (« Et quel étonnant traitement du récit évangélique avec cet abaissement du Christ, les yeux de Satan ! A quelle fin ? Comment le comprendre ? »), je risquerais une explication : en rapprochant le créateur, l'artiste, du Christ qu'il désacralise au passage, Boulgakov en fait à la fois le sauveur du monde et la victime de la lâcheté ordinaire des hommes. Car si Boulgakov croit jusqu'à son dernier souffle au pouvoir rédempteur de l'Art, il sait aussi que l'artiste, le véritable artiste, sera toujours persécuté, maltraité, assassiné. Et s'il a insufflé une énergie galvanisante dans son roman, celui-ci est également empreint d'une immense fatigue, d'une lassitude personnelle et historique qui font doucement pencher le livre du côté de la tragédie. le Christ en son dernier jour est décrit comme un personnage au bord de l'épuisement, qui, du reste, ne tente rien, même pas d'attraper la main que lui tend Pilate pour inverser le cours de son destin. Pilate lui-même, en proie à une migraine atroce, abruti par la chaleur écrasante et par l'impitoyable soleil de Judée, est tellement las qu'il doit prodiguer des efforts surhumains pour articuler une parole audible. Si la suite de Woland, en particulier les deux infatigables compères Koroviev (l'ancien chef de choeur) et Béhémoth (le chat) regorgent de trouvailles pour semer la panique dans Moscou, le diable, lui, exhale le plus souvent un air d'ennui tenace. Quant au Maître, il est, à l'instar de son créateur, au bout du rouleau : persécuté, épuisé, au bord de la folie, bien que passionnément épris de Marguerite qui tente absolument tout pour ranimer en lui la flamme, il n'aspire qu'à une chose : le repos.
« Celui qui a erré dans ces brouillards, celui qui a beaucoup souffert avant de mourir, celui qui a volé au-dessus de cette terre en portant un fardeau trop lourd, celui-là sait ! Celui-là sait, qui est fatigué. Et c'est sans regret, alors, qu'il quitte les brumes de cette terre, ses rivières et ses étangs, qu'il s'abandonne d'un coeur léger entre les mains de la mort, sachant qu'elle — et elle seule — lui apportera la paix. »