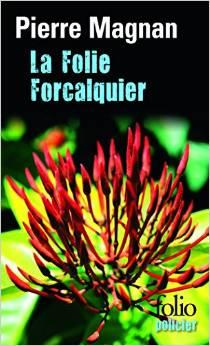Citations sur Pour saluer Giono (17)
La Provence, amère, sombre et sonore citerne, sillonnée de remords et de regrets que portent ses gens muets sur leurs visages, toute grondante de refoulements et de renoncements, sournoise de bénévolence et de malévolence, délicieusement hypocrite et menteuse avec un art consommé, comment Giono aurait-il pu se divertir sans elle, lui à qui étaient nécessaires de si grandioses divertissements ?
On connaît les débandades des cimetières quand, l’ami sitôt enterré, chacun fuit éperdument vers la vie.
La lecture m’empêche de me recroqueviller sur ma terreur ou sur mon désespoir.
Soudain il vous imposait silence ou s’imposait silence.
Je vois encore ce geste de la main dressée en obstacle, j’entends encore ces cinq mots prononcés à voix basse, presque chuchotés :
- Attends ! Attendez ! Juste une minute !
Comme si un oiseau venait de se poser sur le rebord de la fenêtre et qu'il importât de ne pas l'effaroucher. Alors, sans que sa main gauche qui avait imposé silence s'abaissât, il tirait de sa main droite le fameux carnet à spirale qui traînait toujours ouvert sur sa table, il l'attirait à lui comme un naufragé s'agrippe à une bouée et, le silence obtenu, il écrivait une ligne, deux lignes, cinq lignes, jamais plus, qu'il entourait d'un trait léger. Après quoi il abaissait sa main gauche, après quoi il vous regardait avec un bon sourire, après quoi il vous disait :
- Voilà, maintenant on peut continuer.
Je vois encore ce geste de la main dressée en obstacle, j’entends encore ces cinq mots prononcés à voix basse, presque chuchotés :
- Attends ! Attendez ! Juste une minute !
Comme si un oiseau venait de se poser sur le rebord de la fenêtre et qu'il importât de ne pas l'effaroucher. Alors, sans que sa main gauche qui avait imposé silence s'abaissât, il tirait de sa main droite le fameux carnet à spirale qui traînait toujours ouvert sur sa table, il l'attirait à lui comme un naufragé s'agrippe à une bouée et, le silence obtenu, il écrivait une ligne, deux lignes, cinq lignes, jamais plus, qu'il entourait d'un trait léger. Après quoi il abaissait sa main gauche, après quoi il vous regardait avec un bon sourire, après quoi il vous disait :
- Voilà, maintenant on peut continuer.
Il est toujours un peu étonnant pour une âme naïve, de constater que la terre ne se modèle jamais sur le malheur des hommes, qu’elle continue à rire à soleil éclatant ou à dormir paisiblement sous les étoiles tandis qu’ils agonisent.
Sur tout ce pays que je parcours, l’immense effervescence qui bouleverse les nations est invisible, impalpable, parfaitement ignorée de tout et même de tous, si l’on considère que dans les champs les paysans ramassent les courges et que les distilleries de lavande fument leur parfum nostalgique. Qui dirait que, dans trois jours, presque toutes les femmes de ce pays seront seules dans leur lit et pour certaines d’entre elles définitivement ?
Sur tout ce pays que je parcours, l’immense effervescence qui bouleverse les nations est invisible, impalpable, parfaitement ignorée de tout et même de tous, si l’on considère que dans les champs les paysans ramassent les courges et que les distilleries de lavande fument leur parfum nostalgique. Qui dirait que, dans trois jours, presque toutes les femmes de ce pays seront seules dans leur lit et pour certaines d’entre elles définitivement ?
Mon père m’a appris à me méfier des intellectuels. « En cas de guerre, m’a-t-il dit, il n’y a que les paysans et les ouvriers non spécialisés qui morflent. Les autres, on en a besoin pour commander. »
La source, donc le jet passerait à travers le chas d’une aiguille, m’émerveille à son tour pour sa pérennité têtue. J’ai pitié d’elle. Je voudrais tendre mes mains en conque autour de ce filet d’eau comme on protège la flamme d’une bougie.
Nous sommes déjà debout, déjà prêts à nous enfuir, nous attendant au refus.
– Alors, vous allez faire un journal ? C’est très épatant ça ! dit Giono. Un journal de jeunes à Manosque ! Ça m’intéresse prodigieusement !
Je ne mens pas. Pourquoi mentirais-je à mon âge ? J’enregistre, à cette époque, comme je fais toujours. Ces deux termes, très épatant et prodigieux, seront les deux adjectifs préférés de Giono durant tout le temps qu’il aura la passion de sauver et que sa joie demeurera.
– Oui, dit Jef, et ce sera un journal pacifiste. C’est pour ça que nous avons pensé que si vous vouliez bien nous donner un article…
– Mais, naturellement, tout ce que vous voudrez !
Il était en train de bourrer sa pipe. Je sens encore, à cinquante-trois ans de distance, le parfum de ce mélange qu’il tirait d’un pot de faïence de Marnas, brun, constellé de grosses lunes jaunes. Je vois encore le geste de sybarite de son index effilé pour tasser minutieusement le tabac. Il l’alluma, éteignit l’allumette dans l’air en un mouvement que je ne vis jamais faire qu’à lui et soudain, comme frappé d’une inspiration subite, il nous dit :
– Mais au fait ! Pourquoi ne viendriez-vous pas au Contadour avec moi ? Tiens, c’est une idée ça ! Vous venez avec moi et là-haut je vous fais votre article.
Il voit sur nos visages, et surtout sur le mien sans doute, qu’il y a un obstacle majeur. Il doit y avoir de la dépense au Contadour et je n’ai que vingt francs par semaine.
– Allez ! dit-il. Je vous invite au Contadour. Vous resterez tout le temps que vous voudrez.
Il nous donne des détails pratiques :
– Habillez-vous chaudement et soyez à la Saunerie samedi vers onze heures, nous partons par la patache de Banon !
Quand nous sortons de là, Jef et moi, nous sommes l’un contre l’autre jetés par l’émotion et saouls comme des grives. Le plaisir, l’étonnement, l’enthousiasme, se partagent nos cœurs. Nous venons d’être percutés pour la première fois de notre vie par une émotion inconnue. Et Jef pour extérioriser sa joie se tourne vers moi et me morigène pour lui avoir laissé faire tout le travail. – Tu aurais pu au moins me soutenir ! À quoi ça sert que je t’aie traîné jusqu’ici ? Tu avais plutôt l’air d’un con que d’un moulin à vent !
C’était vrai. Mais il pouvait toujours parler. J’avais encore dans le nez le parfum de la maison Giono. C’était cette odeur particulière que je n’ai sentie qu’une dizaine de fois dans ma vie : mélange de cuisine de grand-mère, de vieux livres, de linge repassé dans les armoires, de fontaine de jardin à petit bruit qui entraîne par la porte ouverte un courant d’air odorant d’herbes mouillées. Il pouvait toujours parler mon ami Jef. J’étais au comble du bonheur.
Moi dont la machine à me souvenir est si exacte d’ordinaire, ici je ne me souviens plus de la couleur, de la texture qu’annonçait le couchant ce soir-là. Giono m’avait effacé le ciel.
– Alors, vous allez faire un journal ? C’est très épatant ça ! dit Giono. Un journal de jeunes à Manosque ! Ça m’intéresse prodigieusement !
Je ne mens pas. Pourquoi mentirais-je à mon âge ? J’enregistre, à cette époque, comme je fais toujours. Ces deux termes, très épatant et prodigieux, seront les deux adjectifs préférés de Giono durant tout le temps qu’il aura la passion de sauver et que sa joie demeurera.
– Oui, dit Jef, et ce sera un journal pacifiste. C’est pour ça que nous avons pensé que si vous vouliez bien nous donner un article…
– Mais, naturellement, tout ce que vous voudrez !
Il était en train de bourrer sa pipe. Je sens encore, à cinquante-trois ans de distance, le parfum de ce mélange qu’il tirait d’un pot de faïence de Marnas, brun, constellé de grosses lunes jaunes. Je vois encore le geste de sybarite de son index effilé pour tasser minutieusement le tabac. Il l’alluma, éteignit l’allumette dans l’air en un mouvement que je ne vis jamais faire qu’à lui et soudain, comme frappé d’une inspiration subite, il nous dit :
– Mais au fait ! Pourquoi ne viendriez-vous pas au Contadour avec moi ? Tiens, c’est une idée ça ! Vous venez avec moi et là-haut je vous fais votre article.
Il voit sur nos visages, et surtout sur le mien sans doute, qu’il y a un obstacle majeur. Il doit y avoir de la dépense au Contadour et je n’ai que vingt francs par semaine.
– Allez ! dit-il. Je vous invite au Contadour. Vous resterez tout le temps que vous voudrez.
Il nous donne des détails pratiques :
– Habillez-vous chaudement et soyez à la Saunerie samedi vers onze heures, nous partons par la patache de Banon !
Quand nous sortons de là, Jef et moi, nous sommes l’un contre l’autre jetés par l’émotion et saouls comme des grives. Le plaisir, l’étonnement, l’enthousiasme, se partagent nos cœurs. Nous venons d’être percutés pour la première fois de notre vie par une émotion inconnue. Et Jef pour extérioriser sa joie se tourne vers moi et me morigène pour lui avoir laissé faire tout le travail. – Tu aurais pu au moins me soutenir ! À quoi ça sert que je t’aie traîné jusqu’ici ? Tu avais plutôt l’air d’un con que d’un moulin à vent !
C’était vrai. Mais il pouvait toujours parler. J’avais encore dans le nez le parfum de la maison Giono. C’était cette odeur particulière que je n’ai sentie qu’une dizaine de fois dans ma vie : mélange de cuisine de grand-mère, de vieux livres, de linge repassé dans les armoires, de fontaine de jardin à petit bruit qui entraîne par la porte ouverte un courant d’air odorant d’herbes mouillées. Il pouvait toujours parler mon ami Jef. J’étais au comble du bonheur.
Moi dont la machine à me souvenir est si exacte d’ordinaire, ici je ne me souviens plus de la couleur, de la texture qu’annonçait le couchant ce soir-là. Giono m’avait effacé le ciel.
Le voici : son chapeau noir aux larges ailes émerge d’abord, hissé au long de l’escalier, et tout de suite dessous le visage. Le visage, qu’à l’époque – plus tard il sera nu-tête – souligne à l’envers le chapeau. Rien dans ce visage n’est ordinaire. Nos pères, nos grands-pères, leurs voisins, nous ne nous arrêtons jamais sur leurs visages. Ils ne nous intriguent jamais. Le visage de Giono nous intrigue, nous intimide. « Mon visage asymétrique », dira-t-il. Nous ne savons pas ce que c’est que l’asymétrie d’un visage. Nous avons l’impression de nous trouver devant un homme qui n’est pas d’ici, qui n’est de nulle part.
Il est glabre. Ses oreilles sont un peu pointues vers le haut mais sans excès. Déjà, à trente-neuf ans qu’il a alors, son menton offre un certain empâtement qui ne dépassera jamais la mesure. Ses lèvres sont minces. On craint le sourire que, tout à l’heure peut-être, elles vont dessiner. (Comment peut-on croire qu’avec des lèvres si semblables à celles d’Henri Brulard, il ait pu ne pas aimer Stendhal du fond du cœur ?) Le nez est aussi aristocratique que le front. Ce n’est que par cet adjectif, alors, que nous pouvons le désigner. C’est un nez fin, mince, renardier, captateur. Nous sommes habitués à nos nez communs, trognards, camus, en pomme de terre, ridicules pour tout dire et ne voyant pas plus loin qu’à leur bout. Ce nez-là, ce nez de notaire, même les deux maîtres, de père en fils, de nos officines à panonceaux, ne le possèdent pas, quelque peine qu’ils eussent pris pour tenter de le faire circuler dans leurs gènes, pourtant parfois accentués de sang bleu en pure perte. Notre nez de Bas-Alpin est ineffaçable. Il nous trahit et nous sert d’enseigne. Offrant sa surface camuse aux prêcheurs de toute boutique, il est l’emblème de notre circonspection.
Giono, en revanche, a ce nez que je ne reverrai de ma vie que chez sa fille Aline mais, chez elle, en plus désenchanté et plus timide.
Et que dire alors de ses yeux ? Soit qu’ils aient été immenses par eux-mêmes, soit que la construction particulière de son visage, en feignant de les lui faire porter à fleur de tête, en eût rendu la dimension trompeuse, nous ne pouvons pas les regarder en face. Comme si nous avions peur d’être médusés, nous détournons notre regard du sien, même si nous sommes certains qu’il ne nous voit pas.
Des regards féroces ou trop câlins n’ont jamais fait baisser le nôtre, effronté. Et d’ailleurs, il ne nous est jamais venu à l’idée de nous soucier si peu que ce soit des yeux d’un homme. Seul nous mettrait en émoi s’il se portait sur nous, le regard d’Odette, là-bas en face, de l’autre côté du lévrier, chez sa mère, à l’Hôtel Pascal, la tendre, la douce, la délicieuse Odette, de laquelle nous sommes tous amoureux en secret, pour laquelle nous sommes là en faction, ce qui nous permet, incidemment, chaque soir, de voir passer Giono, de le mesurer et, tout en évitant de le fixer en pleine figure, de rester vigilants sur son aspect du moment.
Il est glabre. Ses oreilles sont un peu pointues vers le haut mais sans excès. Déjà, à trente-neuf ans qu’il a alors, son menton offre un certain empâtement qui ne dépassera jamais la mesure. Ses lèvres sont minces. On craint le sourire que, tout à l’heure peut-être, elles vont dessiner. (Comment peut-on croire qu’avec des lèvres si semblables à celles d’Henri Brulard, il ait pu ne pas aimer Stendhal du fond du cœur ?) Le nez est aussi aristocratique que le front. Ce n’est que par cet adjectif, alors, que nous pouvons le désigner. C’est un nez fin, mince, renardier, captateur. Nous sommes habitués à nos nez communs, trognards, camus, en pomme de terre, ridicules pour tout dire et ne voyant pas plus loin qu’à leur bout. Ce nez-là, ce nez de notaire, même les deux maîtres, de père en fils, de nos officines à panonceaux, ne le possèdent pas, quelque peine qu’ils eussent pris pour tenter de le faire circuler dans leurs gènes, pourtant parfois accentués de sang bleu en pure perte. Notre nez de Bas-Alpin est ineffaçable. Il nous trahit et nous sert d’enseigne. Offrant sa surface camuse aux prêcheurs de toute boutique, il est l’emblème de notre circonspection.
Giono, en revanche, a ce nez que je ne reverrai de ma vie que chez sa fille Aline mais, chez elle, en plus désenchanté et plus timide.
Et que dire alors de ses yeux ? Soit qu’ils aient été immenses par eux-mêmes, soit que la construction particulière de son visage, en feignant de les lui faire porter à fleur de tête, en eût rendu la dimension trompeuse, nous ne pouvons pas les regarder en face. Comme si nous avions peur d’être médusés, nous détournons notre regard du sien, même si nous sommes certains qu’il ne nous voit pas.
Des regards féroces ou trop câlins n’ont jamais fait baisser le nôtre, effronté. Et d’ailleurs, il ne nous est jamais venu à l’idée de nous soucier si peu que ce soit des yeux d’un homme. Seul nous mettrait en émoi s’il se portait sur nous, le regard d’Odette, là-bas en face, de l’autre côté du lévrier, chez sa mère, à l’Hôtel Pascal, la tendre, la douce, la délicieuse Odette, de laquelle nous sommes tous amoureux en secret, pour laquelle nous sommes là en faction, ce qui nous permet, incidemment, chaque soir, de voir passer Giono, de le mesurer et, tout en évitant de le fixer en pleine figure, de rester vigilants sur son aspect du moment.
Au mois d’août 1937, mon ami Jef Scaniglia qui a dix-sept ans, deux de plus que moi, décide de fonder un journal et de l’appeler Au-devant de la vie. Un mois auparavant, dans le dessein inavoué d’approcher quelques filles en short, et lui, en particulier, dans l’espoir d’échapper un peu à la tendresse trop tutélaire d’un père à cheval sur les principes, nous avons adhéré d’enthousiasme au mouvement des Auberges de la jeunesse. Adhérer aux Auberges de la jeunesse en 1937, c’est comme proclamer qu’on fréquente assidûment les lupanars. Mais : le père de Jef est socialiste, mon père est communiste. Nous sommes deux enfants du Front populaire, le frente crapular, comme l’appelle avec conviction notre photographe local Léopold Duplan, lequel fait partie des Croix-de-Feu.
Puisqu’on est en train de secouer le panier, tant vaut-il qu’on en profite. L’Auberge de la jeunesse, à Manosque, c’est l’Hostellerie des Carmes, un bien beau nom qui recouvre un hôtel vétuste et mal considéré.
À force de ne pas avoir de clients, le tenancier, Auguste Reynès, et son épouse se sont résignés à arborer le panonceau des A.J. et à transformer leur établissement en dortoir et salle de jeux. Il faut dire, et nous ne nous le dissimulons guère, que ce père et cette mère aubergiste ont plutôt l’allure d’une mère maquerelle et d’un père maquereau que d’idéalistes prêts à risquer leur chemise sur la triomphante jeunesse. Néanmoins ils l’ont fait. Et l’auberge commence à voir passer des gars et des filles en short, munis de sacs à dos pourvus de fanions et chantant des chansons. C’est l’une de ces chansons qui donnera l’idée à mon ami Jef de fonder un journal et de l’appeler Au-devant de la vie. (…)
(…) Nous avons un imprimeur : Paul Drac, dont le fils René partage toutes nos aventures. Ce Paul Drac pendant vingt ans soutiendra la candidature malheureuse de tous les adversaires du député inamovible : Charles Baron. À chaque fois, en affiches diverses et tracts vengeurs, ils lui planteront un drapeau qui le fera mal aller, mais son tempérament juvénile l’entraînera toujours vers les causes perdues. Il est prêt à défendre la nôtre, de cause, et pourtant, l’an dernier encore, il se proclamait Croix-de-Feu.
Nous avons enrôlé, Jef a enrôlé, un grand garçon de dix-huit ans qu’il subjugue, pour être responsable du journal, car il faut avoir dix-huit ans pour être gérant de périodique. Pour les textes, nous nous sentons tous les deux d’en remplir dix pages et de susciter des vocations. Pour le fric, Paul Drac fera le tour des commerçants de Manosque et toute la quatrième page, par petites portions, ne sera qu’un hymne au commerce manosquin. Pour les lecteurs, nous avons recopié à son insu, chez notre ami commun Maurice Chevaly qui a notre âge mais ne partage pas, encore, nos convictions, le fichier de son journal littéraire La Muse, journal polycopié et qui compte bien quatre-vingts lecteurs. Nous sommes fin prêts. Notre journal sera jeune, dynamique, ouvert à tous, mais surtout, surtout, il sera pacifiste car nos pères vomissent l’armée, les armées, nous ont appris à haïr la guerre et nous sentons bien qu’elle va nous happer. Mais nous avons beau avoir dix-sept et quinze ans, le dérisoire et le peu d’avenir de notre entreprise ne nous échappent pas si elle est livrée à notre seule infimité, à la seule fragilité de notre voix inaudible. C’est alors que Jef me dit :
– Il faudrait qu’on aille demander un article à Giono ?
– Tu le connais Giono ?
– Non.
C’est faux. Giono nous le voyons tous les jours déambuler par Manosque, allant à la poste ou s’installant au café-glacier sur la terrasse pour contempler d’un œil inexpressif l’immensité de ce qu’il fomente. L’oeil bleu de Giono, principale caractéristique de son visage, est comme celui des menons cornus des grands troupeaux. Nous le savons déjà très bien pour l’avoir si souvent contemplé à la dérobée : vide, vacant, anodin, ne voyant volontairement personne mais voyant tout. Toute sa vie, Giono promènera par Manosque ce regard objectif mais qui trie ce qu’il veut du spectacle du monde. Un jour, il me citera cette phrase du peintre Paul Laurens qui le dessine tout entier : « Aujourd’hui je ne vois que les cravates. »
Depuis des années déjà, Giono défile devant la perspicacité enfantine de nos regards investigateurs. Je ne dis pas admiratifs. Nos pères le classent mal et s’en méfient pour cette raison ; la population manosquine, bourgeoise, ouvrière ou agricole, n’ouvre jamais un livre et se demande de quoi peut bien vivre cet homme depuis qu’il a quitté la banque.
Puisqu’on est en train de secouer le panier, tant vaut-il qu’on en profite. L’Auberge de la jeunesse, à Manosque, c’est l’Hostellerie des Carmes, un bien beau nom qui recouvre un hôtel vétuste et mal considéré.
À force de ne pas avoir de clients, le tenancier, Auguste Reynès, et son épouse se sont résignés à arborer le panonceau des A.J. et à transformer leur établissement en dortoir et salle de jeux. Il faut dire, et nous ne nous le dissimulons guère, que ce père et cette mère aubergiste ont plutôt l’allure d’une mère maquerelle et d’un père maquereau que d’idéalistes prêts à risquer leur chemise sur la triomphante jeunesse. Néanmoins ils l’ont fait. Et l’auberge commence à voir passer des gars et des filles en short, munis de sacs à dos pourvus de fanions et chantant des chansons. C’est l’une de ces chansons qui donnera l’idée à mon ami Jef de fonder un journal et de l’appeler Au-devant de la vie. (…)
(…) Nous avons un imprimeur : Paul Drac, dont le fils René partage toutes nos aventures. Ce Paul Drac pendant vingt ans soutiendra la candidature malheureuse de tous les adversaires du député inamovible : Charles Baron. À chaque fois, en affiches diverses et tracts vengeurs, ils lui planteront un drapeau qui le fera mal aller, mais son tempérament juvénile l’entraînera toujours vers les causes perdues. Il est prêt à défendre la nôtre, de cause, et pourtant, l’an dernier encore, il se proclamait Croix-de-Feu.
Nous avons enrôlé, Jef a enrôlé, un grand garçon de dix-huit ans qu’il subjugue, pour être responsable du journal, car il faut avoir dix-huit ans pour être gérant de périodique. Pour les textes, nous nous sentons tous les deux d’en remplir dix pages et de susciter des vocations. Pour le fric, Paul Drac fera le tour des commerçants de Manosque et toute la quatrième page, par petites portions, ne sera qu’un hymne au commerce manosquin. Pour les lecteurs, nous avons recopié à son insu, chez notre ami commun Maurice Chevaly qui a notre âge mais ne partage pas, encore, nos convictions, le fichier de son journal littéraire La Muse, journal polycopié et qui compte bien quatre-vingts lecteurs. Nous sommes fin prêts. Notre journal sera jeune, dynamique, ouvert à tous, mais surtout, surtout, il sera pacifiste car nos pères vomissent l’armée, les armées, nous ont appris à haïr la guerre et nous sentons bien qu’elle va nous happer. Mais nous avons beau avoir dix-sept et quinze ans, le dérisoire et le peu d’avenir de notre entreprise ne nous échappent pas si elle est livrée à notre seule infimité, à la seule fragilité de notre voix inaudible. C’est alors que Jef me dit :
– Il faudrait qu’on aille demander un article à Giono ?
– Tu le connais Giono ?
– Non.
C’est faux. Giono nous le voyons tous les jours déambuler par Manosque, allant à la poste ou s’installant au café-glacier sur la terrasse pour contempler d’un œil inexpressif l’immensité de ce qu’il fomente. L’oeil bleu de Giono, principale caractéristique de son visage, est comme celui des menons cornus des grands troupeaux. Nous le savons déjà très bien pour l’avoir si souvent contemplé à la dérobée : vide, vacant, anodin, ne voyant volontairement personne mais voyant tout. Toute sa vie, Giono promènera par Manosque ce regard objectif mais qui trie ce qu’il veut du spectacle du monde. Un jour, il me citera cette phrase du peintre Paul Laurens qui le dessine tout entier : « Aujourd’hui je ne vois que les cravates. »
Depuis des années déjà, Giono défile devant la perspicacité enfantine de nos regards investigateurs. Je ne dis pas admiratifs. Nos pères le classent mal et s’en méfient pour cette raison ; la population manosquine, bourgeoise, ouvrière ou agricole, n’ouvre jamais un livre et se demande de quoi peut bien vivre cet homme depuis qu’il a quitté la banque.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Pierre Magnan (38)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1726 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1726 lecteurs ont répondu