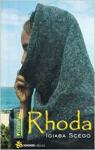Critiques de Igiaba Scego (7)
La linea del colore, que l'auteure afro-italienne considère comme le dernier volet d'une « trilogie de la violence coloniale » faisant suite à Oltre Babilonia (2008) et à Adua (2016), est un roman dont la protagoniste imaginaire, Lafanu Brown, est une peintre Noire américaine d'origines haïtiennes (de père) et autochtones chippewa (de mère) qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, s'établit à Rome pour parfaire son art et s'émanciper de sa condition de femme noire, encore accablante aux États-Unis le lendemain de la Guerre civile. Lafanu est la synthèse de deux personnages historiques réels, deux Américaines noires immigrées à Rome à l'époque où la Cité Éternelle, conquise à la Papauté, devient la capitale du nouveau royaume d'Italie qui se lance aussitôt dans son entreprise coloniale : la sculptrice Edmonia Lewis et la sage-femme activiste des droits civiques Sarah Parker Remond ; le principal personnage masculin du roman, Frederick Bailey, possède lui aussi quelques traits de l'écrivain antiraciste militant Frederick Douglass, de même que l'homme qui intervient dans l'incipit et excipit du roman, Ulisse Barbieri, fut un anarchiste italien qui prononça effectivement les mots que l'auteure lui prête à la fin du Prologue : « Ma non capite, branco di cretini, che i veri patrioti sono gli abissini ? » [« Mais ne comprenez-vous pas, bande de crétins, que les vrais patriotes, ce sont les Abyssins ? »] (p. 29).
La structure du roman, à l'instar des précédents ouvrages d'Igiaba Scego, est dialogique et surprenante dans sa complexité parfaitement maîtrisée : le 1er février 1887, suite à la nouvelle du guet-apens qui a coûté la vie à cinq cents soldats italiens à Dogali, en Érythrée – les Cinq Cents qui ont donné son nom à la place qui fait face à la gare centrale de Rome, Stazione Termini – Lafanu Brown est agressée par la foule furieuse à cause de sa couleur de peau et sauvée in extremis par Ulisse Barbieri qui la demandera en mariage. Avant de lui donner sa réponse, celle-ci s'impose de rédiger ses mémoires, depuis son enfance chez les Chippewa d'où elle est exfiltrée pour être éduquée et prise sous leur protection par deux femmes mécènes abolitionnistes qui la maintiendront dans un état de dépendance économique, psychologique et même personnelle dont elle aura beaucoup de mal à se libérer. Par honnêteté, Lafanu se doit d'expliquer à Ulisse son passé dans toute la dureté qu'il a réservé à une jeune femme noire exposée à la violence sur son corps et envers sa dignité, de lui dévoiler les rôles respectifs de ses « protectrices » et surtout son ancien amour ambivalent pour Frederick Bailey, ainsi que de lui faire accepter, d'abord et principalement, la fonction émancipatrice de son art qui, au moment de leur rencontre, est enfin parvenu à lui assurer une certaine reconnaissance et l'assurance de son talent. Cette narration est faite à la troisième personne, dans le style très XIXe siècle inspiré des nombreux auteurs qui relatent le Grand Tour et leur regard sur l'Italie des arts et des antiquités : Dickens, Goethe, Edith Wharton, Henry James, E. M. Forster, Stendhal, Lord Byron, et, cité in extenso dans le chapitre d'appendice, Nathaniel Hawthorne.
Cependant, chacun des 21 chapitres de la vie de l'héroïne, numéroté en chiffres arabes, est suivi, dans une autre typographie, d'un chapitre « Carrefours » ou « Croisements » (« Incroci ») numéroté en chiffres romains, dans lequel Leila, une jeune historienne de l'art somalo-italienne d'aujourd'hui découvre Lafanu Brown et décide de monter une exposition de ses œuvres à la Biennale de Venise, tout en se faisant le « personnage-pont » de sa jeune cousine somalienne Binti qui, adolescente, tente le « tahrib », le voyage migratoire vers l'Europe, en échouant et essuyant de graves et longues séquelles physiques et psychiques, tout en se révélant le contre-modèle contemporain, tragique, du parcours réussi un siècle et demi auparavant par Lafanu Brown. Le dernier « Carrefours » où, pour la première fois, Binti longtemps mutique s'exprime personnellement sous forme de courriel à Leila révèle à la fois ses analogies biographiques avec Lafanu, à travers le miroir inversant du temps, et parvient à ne pas faire sombrer dans le pessimisme toute tentative cathartique sinon par la migration (devenue meurtrière) au moins par la prise de conscience et par les arts graphiques : Binti, une fois guérie par les soins d'une psychiatre somalienne, est en effet en train de se former à la création de BD de satire politique. Ces chapitres « Carrefours » qui semblent rapprocher quelque peu le personnage de Leila à l'auteure elle-même, sont écrits dans le style incisif et percutant de la littérature contemporaine, qui ne se prive pas d'interposer aux descriptions de l'intime et du psychisme des considérations ouvertement politiques, ici à la fois antiracistes, anti-sexistes, anti-colonialistes, en particulier sur la décadence actuelle de Rome (et de l'Italie) et sur la problématique cruciale de l'apartheid mondial généré par les politiques de la mobilité différenciée entre titulaires des passeports forts et titulaires des passeports « en papier-toilette » dont l'expatriation constitue de nouveau une menace à la vie et au psychisme, surtout pour les femmes.
À noter aussi que l'activité du personnage de Leila, ainsi que le fil rouge du roman qui est représenté par la fontaine des Quatre Maures (1632) de la ville de Marino, près Rome, reflètent l'intérêt de longue date que l'auteure porte à l'iconographie des Noirs dans les arts européens (surtout italiens) depuis les Moyen-Âge, de même que la mission de conscientisation qu'elle s'est donnée. Dans ce roman, une foison de thèmes importants de la pensée et du militantisme anti-discriminatoire contemporains trouvent donc leur place de manière subtile, efficace et perspicace. Je salue une auteure dont la trajectoire fait preuve d'une splendide maturation.
La structure du roman, à l'instar des précédents ouvrages d'Igiaba Scego, est dialogique et surprenante dans sa complexité parfaitement maîtrisée : le 1er février 1887, suite à la nouvelle du guet-apens qui a coûté la vie à cinq cents soldats italiens à Dogali, en Érythrée – les Cinq Cents qui ont donné son nom à la place qui fait face à la gare centrale de Rome, Stazione Termini – Lafanu Brown est agressée par la foule furieuse à cause de sa couleur de peau et sauvée in extremis par Ulisse Barbieri qui la demandera en mariage. Avant de lui donner sa réponse, celle-ci s'impose de rédiger ses mémoires, depuis son enfance chez les Chippewa d'où elle est exfiltrée pour être éduquée et prise sous leur protection par deux femmes mécènes abolitionnistes qui la maintiendront dans un état de dépendance économique, psychologique et même personnelle dont elle aura beaucoup de mal à se libérer. Par honnêteté, Lafanu se doit d'expliquer à Ulisse son passé dans toute la dureté qu'il a réservé à une jeune femme noire exposée à la violence sur son corps et envers sa dignité, de lui dévoiler les rôles respectifs de ses « protectrices » et surtout son ancien amour ambivalent pour Frederick Bailey, ainsi que de lui faire accepter, d'abord et principalement, la fonction émancipatrice de son art qui, au moment de leur rencontre, est enfin parvenu à lui assurer une certaine reconnaissance et l'assurance de son talent. Cette narration est faite à la troisième personne, dans le style très XIXe siècle inspiré des nombreux auteurs qui relatent le Grand Tour et leur regard sur l'Italie des arts et des antiquités : Dickens, Goethe, Edith Wharton, Henry James, E. M. Forster, Stendhal, Lord Byron, et, cité in extenso dans le chapitre d'appendice, Nathaniel Hawthorne.
Cependant, chacun des 21 chapitres de la vie de l'héroïne, numéroté en chiffres arabes, est suivi, dans une autre typographie, d'un chapitre « Carrefours » ou « Croisements » (« Incroci ») numéroté en chiffres romains, dans lequel Leila, une jeune historienne de l'art somalo-italienne d'aujourd'hui découvre Lafanu Brown et décide de monter une exposition de ses œuvres à la Biennale de Venise, tout en se faisant le « personnage-pont » de sa jeune cousine somalienne Binti qui, adolescente, tente le « tahrib », le voyage migratoire vers l'Europe, en échouant et essuyant de graves et longues séquelles physiques et psychiques, tout en se révélant le contre-modèle contemporain, tragique, du parcours réussi un siècle et demi auparavant par Lafanu Brown. Le dernier « Carrefours » où, pour la première fois, Binti longtemps mutique s'exprime personnellement sous forme de courriel à Leila révèle à la fois ses analogies biographiques avec Lafanu, à travers le miroir inversant du temps, et parvient à ne pas faire sombrer dans le pessimisme toute tentative cathartique sinon par la migration (devenue meurtrière) au moins par la prise de conscience et par les arts graphiques : Binti, une fois guérie par les soins d'une psychiatre somalienne, est en effet en train de se former à la création de BD de satire politique. Ces chapitres « Carrefours » qui semblent rapprocher quelque peu le personnage de Leila à l'auteure elle-même, sont écrits dans le style incisif et percutant de la littérature contemporaine, qui ne se prive pas d'interposer aux descriptions de l'intime et du psychisme des considérations ouvertement politiques, ici à la fois antiracistes, anti-sexistes, anti-colonialistes, en particulier sur la décadence actuelle de Rome (et de l'Italie) et sur la problématique cruciale de l'apartheid mondial généré par les politiques de la mobilité différenciée entre titulaires des passeports forts et titulaires des passeports « en papier-toilette » dont l'expatriation constitue de nouveau une menace à la vie et au psychisme, surtout pour les femmes.
À noter aussi que l'activité du personnage de Leila, ainsi que le fil rouge du roman qui est représenté par la fontaine des Quatre Maures (1632) de la ville de Marino, près Rome, reflètent l'intérêt de longue date que l'auteure porte à l'iconographie des Noirs dans les arts européens (surtout italiens) depuis les Moyen-Âge, de même que la mission de conscientisation qu'elle s'est donnée. Dans ce roman, une foison de thèmes importants de la pensée et du militantisme anti-discriminatoire contemporains trouvent donc leur place de manière subtile, efficace et perspicace. Je salue une auteure dont la trajectoire fait preuve d'une splendide maturation.
Cinquième ouvrage et second roman de l'auteure italienne d'origines somaliennes Igiaba Scego, Adua représente ici le nom de l'héroïne davantage que le lieu d'une bataille coloniale (défaite italienne en Abyssinie, en 1896). Ce roman se compose de trois récits qui s'alternent avec une scansion parfaitement régulière : celui – narré à la première personne – de la protagoniste, femme âgée d'environ cinquante ans, installée à Rome depuis 1976 et considérant l'éventualité de rentrer dans sa Somalie natale quittée à l'adolescence et pacifiée depuis 2013, laquelle adresse une confession-lamentation sur sa vie à la statue du Bernin de l'éléphant qui porte l'obélisque le plus petit du monde ; celui – à la troisième personne – de Zoppe, son père, qui, dans les années 1934-35, subit la violence féroce des Italiens colonisateurs et pourtant ne se soustrait pas à sa collaboration avec eux en tant qu'interprète ; celui enfin – à la deuxième personne – dans lequel Zoppe invective sans cesse sa fille, en faisant preuve d'une haine invincible à son égard ainsi qu'à celui de la mère d'Adua, Asha la Téméraire, décédée en la mettant au monde.
D'après ces trois voix, l'on peut recomposer une histoire transgénérationnelle faite de la répétition d'humiliations et violences racistes, d'illusions, d'erreurs et de remords. Elle a pour balises une chronologie en trois temps : le milieu des années 30, à la veille de la guerre fasciste d’Éthiopie mais là où le colonialisme italien est déjà très cruel, le milieu des années 70, où le régime de Siad Barre prend une tournure autoritaire qui provoque des vagues d'arrestations et une considérable diaspora somalienne, et enfin la période contemporaine, où les flux de la Grande Migration commencent à engendrer en Italie une dialectique nouvelle et ambivalente (mais plutôt conflictuelle) entre les nouveaux naufragés échus à Lampedusa (les « Titanics ») et les plus anciens réfugiés/migrants (les « Vecchie Lire » en référence à la devise qui avait cours en Italie avant l'introduction de l'Euro).
Spécifiquement, nous apprenons d'Adua : sa tristesse d'orpheline et de migrante sédentarisée de force dans son pays pendant son enfance et son adolescence ; les chimères qui la poussent à quitter celui-ci (et sa famille) pour se retrouver à Rome dans les plus profonds abîmes d'une carrière ratée d'actrice de cinéma ; les frustrations d'un mariage tardif et éphémère avec un très jeune « Titanic ». De Zoppe nous apprenons : la brutalité du colonialisme italien, en passant par l'inhumanité du bagne de Regina Coeli ; la rupture d'une chaîne généalogique de devins et magiciens, malgré la persistance d'un certain don télépathique et visionnaire hérité – les « visions » de Zoppe produisent de très belles pages d'un intense lyrisme ; l'irrémédiable sentiment de culpabilité à l'égard du peuple trahi et de ses manquements comme époux et surtout comme père.
Il faut noter néanmoins que ce roman fonctionne par des coups de projecteur sur des instants relativement brefs et des circonstances biographiques spécifiques : les non-dits sont nombreux et toute tentative de dresser un bilan de la vie de l'un comme de l'autre personnage n'est que lecture en filigrane, ou spéculation du lecteur. Les considérations historiques que j'ai esquissées sont également des déductions de mon cru. Ce choix narratif plutôt original peut charmer certains mais peut tout aussi bien provoquer des frustrations chez d'autres lecteurs.
D'après ces trois voix, l'on peut recomposer une histoire transgénérationnelle faite de la répétition d'humiliations et violences racistes, d'illusions, d'erreurs et de remords. Elle a pour balises une chronologie en trois temps : le milieu des années 30, à la veille de la guerre fasciste d’Éthiopie mais là où le colonialisme italien est déjà très cruel, le milieu des années 70, où le régime de Siad Barre prend une tournure autoritaire qui provoque des vagues d'arrestations et une considérable diaspora somalienne, et enfin la période contemporaine, où les flux de la Grande Migration commencent à engendrer en Italie une dialectique nouvelle et ambivalente (mais plutôt conflictuelle) entre les nouveaux naufragés échus à Lampedusa (les « Titanics ») et les plus anciens réfugiés/migrants (les « Vecchie Lire » en référence à la devise qui avait cours en Italie avant l'introduction de l'Euro).
Spécifiquement, nous apprenons d'Adua : sa tristesse d'orpheline et de migrante sédentarisée de force dans son pays pendant son enfance et son adolescence ; les chimères qui la poussent à quitter celui-ci (et sa famille) pour se retrouver à Rome dans les plus profonds abîmes d'une carrière ratée d'actrice de cinéma ; les frustrations d'un mariage tardif et éphémère avec un très jeune « Titanic ». De Zoppe nous apprenons : la brutalité du colonialisme italien, en passant par l'inhumanité du bagne de Regina Coeli ; la rupture d'une chaîne généalogique de devins et magiciens, malgré la persistance d'un certain don télépathique et visionnaire hérité – les « visions » de Zoppe produisent de très belles pages d'un intense lyrisme ; l'irrémédiable sentiment de culpabilité à l'égard du peuple trahi et de ses manquements comme époux et surtout comme père.
Il faut noter néanmoins que ce roman fonctionne par des coups de projecteur sur des instants relativement brefs et des circonstances biographiques spécifiques : les non-dits sont nombreux et toute tentative de dresser un bilan de la vie de l'un comme de l'autre personnage n'est que lecture en filigrane, ou spéculation du lecteur. Les considérations historiques que j'ai esquissées sont également des déductions de mon cru. Ce choix narratif plutôt original peut charmer certains mais peut tout aussi bien provoquer des frustrations chez d'autres lecteurs.
Lafanu Brown est métisse : née d’un père haïtien et d’une mère ojibwé. Elle grandit dans une réserve, en Amérique au 19ème siècle.
Lafanu rêve d’autre chose que de l’alcoolisme qui gangrène ses proches.
Le destin lui fait rencontrer Betsebea Mackenzie, une femme qui défend la cause abolitionniste. Celle-ci décide de ramener la jeune fille dans sa ville de Salenius et de payer pour ses études. Une façon de mettre en pratique ses convictions politiques mais, surtout, de remporter la palme de la plus grande bienfaitrice de la ville.
Lafanu est reconnaissante de cette opportunité mais aussi mortifiée par cette dépendance créée par la femme blanche. Mais surtout, elle se heurte à la violence la plus abjecte.
Sa porte de sortie sera la peinture dans laquelle elle excelle, et l’Italie dont elle rêve de fouler la terre.
De nos jours, une jeune femme décide de rendre hommage à cette artiste dont le destin trouve un dramatique écho avec celui de sa cousine, somalienne, qui tente d’émigrer en Europe.
Si Lafanu Brown n’a jamais existé, elle est inspirée d’Edmonia Lewis, de son destin forgé malgré tous les obstacles, de la force de caractère qui lui a été nécessaire pour vivre de son art.
Car le racisme n’est pas seulement chez ceux qui sont en faveur de l’esclavage mais aussi chez les abolitionnistes, qui ont tendance à la condescendance, comme si Lafanu n’était qu’une créature de cirque à exhiber, pour illustrer la grandeur d’âme de ces gens qui ont sauvé une petite métisse.
Ce récit rend, également, hommage à la résilience des victimes de violences, de leur vie qui, malgré tout, se poursuit et leur réserve encore de belles surprises.
Enfin ce roman, lumineux, malgré les thèmes traités, est un aller simple pour l’Italie, sa lumière et sa place centrale pour les arts.
Ce livre est impossible à lâcher, il est enrichissant et très bien écrit. Lafanu est un personnage charismatique à laquelle je me suis très vite attachée.
Et maintenant, à votre tour de la découvrir !
Lafanu rêve d’autre chose que de l’alcoolisme qui gangrène ses proches.
Le destin lui fait rencontrer Betsebea Mackenzie, une femme qui défend la cause abolitionniste. Celle-ci décide de ramener la jeune fille dans sa ville de Salenius et de payer pour ses études. Une façon de mettre en pratique ses convictions politiques mais, surtout, de remporter la palme de la plus grande bienfaitrice de la ville.
Lafanu est reconnaissante de cette opportunité mais aussi mortifiée par cette dépendance créée par la femme blanche. Mais surtout, elle se heurte à la violence la plus abjecte.
Sa porte de sortie sera la peinture dans laquelle elle excelle, et l’Italie dont elle rêve de fouler la terre.
De nos jours, une jeune femme décide de rendre hommage à cette artiste dont le destin trouve un dramatique écho avec celui de sa cousine, somalienne, qui tente d’émigrer en Europe.
Si Lafanu Brown n’a jamais existé, elle est inspirée d’Edmonia Lewis, de son destin forgé malgré tous les obstacles, de la force de caractère qui lui a été nécessaire pour vivre de son art.
Car le racisme n’est pas seulement chez ceux qui sont en faveur de l’esclavage mais aussi chez les abolitionnistes, qui ont tendance à la condescendance, comme si Lafanu n’était qu’une créature de cirque à exhiber, pour illustrer la grandeur d’âme de ces gens qui ont sauvé une petite métisse.
Ce récit rend, également, hommage à la résilience des victimes de violences, de leur vie qui, malgré tout, se poursuit et leur réserve encore de belles surprises.
Enfin ce roman, lumineux, malgré les thèmes traités, est un aller simple pour l’Italie, sa lumière et sa place centrale pour les arts.
Ce livre est impossible à lâcher, il est enrichissant et très bien écrit. Lafanu est un personnage charismatique à laquelle je me suis très vite attachée.
Et maintenant, à votre tour de la découvrir !
Igiana Scebo est italienne d’origine africaine et vit à Rome. C’est en découvrant le destin de deux femmes noires, américaines, qui avaient vécu de façon libre en Italie au XIXème siècle qu’elle a eu envie d’écrire ce roman de fiction.
« Aujourd’hui, ce pays s’est durci envers ceux qu’il considère « autres » et il s’est laissé aller à une tristesse amère. Le climat de racisme et de défiance m’a lentement amenée à la décision fatale d’écrire un livre sur ces deux femmes, pour offrir un autre point de vue à mon pays ».
Plutôt que d’écrire une biographie, elle a choisit de créer un personnage de fiction : Lafanu Brown dont la mère appartenait à la tribu des Ojibwés et le père était Haïtien.
Lafanu Brown, alors qu’elle n’est encore une enfant, est choisie par une femme fortunée qui décide d’en faire sa protégée. Le but inavoué de cette femme est d’en faire une icône du mouvement abolitionniste et de passer elle-même pour une grande bienfaitrice.
Dans le roman, Lafanu Brown, devenue une peintre reconnue et vivant à Rome, couche sur le papier le récit de sa vie afin que l’homme que l’homme qui vient de la demander en mariage connaisse son parcours.
Un parcours qui fut bien loin d’être un long fleuve tranquille mais plutôt un combat quotidien pour son indépendance, la reconnaissance de son art.
Dans le même temps, des chapitres intitulés « Croisements » mettent en exergue les dangers et les terribles souffrances des migrants qui quittent leurs pays d’Afrique. Il y a là un parallèle très intéressant avec ceux qui ont été déportés au temps de l’esclavage.
S’il m’a fallu un petit temps d’adaptation sur les tous premiers chapitres pour comprendre qui était qui, j’ai vraiment accroché à cette histoire qui m’a permis de découvrir des choses sur le comportement des abolitionnistes, de la société américaine et la société italienne qui, au moment où se situent les faits, est en train de se voir créer la République Italienne.
Je remercie les Editions Dalva et Cultura pour cette découverte.
« Aujourd’hui, ce pays s’est durci envers ceux qu’il considère « autres » et il s’est laissé aller à une tristesse amère. Le climat de racisme et de défiance m’a lentement amenée à la décision fatale d’écrire un livre sur ces deux femmes, pour offrir un autre point de vue à mon pays ».
Plutôt que d’écrire une biographie, elle a choisit de créer un personnage de fiction : Lafanu Brown dont la mère appartenait à la tribu des Ojibwés et le père était Haïtien.
Lafanu Brown, alors qu’elle n’est encore une enfant, est choisie par une femme fortunée qui décide d’en faire sa protégée. Le but inavoué de cette femme est d’en faire une icône du mouvement abolitionniste et de passer elle-même pour une grande bienfaitrice.
Dans le roman, Lafanu Brown, devenue une peintre reconnue et vivant à Rome, couche sur le papier le récit de sa vie afin que l’homme que l’homme qui vient de la demander en mariage connaisse son parcours.
Un parcours qui fut bien loin d’être un long fleuve tranquille mais plutôt un combat quotidien pour son indépendance, la reconnaissance de son art.
Dans le même temps, des chapitres intitulés « Croisements » mettent en exergue les dangers et les terribles souffrances des migrants qui quittent leurs pays d’Afrique. Il y a là un parallèle très intéressant avec ceux qui ont été déportés au temps de l’esclavage.
S’il m’a fallu un petit temps d’adaptation sur les tous premiers chapitres pour comprendre qui était qui, j’ai vraiment accroché à cette histoire qui m’a permis de découvrir des choses sur le comportement des abolitionnistes, de la société américaine et la société italienne qui, au moment où se situent les faits, est en train de se voir créer la République Italienne.
Je remercie les Editions Dalva et Cultura pour cette découverte.
Sur la lancée de La linea del colore, j'ai relu le premier roman d'Igiaba Scego, Rhoda, qui possède encore tous les caractères d'une œuvre de littérature migrante ; et d'abord, celui qui peut être pris pour une thèse anti-sociologique : que les formes d'adaptation identitaire à la migration, comportant l'adhésion ou le refus de l'intégration, sont une question individuelle et non générationnelle (au double sens de génération : celle liée à la filiation, et celle de l'expression « immigré d'énième génération », à supposer que l'on puisse légitimement hypostasier une hérédité migratoire...). Ici, trois femmes somaliennes émigrées à Rome, la tante Barni et ses deux nièces Rhoda et Aisha, ont chacune sa stratégie pour affronter la souffrance de la migration. Rhoda en meurt (quoique indirectement) dès le début du roman, mais son personnage décédé est le seul qui parle à la première personne.
Les 5 chapitres du livre sont formés d'un succession inaltéré des points de vue des quatre personnages principaux pour conter l'histoire de la « chute » du personnage éponyme, dans un ordre qui correspond à une narration non-chronologique (avec l'indication des dates entre parenthèses, d'août 2001 à novembre 2003) : Aisha – la sœur cadette de la protagoniste –, Pino – son ami italien puis devenu le petit ami d'Aisha –, Barni – la tante qui est toujours accompagnée de son amie et confidente Faduma –, et enfin l'esprit de Rhoda elle-même.
Il est possible qu'une certaine identification puisse être opérée entre l'auteure et le personnage d'Aisha, non seulement par rapport à la question principale de l'identité et de l'intégration, mais aussi dans la démarche d'un auteur de littérature migrante qui consiste dans l'éclaircissement de soi au lectorat intéressé afin de favoriser la meilleure réception possible par la connaissance et la compréhension réciproques. C'est ainsi qu'il faut interpréter le poids donné à la perception de la société d'accueil par la communauté minoritaire, de même que la mise en évidence mais aussi en perspective parfois critique de ses propres caractéristiques spécifiques (morales-religieuses, culturelles, culinaires, rituelles – comme l'infibulation, etc.), et enfin la description de la vie quotidienne dans la Somalie contemporaine – dès lors que Rhoda y est retournée pour mourir – et de celle auprès de la diaspora somalienne de Londres – où Rhoda a songé à s'installer. Dans ce même but, on trouve un glossaire en fin de roman des mots somaliens utilisés dans le texte, sachant que ces références linguistiques étrangères, de même que la variété des références culturelles importées et tierces (par ex. à la musique brésilienne et aux littératures du monde – en particulier anglo-saxonnes), mais aussi une certaine attention à des aspects régionalistes et pas forcément valorisés par la littérature italienne mainstream, ont été abondamment remarquées et commentées dès le début des études littéraires italiennes sur sa littérature migrante. Ce premier roman montrait donc patte blanche à son lectorat et à ses critiques, conformément aussi aux attentes d'une maison d'édition plutôt spécialisée. Il était, en cela aussi, dans l'air du temps, en 2004. Néanmoins, ceux qui, dans ce milieu restreint comprenant également de nombreux départements d'études italiennes dans les universités des quatre coins du monde, ont (avons) « parié » sur la pérennité de la carrière d'écrivain d'Igiaba Scego (âgée alors de 30 ans) – contrairement à une majorité d'auteurs migrants éphémères – avaient déjà trouvé dans ce roman – et même dans les nouvelles publiées auparavant dans des recueils collectifs – de bons arguments pour nourrir leurs-nos prévisions. Igiaba a assurément fait du chemin depuis...
Les 5 chapitres du livre sont formés d'un succession inaltéré des points de vue des quatre personnages principaux pour conter l'histoire de la « chute » du personnage éponyme, dans un ordre qui correspond à une narration non-chronologique (avec l'indication des dates entre parenthèses, d'août 2001 à novembre 2003) : Aisha – la sœur cadette de la protagoniste –, Pino – son ami italien puis devenu le petit ami d'Aisha –, Barni – la tante qui est toujours accompagnée de son amie et confidente Faduma –, et enfin l'esprit de Rhoda elle-même.
Il est possible qu'une certaine identification puisse être opérée entre l'auteure et le personnage d'Aisha, non seulement par rapport à la question principale de l'identité et de l'intégration, mais aussi dans la démarche d'un auteur de littérature migrante qui consiste dans l'éclaircissement de soi au lectorat intéressé afin de favoriser la meilleure réception possible par la connaissance et la compréhension réciproques. C'est ainsi qu'il faut interpréter le poids donné à la perception de la société d'accueil par la communauté minoritaire, de même que la mise en évidence mais aussi en perspective parfois critique de ses propres caractéristiques spécifiques (morales-religieuses, culturelles, culinaires, rituelles – comme l'infibulation, etc.), et enfin la description de la vie quotidienne dans la Somalie contemporaine – dès lors que Rhoda y est retournée pour mourir – et de celle auprès de la diaspora somalienne de Londres – où Rhoda a songé à s'installer. Dans ce même but, on trouve un glossaire en fin de roman des mots somaliens utilisés dans le texte, sachant que ces références linguistiques étrangères, de même que la variété des références culturelles importées et tierces (par ex. à la musique brésilienne et aux littératures du monde – en particulier anglo-saxonnes), mais aussi une certaine attention à des aspects régionalistes et pas forcément valorisés par la littérature italienne mainstream, ont été abondamment remarquées et commentées dès le début des études littéraires italiennes sur sa littérature migrante. Ce premier roman montrait donc patte blanche à son lectorat et à ses critiques, conformément aussi aux attentes d'une maison d'édition plutôt spécialisée. Il était, en cela aussi, dans l'air du temps, en 2004. Néanmoins, ceux qui, dans ce milieu restreint comprenant également de nombreux départements d'études italiennes dans les universités des quatre coins du monde, ont (avons) « parié » sur la pérennité de la carrière d'écrivain d'Igiaba Scego (âgée alors de 30 ans) – contrairement à une majorité d'auteurs migrants éphémères – avaient déjà trouvé dans ce roman – et même dans les nouvelles publiées auparavant dans des recueils collectifs – de bons arguments pour nourrir leurs-nos prévisions. Igiaba a assurément fait du chemin depuis...
L'auteure, une jeune (1974) Romaine de parents somaliens réfugiés en Italie suite au coup d'état de Siad Barre, est une journaliste-écrivain très engagée, ayant déjà publié deux romans et plusieurs recueils de nouvelles, et sans doute la plus importante et originale de la littérature migrante italienne ("métissée" devrait-on dire s'agissant de seconde génération).
Ce roman est construit dans l'alternance de cinq voix : celles de deux jeunes femmes noires vivant à Rome, demi-sœurs à leur insu se rencontrant en Tunisie où elles suivent un cours d'été d'arabe - la langue des origines ; celles des mères de chacune, l'une somalienne meurtrie par l'exil et par la mystérieuse disparition de son époux, l'autre argentine meurtrie par les séquelles de la dictature de son pays, dans les années 70, avec sa kyrielle de "desaparecidos" ; enfin celle du fameux père absent, dont on devine assez vite qu'il est commun, mais non la raison ni le lieu de sa fuite, sauf qu'elle est inscrite dans la répétition de la fuite de son propre père, meurtri par le colonialisme italien...
Si les deux jeunes femmes sont nouées dans les interrogations de leur origine, dans le manque du père et dans l'incommunicabilité avec la mère souffrante, elles sont pourtant ancrées dans le présent ; alors que les voix des personnages parentaux représentent une ultime et extrême tentative de leur expliquer leur passé, de renouer avec cette progéniture sacrifiée, de donner du sens à une douleur venue d'ailleurs et souvent de temps lointains. L'Histoire est ici un drame incarné, qu'il s'agisse de la violence coloniale, ou de celle de la dictature militaire, ou de celle du déracinement ; elle se tisse autour de trois pays - la Somalie, l'Argentine, l'Italie - dont les liens sont multiples et complexes.
Le style est foisonnant, les langages des personnages divers, mais la complexité et les préoccupations sont celles de cette Babylone du troisième millénaire.
Ce roman est construit dans l'alternance de cinq voix : celles de deux jeunes femmes noires vivant à Rome, demi-sœurs à leur insu se rencontrant en Tunisie où elles suivent un cours d'été d'arabe - la langue des origines ; celles des mères de chacune, l'une somalienne meurtrie par l'exil et par la mystérieuse disparition de son époux, l'autre argentine meurtrie par les séquelles de la dictature de son pays, dans les années 70, avec sa kyrielle de "desaparecidos" ; enfin celle du fameux père absent, dont on devine assez vite qu'il est commun, mais non la raison ni le lieu de sa fuite, sauf qu'elle est inscrite dans la répétition de la fuite de son propre père, meurtri par le colonialisme italien...
Si les deux jeunes femmes sont nouées dans les interrogations de leur origine, dans le manque du père et dans l'incommunicabilité avec la mère souffrante, elles sont pourtant ancrées dans le présent ; alors que les voix des personnages parentaux représentent une ultime et extrême tentative de leur expliquer leur passé, de renouer avec cette progéniture sacrifiée, de donner du sens à une douleur venue d'ailleurs et souvent de temps lointains. L'Histoire est ici un drame incarné, qu'il s'agisse de la violence coloniale, ou de celle de la dictature militaire, ou de celle du déracinement ; elle se tisse autour de trois pays - la Somalie, l'Argentine, l'Italie - dont les liens sont multiples et complexes.
Le style est foisonnant, les langages des personnages divers, mais la complexité et les préoccupations sont celles de cette Babylone du troisième millénaire.
Lafanu se tient droite, debout, triomphante. Le sentiment de fierté, elle ne l’a pas toujours ressentie, mais elle a toujours agit avec dignité et courage. Ayant la malchance d’être femme et noire, elle n’a pas d’existence. Elle est corsetée dans un monde n’offrant aucune liberté dans l’Amérique du XIXème siècle, en pleine guerre de Sécession.
Protégée par ses mentors, qui voient en elle une artiste, autant qu’un objet d’orgueil personnel, elle quitte cette terre qui ne voulait pas d’elle, pas plus que des autres noirs, pour travailler sa peinture. Elle a toujours voulue être artiste, depuis qu’elle traçait des lignes sur le sol poussiéreux de son village.
Elle est allée en Angleterre. Elle a détesté ce pays pluvieux et sans couleur, sans inspiration, qui la rendait morose. Là où elle trouve son inspiration, c’est en Italie. La terre sacrée des artistes. Ce pays qui deviendra enfin sa patrie, qui l’aidera à faire d’elle une personne et une peintre à part entière, tant elle y trouvera de l’inspiration et une certaine forme de considération. Ce livre témoigne du fait qu’un lieu peut changer beaucoup de nos perceptions, influer sur nos ressentis mais également notre état d’esprit, et au final notre inspiration.
L’affection que porte Lafanu pour les couleurs est palpable tout le long du livre. Leur mélange, trouver la bonne pigmentation, le tracé juste, celui qui révèle le plus son modèle, c’est ce qu’elle cherche par-dessus tout. Elle a une belle sensibilité pour les visages qu’elle peint.
Où qu’elle aille, elle s’est toujours rappelée ceux qui la surnommait encore « la négresse », et qui, même quand elle avait ses pinceaux, continuaient à ne voir que sa couleur à elle, pas celle de ses toiles, pourtant vibrantes d’émotion.
Lafanu que grâce à la charité, à la bonté plus ou moins calculatrice de quelques puissants, et pas grâce à ses pinceaux. Ce qui la définit pourtant le plus. C’est aussi un livre qui témoigne du racisme de l’époque, qui est non dissimulé, infect, orgueilleux et méprisant, mais aussi de celui qui se dissimule dans les actions en apparence les plus généreuses. Pour moi, ce livre parle aussi de nos actions, de leur sens cachées et de leur pourquoi, en tout cas pour les personnages secondaires qui entourent Lafanu. Cela n’est pas aisé de se débrouiller seule et d’être entourée de personnes qui au pire vous haïsse, au mieux attente égoïstement quelque chose de vous, sans vous considérer vous et vos sentiments.
L’écriture est très belle, elle nous installe dans une ambiance qui assure une continuité entre les différents lieux que traverse Lafanu. Son périple est impressionnant, de son village aux rues de Rome, elle parvient à se trouver, et elle le doit à son courage et sa témérité. C'était un très beau roman.
Milena
J'ai un petit blog où je publie mes chroniques :
Protégée par ses mentors, qui voient en elle une artiste, autant qu’un objet d’orgueil personnel, elle quitte cette terre qui ne voulait pas d’elle, pas plus que des autres noirs, pour travailler sa peinture. Elle a toujours voulue être artiste, depuis qu’elle traçait des lignes sur le sol poussiéreux de son village.
Elle est allée en Angleterre. Elle a détesté ce pays pluvieux et sans couleur, sans inspiration, qui la rendait morose. Là où elle trouve son inspiration, c’est en Italie. La terre sacrée des artistes. Ce pays qui deviendra enfin sa patrie, qui l’aidera à faire d’elle une personne et une peintre à part entière, tant elle y trouvera de l’inspiration et une certaine forme de considération. Ce livre témoigne du fait qu’un lieu peut changer beaucoup de nos perceptions, influer sur nos ressentis mais également notre état d’esprit, et au final notre inspiration.
L’affection que porte Lafanu pour les couleurs est palpable tout le long du livre. Leur mélange, trouver la bonne pigmentation, le tracé juste, celui qui révèle le plus son modèle, c’est ce qu’elle cherche par-dessus tout. Elle a une belle sensibilité pour les visages qu’elle peint.
Où qu’elle aille, elle s’est toujours rappelée ceux qui la surnommait encore « la négresse », et qui, même quand elle avait ses pinceaux, continuaient à ne voir que sa couleur à elle, pas celle de ses toiles, pourtant vibrantes d’émotion.
Lafanu que grâce à la charité, à la bonté plus ou moins calculatrice de quelques puissants, et pas grâce à ses pinceaux. Ce qui la définit pourtant le plus. C’est aussi un livre qui témoigne du racisme de l’époque, qui est non dissimulé, infect, orgueilleux et méprisant, mais aussi de celui qui se dissimule dans les actions en apparence les plus généreuses. Pour moi, ce livre parle aussi de nos actions, de leur sens cachées et de leur pourquoi, en tout cas pour les personnages secondaires qui entourent Lafanu. Cela n’est pas aisé de se débrouiller seule et d’être entourée de personnes qui au pire vous haïsse, au mieux attente égoïstement quelque chose de vous, sans vous considérer vous et vos sentiments.
L’écriture est très belle, elle nous installe dans une ambiance qui assure une continuité entre les différents lieux que traverse Lafanu. Son périple est impressionnant, de son village aux rues de Rome, elle parvient à se trouver, et elle le doit à son courage et sa témérité. C'était un très beau roman.
Milena
J'ai un petit blog où je publie mes chroniques :
Les Dernières Actualités
Voir plus
Auteurs proches de Igiaba Scego
Lecteurs de Igiaba Scego (16)Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Odyssée d'Homère
Ou est partit Ulysse ?
En grèce
A Paris
A Troie
En Italie
5 questions
232 lecteurs ont répondu
Thème : L'Odyssée de
HomèreCréer un quiz sur cet auteur232 lecteurs ont répondu