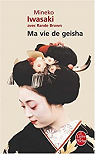Nationalité : Japon
Né(e) à : Kyôto , le 02/11/1949
Né(e) à : Kyôto , le 02/11/1949
Biographie :
Mineko Iwasaki , née Masako Tanaka, est une femme d'affaires japonaise, auteure et ancienne geiko (terme employé à Kyoto pour désigner une geisha).
Issue d'une famille nombreuse, d'origine noble mais ruinée, Masako avait déja deux de ses sœurs maiko (apprentie geisha). Dès l'âge de trois ans, ses parents sont sollicités pour en faire une apprentie. Elle est très belle mais très timide.
Elle accepte de quitter ses parents à l'âge de 5 ans pour les sauver de la misère. Elle est intégrée dans l'okiya (maison de geisha) Iwasaki et destinée à devenir la future patronne (atotori). à 10 ans, elle passe devant un juge et devient légalement la fille adoptive de la maison Iwasaki. Elle se nomme désormais Mineko Iwasaki et ses parents n'ont plus aucune autorité sur elle. On lui apprend la danse, la musique, la calligraphie, la discipline.
À 15 ans elle endosse l'habit de maiko et commence à pouvoir danser en public et accompagner les geiko dans leurs activités. Pour ses 21 ans elle reçoit le col blanc des geikos. Elle connait alors un succès considérable, multiplie les activités et gagne des sommes colossales, dont seulement une faible part lui revient. Elle rencontre des personnages prestigieux dont le prince Charles, la reine Elizabeth 2 et Henry Kissinger. Mais elle découvre peu à peu, derrière les kimonos de soie et les réceptions prestigieuses, où magnats de l'industrie, monstres sacrés du cinéma et têtes couronnées se disputent sa compagnie, que la condition des geishas, peu instruites et soumises au bon vouloir de leurs clients, n'évolue pas depuis le Japon post-féodal.
À 29 ans, elle se retire pour se marier et pour marquer sa réprobation devant le système bloqué et archaïque, le "Karyukai", qui régit les activités de Gion. Elle se marie avec le peintre Jinichiro Sato et donne naissance à une fille Kosuke.
En 1997, elle est consultée par l'auteur américain Atrhur Golden qui souhaite avoir son témoignage pour l'élaboration de son roman "Geisha". Plus tard, elle regrettera ces confidences et attaquera Golden en justice pour violation de confidentialité.
Mineko décide alors de publier son propre livre, aidé par l'américain Rande Brown. Il parait en 2002 sous le titre Geisha, A Life et en français "Ma vie de Geisha".
+ Voir plusMineko Iwasaki , née Masako Tanaka, est une femme d'affaires japonaise, auteure et ancienne geiko (terme employé à Kyoto pour désigner une geisha).
Issue d'une famille nombreuse, d'origine noble mais ruinée, Masako avait déja deux de ses sœurs maiko (apprentie geisha). Dès l'âge de trois ans, ses parents sont sollicités pour en faire une apprentie. Elle est très belle mais très timide.
Elle accepte de quitter ses parents à l'âge de 5 ans pour les sauver de la misère. Elle est intégrée dans l'okiya (maison de geisha) Iwasaki et destinée à devenir la future patronne (atotori). à 10 ans, elle passe devant un juge et devient légalement la fille adoptive de la maison Iwasaki. Elle se nomme désormais Mineko Iwasaki et ses parents n'ont plus aucune autorité sur elle. On lui apprend la danse, la musique, la calligraphie, la discipline.
À 15 ans elle endosse l'habit de maiko et commence à pouvoir danser en public et accompagner les geiko dans leurs activités. Pour ses 21 ans elle reçoit le col blanc des geikos. Elle connait alors un succès considérable, multiplie les activités et gagne des sommes colossales, dont seulement une faible part lui revient. Elle rencontre des personnages prestigieux dont le prince Charles, la reine Elizabeth 2 et Henry Kissinger. Mais elle découvre peu à peu, derrière les kimonos de soie et les réceptions prestigieuses, où magnats de l'industrie, monstres sacrés du cinéma et têtes couronnées se disputent sa compagnie, que la condition des geishas, peu instruites et soumises au bon vouloir de leurs clients, n'évolue pas depuis le Japon post-féodal.
À 29 ans, elle se retire pour se marier et pour marquer sa réprobation devant le système bloqué et archaïque, le "Karyukai", qui régit les activités de Gion. Elle se marie avec le peintre Jinichiro Sato et donne naissance à une fille Kosuke.
En 1997, elle est consultée par l'auteur américain Atrhur Golden qui souhaite avoir son témoignage pour l'élaboration de son roman "Geisha". Plus tard, elle regrettera ces confidences et attaquera Golden en justice pour violation de confidentialité.
Mineko décide alors de publier son propre livre, aidé par l'américain Rande Brown. Il parait en 2002 sous le titre Geisha, A Life et en français "Ma vie de Geisha".
Source : nezumi.dumousseau.free.fr
Ajouter des informations
étiquettes
Citations et extraits (34)
Voir plus
Ajouter une citation
Dans mon pays, le Japon, il existe des quartiers consacrés aux arts du divertissement et au plaisir esthétique, où vivent et travaillent des artistes à la formation d'une impeccable rigueur. On les appelle des karyukai.
Karyukai signifie "monde des fleurs et des saules", car si la geisha est une fleur parmi les fleurs, elle possède aussi la grâce, la souplesse et la force d'un saule.
Au cours de nos trois siècles d'histoire, une convention tacite ancrée par la tradition et le caractère sacré de notre profession nous a imposé le silence. L'heure est toutefois venue pour moi de dévoiler nos secrets (...).
Karyukai signifie "monde des fleurs et des saules", car si la geisha est une fleur parmi les fleurs, elle possède aussi la grâce, la souplesse et la force d'un saule.
Au cours de nos trois siècles d'histoire, une convention tacite ancrée par la tradition et le caractère sacré de notre profession nous a imposé le silence. L'heure est toutefois venue pour moi de dévoiler nos secrets (...).
Mon père avait deux maximes préférées. La première était une sorte de noblesse oblige à l'usage du samouraï : même affamé, un samouraï doit feindre d'être rassasié - la règle d'or étant qu'on ne doit à aucun prix se départir de sa fierté et qu'il ne faut jamais avouer sa faiblesse face à l'adversité. La seconde tient dans l'expression hokori o motsu : cramponne-toi à ta dignité. Il répétait ces adages si souvent et avec une telle conviction que nous finissions par y croire dur comme fer.
À Gion-Kobu, on était très pieux. La profession de geisha était étroitement liée à la religion et aux valeurs spirituelles qui sont le fondement de notre culture. Notre vie quotidienne se trouvait ainsi au fil de l'année balisée de cérémonies et de festivals.
Chaque matin, au réveil, après avoir pris soin de se laver la figure, tata Oïma disait ses prières devant l'autel. Je m'efforçais toujours de finir mes tâches à temps pour l'accompagner. Cela demeure encore aujourd'hui ma première action de la journée.
Chaque matin, au réveil, après avoir pris soin de se laver la figure, tata Oïma disait ses prières devant l'autel. Je m'efforçais toujours de finir mes tâches à temps pour l'accompagner. Cela demeure encore aujourd'hui ma première action de la journée.
Hikari était une burakumin, elle appartenait à une caste considérée comme souillée, un peu comme les intouchables en Inde. Jadis ils s’occupaient des cadavres ou manipulaient des substances dites polluantes comme la viande de bœuf et le cuir. Ils étaient croque-morts, bouchers, tanneurs. À l’heure actuelle, leur situation s’est améliorée, mais quand j’étais petite fille, ils faisaient encore l’objet d’une cruelle ségrégation.
Chapitre 11
Chapitre 11
Je suis pleine de reconnaissance pour les grands et les petits bonheurs qui m'ont été prodigués sur les chemins imprévisibles de la vie.
Si j'ai réussi à atteindre ces rivages paisibles, c'est grâce à la fierté et à l'intégrité que m'a inculquées mon père, à l'esprit d'indépendance et de liberté que j'ai acquis au contact de mère Sakaguchi, de tata Oïma et de maman Masako. (P279)
Si j'ai réussi à atteindre ces rivages paisibles, c'est grâce à la fierté et à l'intégrité que m'a inculquées mon père, à l'esprit d'indépendance et de liberté que j'ai acquis au contact de mère Sakaguchi, de tata Oïma et de maman Masako. (P279)
Tout lien durable au Japon, surtout celui qui attache le mari à l’épouse, ou celui qui associe un professeur à un élève, est toujours arrangé par un tiers qui continue ensuite longtemps à jouer les messagers entre ceux-là qu’il a contribué à unir.
Chapitre 31
Chapitre 31
Il existe dans une ochaya une personne spécialement chargée de chauffer le saké : on l’appelle l’okanban. C’est elle qui remplit le cruchon d’alcool et le plonge au bain-marie. À priori, la tâche a l’air simple, mais elle se complique quand on sait que chaque client aime son saké à une température différente. Tout l’art de l’okanban consiste à calculer combien de degrés perdra le liquide pendant son trajet de la cuisine à la salle de banquet, afin qu’il arrive juste à la bonne température.
Chapitre 25
Chapitre 25
De considérables remaniements se produisirent au Japon au milieu du XIXe siècle. La dictature militaire au pouvoir pendant six cent cinquante ans fut renversée et l’empereur Meiji prit la tête du gouvernement. Une fois le système féodal démantelé, nous étions prêts à nous transformer en un État-nation moderne. […] L’empereur décréta alors un changement de capitale : Kyoto, siège du pouvoir depuis plus de mille ans, céda la place à Tokyo.
Chapitre 1
Chapitre 1
Une maiko* en costume est conforme à l’idéal de beauté nippon. Elle ressemble à une princesse de l’époque Heian, au point qu’on la dirait sortie d’un rouleau peint du XIe siècle. Son visage est un ovale parfait, sa peau de lait, sa chevelure aile-de-corbeau. Ses sourcils sont des demi-lunes, sa bouche un bouton de rose. Elle a un long cou gracile et sensuel, un corps aux courbes exquises.
*apprentie geisha
Chapitre 17
*apprentie geisha
Chapitre 17
Le placement du maiohgi* entre la maîtresse et soi-même est un acte rituel, indiquant que l’on tourne le dos au monde ordinaire et que l’on est prête à entrer dans le royaume où l’enseignante est toute-puissante. En se prosternant, on montre que l’on est disposée à recevoir son savoir.
*maiohgi : éventail
Chapitre 10
*maiohgi : éventail
Chapitre 10
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Mes lectures japonaises 1
kuroineko
196 livres

Geisha
CamilleExplore
7 livres

Romans Asiatique
lafilleauxchaussures
9 livres
Auteurs proches de Mineko Iwasaki
Quiz
Voir plus
la mythologie grecque
Qu i sont les premiers enfants d'Ouranous et de Gaia ?
les titans
les cyclopes
les titans et les titanides
les titanides
50 questions
879 lecteurs ont répondu
Thèmes :
mythologie grecqueCréer un quiz sur cet auteur879 lecteurs ont répondu