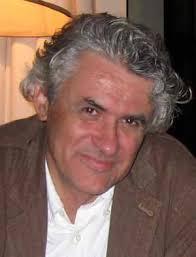Critiques de Pierre-François Souyri (26)
Ce livre de plus de 400 pages est un condensé de l'époque du Japon Médiéval. Je dois dire qu'il s'agit d'une époque que je ne connaissais pas et que le livre m'a permis de découvrir avec une accessibilité certaine. Le style employé est clair et il est aisé de dévorer cet ouvrage...
La période étudiée est assez restreinte, si le détail est l'analyse développée sont importants, on peut néanmoins reprocher que l'ouvrage n'aborde pas plus une période dépassant XVI ème siècle. Ainsi se limite le Japon Médiéval.
Il est au départ un peut difficile de s'habituer aux termes utilisés propres au Japonais. On sent tout de même un dépaysement fort en lisant cette partie de l'histoire.
Un très bon livre d'histoire, accessible et permettant de s'engager dans le découverte de se pays par l'angle historique. La lecture est agréable, on note quelques problèmes sur l'orthographe mais ce n'est pas trop déconcertant. Il est du détail face à l'œuvre que l'on a entre les mains.
La période étudiée est assez restreinte, si le détail est l'analyse développée sont importants, on peut néanmoins reprocher que l'ouvrage n'aborde pas plus une période dépassant XVI ème siècle. Ainsi se limite le Japon Médiéval.
Il est au départ un peut difficile de s'habituer aux termes utilisés propres au Japonais. On sent tout de même un dépaysement fort en lisant cette partie de l'histoire.
Un très bon livre d'histoire, accessible et permettant de s'engager dans le découverte de se pays par l'angle historique. La lecture est agréable, on note quelques problèmes sur l'orthographe mais ce n'est pas trop déconcertant. Il est du détail face à l'œuvre que l'on a entre les mains.
La période médiévale débute au Japon à la fin du XIIème siècle avec l'émergence d'une nouvelle classe de guerriers établis à Kamakura autour du Shogun. Celui-ci redistribue des terres à ses vassaux concurrençant les anciennes structures du pouvoir : l'empereur dont la capitale est à Kyôto, l'aristocratie et les monastères, comme celui du Mont Hiei à la tête d'un puissant domaine défendu par de redoutables moines-guerriers. Les factions se multiplient entraînant de grands désordres. A cet émiettement des pouvoirs s'ajoutent les révoltes paysannes et urbaines, une marginalité croissante qui vit à la périphérie des villes. Tous ces troubles font de ce moyen âge "un monde à l'envers". C'est aussi à cette époque que se façonne la culture japonaise et que se développe une importante spiritualité : le Zen a la faveur des guerriers, l'école de la Terre Pure des classes populaires et celle de Nichiren des marchands. Cet essai est très instructif et passionnant à lire.
Allez, un peu d’histoire du Japon, aujourd’hui – ça faisait longtemps... Et pour le coup sur un sujet relativement « pointu », ou du moins est-ce l’effet que peut produire ce livre en français : au Japon, il a pourtant été publié initialement dans une collection de poche, qui, sans en faire le moins du monde un ouvrage léger ou même à ce compte-là de vulgarisation, lui a assuré tout de même un certain écho.
Il faut dire que le sujet des ikki – mot derrière lequel on range, en gros, essentiellement des mouvements de révolte paysans du moyen âge et de l’époque d’Edo, qui peuvent faire penser à nos jacqueries, mais cela va en fait bien au-delà (les paysans n’étaient pas les seuls impliqués, les ikki pouvaient être urbains, etc.) –, ce sujet donc a été beaucoup traité là-bas, et de manières très différentes. Ici, l’introduction de Pierre-François Souyri, auteur notamment d’une très bonne Histoire du Japon médiéval, et qui traduit le présent ouvrage dû au médiéviste japonais Katsumata Shizuo, cette introduction donc se montre particulièrement précieuse, qui permet de se faire une idée de l’historiographie sur le sujet – car elle est complexe, et déterminante pour bien apprécier l’écho que ce (relativement) petit livre a pu rencontrer à sa sortie en 1982.
Les ikki, initialement, n’intéressaient pas les historiens « traditionnels » de Meiji. Ceux-ci avaient hérité de leurs précurseurs imprégnés de néo-confucianisme une conception très événementielle de l’histoire, qui s’intéressait aux « grands hommes » et aux faits politiques. Dans leur conception, les ikki ne pouvaient être, au mieux, qu’un symptôme de « mauvais gouvernement », et du temps de Meiji ils étaient donc fort pratiques pour dénigrer le régime shogunal, mais il n’y avait rien de plus à en dire, et il aurait même été de mauvais goût de le faire : c’était, dans tous les sens du terme, un sujet « vulgaire ».
Mais cette perspective a évolué en même temps que l’approche de la science historique changeait : des historiens progressistes, à la même époque, se sont mis à évoquer le sujet, sous un jour différent, qui ont montré que les ikki ne pouvaient pas simplement être envisagés comme des épiphénomènes, mais avaient leur propre valeur, non négligeable, et traduisaient des réalités sociales et historiques autrement complexes que le tableau bien lisse et focalisé sur l’élite que perpétuaient toujours les historiens traditionnels.
Sans surprise, la matière a été bouleversée par l’historiographie marxiste – surtout après 1918, quand des « émeutes du riz » ont réveillé le souvenir des ikki du moyen âge ou de l’époque d’Edo. Les ikki s’inscrivaient alors dans la logique du matérialisme historique, et étaient un symptôme de la lutte des classes plutôt que du « mauvais gouvernement » à proprement parler. Cette approche a été déterminante et fructueuse, notamment en incitant la discipline historique japonaise à se tourner vers les éléments économiques et sociaux, approche qui a peut-être surtout payé en histoire locale. Car cette approche, à terme, et de manière plus générale, avait ses propres défauts : l’idéologie y jouait une part importante, qui a pu biaiser les recherches, par exemple en mettant trop l’accès sur l’idée de lutte des classes (là où les ikki étaient des mouvements plus divers socialement), ou en postulant l’échec de ces mouvements dans la logique du matérialisme historique. Les travaux précurseurs des années 1920 ou 1930, cinquante ans plus tard, avaient laissé la place à des héritiers un peu trop sclérosés par l’idéologie… et aveugles à certains aspects d’un phénomène trop complexe pour rentrer parfaitement dans des nomenclatures rigides.
D’autres approches étaient pourtant envisageables. À peu près à l’époque où le marxisme faisait son apparition dans la discipline historique au Japon, un autre courant, dans la lignée de Yanagita Kunio, le fondateur de l’anthropologie japonaise moderne, entendait approcher la paysannerie et la ruralité sous un prisme différent. Ces auteurs, très assidus dans l’histoire locale, reprochaient notamment aux historiens marxistes (et sans doute à d’autres parmi leurs précurseurs) de n’envisager le monde paysan qu’au regard de ses crises – dont les ikki étaient probablement l’exemple le plus frappant. Pour ces auteurs critiques, il importait au moins autant et probablement davantage d’envisager la paysannerie dans sa « normalité », dans son quotidien – étudier les ikki était utile, mais se focaliser sur ces mouvements parfois très violents biaisait nécessairement l’approche du phénomène paysan global ; et on ne pouvait sans doute pleinement appréhender les ikki si l’on faisait abstraction des pratiques et des idées du monde paysans hors crises – et c’était bien là ce qu’il fallait critiquer notamment chez les historiens marxistes.
Vers les années 1970-1980, un nouveau courant s’est développé, souvent qualifié d’ « histoire sociale », qui a fait la part des choses dans tout cela. L’ouvrage de Katsumata Shizuo s’inscrit globalement dans cette nouvelle approche, et son analyse des ikki en témoigne : l’auteur n’exclut certes pas les dimensions politiques, économiques et sociales du phénomène, mais celles qui l’intéressent le plus ici tiennent essentiellement aux rituels, à la symbolique et à la pratique, au droit aussi – et c’est en conjuguant ces différentes approches que l’on peut, si l’on y tient, dériver, d’une certaine manière, un discours politique éclairant pour le Japon contemporain et éventuellement au-delà.
Mais, avant d’en arriver là, il faut remonter aux origines. Quand on parle d’ikki, généralement, on fait référence à des mouvements d’ampleur des époques Muromachi et Sengoku ou Azuchi-Momoyama, disons « le moyen âge japonais », puis de l’époque d’Edo, davantage envisagée comme « époque moderne » – et ces deux temps de l’histoire des ikki sont assez différents. Mais, pour Katsumata Shizuo, non seulement il faut remonter bien plus loin, mais, en outre, il ne faut pas se focaliser excessivement sur la seule paysannerie.
En effet, pour l’auteur, ce qui constitue l’ikki à proprement parler, c’est le fait de « jurer ensemble ». Et, à ce compte-là, on peut relever des ikki, datant de Heian (voire de Nara ?) ou de Kamakura, dans d’autres couches sociales que la paysannerie, et qui ont probablement influencé cette dernière dans ses pratiques ultérieures. Il y a alors des ikki de guerriers, si cette dernière notion évolue alors rapidement, mais, ce qui retient le plus l’attention de l’auteur, ce sont les ikki de moines bouddhistes. Dans divers monastères, et non des moindres, on voit en effet des moines jurer, et selon un rituel presque immuable : on émet ensemble une revendication, on l’écrit, tout le monde la signe (et sans distinctions de rang), on brûle la pétition, on en mêle les cendres à de l’eau, et tout le monde boit cette dernière – ce « rituel de l’eau » est très répandu, et on le retrouvera dans les ikki paysans.
Or il y a toute une manière de penser derrière ce rituel. Les moines qui boivent l’eau, consciemment ou pas, font appel à des « souvenirs » plus ou moins exacts du bouddhisme primitif, et en dérivent la valeur supérieure du principe d’unanimité : une décision qui est prise par tous est forcément légitime, en fait on ne saurait concevoir légitimité plus importante – il y a quelque chose, là-bas, du vox populi, vox Dei, encore que cet adage latin trouve probablement davantage à s’appliquer aux ikki paysans ultérieurs, mais justement parce qu’ils perpétueront cette pratique et ce sentiment. Pourtant, la notion évolue – car, bientôt, le principe d’unanimité se transforme en principe majoritaire. Pour les moines, il n’y a pas là de contradiction : la décision prise à la majorité bénéficie de la légitimité de l’unanimité – car ceux qui ont voté différemment se plient à la décision majoritaire, et, dès lors, font tout pour la défendre même si elle ne leur plaisait pas initialement.
Or il faut revenir sur l’idée qu’il n’y a pas de distinctions de rang dans ces ikki de moines, parce qu’il en restera quelque chose dans les ikki paysans – où les tenanciers les plus humbles se retrouveront souvent associés à des petits propriétaires terriens, à des jizamurai, parfois là aussi à des moines, sans que le serment ne témoigne de leurs différences de statut : ils sont tous au même niveau. Et c’est probablement là encore quelque chose qui a pu être influencé par le bouddhisme primitif (je suppose que le Shintô a pu aussi y avoir sa part).
L’auteur voit dans cette pensée de la légitimité et de l’unanimité une forme de principe démocratique qui éclaire la démocratie japonaise contemporaine – mais il aura aussi l’occasion de montrer combien les mouvements de révolte tels que les ikki ont toujours accordé un rôle prépondérant à cette idée d’une légitimité « automatique », d’une certaine manière : du simple fait qu’ils jurent ensemble, les paysans révoltés expriment une légitimité absolue et incontestable – au point de l’incompréhension fondamentale et mutuelle, quand ils doivent faire face à la répression par les autorités, et leur « monopole de la violence légitime », pour citer Max Weber.
Mais, justement, il y a là d’emblée un aspect politique intéressant de ce discours, et qui vient nuancer voire contredire l’approche notamment marxiste des ikki. Celle-ci ne pouvait que relever combien les ikki, ces mouvements populaires, avaient pu effrayer les puissants, et, dans le cadre de l’historiographie japonaise, c’était donc déjà quelque chose : les ikki n’étaient pas que des épiphénomènes symptomatiques d’un « mauvais gouvernement », ils étaient des aspects de la lutte des classes, et parfois étrangement efficaces car finalement organisés dans leur fonctionnement, plutôt que véritablement spontanés ; en se fédérant, les ikki ont pu exercer le véritable pouvoir effectif sur de vastes provinces pendant des années, voire des décennies – et tant pis pour les « grands hommes », l’élite guerrière ; tant pis aussi et surtout pour le mythe encore largement perpétué aujourd’hui d’un Japon par essence « soumis » à ses dirigeants, un des stéréotypes les plus tenaces en la matière… Cependant, l’historiographie marxiste japonaise tendait semble-t-il à conclure à « l’échec » des ikki – pour des raisons idéologiques que je serais bien en peine de détailler outre mesure. L’approche de Katsumata Shizuo est différente – et, dans ce principe démocratique et ce questionnement de la légitimité via l’unanimité, même dégradée en majorité, il voit donc quelque chose qui a pu se montrer déterminant dans l’histoire politique du Japon contemporain, même si d’abord de manière plus ou moins insidieuse.
Mais il s’intéresse avant tout, ici, aux rituels et à la symbolique – car le « rituel de l’eau » n’est pas le seul. Les ikki paysans témoignent d’autres pratiques, mais, dans l’esprit de l’auteur, elles renvoient pour la plupart à cette notion centrale de légitimité. Ainsi, par exemple, il relève que les paysans qui constituent un ikki le font de manière très solennelle, mais en usant d’une symbolique à première vue ambiguë, notamment en ce qui concerne les costumes. Katsumata Shizuo, dans les nombreuses sources locales qui sont à l’origine de son argumentaire, relève que les paysans révoltés usent d’un costume particulier : manteau de pluie, large chapeau conique, parfois une étole blanche qui leur masque le visage. À l’en croire, ces atours vestimentaires ont une signification, les paysans ne les emploient pas seulement parce qu’ils sont « pratiques » et aisément disponibles : ils constituent en fait les attributs d’un personnage qui, d’une certaine manière, « sort du monde », ce dont le tissu qui dissimule leur visage témoigne tout particulièrement, car, bien avant d’être un moyen de se prémunir des investigations des autorités désireuses d’identifier les insoumis, c’était un signe distinctif traditionnel des lépreux (parmi d’autres, dont des vêtements de couleur orange sauf erreur, dont les paysans révoltés se revêtent parfois, d’ailleurs). Mais ce statut « hors-castes », qui pouvait temporairement les associer aux hinin et eta, avait des implications symboliques plus complexes, aux conséquences politiques notables : en fait, si revêtir ce costume excluait de la société des hommes, de manière plus ou moins « magique », il conférait aussi à qui l’arborait des attributs non humains et en fait d’essence supérieure – Katsumata Shizuo relève ainsi que, dans bien des cas, et notamment en lien avec ce costume, les paysans révoltés comme ceux contre lesquels ils s’insurgeaient multipliaient les références aux tengu, ces êtres mythiques tenant de l’homme et du corbeau, et dotés de pouvoirs hors-normes ; le costume, d’une certaine manière, conférait aux paysans ces pouvoirs – mais ils en dérivaient là aussi une forme de légitimité supérieure ; en fait, très concrètement, certaines sources évoquent clairement l’idée que les paysans membres des ikki, au travers de divers rituels, étaient comme « habités » par des divinités, tout bonnement, le temps de leur révolte. La légitimité « automatique » dérivée du principe d’unanimité était ainsi redoublée d’une autre légitimité, d’ordre davantage magico-religieux, mais d’essence tout aussi « supérieure ».
Mais les ikki évoluent – parce que la société japonaise dans laquelle elles germent change, notamment aux plans, pas seulement politique, mais aussi et surtout économique et juridique. Le chaos de la fin de Muromachi, ou de la période dite Sengoku, des « provinces en guerre », incite sans doute les paysans à se fédérer en ikki, puis les ikki entre eux, pour assurer « l’ordre » quand les seigneurs théoriques ne sont pas en mesure de le faire, mais cela va au-delà – et c’est bien pourquoi ce sont d’abord ces ikki sur lesquels on met traditionnellement l’accent (plus tard, ceux d’Edo seront d’un ordre un peu différent).
Les ikki, traditionnellement, à vrai dire ceux des paysans comme ceux des moines, étaient souvent liés aux déprédations commises par de mauvais intendants, préfets, etc., qu’il s’agissait de démettre : les ikki réclamaient le départ de l’administrateur, et, plus qu’à leur tour, ils obtenaient gain de cause. Mais ces déprédations reprochées, au premier chef, étaient souvent d’ordre fiscal : il s’agissait de rejeter des impositions nouvelles ou excessives. Ce trait demeurera tout au long de l’histoire des ikki, mais, vers cette époque, il commence à être associé à d’autres aspects de la question – parce que le rapport à la terre, en même temps que l’économie rurale et la conception même du droit de propriété, évoluent.
En effet, un terme qui revient souvent dans les revendications des ikki est celui du « gouvernement vertueux » : les paysans réclament des autorités, sous cet intitulé, un « acte de grâce », autre moyen de désigner en fait, de manière systématique, l’abolition des dettes et la récupération des terres mises en gage. En effet, vers cette époque, dans les campagnes, certains individus développent une activité de prêt à intérêt – les aubergistes et les brasseurs de saké, notamment… mais aussi certains monastères pas très scrupuleux ! Les paysans, confrontés à un système d’imposition nouveau, sont souvent contraints de recourir à leurs prêts, et s’endettent drastiquement, très vite. Ils forment alors un ikki, réclamant l’abolition des dettes (et, sous Edo, on trouvera certaines allusions significatives au fait qu’il s’agit d’abolir toutes les dettes, pour tout le monde), et la restitution des terres vendues ou mises en gage. Là encore, il leur arrive régulièrement d’obtenir gain de cause – et les autorités anticipent même parfois les revendications ou à vrai dire la simple constitution des ikki en émettant d’elles-mêmes de telles lois de « gouvernement vertueux » (notamment, relève l’auteur, en périodes de crise… ou quand le calendrier, ou tel signe astronomique, laissent entendre que l’année sera « mauvaise », pour des raisons là encore magico-religieuses).
Cela peut nous paraître étonnant, aujourd’hui, mais Katsumata Shizuo explique ce phénomène de manière assez lumineuse : recourant aussi bien à l’Essai sur le don de Marcel Mauss qu’aux études de ses compatriotes sur le droit médiéval, il établit bien que tout cela témoigne d’une conception du droit de propriété, et de l’acte de vente, différente de celles auxquelles nous a habitué le droit contemporain, dans la lignée de l'essor du capitalisme – car c'est bien ce qui se produit alors. Dans ce contexte, il est en fait parfaitement normal que la terre « revienne », qu’on ne la laisse pas « filer », parce qu’elle avant tout liée à la famille, ainsi qu’à l’usage effectif ; et, au fond, le cas du Japon ici n’est pas si différent de celui de la France, qui a connu des institutions comme le retrait lignager – et Marcel Mauss, parmi d’autres, avait étudié le droit coutumier pour le mettre en évidence. On pèse ici combien la conception moderne et actuelle du droit de propriété n’a absolument rien de « naturel » et d’inaltérable, quoi qu'on en dise… Et il faut relever qu’à cet égard l’alliance entre les petits tenanciers et des paysans davantage prospères pouvaient se perpétuer, avec des ennemis communs en la personne des prêteurs – les samouraïs ruraux étant également de la partie, le cas échéant, et parfois des religieux.
Mais cette nouvelle conception du droit de propriété, avec ses corollaires, se développe bel et bien au Japon vers cette époque – et la contradiction insoluble entre cette nouvelle approche et la traditionnelle génère de nombreux ikki.
Qui tendent par ailleurs à devenir plus violents… Les ikki initiaux, ceux des moines notamment, n’étaient certes pas exempts de démonstrations de force : les moines qui manifestaient par milliers, en emportant sur des sortes de palanquins des statues de divinités et de bouddhas (ils n’étaient donc à cet égard pas du tout différents des paysans se changeant plus ou moins en tengu ou se laissant temporairement habiter par des divinités, le rituel avait exactement le même objectif au regard de la légitimité comme de l’intimidation), ces moines donc constituaient un spectacle intimidant mais aussi assez récurrent – ils faisaient souvent plier leurs adversaires de la sorte, mais des violences plus concrètes pouvaient éclater à l’occasion. À vrai dire, ces moines étaient une plaie endémique, notamment aux environs de la capitale – un problème auquel Oda Nobunaga a apporté une solution brutale…
Mais il en allait de même pour les paysans. Initialement, les ikki ruraux se contentaient le plus souvent de menacer de « faire la grève » ou de déguerpir en masse (via le rituel consistant à « étaler les bambous », à la symbolique complexe) ; et les juristes d'alors stipulaient que c'était là un droit inaliénable des paysans. Ces menaces, parfois mises en pratique, sont, au sens juridique, des « violences », mais pas exactement comme nous l’entendons le plus souvent… Or les violences au sens où nous l'entendons couramment se développent – et les ultimes ikki de la période d’Edo franchiront encore une étape en l’espèce, en se montrant parfois sanglants, toujours destructeurs. Cependant, juste après Oda Nobunaga, il faut sans doute mentionner la « chasse aux sabres » menée par Toyotomi Hideyoshi, qui visait à désarmer les paysans – et a constitué une première étape vers l’établissement du système de castes assez rigide du shogunat Tokugawa ; mais c’est une question très complexe, et éventuellement plus ambiguë qu'il n'y paraît, que je ne me sens vraiment pas de développer ici…
Quoi qu’il en soit, les violences des ikki pèsent d’abord essentiellement sur les biens matériels : on s’en prend aux entrepôts monopolisant le riz, aux brasseries, aux auberges, mais donc aussi à certains monastères – très souvent, on y met le feu. Il y avait probablement un aspect très pratique à cet égard :
Lien : http://nebalestuncon.over-bl..
Il faut dire que le sujet des ikki – mot derrière lequel on range, en gros, essentiellement des mouvements de révolte paysans du moyen âge et de l’époque d’Edo, qui peuvent faire penser à nos jacqueries, mais cela va en fait bien au-delà (les paysans n’étaient pas les seuls impliqués, les ikki pouvaient être urbains, etc.) –, ce sujet donc a été beaucoup traité là-bas, et de manières très différentes. Ici, l’introduction de Pierre-François Souyri, auteur notamment d’une très bonne Histoire du Japon médiéval, et qui traduit le présent ouvrage dû au médiéviste japonais Katsumata Shizuo, cette introduction donc se montre particulièrement précieuse, qui permet de se faire une idée de l’historiographie sur le sujet – car elle est complexe, et déterminante pour bien apprécier l’écho que ce (relativement) petit livre a pu rencontrer à sa sortie en 1982.
Les ikki, initialement, n’intéressaient pas les historiens « traditionnels » de Meiji. Ceux-ci avaient hérité de leurs précurseurs imprégnés de néo-confucianisme une conception très événementielle de l’histoire, qui s’intéressait aux « grands hommes » et aux faits politiques. Dans leur conception, les ikki ne pouvaient être, au mieux, qu’un symptôme de « mauvais gouvernement », et du temps de Meiji ils étaient donc fort pratiques pour dénigrer le régime shogunal, mais il n’y avait rien de plus à en dire, et il aurait même été de mauvais goût de le faire : c’était, dans tous les sens du terme, un sujet « vulgaire ».
Mais cette perspective a évolué en même temps que l’approche de la science historique changeait : des historiens progressistes, à la même époque, se sont mis à évoquer le sujet, sous un jour différent, qui ont montré que les ikki ne pouvaient pas simplement être envisagés comme des épiphénomènes, mais avaient leur propre valeur, non négligeable, et traduisaient des réalités sociales et historiques autrement complexes que le tableau bien lisse et focalisé sur l’élite que perpétuaient toujours les historiens traditionnels.
Sans surprise, la matière a été bouleversée par l’historiographie marxiste – surtout après 1918, quand des « émeutes du riz » ont réveillé le souvenir des ikki du moyen âge ou de l’époque d’Edo. Les ikki s’inscrivaient alors dans la logique du matérialisme historique, et étaient un symptôme de la lutte des classes plutôt que du « mauvais gouvernement » à proprement parler. Cette approche a été déterminante et fructueuse, notamment en incitant la discipline historique japonaise à se tourner vers les éléments économiques et sociaux, approche qui a peut-être surtout payé en histoire locale. Car cette approche, à terme, et de manière plus générale, avait ses propres défauts : l’idéologie y jouait une part importante, qui a pu biaiser les recherches, par exemple en mettant trop l’accès sur l’idée de lutte des classes (là où les ikki étaient des mouvements plus divers socialement), ou en postulant l’échec de ces mouvements dans la logique du matérialisme historique. Les travaux précurseurs des années 1920 ou 1930, cinquante ans plus tard, avaient laissé la place à des héritiers un peu trop sclérosés par l’idéologie… et aveugles à certains aspects d’un phénomène trop complexe pour rentrer parfaitement dans des nomenclatures rigides.
D’autres approches étaient pourtant envisageables. À peu près à l’époque où le marxisme faisait son apparition dans la discipline historique au Japon, un autre courant, dans la lignée de Yanagita Kunio, le fondateur de l’anthropologie japonaise moderne, entendait approcher la paysannerie et la ruralité sous un prisme différent. Ces auteurs, très assidus dans l’histoire locale, reprochaient notamment aux historiens marxistes (et sans doute à d’autres parmi leurs précurseurs) de n’envisager le monde paysan qu’au regard de ses crises – dont les ikki étaient probablement l’exemple le plus frappant. Pour ces auteurs critiques, il importait au moins autant et probablement davantage d’envisager la paysannerie dans sa « normalité », dans son quotidien – étudier les ikki était utile, mais se focaliser sur ces mouvements parfois très violents biaisait nécessairement l’approche du phénomène paysan global ; et on ne pouvait sans doute pleinement appréhender les ikki si l’on faisait abstraction des pratiques et des idées du monde paysans hors crises – et c’était bien là ce qu’il fallait critiquer notamment chez les historiens marxistes.
Vers les années 1970-1980, un nouveau courant s’est développé, souvent qualifié d’ « histoire sociale », qui a fait la part des choses dans tout cela. L’ouvrage de Katsumata Shizuo s’inscrit globalement dans cette nouvelle approche, et son analyse des ikki en témoigne : l’auteur n’exclut certes pas les dimensions politiques, économiques et sociales du phénomène, mais celles qui l’intéressent le plus ici tiennent essentiellement aux rituels, à la symbolique et à la pratique, au droit aussi – et c’est en conjuguant ces différentes approches que l’on peut, si l’on y tient, dériver, d’une certaine manière, un discours politique éclairant pour le Japon contemporain et éventuellement au-delà.
Mais, avant d’en arriver là, il faut remonter aux origines. Quand on parle d’ikki, généralement, on fait référence à des mouvements d’ampleur des époques Muromachi et Sengoku ou Azuchi-Momoyama, disons « le moyen âge japonais », puis de l’époque d’Edo, davantage envisagée comme « époque moderne » – et ces deux temps de l’histoire des ikki sont assez différents. Mais, pour Katsumata Shizuo, non seulement il faut remonter bien plus loin, mais, en outre, il ne faut pas se focaliser excessivement sur la seule paysannerie.
En effet, pour l’auteur, ce qui constitue l’ikki à proprement parler, c’est le fait de « jurer ensemble ». Et, à ce compte-là, on peut relever des ikki, datant de Heian (voire de Nara ?) ou de Kamakura, dans d’autres couches sociales que la paysannerie, et qui ont probablement influencé cette dernière dans ses pratiques ultérieures. Il y a alors des ikki de guerriers, si cette dernière notion évolue alors rapidement, mais, ce qui retient le plus l’attention de l’auteur, ce sont les ikki de moines bouddhistes. Dans divers monastères, et non des moindres, on voit en effet des moines jurer, et selon un rituel presque immuable : on émet ensemble une revendication, on l’écrit, tout le monde la signe (et sans distinctions de rang), on brûle la pétition, on en mêle les cendres à de l’eau, et tout le monde boit cette dernière – ce « rituel de l’eau » est très répandu, et on le retrouvera dans les ikki paysans.
Or il y a toute une manière de penser derrière ce rituel. Les moines qui boivent l’eau, consciemment ou pas, font appel à des « souvenirs » plus ou moins exacts du bouddhisme primitif, et en dérivent la valeur supérieure du principe d’unanimité : une décision qui est prise par tous est forcément légitime, en fait on ne saurait concevoir légitimité plus importante – il y a quelque chose, là-bas, du vox populi, vox Dei, encore que cet adage latin trouve probablement davantage à s’appliquer aux ikki paysans ultérieurs, mais justement parce qu’ils perpétueront cette pratique et ce sentiment. Pourtant, la notion évolue – car, bientôt, le principe d’unanimité se transforme en principe majoritaire. Pour les moines, il n’y a pas là de contradiction : la décision prise à la majorité bénéficie de la légitimité de l’unanimité – car ceux qui ont voté différemment se plient à la décision majoritaire, et, dès lors, font tout pour la défendre même si elle ne leur plaisait pas initialement.
Or il faut revenir sur l’idée qu’il n’y a pas de distinctions de rang dans ces ikki de moines, parce qu’il en restera quelque chose dans les ikki paysans – où les tenanciers les plus humbles se retrouveront souvent associés à des petits propriétaires terriens, à des jizamurai, parfois là aussi à des moines, sans que le serment ne témoigne de leurs différences de statut : ils sont tous au même niveau. Et c’est probablement là encore quelque chose qui a pu être influencé par le bouddhisme primitif (je suppose que le Shintô a pu aussi y avoir sa part).
L’auteur voit dans cette pensée de la légitimité et de l’unanimité une forme de principe démocratique qui éclaire la démocratie japonaise contemporaine – mais il aura aussi l’occasion de montrer combien les mouvements de révolte tels que les ikki ont toujours accordé un rôle prépondérant à cette idée d’une légitimité « automatique », d’une certaine manière : du simple fait qu’ils jurent ensemble, les paysans révoltés expriment une légitimité absolue et incontestable – au point de l’incompréhension fondamentale et mutuelle, quand ils doivent faire face à la répression par les autorités, et leur « monopole de la violence légitime », pour citer Max Weber.
Mais, justement, il y a là d’emblée un aspect politique intéressant de ce discours, et qui vient nuancer voire contredire l’approche notamment marxiste des ikki. Celle-ci ne pouvait que relever combien les ikki, ces mouvements populaires, avaient pu effrayer les puissants, et, dans le cadre de l’historiographie japonaise, c’était donc déjà quelque chose : les ikki n’étaient pas que des épiphénomènes symptomatiques d’un « mauvais gouvernement », ils étaient des aspects de la lutte des classes, et parfois étrangement efficaces car finalement organisés dans leur fonctionnement, plutôt que véritablement spontanés ; en se fédérant, les ikki ont pu exercer le véritable pouvoir effectif sur de vastes provinces pendant des années, voire des décennies – et tant pis pour les « grands hommes », l’élite guerrière ; tant pis aussi et surtout pour le mythe encore largement perpétué aujourd’hui d’un Japon par essence « soumis » à ses dirigeants, un des stéréotypes les plus tenaces en la matière… Cependant, l’historiographie marxiste japonaise tendait semble-t-il à conclure à « l’échec » des ikki – pour des raisons idéologiques que je serais bien en peine de détailler outre mesure. L’approche de Katsumata Shizuo est différente – et, dans ce principe démocratique et ce questionnement de la légitimité via l’unanimité, même dégradée en majorité, il voit donc quelque chose qui a pu se montrer déterminant dans l’histoire politique du Japon contemporain, même si d’abord de manière plus ou moins insidieuse.
Mais il s’intéresse avant tout, ici, aux rituels et à la symbolique – car le « rituel de l’eau » n’est pas le seul. Les ikki paysans témoignent d’autres pratiques, mais, dans l’esprit de l’auteur, elles renvoient pour la plupart à cette notion centrale de légitimité. Ainsi, par exemple, il relève que les paysans qui constituent un ikki le font de manière très solennelle, mais en usant d’une symbolique à première vue ambiguë, notamment en ce qui concerne les costumes. Katsumata Shizuo, dans les nombreuses sources locales qui sont à l’origine de son argumentaire, relève que les paysans révoltés usent d’un costume particulier : manteau de pluie, large chapeau conique, parfois une étole blanche qui leur masque le visage. À l’en croire, ces atours vestimentaires ont une signification, les paysans ne les emploient pas seulement parce qu’ils sont « pratiques » et aisément disponibles : ils constituent en fait les attributs d’un personnage qui, d’une certaine manière, « sort du monde », ce dont le tissu qui dissimule leur visage témoigne tout particulièrement, car, bien avant d’être un moyen de se prémunir des investigations des autorités désireuses d’identifier les insoumis, c’était un signe distinctif traditionnel des lépreux (parmi d’autres, dont des vêtements de couleur orange sauf erreur, dont les paysans révoltés se revêtent parfois, d’ailleurs). Mais ce statut « hors-castes », qui pouvait temporairement les associer aux hinin et eta, avait des implications symboliques plus complexes, aux conséquences politiques notables : en fait, si revêtir ce costume excluait de la société des hommes, de manière plus ou moins « magique », il conférait aussi à qui l’arborait des attributs non humains et en fait d’essence supérieure – Katsumata Shizuo relève ainsi que, dans bien des cas, et notamment en lien avec ce costume, les paysans révoltés comme ceux contre lesquels ils s’insurgeaient multipliaient les références aux tengu, ces êtres mythiques tenant de l’homme et du corbeau, et dotés de pouvoirs hors-normes ; le costume, d’une certaine manière, conférait aux paysans ces pouvoirs – mais ils en dérivaient là aussi une forme de légitimité supérieure ; en fait, très concrètement, certaines sources évoquent clairement l’idée que les paysans membres des ikki, au travers de divers rituels, étaient comme « habités » par des divinités, tout bonnement, le temps de leur révolte. La légitimité « automatique » dérivée du principe d’unanimité était ainsi redoublée d’une autre légitimité, d’ordre davantage magico-religieux, mais d’essence tout aussi « supérieure ».
Mais les ikki évoluent – parce que la société japonaise dans laquelle elles germent change, notamment aux plans, pas seulement politique, mais aussi et surtout économique et juridique. Le chaos de la fin de Muromachi, ou de la période dite Sengoku, des « provinces en guerre », incite sans doute les paysans à se fédérer en ikki, puis les ikki entre eux, pour assurer « l’ordre » quand les seigneurs théoriques ne sont pas en mesure de le faire, mais cela va au-delà – et c’est bien pourquoi ce sont d’abord ces ikki sur lesquels on met traditionnellement l’accent (plus tard, ceux d’Edo seront d’un ordre un peu différent).
Les ikki, traditionnellement, à vrai dire ceux des paysans comme ceux des moines, étaient souvent liés aux déprédations commises par de mauvais intendants, préfets, etc., qu’il s’agissait de démettre : les ikki réclamaient le départ de l’administrateur, et, plus qu’à leur tour, ils obtenaient gain de cause. Mais ces déprédations reprochées, au premier chef, étaient souvent d’ordre fiscal : il s’agissait de rejeter des impositions nouvelles ou excessives. Ce trait demeurera tout au long de l’histoire des ikki, mais, vers cette époque, il commence à être associé à d’autres aspects de la question – parce que le rapport à la terre, en même temps que l’économie rurale et la conception même du droit de propriété, évoluent.
En effet, un terme qui revient souvent dans les revendications des ikki est celui du « gouvernement vertueux » : les paysans réclament des autorités, sous cet intitulé, un « acte de grâce », autre moyen de désigner en fait, de manière systématique, l’abolition des dettes et la récupération des terres mises en gage. En effet, vers cette époque, dans les campagnes, certains individus développent une activité de prêt à intérêt – les aubergistes et les brasseurs de saké, notamment… mais aussi certains monastères pas très scrupuleux ! Les paysans, confrontés à un système d’imposition nouveau, sont souvent contraints de recourir à leurs prêts, et s’endettent drastiquement, très vite. Ils forment alors un ikki, réclamant l’abolition des dettes (et, sous Edo, on trouvera certaines allusions significatives au fait qu’il s’agit d’abolir toutes les dettes, pour tout le monde), et la restitution des terres vendues ou mises en gage. Là encore, il leur arrive régulièrement d’obtenir gain de cause – et les autorités anticipent même parfois les revendications ou à vrai dire la simple constitution des ikki en émettant d’elles-mêmes de telles lois de « gouvernement vertueux » (notamment, relève l’auteur, en périodes de crise… ou quand le calendrier, ou tel signe astronomique, laissent entendre que l’année sera « mauvaise », pour des raisons là encore magico-religieuses).
Cela peut nous paraître étonnant, aujourd’hui, mais Katsumata Shizuo explique ce phénomène de manière assez lumineuse : recourant aussi bien à l’Essai sur le don de Marcel Mauss qu’aux études de ses compatriotes sur le droit médiéval, il établit bien que tout cela témoigne d’une conception du droit de propriété, et de l’acte de vente, différente de celles auxquelles nous a habitué le droit contemporain, dans la lignée de l'essor du capitalisme – car c'est bien ce qui se produit alors. Dans ce contexte, il est en fait parfaitement normal que la terre « revienne », qu’on ne la laisse pas « filer », parce qu’elle avant tout liée à la famille, ainsi qu’à l’usage effectif ; et, au fond, le cas du Japon ici n’est pas si différent de celui de la France, qui a connu des institutions comme le retrait lignager – et Marcel Mauss, parmi d’autres, avait étudié le droit coutumier pour le mettre en évidence. On pèse ici combien la conception moderne et actuelle du droit de propriété n’a absolument rien de « naturel » et d’inaltérable, quoi qu'on en dise… Et il faut relever qu’à cet égard l’alliance entre les petits tenanciers et des paysans davantage prospères pouvaient se perpétuer, avec des ennemis communs en la personne des prêteurs – les samouraïs ruraux étant également de la partie, le cas échéant, et parfois des religieux.
Mais cette nouvelle conception du droit de propriété, avec ses corollaires, se développe bel et bien au Japon vers cette époque – et la contradiction insoluble entre cette nouvelle approche et la traditionnelle génère de nombreux ikki.
Qui tendent par ailleurs à devenir plus violents… Les ikki initiaux, ceux des moines notamment, n’étaient certes pas exempts de démonstrations de force : les moines qui manifestaient par milliers, en emportant sur des sortes de palanquins des statues de divinités et de bouddhas (ils n’étaient donc à cet égard pas du tout différents des paysans se changeant plus ou moins en tengu ou se laissant temporairement habiter par des divinités, le rituel avait exactement le même objectif au regard de la légitimité comme de l’intimidation), ces moines donc constituaient un spectacle intimidant mais aussi assez récurrent – ils faisaient souvent plier leurs adversaires de la sorte, mais des violences plus concrètes pouvaient éclater à l’occasion. À vrai dire, ces moines étaient une plaie endémique, notamment aux environs de la capitale – un problème auquel Oda Nobunaga a apporté une solution brutale…
Mais il en allait de même pour les paysans. Initialement, les ikki ruraux se contentaient le plus souvent de menacer de « faire la grève » ou de déguerpir en masse (via le rituel consistant à « étaler les bambous », à la symbolique complexe) ; et les juristes d'alors stipulaient que c'était là un droit inaliénable des paysans. Ces menaces, parfois mises en pratique, sont, au sens juridique, des « violences », mais pas exactement comme nous l’entendons le plus souvent… Or les violences au sens où nous l'entendons couramment se développent – et les ultimes ikki de la période d’Edo franchiront encore une étape en l’espèce, en se montrant parfois sanglants, toujours destructeurs. Cependant, juste après Oda Nobunaga, il faut sans doute mentionner la « chasse aux sabres » menée par Toyotomi Hideyoshi, qui visait à désarmer les paysans – et a constitué une première étape vers l’établissement du système de castes assez rigide du shogunat Tokugawa ; mais c’est une question très complexe, et éventuellement plus ambiguë qu'il n'y paraît, que je ne me sens vraiment pas de développer ici…
Quoi qu’il en soit, les violences des ikki pèsent d’abord essentiellement sur les biens matériels : on s’en prend aux entrepôts monopolisant le riz, aux brasseries, aux auberges, mais donc aussi à certains monastères – très souvent, on y met le feu. Il y avait probablement un aspect très pratique à cet égard :
Lien : http://nebalestuncon.over-bl..
SERENI (Constance) et SOUYRI (Pierre-François), Kamikazes (25 octobre 1944 – 15 août 1945), [Paris], Flammarion, coll. Au fil de l’histoire, 2015, 251 p. [+ 8 p. de pl.]
INCOMPRÉHENSION
Les kamikazes, à l'instar du seppuku (qui leur est éventuellement associé et sans doute bien trop légèrement), font partie de ces emblèmes à forte connotation symbolique qui en sont venus à caractériser le Japon auprès des non-Japonais – presque instinctivement. Ce phénomène étonnant n’a guère tardé à véhiculer des connotations qui lui sont propres ; ainsi, on en fait souvent l’exemple typique du suicide altruiste au sens de Durkheim, qui ne pouvait certes lui-même en avoir conscience en 1897, date de parution de son célèbre ouvrage... De manière plus générale, le mot même de « kamikaze » (que les Japonais n’emploient d’ailleurs pas forcément, ou pas avec le même sens, j’y reviendrai) a intégré le lexique des langues occidentales, y compris voire avant tout le lexique « populaire », disons, et, mine de rien, cela n’arrive pas si souvent. Pour autant, s’il est une chose dont tant le vocable que ses emplois conventionnels témoignent, c’est sans doute d’une incompréhension fondamentale à l’égard de ce phénomène très ponctuel mais qui a durablement marqué les esprits.
Finalement, il ne s’agit pas forcément tant d’une question factuelle (même si c’est bien sûr la base de toute autre interrogation) que d’une question de représentations. Et c’est peut-être là que se situe le problème, car les représentations sont fluctuantes – et même plus que cela, dans le cas présent : de part et d’autre du Pacifique, « kamikaze », même à s’en tenir à la référence la plus précise aux événements de 1944-1945, ne signifie au fond pas du tout la même chose… À cet égard, l’incompréhension est peut-être, d’une certaine manière, renforcée, propice aux jugements de valeur parfaitement arbitraires et détachés des faits comme de leur interprétation raisonnée (même si jamais totalement assurée).
Bien sûr, il y a une part essentielle de fascination dans toute étude de ce phénomène hors-normes – une fascination morbide, une fascination néanmoins ; et je n’y échappe certainement pas, bien au contraire : je plaide coupable. Mais, cette fois, c’est sans doute dans l’ordre des choses – car les kamikazes, dans leur dimension symbolique, ont sans doute été appréhendés, et même conçus, dès le départ, comme un récit médiatique saisissant, qu’on le considère avant tout poignant, inspirant ou terrifiant ; en fait, toutes ces dimensions, et d’autres encore, doivent probablement être associées : les kamikazes n’ont rien d’unilatéral, même s’il serait tentant de s’en tenir là...
D’où, me concernant, la lecture de cet ouvrage, assez bref, très abordable, tout à fait sérieux néanmoins (ne pas se fier à l’accroche un peu putassière en couverture – et le nom de Pierre-François Souyri, régulièrement croisé ici ou là, si je n’en ai lu pour l’heure que son excellente Histoire du Japon médiéval : le monde à l’envers, m’inspirait confiance). Ce fut aussi l’occasion de prolonger avec un exemple très concret, et par ailleurs ponctuel, d’autres lectures éventuellement liées, comme La Mort volontaire au Japon, de Maurice Pinguet, ou Morts pour l’empereur : la question du Yasukuni, de Takahashi Tetsuya – deux ouvrages cités dans la bibliographie, d’ailleurs et sans vraie surprise.
QUESTIONS DE TERMINOLOGIE
En fait, un problème se pose d’emblée, concernant le simple vocabulaire utilisé. En français, et dans beaucoup d’autres langues en dehors du Japon, nous parlons donc de « kamikazes » ; la signification de ce vocable découle des deux mots (et idéogrammes, ou kanji) japonais ainsi associés, kami qui désigne, pour faire simple, les esprits ou les dieux, et kaze, qui signifie le vent.
Donc, « kamikaze » signifie « vent divin » ; et, très concrètement, cela renvoie à une anecdote historique, portant sur les deux tentatives d’invasion du Japon par les Mongols à la fin du XIIIe siècle – deux échecs où, selon la légende, la météo eut sa part, puisque des typhons ont balayé à chaque fois la flotte des envahisseurs : à proprement parler, c’est donc ceci qui est le « vent divin » – comme une confirmation éloquente de ce que le Japon est « le pays des dieux », et que les dieux ne manqueront pas de venir à son secours en cas de tentative d’invasion étrangère (rappelons que le Japon n’a jamais été envahi avant 1945). Il ne s’agit pas cependant de se reposer sur ce mythe : « Aide-toi, le ciel t’aidera », dit-on par ici, et finalement il y a de cette idée au Japon également – car les combats acharnés des samouraïs du XIIIe siècle ont eu leur part essentielle dans la défaite des Mongols : il n’y avait pas « que » le « vent divin »… Le lien avec la situation du Japon en 1944-1945 se fait donc tout naturellement, à ces différents niveaux.
Les Japonais utilisent le mot kamikaze, écrit ainsi : 神風 ; et on retrouve bien sûr le lien avec l’anecdote du « vent divin ». En fait, c’est surtout la presse (à laquelle il faut adjoindre la propagande cinématographique, actualités ou films de « fiction ») qui, à l’époque, avait employé ce terme, et avec cette prononciation, c’est-à-dire la lecture kun, ou proprement japonaise ; or l’armée lisait plus souvent les mêmes kanji avec la lecture on, ou « sino-japonaise », soit shinpû ; le sens global reste peu ou prou le même, mais il s’accompagne en même temps de connotations différentes – de manière générale, la lecture on est souvent perçue comme plus « sophistiquée » (élégante, cultivée, etc.) que la lecture kun, mais il semblerait aussi qu’on ait trouvé en l’espèce cette prononciation plus « martiale ». D’emblée, donc, le terme « kamikaze » existe, mais sans être le terme courant.
D’autant qu’il s’agit d’une sorte de licence poétique… Le terme officiel pour désigner ce que nous nommons « kamikazes » n’a en fait rien à voir, et est autrement prosaïque : on parle de tokubetsu kôgekitai (特別攻撃隊), souvent abrégé en tokkôtai (特攻隊), ce qui signifie « unités d’attaque spéciales ». Encore aujourd’hui, c’est le terme employé par les Japonais – qui ne recourent guère à kamikaze ou shinpû, si ce n’est pas totalement inenvisageable. Et on pèse ici le poids des connotations.
D’autant qu’un dernier aspect doit sans doute être mentionné – et qui est l’emploi contemporain du mot « kamikaze » par les Occidentaux, etc. Dans nos médias, il n’y a rien que de très normal et parfaitement logique à qualifier de « kamikaze » tel terroriste islamiste qui se fait sauter au milieu de la foule, a fortiori tel autre qui use d’un avion comme d’une arme en se précipitant sur le World Trade Center. Pour les Japonais, cependant, pareille assimilation ne coule pas du tout de source, et les laisse souvent perplexe, semble-t-il – et au mieux ? Car cela pourrait même aller au-delà – jusqu’à l’affect, le sentiment le plus intime… Les kamikazes, ou plutôt les tokkôtai, représentent pour eux une réalité précise, concrète – et terrible ; étendre le vocable à d’autres actions, finalement bien différentes au-delà des similitudes apparentes, ne fait pas vraiment sens.
LE CONTEXTE
Le contexte de l’apparition des kamikazes est donc crucial, tout particulièrement aux yeux des Japonais. Le sous-titre de l’ouvrage en donne les dates précises : les premières attaques kamikazes ont lieu le 25 octobre 1944, lors de la bataille des Philippines (mais il faudra certes revenir un peu en arrière), et le phénomène se poursuit jusqu’au 15 août 1945, date de la reddition du Japon (ou en tout cas, du discours de l’empereur l’annonçant). Moins d’un an, donc – mais bien assez pour que le phénomène se développe et marque à jamais les mentalités, au Japon et au-delà.
Une guerre perdue d’avance
Je ne vais pas rentrer dans le détail des circonstances de la guerre du Pacifique (que j’ai pu évoquer dans d’autres chroniques, comme Morts pour l’empereur : la question du Yasukuni, de Takahashi Tetsuya, Histoire politique du Japon de 1853 à nos jours, d’Eddy Dufourmont, ou Le Japon contemporain, de Michel Vié ; peut-être faut-il aussi mentionner, dans une optique un peu différente, car directement liée à la guerre et aux intérêts américains, Histoire du Japon et des Japonais, d’Edwin O. Reischauer, et Le Chrysanthème et le sabre, de Ruth Benedict).
Retenons cependant cet aspect essentiel : c’était une guerre perdue d’avance. Le plus fou dans tout cela est que l’état-major japonais en était parfaitement conscient – l’amiral Yamamoto, probablement le plus grand stratège nippon d’alors, l’avait signifié à maintes reprises, et d'autres comme lui. Il y avait plusieurs raisons à cela, mais la principale était probablement d’ordre économique : le Japon manquait de ressources, et, à terme, sa production industrielle ou même sa simple mobilité (en termes de carburant, etc.) ne pouvaient qu’en être affectées. Face au Japon, les États-Unis – et leur puissance économique tout autre.
Le seul espoir, très mince, de l’emporter face aux Américains impliquait d’avancer vite, très vite : au moment T, le Japon dispose d’une meilleure flotte (avec des vaisseaux monstrueux dont le célèbre Yamato, brillant symbole de la supériorité de la marine impériale et outil de propagande de choix ; sa perte n'en sera que plus traumatisante), supérieure en nombre (d’autant que la flotte américaine se partage bien sûr entre le Pacifique et l’Atlantique) et d’une technologie remarquable ; de même, il peut compter sur d’excellents avions (notamment les fameux Zéros), bien meilleurs que ceux des Américains alors, ou de tout autre nation à vrai dire, et dont les pilotes sont probablement les mieux formés de par le monde entier. Puisque les militaires ayant accaparé le pouvoir au cours des années 1930, contre toute raison, et, pour certains d’entre eux, absurdement confiants en la supériorité intrinsèque de « l’esprit » japonais, à même de surmonter toute difficulté, comptent bien s’engager dans cette aventure au mieux hasardeuse, pas le choix : il faut profiter immédiatement de ces atouts – d’où l’assaut sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, destiné à porter d’emblée un coup fatal aux États-Unis (qui s’en remettront toutefois très vite), et une conquête accélérée de ce que les Japonais appelleront la « Sphère de Coprospérité de la Grande Asie Orientale ». Très vite, la quasi-totalité des possessions coloniales européennes dans la région tombent entre les mains des Japonais (qui en avaient déjà annexé quelques-unes auparavant, dont l’Indochine française en 1940), et les Alliés sont contraints de reculer partout. L’avancée fulgurante des troupes japonaises donne alors l’impression d’être irrépressible…
Mais, à partir de la bataille de Midway (début juin 1942 ; à peine six mois après Pearl Harbor, donc !), l’armée japonaise cesse d’avancer… et, bientôt, elle recule. Les prévisions de Yamamoto (et de bien d’autres) commencent à se vérifier, et nombreux sont ceux qui conçoivent d’ores et déjà que la guerre est perdue – elle durera pourtant encore trois ans !
Fait crucial : l’économie américaine permet de produire en masse des bateaux ainsi que des avions qui, non contents de rattraper le retard technologique initial sur le Japon, le dépassent bien vite – l’enfoncent, même ; et, en termes quantitatifs, c’est encore plus saisissant. L’économie japonaise ne peut tout simplement pas suivre : elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour ce faire. Les navires et avions que les Japonais produisent de leur côté sont toujours moins performants, moins fiables (au point où de nombreux avions trop hâtivement conçus présentent le risque de se désintégrer en vol !) et de toute façon pas assez nombreux… Et il en va à vrai dire de même de leurs soldats – toujours plus jeunes, toujours moins bien formés ; et tout particulièrement les pilotes, en fait, en contraste flagrant avec la situation au début de la décennie.
Effrayer pour négocier
Bien sûr, les dirigeants de l’armée nippone ne sauraient tenir ce discours à leur propre peuple, civils ou militaires. Jusqu’aux derniers jours du conflit, alors même que la réalité de leur situation se fait de plus en plus palpable, ils continuent de prétendre que la victoire est inéluctable, voire proche – et sont relayés par une propagande médiatique tout aussi confiante. Pourtant, des revers sont notables, qui ne peuvent pas totalement échapper aux Japonais… Mais ils sont systématiquement présentés comme ayant été « prévus » : en fait, ces prétendus revers font pleinement partie du plan qui assurera la victoire du Japon ! Ne serait-ce qu’envisager la possibilité de la défaite est hors de question : la supériorité de « l’esprit » japonais ne le tolère pas.
Mais, sur le terrain, la réalité est tout autre. Les officiers savent, sans doute, et très vite, que la défaite du Japon est inévitable. Dès lors, la tâche de l’armée évolue : il ne s’agit plus de vaincre, mais de résister suffisamment pour imposer aux Américains de négocier la « meilleure » paix possible. La stratégie globale connaît dès lors des errances significatives (et à terme dramatiques, même sans évoquer pour l’heure la question des kamikazes : l’armée japonaise abandonne littéralement des dizaines, voire des centaines de milliers de ses soldats, à charge pour eux de mener avec leurs propres moyens une longue guerre de guérilla...).
Mais même l’opération Shô (« Victoire »), dans les Philippines, en octobre 1944, tient pour une bonne part de la tentative de bluff : il s’agit de leurrer les Américains quant aux troupes et aux moyens dont le Japon dispose encore… ceci, afin de leur faire peur – et donc, car c’est bien le propos, de leur faire entendre que la victoire, même inéluctable, leur coûtera très, très cher. Mieux vaut donc pour eux négocier au plus tôt, et en des termes relativement favorables au Japon – lequel n’est plus en mesure d’espérer davantage.
C’est justement alors qu’ont lieu les premières frappes kamikazes, à partir donc du 25 octobre 1944. Et c’est tout sauf une arme secrète : son pouvoir de dissuasion tient pour une part essentielle à la parfaite connaissance de l’ennemi quant à ce dont il s’agit ! Efficacité matérielle de la stratégie mise à part (j’y reviendrai), l’effet est d’une certaine manière atteint : les Américains développent une véritable psychose des attaques suicides… Mais peut-être l’effet souhaité par les Japonais va-t-il en fait un peu trop loin ? Le « fanatisme » que les Américains croient déceler chez les kamikazes pèsera sans doute d’un certain poids, quitte à ce que ce soit en guise de prétexte, dans la décision d'employer la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki – car, face au « mythe » savamment entretenu des « cent millions de Japonais » prêts à combattre pour leur patrie et leur empereur jusqu’à la mort, à l’instar de ces glorieux pilotes des missions suicides, se développe alors chez les Américains un « mythe » parallèle, celui des « 100 000 vies américaines » que le champignon nucléaire doit permettre d’épargner...
Le suicide d’une nation
Les kamikazes, par une cruelle ironie de l’histoire, sont finalement un symptôme plus qu’éloquent d’une nation aux abois, que les militaires et autres dévots ultranationalistes poussent littéralement au suicide.
La stratégie kamikaze, telle qu’elle a été conçue et mise en place par l’amiral Ônishi Takijirô, aussi horrible qu’elle soit, ne pouvait être dans son esprit qu’une solution ponctuelle, temporaire – ce qui faisait partie du coup de bluff plus global de l’opération Shô. Mais, en quelques semaines, au plus quelques mois (mais rappelons que moins d’un an s’écoulera entre le premier assaut kamikaze et la reddition du Japon), cette stratégie ponctuelle tend toujours un peu plus à devenir structurelle – à définir en fait une stratégie globale, systématique, de l’armée et de la marine impériales. Les kamikazes devaient être une exception, des troupes « spéciales » à proprement parler, mais l’éthique militaire japonaise en étend sans cesse la portée et le champ d’application.
L’exaltation des kamikazes par la propagande joue tout d’abord du mode héroïque – les kamikazes sont littéralement déjà des kami, et, selon la formule devenue rituelle, ils se retrouveront tous au Yasukuni. Mais, progressivement, cette représentation tend à s’effacer au profit d’une autre, qui en fait, d’une certaine manière, « des Japonais comme les autres ». Dès lors, tous les Japonais peuvent connaître leur gloire – les « cent millions de Japonais » seront autant de « joyaux brisés » en leur temps, autant de « boucliers de l’empereur », autant, enfin, de fleurs de cerisier : le symbole parfait de l’âme japonaise, la beauté d’autant plus saisissante qu’elle est très fugace – et se réalise pleinement dans la mort.
Les militaires endoctrinés (en même temps que responsables de cet endoctrinement massif) prônent bel et bien le suicide de la nation entière. Les Japonais ne se rendent pas – seuls les lâches se rendent, c’est indigne des soldats de l’empereur. Les Japonais se battront donc jusqu’au bout – jusqu’à la mort.
La propagande met en avant une culture tragique et souvent morbide du Japon ancien ; qu’elle déforme forcément au prix de nombreuses simplifications d’ordre rhétorique… Il n’y a pas d’atavisme suicidaire au Japon. Mais on pioche bel et bien nombre d’anecdotes édifiantes dans les siècles passés, éventuellement dans Le Dit des Heiké, etc., tandis que le Hagakure et d’autres œuvres du genre fournissent l’arrière-plan philosophique de l’entreprise : les « études nationales » ont le vent en poupe, qui reviennent, avec l’intellectuel d’Edo Motoori Norinaga, inspiration essentielle, sur la culture autochtone millénaire du Japon (un exemple éloquent, ici : le nom des quatre premières escadrilles kamikazes, choisi par Ônishi Takijirô lui-même, figure dans un unique poème waka de Motoori, définissant justement l’âme japonaise par la référence devenue incontournable à la fleur de cerisier). Tout ceci peut souvent se résumer en une idée simple : la belle mort rachète la défaite. La victoire au prix de compromissions est une honte – survivre à la défaite une plus grande honte encore. Il faut mourir !
En fait, mourir devient même désirable – pas seulement souhaitable, mais un véritable objectif : les Japonais ne se battent plus pour vaincre, mais pour mourir ! C’est totalement invraisemblable, au plan de la stratégie militaire – mais c’est semble-t-il un fait constaté, dont parlait notamment Takahashi Tetsuya dans Morts pour l’empereur : la question du Yasukuni...
Et c’est donc la nation entière qui, sur ces bases, doit se montrer prête à accomplir le sacrifice ultime, le plus beau des sacrifices : cet honneur incomparable consistant à mourir dignement pour l’empereur.
Et qu’importe, à cet égard, si un certain nombre de ces officiers si pointilleux quant à l’honneur et à la gloire de mourir dignement, le moment venu, se montreront au-dessous de tout – fuyant en abandonnant leurs hommes un peu partout dans l’Asie et le Pacifique, se précipitant à la rencontre des Russes envahissant tardivement la Mandchourie pour être faits prisonniers sans combattre, ou, dans les premiers jours d’août 1945, abusant de leurs privilèges pour se livrer à un pillage en règles des ressources raréfiées au Japon même… Sans doute ne faut-il pas trop s’y attarder, ces comportements ne sont pas forcément significatifs ; mais ne l’oublions pas pour autant...
AUX SOURCES
Bien sûr, l’idée même des kamikazes n’est pas apparue d’un bloc, surgissant comme par magie du képi d’Ônishi Takijirô. Et la décision d’envoyer tant de jeunes hommes à la mort ne s’est pas davantage faite sur un coup de tête – elle a été mûrement réfléchie, et guère aisée à prendre…
Mais il faut à ce stade mettre en avant la singularité des kamikazes. Il ne s’agit pas, da
Lien : http://nebalestuncon.over-bl..
INCOMPRÉHENSION
Les kamikazes, à l'instar du seppuku (qui leur est éventuellement associé et sans doute bien trop légèrement), font partie de ces emblèmes à forte connotation symbolique qui en sont venus à caractériser le Japon auprès des non-Japonais – presque instinctivement. Ce phénomène étonnant n’a guère tardé à véhiculer des connotations qui lui sont propres ; ainsi, on en fait souvent l’exemple typique du suicide altruiste au sens de Durkheim, qui ne pouvait certes lui-même en avoir conscience en 1897, date de parution de son célèbre ouvrage... De manière plus générale, le mot même de « kamikaze » (que les Japonais n’emploient d’ailleurs pas forcément, ou pas avec le même sens, j’y reviendrai) a intégré le lexique des langues occidentales, y compris voire avant tout le lexique « populaire », disons, et, mine de rien, cela n’arrive pas si souvent. Pour autant, s’il est une chose dont tant le vocable que ses emplois conventionnels témoignent, c’est sans doute d’une incompréhension fondamentale à l’égard de ce phénomène très ponctuel mais qui a durablement marqué les esprits.
Finalement, il ne s’agit pas forcément tant d’une question factuelle (même si c’est bien sûr la base de toute autre interrogation) que d’une question de représentations. Et c’est peut-être là que se situe le problème, car les représentations sont fluctuantes – et même plus que cela, dans le cas présent : de part et d’autre du Pacifique, « kamikaze », même à s’en tenir à la référence la plus précise aux événements de 1944-1945, ne signifie au fond pas du tout la même chose… À cet égard, l’incompréhension est peut-être, d’une certaine manière, renforcée, propice aux jugements de valeur parfaitement arbitraires et détachés des faits comme de leur interprétation raisonnée (même si jamais totalement assurée).
Bien sûr, il y a une part essentielle de fascination dans toute étude de ce phénomène hors-normes – une fascination morbide, une fascination néanmoins ; et je n’y échappe certainement pas, bien au contraire : je plaide coupable. Mais, cette fois, c’est sans doute dans l’ordre des choses – car les kamikazes, dans leur dimension symbolique, ont sans doute été appréhendés, et même conçus, dès le départ, comme un récit médiatique saisissant, qu’on le considère avant tout poignant, inspirant ou terrifiant ; en fait, toutes ces dimensions, et d’autres encore, doivent probablement être associées : les kamikazes n’ont rien d’unilatéral, même s’il serait tentant de s’en tenir là...
D’où, me concernant, la lecture de cet ouvrage, assez bref, très abordable, tout à fait sérieux néanmoins (ne pas se fier à l’accroche un peu putassière en couverture – et le nom de Pierre-François Souyri, régulièrement croisé ici ou là, si je n’en ai lu pour l’heure que son excellente Histoire du Japon médiéval : le monde à l’envers, m’inspirait confiance). Ce fut aussi l’occasion de prolonger avec un exemple très concret, et par ailleurs ponctuel, d’autres lectures éventuellement liées, comme La Mort volontaire au Japon, de Maurice Pinguet, ou Morts pour l’empereur : la question du Yasukuni, de Takahashi Tetsuya – deux ouvrages cités dans la bibliographie, d’ailleurs et sans vraie surprise.
QUESTIONS DE TERMINOLOGIE
En fait, un problème se pose d’emblée, concernant le simple vocabulaire utilisé. En français, et dans beaucoup d’autres langues en dehors du Japon, nous parlons donc de « kamikazes » ; la signification de ce vocable découle des deux mots (et idéogrammes, ou kanji) japonais ainsi associés, kami qui désigne, pour faire simple, les esprits ou les dieux, et kaze, qui signifie le vent.
Donc, « kamikaze » signifie « vent divin » ; et, très concrètement, cela renvoie à une anecdote historique, portant sur les deux tentatives d’invasion du Japon par les Mongols à la fin du XIIIe siècle – deux échecs où, selon la légende, la météo eut sa part, puisque des typhons ont balayé à chaque fois la flotte des envahisseurs : à proprement parler, c’est donc ceci qui est le « vent divin » – comme une confirmation éloquente de ce que le Japon est « le pays des dieux », et que les dieux ne manqueront pas de venir à son secours en cas de tentative d’invasion étrangère (rappelons que le Japon n’a jamais été envahi avant 1945). Il ne s’agit pas cependant de se reposer sur ce mythe : « Aide-toi, le ciel t’aidera », dit-on par ici, et finalement il y a de cette idée au Japon également – car les combats acharnés des samouraïs du XIIIe siècle ont eu leur part essentielle dans la défaite des Mongols : il n’y avait pas « que » le « vent divin »… Le lien avec la situation du Japon en 1944-1945 se fait donc tout naturellement, à ces différents niveaux.
Les Japonais utilisent le mot kamikaze, écrit ainsi : 神風 ; et on retrouve bien sûr le lien avec l’anecdote du « vent divin ». En fait, c’est surtout la presse (à laquelle il faut adjoindre la propagande cinématographique, actualités ou films de « fiction ») qui, à l’époque, avait employé ce terme, et avec cette prononciation, c’est-à-dire la lecture kun, ou proprement japonaise ; or l’armée lisait plus souvent les mêmes kanji avec la lecture on, ou « sino-japonaise », soit shinpû ; le sens global reste peu ou prou le même, mais il s’accompagne en même temps de connotations différentes – de manière générale, la lecture on est souvent perçue comme plus « sophistiquée » (élégante, cultivée, etc.) que la lecture kun, mais il semblerait aussi qu’on ait trouvé en l’espèce cette prononciation plus « martiale ». D’emblée, donc, le terme « kamikaze » existe, mais sans être le terme courant.
D’autant qu’il s’agit d’une sorte de licence poétique… Le terme officiel pour désigner ce que nous nommons « kamikazes » n’a en fait rien à voir, et est autrement prosaïque : on parle de tokubetsu kôgekitai (特別攻撃隊), souvent abrégé en tokkôtai (特攻隊), ce qui signifie « unités d’attaque spéciales ». Encore aujourd’hui, c’est le terme employé par les Japonais – qui ne recourent guère à kamikaze ou shinpû, si ce n’est pas totalement inenvisageable. Et on pèse ici le poids des connotations.
D’autant qu’un dernier aspect doit sans doute être mentionné – et qui est l’emploi contemporain du mot « kamikaze » par les Occidentaux, etc. Dans nos médias, il n’y a rien que de très normal et parfaitement logique à qualifier de « kamikaze » tel terroriste islamiste qui se fait sauter au milieu de la foule, a fortiori tel autre qui use d’un avion comme d’une arme en se précipitant sur le World Trade Center. Pour les Japonais, cependant, pareille assimilation ne coule pas du tout de source, et les laisse souvent perplexe, semble-t-il – et au mieux ? Car cela pourrait même aller au-delà – jusqu’à l’affect, le sentiment le plus intime… Les kamikazes, ou plutôt les tokkôtai, représentent pour eux une réalité précise, concrète – et terrible ; étendre le vocable à d’autres actions, finalement bien différentes au-delà des similitudes apparentes, ne fait pas vraiment sens.
LE CONTEXTE
Le contexte de l’apparition des kamikazes est donc crucial, tout particulièrement aux yeux des Japonais. Le sous-titre de l’ouvrage en donne les dates précises : les premières attaques kamikazes ont lieu le 25 octobre 1944, lors de la bataille des Philippines (mais il faudra certes revenir un peu en arrière), et le phénomène se poursuit jusqu’au 15 août 1945, date de la reddition du Japon (ou en tout cas, du discours de l’empereur l’annonçant). Moins d’un an, donc – mais bien assez pour que le phénomène se développe et marque à jamais les mentalités, au Japon et au-delà.
Une guerre perdue d’avance
Je ne vais pas rentrer dans le détail des circonstances de la guerre du Pacifique (que j’ai pu évoquer dans d’autres chroniques, comme Morts pour l’empereur : la question du Yasukuni, de Takahashi Tetsuya, Histoire politique du Japon de 1853 à nos jours, d’Eddy Dufourmont, ou Le Japon contemporain, de Michel Vié ; peut-être faut-il aussi mentionner, dans une optique un peu différente, car directement liée à la guerre et aux intérêts américains, Histoire du Japon et des Japonais, d’Edwin O. Reischauer, et Le Chrysanthème et le sabre, de Ruth Benedict).
Retenons cependant cet aspect essentiel : c’était une guerre perdue d’avance. Le plus fou dans tout cela est que l’état-major japonais en était parfaitement conscient – l’amiral Yamamoto, probablement le plus grand stratège nippon d’alors, l’avait signifié à maintes reprises, et d'autres comme lui. Il y avait plusieurs raisons à cela, mais la principale était probablement d’ordre économique : le Japon manquait de ressources, et, à terme, sa production industrielle ou même sa simple mobilité (en termes de carburant, etc.) ne pouvaient qu’en être affectées. Face au Japon, les États-Unis – et leur puissance économique tout autre.
Le seul espoir, très mince, de l’emporter face aux Américains impliquait d’avancer vite, très vite : au moment T, le Japon dispose d’une meilleure flotte (avec des vaisseaux monstrueux dont le célèbre Yamato, brillant symbole de la supériorité de la marine impériale et outil de propagande de choix ; sa perte n'en sera que plus traumatisante), supérieure en nombre (d’autant que la flotte américaine se partage bien sûr entre le Pacifique et l’Atlantique) et d’une technologie remarquable ; de même, il peut compter sur d’excellents avions (notamment les fameux Zéros), bien meilleurs que ceux des Américains alors, ou de tout autre nation à vrai dire, et dont les pilotes sont probablement les mieux formés de par le monde entier. Puisque les militaires ayant accaparé le pouvoir au cours des années 1930, contre toute raison, et, pour certains d’entre eux, absurdement confiants en la supériorité intrinsèque de « l’esprit » japonais, à même de surmonter toute difficulté, comptent bien s’engager dans cette aventure au mieux hasardeuse, pas le choix : il faut profiter immédiatement de ces atouts – d’où l’assaut sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, destiné à porter d’emblée un coup fatal aux États-Unis (qui s’en remettront toutefois très vite), et une conquête accélérée de ce que les Japonais appelleront la « Sphère de Coprospérité de la Grande Asie Orientale ». Très vite, la quasi-totalité des possessions coloniales européennes dans la région tombent entre les mains des Japonais (qui en avaient déjà annexé quelques-unes auparavant, dont l’Indochine française en 1940), et les Alliés sont contraints de reculer partout. L’avancée fulgurante des troupes japonaises donne alors l’impression d’être irrépressible…
Mais, à partir de la bataille de Midway (début juin 1942 ; à peine six mois après Pearl Harbor, donc !), l’armée japonaise cesse d’avancer… et, bientôt, elle recule. Les prévisions de Yamamoto (et de bien d’autres) commencent à se vérifier, et nombreux sont ceux qui conçoivent d’ores et déjà que la guerre est perdue – elle durera pourtant encore trois ans !
Fait crucial : l’économie américaine permet de produire en masse des bateaux ainsi que des avions qui, non contents de rattraper le retard technologique initial sur le Japon, le dépassent bien vite – l’enfoncent, même ; et, en termes quantitatifs, c’est encore plus saisissant. L’économie japonaise ne peut tout simplement pas suivre : elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour ce faire. Les navires et avions que les Japonais produisent de leur côté sont toujours moins performants, moins fiables (au point où de nombreux avions trop hâtivement conçus présentent le risque de se désintégrer en vol !) et de toute façon pas assez nombreux… Et il en va à vrai dire de même de leurs soldats – toujours plus jeunes, toujours moins bien formés ; et tout particulièrement les pilotes, en fait, en contraste flagrant avec la situation au début de la décennie.
Effrayer pour négocier
Bien sûr, les dirigeants de l’armée nippone ne sauraient tenir ce discours à leur propre peuple, civils ou militaires. Jusqu’aux derniers jours du conflit, alors même que la réalité de leur situation se fait de plus en plus palpable, ils continuent de prétendre que la victoire est inéluctable, voire proche – et sont relayés par une propagande médiatique tout aussi confiante. Pourtant, des revers sont notables, qui ne peuvent pas totalement échapper aux Japonais… Mais ils sont systématiquement présentés comme ayant été « prévus » : en fait, ces prétendus revers font pleinement partie du plan qui assurera la victoire du Japon ! Ne serait-ce qu’envisager la possibilité de la défaite est hors de question : la supériorité de « l’esprit » japonais ne le tolère pas.
Mais, sur le terrain, la réalité est tout autre. Les officiers savent, sans doute, et très vite, que la défaite du Japon est inévitable. Dès lors, la tâche de l’armée évolue : il ne s’agit plus de vaincre, mais de résister suffisamment pour imposer aux Américains de négocier la « meilleure » paix possible. La stratégie globale connaît dès lors des errances significatives (et à terme dramatiques, même sans évoquer pour l’heure la question des kamikazes : l’armée japonaise abandonne littéralement des dizaines, voire des centaines de milliers de ses soldats, à charge pour eux de mener avec leurs propres moyens une longue guerre de guérilla...).
Mais même l’opération Shô (« Victoire »), dans les Philippines, en octobre 1944, tient pour une bonne part de la tentative de bluff : il s’agit de leurrer les Américains quant aux troupes et aux moyens dont le Japon dispose encore… ceci, afin de leur faire peur – et donc, car c’est bien le propos, de leur faire entendre que la victoire, même inéluctable, leur coûtera très, très cher. Mieux vaut donc pour eux négocier au plus tôt, et en des termes relativement favorables au Japon – lequel n’est plus en mesure d’espérer davantage.
C’est justement alors qu’ont lieu les premières frappes kamikazes, à partir donc du 25 octobre 1944. Et c’est tout sauf une arme secrète : son pouvoir de dissuasion tient pour une part essentielle à la parfaite connaissance de l’ennemi quant à ce dont il s’agit ! Efficacité matérielle de la stratégie mise à part (j’y reviendrai), l’effet est d’une certaine manière atteint : les Américains développent une véritable psychose des attaques suicides… Mais peut-être l’effet souhaité par les Japonais va-t-il en fait un peu trop loin ? Le « fanatisme » que les Américains croient déceler chez les kamikazes pèsera sans doute d’un certain poids, quitte à ce que ce soit en guise de prétexte, dans la décision d'employer la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki – car, face au « mythe » savamment entretenu des « cent millions de Japonais » prêts à combattre pour leur patrie et leur empereur jusqu’à la mort, à l’instar de ces glorieux pilotes des missions suicides, se développe alors chez les Américains un « mythe » parallèle, celui des « 100 000 vies américaines » que le champignon nucléaire doit permettre d’épargner...
Le suicide d’une nation
Les kamikazes, par une cruelle ironie de l’histoire, sont finalement un symptôme plus qu’éloquent d’une nation aux abois, que les militaires et autres dévots ultranationalistes poussent littéralement au suicide.
La stratégie kamikaze, telle qu’elle a été conçue et mise en place par l’amiral Ônishi Takijirô, aussi horrible qu’elle soit, ne pouvait être dans son esprit qu’une solution ponctuelle, temporaire – ce qui faisait partie du coup de bluff plus global de l’opération Shô. Mais, en quelques semaines, au plus quelques mois (mais rappelons que moins d’un an s’écoulera entre le premier assaut kamikaze et la reddition du Japon), cette stratégie ponctuelle tend toujours un peu plus à devenir structurelle – à définir en fait une stratégie globale, systématique, de l’armée et de la marine impériales. Les kamikazes devaient être une exception, des troupes « spéciales » à proprement parler, mais l’éthique militaire japonaise en étend sans cesse la portée et le champ d’application.
L’exaltation des kamikazes par la propagande joue tout d’abord du mode héroïque – les kamikazes sont littéralement déjà des kami, et, selon la formule devenue rituelle, ils se retrouveront tous au Yasukuni. Mais, progressivement, cette représentation tend à s’effacer au profit d’une autre, qui en fait, d’une certaine manière, « des Japonais comme les autres ». Dès lors, tous les Japonais peuvent connaître leur gloire – les « cent millions de Japonais » seront autant de « joyaux brisés » en leur temps, autant de « boucliers de l’empereur », autant, enfin, de fleurs de cerisier : le symbole parfait de l’âme japonaise, la beauté d’autant plus saisissante qu’elle est très fugace – et se réalise pleinement dans la mort.
Les militaires endoctrinés (en même temps que responsables de cet endoctrinement massif) prônent bel et bien le suicide de la nation entière. Les Japonais ne se rendent pas – seuls les lâches se rendent, c’est indigne des soldats de l’empereur. Les Japonais se battront donc jusqu’au bout – jusqu’à la mort.
La propagande met en avant une culture tragique et souvent morbide du Japon ancien ; qu’elle déforme forcément au prix de nombreuses simplifications d’ordre rhétorique… Il n’y a pas d’atavisme suicidaire au Japon. Mais on pioche bel et bien nombre d’anecdotes édifiantes dans les siècles passés, éventuellement dans Le Dit des Heiké, etc., tandis que le Hagakure et d’autres œuvres du genre fournissent l’arrière-plan philosophique de l’entreprise : les « études nationales » ont le vent en poupe, qui reviennent, avec l’intellectuel d’Edo Motoori Norinaga, inspiration essentielle, sur la culture autochtone millénaire du Japon (un exemple éloquent, ici : le nom des quatre premières escadrilles kamikazes, choisi par Ônishi Takijirô lui-même, figure dans un unique poème waka de Motoori, définissant justement l’âme japonaise par la référence devenue incontournable à la fleur de cerisier). Tout ceci peut souvent se résumer en une idée simple : la belle mort rachète la défaite. La victoire au prix de compromissions est une honte – survivre à la défaite une plus grande honte encore. Il faut mourir !
En fait, mourir devient même désirable – pas seulement souhaitable, mais un véritable objectif : les Japonais ne se battent plus pour vaincre, mais pour mourir ! C’est totalement invraisemblable, au plan de la stratégie militaire – mais c’est semble-t-il un fait constaté, dont parlait notamment Takahashi Tetsuya dans Morts pour l’empereur : la question du Yasukuni...
Et c’est donc la nation entière qui, sur ces bases, doit se montrer prête à accomplir le sacrifice ultime, le plus beau des sacrifices : cet honneur incomparable consistant à mourir dignement pour l’empereur.
Et qu’importe, à cet égard, si un certain nombre de ces officiers si pointilleux quant à l’honneur et à la gloire de mourir dignement, le moment venu, se montreront au-dessous de tout – fuyant en abandonnant leurs hommes un peu partout dans l’Asie et le Pacifique, se précipitant à la rencontre des Russes envahissant tardivement la Mandchourie pour être faits prisonniers sans combattre, ou, dans les premiers jours d’août 1945, abusant de leurs privilèges pour se livrer à un pillage en règles des ressources raréfiées au Japon même… Sans doute ne faut-il pas trop s’y attarder, ces comportements ne sont pas forcément significatifs ; mais ne l’oublions pas pour autant...
AUX SOURCES
Bien sûr, l’idée même des kamikazes n’est pas apparue d’un bloc, surgissant comme par magie du képi d’Ônishi Takijirô. Et la décision d’envoyer tant de jeunes hommes à la mort ne s’est pas davantage faite sur un coup de tête – elle a été mûrement réfléchie, et guère aisée à prendre…
Mais il faut à ce stade mettre en avant la singularité des kamikazes. Il ne s’agit pas, da
Lien : http://nebalestuncon.over-bl..
Les jeunes Japonais embrigadés qui jetaient leur avion contre des navires américains n'étaient pas tous dupes de la propagande impériale. Deux historiens apportent un éclairage nouveau sur les "bombes humaines".
Lien : http://rss.feedsportal.com/c..
Lien : http://rss.feedsportal.com/c..
Ce livre qui est l'oeuvre de Pierre-François Souyri, historien reconnu du Japon et Philippe Pons orrespondant du Monde à Tokyo nous offre une plongée assez fascinante au royaume de Nagisha 'Oshima entre société misogyne, sexualité débridée et moeurs désinhibées.
Ces deux éminents spécialistes du Japon nous propose une histoire du plaisir et du désir au Japon sur quatre siècles, du raffinement et de l'inventivité effrénée de la période Edo (17e-19e s.), à travers les érotiques estampes shunga, les geishas et leurs quartiers de plaisir, les samouraïs et leur passion pour les éphèbes, aux moeurs corsetées et à la sexualité bridée du début du 20e siècle, sous l'influence d'un Occident moralisateur, jusqu'aux produits standardisés et mondialisés laissant exploser les fantasmes les plus outranciers à partir des années 1960.La sexualité étant affaire de pratiques, et de représentations, l'art de jouer du plaisir s'accompagne d'une iconographie dense avec ces images du "monde flottant" que l'on connait tous
Plongez dans la première étude d'envergure sur les pratiques et les contradictions en matière de sexe et de rapports hommes-femmes au pays de Nagisa Oshima, par deux grands spécialistes du Japon.
Ces deux éminents spécialistes du Japon nous propose une histoire du plaisir et du désir au Japon sur quatre siècles, du raffinement et de l'inventivité effrénée de la période Edo (17e-19e s.), à travers les érotiques estampes shunga, les geishas et leurs quartiers de plaisir, les samouraïs et leur passion pour les éphèbes, aux moeurs corsetées et à la sexualité bridée du début du 20e siècle, sous l'influence d'un Occident moralisateur, jusqu'aux produits standardisés et mondialisés laissant exploser les fantasmes les plus outranciers à partir des années 1960.La sexualité étant affaire de pratiques, et de représentations, l'art de jouer du plaisir s'accompagne d'une iconographie dense avec ces images du "monde flottant" que l'on connait tous
Plongez dans la première étude d'envergure sur les pratiques et les contradictions en matière de sexe et de rapports hommes-femmes au pays de Nagisa Oshima, par deux grands spécialistes du Japon.
Aborder le sexe au pays du Soleil Levant, voilà le challenge auquel se sont livrés Philippe Pons, correspondant du Monde à Tokyo, et Pierre-François Souyri, professeur honoraire à l'université de Genève. A deux, ils ridiculisent Wikipédia et peuvent s’enorgueillir d’une somme de connaissances dont ils n’ont pas à rougir. Ils abordent donc à quatre mains l’histoire de la sexualité et de l’érotisme au japon avec une optique actuelle, un sens aigu de l’authenticité et celui de sa signification dans la culture nippone. Bien entendu, ils décryptent ce que nous autres Européens avons souvent tendance à assimiler à de la paillardise ou à de la perversité. Selon les conditions, les codes n’ont pas toujours les mêmes connotations.
Pour se plonger dans ''L’Esprit de plaisir'', de Philippe Pons et Pierre-François Souyri, mieux vaut ne pas avoir en tête la remarquable ''Vie sexuelle dans la Chine ancienne'', de Robert Van Gulik, dont ce livre est un peu le pendant pour le Japon. L'étude définitive de Van Gulik, auquel on peut seulement reprocher son déficit de background anthropologique (confusion entre matrilinéarité et matriarcat), mettait la barre très haut.
De fait, L’Esprit de plaisir ne manque pas de faiblesses. Il fait d’abord la part belle, parfois quasi unique, à la littérature romanesque. Mais qui dit que celle-ci témoigne de son époque ? Le romancier recopie rarement les mœurs, sexuelles ou autres, de son temps, il fait avant tout œuvre imaginaire et son succès tient beaucoup à ce que son œuvre comporte d’inhabituel et de surprenant. Il y a donc un malentendu ou une ambiguïté sur la portée du livre : si on y cherche une revue des arts et des lettres entre le début d’Edo vers 1600 et les années 1970, il est très riche. Si on en attend un travail anthropologique sur la sexualité et l’érotisme au Japon, on est forcément déçu par l’immense point d’interrogation qu’il peut y avoir entre la réalité de la société et ses « vues d’artistes ».
Une lacune du livre est le peu d’importance attaché aux bases religieuses des morales et des comportements sexuels. Shinto, confucianisme, bouddhisme, a fortiori taoïsme, ne sont qu’à peine évoqués, et ils le sont presque toujours en bloc, quand chacune de ces religions se décline, selon les époques et les courants, en nombre de variantes et d’implémentations parfois contradictoires. Il n’est pas faux, mais bien abrupt d’asséner que « l’érotique d’Edo [est fondée] sur une conception aux antipodes de la doctrine bouddhique » (p. 430), même si les auteurs ajoutent qu’Edo tire un parti paradoxal de ''l’impermanence'' bouddhique : la vie sexuelle souvent torride des moines et des nonnes bouddhiques décrite dans le livre, ou l’existence d’un tantrisme bouddhique, comme celui de la Chine des Yuan, montre qu’il est périlleux de réduire le bouddhisme à la doctrine canonique du Bouddha.
Une autre limite tient au sentiment d’approximation que laisse le livre. Il a beau comporter d’excellents compléments sur les sources et la bibliographie, l’interprétation personnelle des auteurs semble à maints endroits prendre le pas sur la rigueur scientifique. Le livre est chargé de répétitions tautologiques : mêmes informations et mêmes formules maintes fois reprises, sans qu’on voie quelle pourrait en être la justification. Lorsque cette formule est le pléonasme de la « moralisation des mœurs », on se dit que les auteurs, les correcteurs et l’éditeur n’ont pas dû relire le texte d’assez près. Ce malaise va croissant, et plus nous nous rapprochons du temps présent, plus nous éprouvons l’impression d’un manque de recul.
Plus grave est l’association faite, même si c’est implicitement, entre les époques « fermées » (la société à maison venue des samouraïs, l’ordre moral de Meiji singé de l’Occident et habillé de confucianisme, etc.) et le patriarcat, comme si les époques « ouvertes » en étaient indemnes. Or, si les époques « libérales » ou « égalitaires », comme Heian ou Edo, accordent clairement une place plus importante aux femmes (et aucune autre civilisation que la Chine et le Japon n’ont sans doute attaché cette importance au plaisir féminin), elles n’en représentent pas moins une autre forme de patriarcat, dans laquelle les femmes, qu’elles soient prostituées, courtisanes de haut rang, geisha, concubines ou épouses restent malgré tout les pourvoyeuses du plaisir, de la progéniture et du pouvoir masculins.
Enfin, l’opposition entre l’hédonisme sexuel, comme sous Edo, et le sexe corseté aux fins de reproduction, comme sous Meiji, laisse échapper largement les autres finalités de la sexualité humaine (si ce n’est la domination, bien documentée) : conviviales, sociales, religieuses… Il serait étonnant qu’elles aient été plus absentes au Japon qu’ailleurs. On ne fait pas l’amour que pour procréer ou pour le plaisir — ou pour la rémunération. Ce n’est le moindre des mérites de Van Gulik, un des rares auteurs à en avoir montré toute l’importance, il est vrai exacerbée dans le taoïsme.
En revanche, on ne reprochera évidemment pas aux auteurs le choix des limites temporelles de l’ouvrage, même si on reste sur sa faim sur ce que pouvait être la sexualité de l’époque Heian (d’ailleurs souvent évoquée comme racine des évolutions ultérieures) ou du Moyen Âge ; c’est leur choix et il faut bien en fixer. On ne leur reprochera pas non plus de sembler tailler à la hache entre les époques, celles d’un Japon sexuellement ultralibéral sous Edo (1603-1867), durant l’entre-deux-guerres (1920-1935) et sous l’occupation américaine (1945-1952), et ultrarépressif sous Meiji (1868-1912), sous le totalitarisme militaire (1935-1945) et sous le nouvel ordre moral conservateur (1952-…) : les chevauchements de dates dans les différents chapitres montrent bien que, comme partout, chaque époque contient les germes de la suivante et continue à vivre sur l’inertie des mentalités de la précédente.
Ces critiques peuvent être jugées sévères pour l’énorme travail de Pons et Souyri, et sont au bout du compte mineures eu égard à ses qualités. On est impressionné par l’étendue de leur érudition japonaise, jusqu’à nous faire douter de l’étendue de notre culture française…
Et le livre atteint sa cible en dégageant bien les lignes de force de cette histoire de la sexualité et de l’érotisme. Ainsi de l’absence de tabou sexuel et de notion de péché ou de culpabilité devant la nudité et le sexe, jusqu’à ce que des « réformateurs » se mettent en tête de s’occidentaliser en s’autocolonisant… pour échapper à la colonisation ; en voulant à juste titre se sauver de la mainmise de l’étranger, ils n’ont rien trouvé de mieux que de détruire leur civilisation dans ses formes les plus précieuses. Ainsi de la pansexualité récurrente — même si le mot n’est pas prononcé — dans la tradition japonaise, comme elle l’était dans l’Antiquité grecque ; elle est traitée avec beaucoup de nuances et de subtilité suivant les milieux et les époques. Ainsi de l’importance de l’association entre la sexualité et la violence ou la mort dans la culture japonaise. Est-ce parce que l’idée du péché de chair lui était étrangère qu’elle a dû repousser le goût de l’interdit vers des formes de sexualité morbides ?
Lien : http://www.carnetsdexil.com/
De fait, L’Esprit de plaisir ne manque pas de faiblesses. Il fait d’abord la part belle, parfois quasi unique, à la littérature romanesque. Mais qui dit que celle-ci témoigne de son époque ? Le romancier recopie rarement les mœurs, sexuelles ou autres, de son temps, il fait avant tout œuvre imaginaire et son succès tient beaucoup à ce que son œuvre comporte d’inhabituel et de surprenant. Il y a donc un malentendu ou une ambiguïté sur la portée du livre : si on y cherche une revue des arts et des lettres entre le début d’Edo vers 1600 et les années 1970, il est très riche. Si on en attend un travail anthropologique sur la sexualité et l’érotisme au Japon, on est forcément déçu par l’immense point d’interrogation qu’il peut y avoir entre la réalité de la société et ses « vues d’artistes ».
Une lacune du livre est le peu d’importance attaché aux bases religieuses des morales et des comportements sexuels. Shinto, confucianisme, bouddhisme, a fortiori taoïsme, ne sont qu’à peine évoqués, et ils le sont presque toujours en bloc, quand chacune de ces religions se décline, selon les époques et les courants, en nombre de variantes et d’implémentations parfois contradictoires. Il n’est pas faux, mais bien abrupt d’asséner que « l’érotique d’Edo [est fondée] sur une conception aux antipodes de la doctrine bouddhique » (p. 430), même si les auteurs ajoutent qu’Edo tire un parti paradoxal de ''l’impermanence'' bouddhique : la vie sexuelle souvent torride des moines et des nonnes bouddhiques décrite dans le livre, ou l’existence d’un tantrisme bouddhique, comme celui de la Chine des Yuan, montre qu’il est périlleux de réduire le bouddhisme à la doctrine canonique du Bouddha.
Une autre limite tient au sentiment d’approximation que laisse le livre. Il a beau comporter d’excellents compléments sur les sources et la bibliographie, l’interprétation personnelle des auteurs semble à maints endroits prendre le pas sur la rigueur scientifique. Le livre est chargé de répétitions tautologiques : mêmes informations et mêmes formules maintes fois reprises, sans qu’on voie quelle pourrait en être la justification. Lorsque cette formule est le pléonasme de la « moralisation des mœurs », on se dit que les auteurs, les correcteurs et l’éditeur n’ont pas dû relire le texte d’assez près. Ce malaise va croissant, et plus nous nous rapprochons du temps présent, plus nous éprouvons l’impression d’un manque de recul.
Plus grave est l’association faite, même si c’est implicitement, entre les époques « fermées » (la société à maison venue des samouraïs, l’ordre moral de Meiji singé de l’Occident et habillé de confucianisme, etc.) et le patriarcat, comme si les époques « ouvertes » en étaient indemnes. Or, si les époques « libérales » ou « égalitaires », comme Heian ou Edo, accordent clairement une place plus importante aux femmes (et aucune autre civilisation que la Chine et le Japon n’ont sans doute attaché cette importance au plaisir féminin), elles n’en représentent pas moins une autre forme de patriarcat, dans laquelle les femmes, qu’elles soient prostituées, courtisanes de haut rang, geisha, concubines ou épouses restent malgré tout les pourvoyeuses du plaisir, de la progéniture et du pouvoir masculins.
Enfin, l’opposition entre l’hédonisme sexuel, comme sous Edo, et le sexe corseté aux fins de reproduction, comme sous Meiji, laisse échapper largement les autres finalités de la sexualité humaine (si ce n’est la domination, bien documentée) : conviviales, sociales, religieuses… Il serait étonnant qu’elles aient été plus absentes au Japon qu’ailleurs. On ne fait pas l’amour que pour procréer ou pour le plaisir — ou pour la rémunération. Ce n’est le moindre des mérites de Van Gulik, un des rares auteurs à en avoir montré toute l’importance, il est vrai exacerbée dans le taoïsme.
En revanche, on ne reprochera évidemment pas aux auteurs le choix des limites temporelles de l’ouvrage, même si on reste sur sa faim sur ce que pouvait être la sexualité de l’époque Heian (d’ailleurs souvent évoquée comme racine des évolutions ultérieures) ou du Moyen Âge ; c’est leur choix et il faut bien en fixer. On ne leur reprochera pas non plus de sembler tailler à la hache entre les époques, celles d’un Japon sexuellement ultralibéral sous Edo (1603-1867), durant l’entre-deux-guerres (1920-1935) et sous l’occupation américaine (1945-1952), et ultrarépressif sous Meiji (1868-1912), sous le totalitarisme militaire (1935-1945) et sous le nouvel ordre moral conservateur (1952-…) : les chevauchements de dates dans les différents chapitres montrent bien que, comme partout, chaque époque contient les germes de la suivante et continue à vivre sur l’inertie des mentalités de la précédente.
Ces critiques peuvent être jugées sévères pour l’énorme travail de Pons et Souyri, et sont au bout du compte mineures eu égard à ses qualités. On est impressionné par l’étendue de leur érudition japonaise, jusqu’à nous faire douter de l’étendue de notre culture française…
Et le livre atteint sa cible en dégageant bien les lignes de force de cette histoire de la sexualité et de l’érotisme. Ainsi de l’absence de tabou sexuel et de notion de péché ou de culpabilité devant la nudité et le sexe, jusqu’à ce que des « réformateurs » se mettent en tête de s’occidentaliser en s’autocolonisant… pour échapper à la colonisation ; en voulant à juste titre se sauver de la mainmise de l’étranger, ils n’ont rien trouvé de mieux que de détruire leur civilisation dans ses formes les plus précieuses. Ainsi de la pansexualité récurrente — même si le mot n’est pas prononcé — dans la tradition japonaise, comme elle l’était dans l’Antiquité grecque ; elle est traitée avec beaucoup de nuances et de subtilité suivant les milieux et les époques. Ainsi de l’importance de l’association entre la sexualité et la violence ou la mort dans la culture japonaise. Est-ce parce que l’idée du péché de chair lui était étrangère qu’elle a dû repousser le goût de l’interdit vers des formes de sexualité morbides ?
Lien : http://www.carnetsdexil.com/
Un livre sur le Japon oui, mais un livre sur l'érotisme au Japon, et même "l'érotique" comme dirait l'auteur, c'est plutôt original. Ce livre, bien au delà de nous apprendre énormément de choses sur la sexualité et l'érotisme au Japon depuis les 4 derniers siècles, nous donne à voir une facette de ce pays peu connue et pourtant tellement intéressante par sa diversité, ses moments troubles, difficiles mais aussi sa légèreté et sa "mentalité" si différente de la mentalité occidentale. J'ai appris énormément. C'était parfois un peu pompeux, il y avait parfois des redondances ou des longueurs et il aurait été appréciable d'avoir plus d'images pour étayer certains propos. Mais quelle richesse. Quel travail de recherche époustouflant. Je ne suis pas de ceux qui aime lire pour apprendre mais plutôt pour me divertir et j'évite les livres types "mémoire" ou thèse. Pourtant celui ci m'a happé. Principalement dans ses débuts sur l'ère Edo, mais jusqu'au bout pour sa qualité et sa précision.
Aussi loin que l’on puisse investiguer en remontant les layons du temps, les hommes ont toujours entretenu des liens intimes avec la mer. Cinq mille ans d’histoire connue qui prouvent à quel point les uns ne peuvent pas se passer de l’autre. Lien étroit qui a permis de développer les voyages, le commerce et de bâtir des civilisations insignes. Aussi, il fallait un livre qui revienne sur la manière dont l’humanité s’est progressivement familiarisée avec le monde marin et ses nombreuses ressources. Un récit passionnant qui retrace une histoire d’amour, de défiance et parfois de terreur. Bien des légendes ont surgi des flots avec des poignées de récits devenus mythiques dans le bassin méditerranéen. Faut-il raviver le souvenir des périples d’Ulysse ou d’Enée ?
Très intéressée depuis plus de 50 ans par tout ce qui touche au Japon, j'ai rarement trouvé un livre aussi passionnant sous un si faible volume. C'est du concentré !
Présentés en ordre chronologique, les sujets balayent les grands thèmes de l'histoire du Japon, depuis l'antiquité – une civilisation qui a traversé la période néolithique sans passer par l'agriculture – la filiation avec le grand voisin chinois, ses apports et les conflits, le statut des samouraï, le rôle des Yakuzas, le sens du suicide par Seppuku, l'ouverture vers l'occident, la tentation coloniale, le massacre de Nankin et le militarisme, la victoire de Tsushima, les motifs de l'attaque de Pearl Harbor, l'anéantissement nucléaire, le miracle économique ...
Bref, une lecture enrichissante qui nous ouvre des perspectives originales sur une civilisation fascinante et très mal connue. C'est assez rare pour être souligné.
Lien : http://www.bigmammy.fr/archi..
Présentés en ordre chronologique, les sujets balayent les grands thèmes de l'histoire du Japon, depuis l'antiquité – une civilisation qui a traversé la période néolithique sans passer par l'agriculture – la filiation avec le grand voisin chinois, ses apports et les conflits, le statut des samouraï, le rôle des Yakuzas, le sens du suicide par Seppuku, l'ouverture vers l'occident, la tentation coloniale, le massacre de Nankin et le militarisme, la victoire de Tsushima, les motifs de l'attaque de Pearl Harbor, l'anéantissement nucléaire, le miracle économique ...
Bref, une lecture enrichissante qui nous ouvre des perspectives originales sur une civilisation fascinante et très mal connue. C'est assez rare pour être souligné.
Lien : http://www.bigmammy.fr/archi..
Ce livre regoupe en fait divers articles parus dans la revue L'Histoire au fil des ans. On y retrouve de grands noms spécialistes de l'Histoire japonaise tels que François et Mieko Macé, Jean-Marie Bouissou, Philippe Pons et j'en passe.
La structure de l'ouvrage suit un ordre chronologique à l'intérieur de chacune des 4 parties. Il ne s'agit pas ici d'Histoire globale de l'archipel mais plutôt une série de gros plans sur des points précis, tels que les tentatives d'invasions mongoles du XIIIème siècle, le rôle de la Chine dans l'invention de l'écriture japonaise, l'attaque de Nankin de 1937 ou les kamikazes.
L'ouvrage est très instructif mais nécessite d'avoir déjà une petite base en Histoire japonaise afin de pleinement bénéficier de ses avantages. Comme il s'agit d'articles, les sujets ne sont pas creusés de façon exhaustive et suscitent l'envie de pousser plus loin ses recherches.
La structure de l'ouvrage suit un ordre chronologique à l'intérieur de chacune des 4 parties. Il ne s'agit pas ici d'Histoire globale de l'archipel mais plutôt une série de gros plans sur des points précis, tels que les tentatives d'invasions mongoles du XIIIème siècle, le rôle de la Chine dans l'invention de l'écriture japonaise, l'attaque de Nankin de 1937 ou les kamikazes.
L'ouvrage est très instructif mais nécessite d'avoir déjà une petite base en Histoire japonaise afin de pleinement bénéficier de ses avantages. Comme il s'agit d'articles, les sujets ne sont pas creusés de façon exhaustive et suscitent l'envie de pousser plus loin ses recherches.
Ouvrage collectif, ce recueil compile des articles publiés initialement dans la revue mensuelle L'Histoire. Ils émanent tous de grands spécialistes de l'Histoire japonaise tels que le couple François et Mieko Macé, Pierre-François Souyri, Francine Hérail, Philippe Pons, etc.
La compilation ne suit pas un ordre chronologique mais thématique même si l'ensemble court, grosso modo de l'époque d'Heian - considérée comme le Moyen-Âge nippon - au désastre de 2011, entre tsunami et péril nucléaire à Fukushima.
Compte tenu de la caractéristique de ce recueil, il ne peut servir d'Histoire globale de l'archipel. En revanche, ses articles peuvent permettre une initiation au passé japonais ou encore apporter des éléments plus spécifiques sur un thème ou un événement donné.
Un ouvrage utile à toute personne intéressée par ce pays. Il se lit facilement et de façon plaisante, est très instructif et ouvre des perspectives pour de plus amples recherches via une courte notice biographique et bibliographique de chaque auteur participant. Ne manque que l'iconographie qui devait illustrer les articles de L'Histoire et qui n'a pas été reprise par les éditions Pluriel.
La compilation ne suit pas un ordre chronologique mais thématique même si l'ensemble court, grosso modo de l'époque d'Heian - considérée comme le Moyen-Âge nippon - au désastre de 2011, entre tsunami et péril nucléaire à Fukushima.
Compte tenu de la caractéristique de ce recueil, il ne peut servir d'Histoire globale de l'archipel. En revanche, ses articles peuvent permettre une initiation au passé japonais ou encore apporter des éléments plus spécifiques sur un thème ou un événement donné.
Un ouvrage utile à toute personne intéressée par ce pays. Il se lit facilement et de façon plaisante, est très instructif et ouvre des perspectives pour de plus amples recherches via une courte notice biographique et bibliographique de chaque auteur participant. Ne manque que l'iconographie qui devait illustrer les articles de L'Histoire et qui n'a pas été reprise par les éditions Pluriel.
Complémentaire du Guide Voir Hachette: Japon, Le Japon des Japonais (chez Liana Lévi) n'est pas un guide touristique à proprement parler, mais un compagnon de route qui donne une vision intérieure du Japon et des Japonais.
Ici, on ne parle pas pays mais "dépays" car on demande au lecteur de se vider la tête de ses préjugés et clichés pour comprendre les comportements, la résistance à la modernité pour préserver la mémoire à opposer à une modernisation constante. Ici on relate les métissages et les diversités, la "violence contenue", les paysages forgés de main de maître, la façon de vivre des "bourreaux de travail" et des femmes entre fantasme et évolution, la "religiosité flottante", la "stagnation du monde politique", "l'esprit de plaisir" et de fêtes. Ici, on comprend "l'architecture de l'esprit" en symbiose avec la nature, cette sensibilité exacerbée qui imprègne l'art d'élégance et de raffinement. Petit plus:les photos sublimes de Paola Ghirotti.
Le Japon des Japonais, même hors voyage est une approche pour parfaire ses connaissances d'un pays aux sentiments cachés qui ressent sans verser de larmes et reste digne malgré tout.
Ici, on ne parle pas pays mais "dépays" car on demande au lecteur de se vider la tête de ses préjugés et clichés pour comprendre les comportements, la résistance à la modernité pour préserver la mémoire à opposer à une modernisation constante. Ici on relate les métissages et les diversités, la "violence contenue", les paysages forgés de main de maître, la façon de vivre des "bourreaux de travail" et des femmes entre fantasme et évolution, la "religiosité flottante", la "stagnation du monde politique", "l'esprit de plaisir" et de fêtes. Ici, on comprend "l'architecture de l'esprit" en symbiose avec la nature, cette sensibilité exacerbée qui imprègne l'art d'élégance et de raffinement. Petit plus:les photos sublimes de Paola Ghirotti.
Le Japon des Japonais, même hors voyage est une approche pour parfaire ses connaissances d'un pays aux sentiments cachés qui ressent sans verser de larmes et reste digne malgré tout.
La collection "Mondes anciens" de Belin propose un volume sur le Japon des origines, de -36000 à l'An Mil. Deux auteurs ont veillé à cette publication, Laurent Nespoulous et Pierre-François Souyri, et leur livre relate l'histoire de l'archipel japonais des premières traces d'occupation humaine jusqu'à la fin de "l'Antiquité" locale, qui correspond au milieu de notre Moyen-Age.
Le volume bouscule un peu nos habitudes, car son découpage chronologique ne correspond en rien à ce que nous connaissons, et pour cause. Tardivement peuplé, l'archipel japonais a une histoire décalée par rapport à celle du continent eurasiatique. Les auteurs fixent à -36000 le premier peuplement, mais la fixation des périodes est rendue difficile par l'acidité des sols volcaniques, qui dissolvent vite les restes humains. D'autre part, l'archéologie permet d'observer que des phénomènes originaux se sont produits au Japon, qui distinguent cet espace des autres : la néolithisation, l'agriculture, les premiers états et chefferies doivent être repensés à la lumière des fouilles et des trouvailles. Les progrès techniques n'ont rien de linéaire, et certaines découvertes sont abandonnées si elles ne conviennent pas à leurs inventeurs. En somme, les grands schémas académiques ne sont pas toujours utilisables dans cette histoire ancienne, ce qui vient confirmer les observations d'Alain Testart sur l'esclavage et les sociétés de chasseurs-cueilleurs de l'Alaska, par exemple, ou de la Sibérie.
On se souviendra que ces périodes et ces concepts ne sont souvent que des commodités pour l'enseignement et l'étude : peu importe donc, si l'on nomme "Antiquité" les sociétés et la culture japonaises du VII°s au XII°s, alors que d'un point de vue européen, "notre" Antiquité commence avec l'écriture, vers -3000, et se termine au V°s. La lecture de la partie consacrée à la préhistoire plaira aux amateurs de poteries, de pointes de flèches et d'amas de coquillages ; pour ce qui est de l'Antiquité, née avec l'introduction de l'écriture chinoise (la première attestation est un sceau en or reçu par un chef japonais en 57 ap. J.C.), ce qui la distingue de la suite des temps est la présence d'un pouvoir impérial de plus en plus centralisé, utilisant à ses fins les apports de la culture chinoise filtrés par la Corée ou reçus directement. A la fin de la période, l'état japonais du XII°s établi à Kyoto se dissout dans les luttes entre grands féodaux.
C'est donc un magnifique volume, extrêmement bien illustré, mais écrit dans un style lourd et incorrect, à l'image du néo-français universitaire actuel. Les auteurs ne s'aventurent pas en un terrain inexploré : l'archéologie au Japon, associée au récit des origines, est née sous les Shoguns au XVII°s, a prospéré avec la restauration Meiji du XIX°s, et les questions qu'elle soulève touchent la nation et ses récits fondateurs. Un peu comme en Israël, l'histoire est d'une brûlante actualité.
Le volume bouscule un peu nos habitudes, car son découpage chronologique ne correspond en rien à ce que nous connaissons, et pour cause. Tardivement peuplé, l'archipel japonais a une histoire décalée par rapport à celle du continent eurasiatique. Les auteurs fixent à -36000 le premier peuplement, mais la fixation des périodes est rendue difficile par l'acidité des sols volcaniques, qui dissolvent vite les restes humains. D'autre part, l'archéologie permet d'observer que des phénomènes originaux se sont produits au Japon, qui distinguent cet espace des autres : la néolithisation, l'agriculture, les premiers états et chefferies doivent être repensés à la lumière des fouilles et des trouvailles. Les progrès techniques n'ont rien de linéaire, et certaines découvertes sont abandonnées si elles ne conviennent pas à leurs inventeurs. En somme, les grands schémas académiques ne sont pas toujours utilisables dans cette histoire ancienne, ce qui vient confirmer les observations d'Alain Testart sur l'esclavage et les sociétés de chasseurs-cueilleurs de l'Alaska, par exemple, ou de la Sibérie.
On se souviendra que ces périodes et ces concepts ne sont souvent que des commodités pour l'enseignement et l'étude : peu importe donc, si l'on nomme "Antiquité" les sociétés et la culture japonaises du VII°s au XII°s, alors que d'un point de vue européen, "notre" Antiquité commence avec l'écriture, vers -3000, et se termine au V°s. La lecture de la partie consacrée à la préhistoire plaira aux amateurs de poteries, de pointes de flèches et d'amas de coquillages ; pour ce qui est de l'Antiquité, née avec l'introduction de l'écriture chinoise (la première attestation est un sceau en or reçu par un chef japonais en 57 ap. J.C.), ce qui la distingue de la suite des temps est la présence d'un pouvoir impérial de plus en plus centralisé, utilisant à ses fins les apports de la culture chinoise filtrés par la Corée ou reçus directement. A la fin de la période, l'état japonais du XII°s établi à Kyoto se dissout dans les luttes entre grands féodaux.
C'est donc un magnifique volume, extrêmement bien illustré, mais écrit dans un style lourd et incorrect, à l'image du néo-français universitaire actuel. Les auteurs ne s'aventurent pas en un terrain inexploré : l'archéologie au Japon, associée au récit des origines, est née sous les Shoguns au XVII°s, a prospéré avec la restauration Meiji du XIX°s, et les questions qu'elle soulève touchent la nation et ses récits fondateurs. Un peu comme en Israël, l'histoire est d'une brûlante actualité.
Des premiers paysans à l’âge des chefs, de la chasse à la riziculture, de l’outillage lithique au développement du fer, le Japon nourrit une histoire complexe qu’il faut relire avec les découvertes archéologiques.
Lien : https://laviedesidees.fr/Nes..
Lien : https://laviedesidees.fr/Nes..
Excellent ouvrage qui nous permet de nous plonger aux sources de la civilisation japonaise, tellement différente des civilisations occidentales.
Différence tout d'abord dans son approche puisque nous avons eu une civilisation de chasseurs cueilleurs qui ont utilisé la céramique mais qui n'ont pas fait évoluer leur cadre de vie vers des sites urbanisés et agricoles durant de nombreuses années.
L'évolution chronologique de cette civilisation nous fait découvrir une préhistoire très longue, suivie d'une antiquité non moins longue avant de basculer dans une époque féodale puis différentes périodes qui s'accélèrent.
L'ouvrage met bien en avant les relations avec les Chine impériale et la péninsule Coréenne. Il permet de bien positionner l'institution que représente l'Empereur que l'on pourrait voir comme assez monolithique de notre lointain occident, mais qui mis du temps à s'imposer et qui sera concurrencé sur le plan politique par le shoguna.
Ouvrage très clair, pédagogique et passionnant.
Différence tout d'abord dans son approche puisque nous avons eu une civilisation de chasseurs cueilleurs qui ont utilisé la céramique mais qui n'ont pas fait évoluer leur cadre de vie vers des sites urbanisés et agricoles durant de nombreuses années.
L'évolution chronologique de cette civilisation nous fait découvrir une préhistoire très longue, suivie d'une antiquité non moins longue avant de basculer dans une époque féodale puis différentes périodes qui s'accélèrent.
L'ouvrage met bien en avant les relations avec les Chine impériale et la péninsule Coréenne. Il permet de bien positionner l'institution que représente l'Empereur que l'on pourrait voir comme assez monolithique de notre lointain occident, mais qui mis du temps à s'imposer et qui sera concurrencé sur le plan politique par le shoguna.
Ouvrage très clair, pédagogique et passionnant.
Fondé sur les apports récents de l’archéologie japonaise [...], il représente une parfaite introduction à une histoire dont la singularité fait voler en éclats maints préjugés sur l’évolution des sociétés humaines.
Lien : https://www.lemonde.fr/criti..
Lien : https://www.lemonde.fr/criti..
Le samouraï est devenu , de nos jours ,un « topos » dès que l’on évoque le Japon : ses codes, sa morale, , ses armes , ses exploits alimentent roman et films. Le grand mérite de ce livre est de replacer cette image dans sa réalité historique : une mythologie réinventée au XX ème siècle . Et l’on découvre grâce à cette déconstruction l’importance capitale du groupe social des guerriers dans la société japonaise dont il a épousé et parfois initié les évolutions jusqu’à nos jours.
Les guerriers dans la rizière, un titre très poétique pour nous raconter l'histoire des samouraïs. Dans ce livre, Pierre-François Souyri, l'expert francophone des samouraïs nous entraîne du VIIème siècle à la deuxième guerre mondiale. Le samouraï, figure emblématique du Japon, est bien souvent idéalisé dans nos culture occidentales. Ce livre permet de comprendre l'évolution de cette classe sociale guerrière mais aussi la formation du Japon.
Ce livre est un très bon condensé des dernières recherches et ouvrages de l'auteur. C'est un indispensable pour ceux qui s'intéressent au samouraïs : court, précis et qui se lit très facilement. Une fois commencé on ne l'arrête plus. L'auteur brosse les portraits des guerriers aux différentes périodes de l'histoire japonaise et finalement nous comprenons qu'un même terme peut désigner des réalités différentes selon les temps de paix ou de guerre ou selon les époques. Le point final sur l'aspect moderne du samouraï et de son utilisation biaisée à des fins de propagande pendant la deuxième guerre mondiale est également intéressant.
Le seul regret est de ne pas avoir eu de carte pour suivre les nombreuses provinces mentionnées par l'auteur. Cela aurait été préférable aux illustrations qui n'apportent pas grand chose et n'ont rien d'exceptionnelles.
Je recommande cet ouvrage à tous les amateurs de l'histoire japonaise.
Ce livre est un très bon condensé des dernières recherches et ouvrages de l'auteur. C'est un indispensable pour ceux qui s'intéressent au samouraïs : court, précis et qui se lit très facilement. Une fois commencé on ne l'arrête plus. L'auteur brosse les portraits des guerriers aux différentes périodes de l'histoire japonaise et finalement nous comprenons qu'un même terme peut désigner des réalités différentes selon les temps de paix ou de guerre ou selon les époques. Le point final sur l'aspect moderne du samouraï et de son utilisation biaisée à des fins de propagande pendant la deuxième guerre mondiale est également intéressant.
Le seul regret est de ne pas avoir eu de carte pour suivre les nombreuses provinces mentionnées par l'auteur. Cela aurait été préférable aux illustrations qui n'apportent pas grand chose et n'ont rien d'exceptionnelles.
Je recommande cet ouvrage à tous les amateurs de l'histoire japonaise.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Pierre-François Souyri
Lecteurs de Pierre-François Souyri (246)Voir plus
Quiz
Voir plus
Avec des quand
Quand on parle du
blaireau
loup
renard
12 questions
61 lecteurs ont répondu
Thèmes :
expressions
, littérature
, cinema
, chansonCréer un quiz sur cet auteur61 lecteurs ont répondu