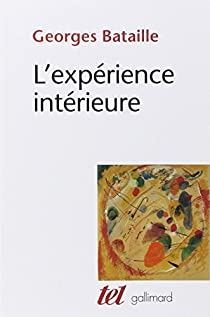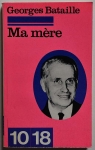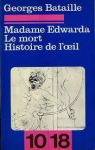Citations sur L'expérience intérieure (99)
Avant-propos
Combien j’aimerais dire de mon livre la même chose que Nietzsche du Gai
savoir : « Presque pas une phrase où la profondeur et l’enjouement ne se
tiennent tendrement la main ! »
Nietzsche écrit dans Ecce homo : « Un autre idéal court devant nos pas,
prodigieux, séduisant et riche de périls, auquel nous ne cherchons à convertir
personne, parce que nous ne reconnaissons pas facilement à quelqu’un de
droits sur lui : l’idéal d’un esprit qui joue naïvement, c’est-à-dire sans
intention, par excès de force et de fécondité, avec tout ce qui s’est appelé
jusque-là sacré, bon, intangible, divin ; d’un esprit pour qui les suprêmes
valeurs justement en cours dans le peuple signifieraient déjà danger,
décrépitude, avilissement ou tout au moins repos, cécité, oubli de soi
momentané ; un idéal de bien-être et de bienveillance humainement surhumain
qui paraîtra facilement inhumain, quand, par exemple, prenant place à côté de
tout ce sérieux qu’on a révéré ici, à côté de toute la solennité qui a régné
jusqu’à ce jour dans le geste, le verbe, le ton, le regard, la morale et le devoir,
il se révélera involontairement comme leur parodie incarnée ; lui qui pourtant
est appelé peut-être à inaugurer l’ère du grand sérieux, à poser le premier à sa
place le grand point d’interrogation, à changer le destin de l’âme, à faire
avancer l’aiguille, à lever le rideau de la tragédie… »
Je cite encore ces quelques mots (note datant de 82-84.) : « Voir sombrer les
natures tragiques et pouvoir en rire, malgré la profonde compréhension,
l’émotion et la sympathie que l’on ressent, cela est divin. »
Les seules parties de ce livre écrites nécessairement – répondant à mesure à
ma vie – sont la seconde, le Supplice, et la dernière. J’écrivis les autres avec le
louable souci de composer un livre.
Se demander devant un autre : par quelle voie apaise-t-il en lui le désir
d’être tout ? sacrifice, conformisme, tricherie, poésie, morale, snobisme,
héroïsme, religion, révolte, vanité, argent ? ou plusieurs voies ensemble ? ou
toutes ensemble ? Un clin d’œil où brille une malice, un sourire mélancolique,
une grimace de fatigue décèlent la souf rance dissimulée que nous donne
l’étonnement de n’être pas tout, d’avoir même de courtes limites. Une
souf rance si peu avouable mène à l’hypocrisie intérieure, à des exigences
lointaines, solennelles (telle la morale de Kant).
A l’encontre. Ne plus se vouloir tout est tout mettre en cause. N’importe qui,
sournoisement, voulant éviter de souf rir se confond avec le tout de l’univers,
juge de chaque chose comme s’il l’était, de la même façon qu’il imagine, au
fond, ne jamais mourir. Ces illusions nuageuses, nous les recevons avec la vie
comme un narcotique nécessaire à la supporter. Mais qu’en est-il de nous
quand, désintoxiqués, nous apprenons ce que nous sommes ? perdus entre des
bavards, dans une nuit où nous ne pouvons que haïr l’apparence de lumière qui
vient des bavardages. La souf rance s’avouant du désintoxiqué est l’objet de
ce livre.
Nous ne sommes pas tout, n’avons même que deux certitudes en ce monde,
celle-là et celle de mourir. Si nous avons conscience de n’être pas tout comme
nous l’avons d’être mortel, ce n’est rien. Mais si nous n’avons pas de
narcotique, se révèle un vide irrespirable. Je voulais être tout : que défaillant
dans ce vide, mais me prenant de courage, je me dise : « J’ai honte d’avoir
voulu l’être, car je le vois maintenant, c’était dormir », dès lors commence une
expérience singulière. L’esprit se meut dans un monde étrange où l’angoisse et
l’extase se composent.
Une telle expérience n’est pas inef able, mais je la communique à qui
l’ignore : sa tradition est dif icile (écrite n’est guère que l’introduction de
l’orale) ; exige d’autrui angoisse et désir préalables.
Ce qui caractérise une telle expérience, qui ne procède pas d’une
révélation, où rien non plus ne se révèle, sinon l’inconnu, est qu’elle n’apporte
jamais rien d’apaisant. Mon livre fini, j’en vois les côtés haïssables, son
insuf isance, et pire, en moi, le souci de suf isance que j’y ai mêlé, que j’y mêle
encore, et dont je hais en même temps l’impuissance et une partie de
l’intention.
Ce livre est le récit d’un désespoir. Ce monde est donné à l’homme ainsi
qu’une énigme à résoudre. Toute ma vie – ses moments bizarres, déréglés,
autant que mes lourdes méditations – s’est passée à résoudre l’énigme. Je vins
ef ectivement à bout de problèmes dont la nouveauté et l’étendue m’exaltèrent.
Entré dans des contrées insoupçonnées, je vis ce que jamais des yeux n’avaient
vu. Rien de plus enivrant : le rire et la raison, l’horreur et la lumière devenus
pénétrables… il n’était rien que je ne sache, qui ne soit accessible à ma fièvre.
Comme une insensée merveilleuse, la mort ouvrait sans cesse ou fermait les
portes du possible. Dans ce dédale, je pouvais à volonté me perdre, me donner
au ravissement, mais à volonté je pouvais discerner les voies, ménager à la
démarche intellectuelle un passage précis. L’analyse du rire m’avait ouvert un
champ de coïncidences entre les données d’une connaissance émotionnelle
commune et rigoureuse et celles de la connaissance discursive. Les contenus se
perdant les uns dans les autres des diverses formes de dépense (rire, héroïsme,
extase, sacrifice, poésie, érotisme ou autres) définissaient d’eux-mêmes une loi
de communication réglant les jeux de l’isolement et de la perte des êtres. La
possibilité d’unir en un point précis deux sortes de connaissance jusqu’ici ou
étrangères l’une à l’autre ou confondues grossièrement donnait à cette
ontologie sa consistance inespérée : tout entier le mouvement de la pensée se
perdait, mais tout entier se retrouvait, en un point où rit la foule unanime. J’en
éprouvai un sentiment de triomphe : peut-être illégitime, prématuré ?… il me
semble que non. Je sentis rapidement ce qui m’arrivait comme un poids. Ce qui
ébranla mes nerfs fut d’avoir achevé ma tâche : mon ignorance portait sur des
points insignifiants, plus d’énigmes à résoudre ! Tout s’écroulait ! je m’éveillai
devant une énigme nouvelle, et celle-là, je le sus aussitôt, insoluble : cette
énigme était même si amère, elle me laissa dans une impuissance si accablée
que je l’éprouvai comme Dieu, s’il est, l’éprouverait.
Aux trois quarts achevé, j’abandonnai l’ouvrage où devait se trouver
l’énigme résolue. J’écrivis Le Supplice, où l’homme atteint l’extrême du
possible.
Combien j’aimerais dire de mon livre la même chose que Nietzsche du Gai
savoir : « Presque pas une phrase où la profondeur et l’enjouement ne se
tiennent tendrement la main ! »
Nietzsche écrit dans Ecce homo : « Un autre idéal court devant nos pas,
prodigieux, séduisant et riche de périls, auquel nous ne cherchons à convertir
personne, parce que nous ne reconnaissons pas facilement à quelqu’un de
droits sur lui : l’idéal d’un esprit qui joue naïvement, c’est-à-dire sans
intention, par excès de force et de fécondité, avec tout ce qui s’est appelé
jusque-là sacré, bon, intangible, divin ; d’un esprit pour qui les suprêmes
valeurs justement en cours dans le peuple signifieraient déjà danger,
décrépitude, avilissement ou tout au moins repos, cécité, oubli de soi
momentané ; un idéal de bien-être et de bienveillance humainement surhumain
qui paraîtra facilement inhumain, quand, par exemple, prenant place à côté de
tout ce sérieux qu’on a révéré ici, à côté de toute la solennité qui a régné
jusqu’à ce jour dans le geste, le verbe, le ton, le regard, la morale et le devoir,
il se révélera involontairement comme leur parodie incarnée ; lui qui pourtant
est appelé peut-être à inaugurer l’ère du grand sérieux, à poser le premier à sa
place le grand point d’interrogation, à changer le destin de l’âme, à faire
avancer l’aiguille, à lever le rideau de la tragédie… »
Je cite encore ces quelques mots (note datant de 82-84.) : « Voir sombrer les
natures tragiques et pouvoir en rire, malgré la profonde compréhension,
l’émotion et la sympathie que l’on ressent, cela est divin. »
Les seules parties de ce livre écrites nécessairement – répondant à mesure à
ma vie – sont la seconde, le Supplice, et la dernière. J’écrivis les autres avec le
louable souci de composer un livre.
Se demander devant un autre : par quelle voie apaise-t-il en lui le désir
d’être tout ? sacrifice, conformisme, tricherie, poésie, morale, snobisme,
héroïsme, religion, révolte, vanité, argent ? ou plusieurs voies ensemble ? ou
toutes ensemble ? Un clin d’œil où brille une malice, un sourire mélancolique,
une grimace de fatigue décèlent la souf rance dissimulée que nous donne
l’étonnement de n’être pas tout, d’avoir même de courtes limites. Une
souf rance si peu avouable mène à l’hypocrisie intérieure, à des exigences
lointaines, solennelles (telle la morale de Kant).
A l’encontre. Ne plus se vouloir tout est tout mettre en cause. N’importe qui,
sournoisement, voulant éviter de souf rir se confond avec le tout de l’univers,
juge de chaque chose comme s’il l’était, de la même façon qu’il imagine, au
fond, ne jamais mourir. Ces illusions nuageuses, nous les recevons avec la vie
comme un narcotique nécessaire à la supporter. Mais qu’en est-il de nous
quand, désintoxiqués, nous apprenons ce que nous sommes ? perdus entre des
bavards, dans une nuit où nous ne pouvons que haïr l’apparence de lumière qui
vient des bavardages. La souf rance s’avouant du désintoxiqué est l’objet de
ce livre.
Nous ne sommes pas tout, n’avons même que deux certitudes en ce monde,
celle-là et celle de mourir. Si nous avons conscience de n’être pas tout comme
nous l’avons d’être mortel, ce n’est rien. Mais si nous n’avons pas de
narcotique, se révèle un vide irrespirable. Je voulais être tout : que défaillant
dans ce vide, mais me prenant de courage, je me dise : « J’ai honte d’avoir
voulu l’être, car je le vois maintenant, c’était dormir », dès lors commence une
expérience singulière. L’esprit se meut dans un monde étrange où l’angoisse et
l’extase se composent.
Une telle expérience n’est pas inef able, mais je la communique à qui
l’ignore : sa tradition est dif icile (écrite n’est guère que l’introduction de
l’orale) ; exige d’autrui angoisse et désir préalables.
Ce qui caractérise une telle expérience, qui ne procède pas d’une
révélation, où rien non plus ne se révèle, sinon l’inconnu, est qu’elle n’apporte
jamais rien d’apaisant. Mon livre fini, j’en vois les côtés haïssables, son
insuf isance, et pire, en moi, le souci de suf isance que j’y ai mêlé, que j’y mêle
encore, et dont je hais en même temps l’impuissance et une partie de
l’intention.
Ce livre est le récit d’un désespoir. Ce monde est donné à l’homme ainsi
qu’une énigme à résoudre. Toute ma vie – ses moments bizarres, déréglés,
autant que mes lourdes méditations – s’est passée à résoudre l’énigme. Je vins
ef ectivement à bout de problèmes dont la nouveauté et l’étendue m’exaltèrent.
Entré dans des contrées insoupçonnées, je vis ce que jamais des yeux n’avaient
vu. Rien de plus enivrant : le rire et la raison, l’horreur et la lumière devenus
pénétrables… il n’était rien que je ne sache, qui ne soit accessible à ma fièvre.
Comme une insensée merveilleuse, la mort ouvrait sans cesse ou fermait les
portes du possible. Dans ce dédale, je pouvais à volonté me perdre, me donner
au ravissement, mais à volonté je pouvais discerner les voies, ménager à la
démarche intellectuelle un passage précis. L’analyse du rire m’avait ouvert un
champ de coïncidences entre les données d’une connaissance émotionnelle
commune et rigoureuse et celles de la connaissance discursive. Les contenus se
perdant les uns dans les autres des diverses formes de dépense (rire, héroïsme,
extase, sacrifice, poésie, érotisme ou autres) définissaient d’eux-mêmes une loi
de communication réglant les jeux de l’isolement et de la perte des êtres. La
possibilité d’unir en un point précis deux sortes de connaissance jusqu’ici ou
étrangères l’une à l’autre ou confondues grossièrement donnait à cette
ontologie sa consistance inespérée : tout entier le mouvement de la pensée se
perdait, mais tout entier se retrouvait, en un point où rit la foule unanime. J’en
éprouvai un sentiment de triomphe : peut-être illégitime, prématuré ?… il me
semble que non. Je sentis rapidement ce qui m’arrivait comme un poids. Ce qui
ébranla mes nerfs fut d’avoir achevé ma tâche : mon ignorance portait sur des
points insignifiants, plus d’énigmes à résoudre ! Tout s’écroulait ! je m’éveillai
devant une énigme nouvelle, et celle-là, je le sus aussitôt, insoluble : cette
énigme était même si amère, elle me laissa dans une impuissance si accablée
que je l’éprouvai comme Dieu, s’il est, l’éprouverait.
Aux trois quarts achevé, j’abandonnai l’ouvrage où devait se trouver
l’énigme résolue. J’écrivis Le Supplice, où l’homme atteint l’extrême du
possible.
Où commence le corps ?
Le corps commence nulle part.
Le corps commence nulle part.
Ma recherche eut d’abord un objet double : le sacré, puis l’extase.
Qui ne "meurt" pas de n'être qu'un homme ne sera jamais qu'un homme.
Je veux bien qu'on entende plus rien, mais on parle, on crie pourquoi ai-je peur d'entendre aussi ma propre voix ? Et je ne parle pas de peur, mais de terreur, d'horreur.
Je dirais l'occasion d'où ce rire est sorti : j'étais à Londres (1920) et devais me trouver à table avec Bergson; je n'avais alors rien lu de lui (ni d'ailleurs, peu s'en faut d'autres philosophes); j'eus cette curiosité, me trouvant au British Muséum je demandai le "Rire" (le plus court de ses livres); la lecture m'irrita, la théorie me sembla courte (là-dessus le personnage me déçut : ce petit homme prudent, philosophe!) mais la question, le sens demeuré caché du rire, fut dès lors à mes yeux la question clé (liée au rire heureux, intime, dont je vis sur le coup que j'étais possédé), l'énigme qu'à tout prix je résoudrais (qui résolue, d'elle-même résoudrait tout). Je ne connus longtemps qu'une euphorie chaotique. Après plusieurs années seulement, je sentis le chaos - fidèle image d'une incohérence d'être divers - par degrés, devenir suffocant. J'étais brisé, dissous d'avoir trop ri, tel, déprimé, je me trouvai : le monstre inconsistant, vide de sens et de volonté que j'étais me fit peur.
Mais je fais l'épreuve amère de l'"impossible". Toute vie profonde est lourde d'"impossible". L'intention, le projet détruisent.
J'oppose à la poésie l'expérience du possible. Il s'agit moins de contemplation que de déchirement.
(...) il le fallait bien, rien ne résiste à la nécessité d'aller plus loin. S'il en était besoin, la démence serait le paiement.
J'échoue, quoi que j'écrive, en ceci que je devrais lie, à la précision du sens, la richesse infinie - insensée - des possibles. A cette besogne de Danaïde, je suis astreint - gaiement ? - peut-être, car je ne puis concevoir ma vie désormais, sinon clouée à "l'extrême du possible" (Cela suppose d'abord une intelligence surhumaine, quand j'ai dû souvent recourir à l'intelligence d'autrui, plus habile... Mais que faire ? oublier ? aussitôt, je le sens, je serai fou : on comprend mal encore la misère d'un esprit "dévêtu".)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Georges Bataille (71)
Voir plus
Quiz
Voir plus
C'est mon quiz, mon Bataille, fallait pas qu'il s'en aille !
Ce qui est écrit est écrit, mais je ne comprendrai jamais pourquoi Georges en a fait toute une histoire :
L'oeil
Le sang
10 questions
22 lecteurs ont répondu
Thème :
Georges BatailleCréer un quiz sur ce livre22 lecteurs ont répondu