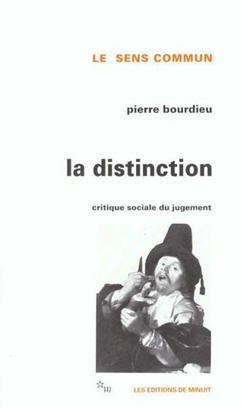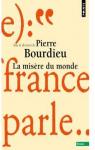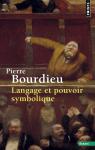Citations sur La distinction (112)
Contre le discours ni vrai ni faux, ni vérifiable ni falsifiable, ni théorique ni empirique qui, comme Racine, ne parlait pas de vaches mais de génisses, ne peut pas parler du Smig ou des maillots de corps de la classe ouvrière mais seulement du mode de production et du prolétariat ou des rôles et des attitudes de la lower middle class, il ne suffit pas de démontrer, il faut montrer, des objets et même des personnes, faire toucher du doigt –ce qui ne veut pas dire montrer du doigt, mettre à l’index-, et faire entrer dans un bistrot populaire ou sur un terrain de rugby, sur un terrain de golf ou dans un club privé, des gens qui, accoutumés à parler ce qu’ils pensent penser, ne savent plus penser ce qu’ils parlent.
On peut se fier à Proust qui n’a cessé de cultiver et d’analyser à la fois le plaisir cultivé, lorsque, pour essayer de comprendre et de faire comprendre cette sorte de plaisir idolâtre que l’on prend à lire telle page célèbre […], il doit évoquer, outre les propriétés mêmes de l’œuvre, tout le réseau des références croisées qui se tisse autour d’elle, référence de l’œuvre aux expériences personnelles qu’elle a accompagnées, favorisées, ou même produites chez le lecteur, référence de l’expérience personnelle aux œuvres qu’elle a contaminées souterrainement de ses connotations, références, enfin, de l’expérience de l’œuvre à une expérience antérieure de la même œuvre ou à l’expérience d’autres œuvres, chacune d’elles enrichie de toutes les associations et les résonances qui lui sont attachées […]
[…] de même que, par un merveilleux retournement dialectique, les actes de dérision et de désacralisation que l’art moderne à multipliés contre l’art ont toujours tourné, en tant qu’actes artistiques, à la gloire de l’art et de l’artiste, de même la « déconstruction » philosophique de la philosophie est bien, lorsque s’est évanoui l’espoir même d’une reconstruction radicale, la seule réponse philosophique à la destruction de la philosophie.
[…] l’inhibition du plaisir trop immédiatement accessible peut même devenir source de plaisir en elle-même, le raffinement conduisant à cultiver pour lui-même le « plaisir préliminaire » dont parler Freud, à différer toujours davantage la résolution de la tension, à accroître par exemple la distance entre l’accord dissonant et sa résolution complète ou conforme. En sorte que la forme la plus « pure » du plaisir de l’esthète, l’aisthesis épurée, sublimée, déniée, pourrait ainsi considérer, paradoxalement, dans une ascèse askesis, une tension entraînée et entretenue, qui est le contraire même de l’aisthesis primaire et primitive.
Le dégoût est l’expérience paradoxale de la jouissance extorquée par la violence, de la jouissance qui fait horreur. Cette horreur ignorée de ceux qui s’abandonnent à la sensation, résulte, fondamentalement, de l’abolition de la distance, où s’affirme la liberté entre la représentation et la chose représentée, bref de l’aliénation, de la perte du sujet dans l’objet, de la soumission immédiate au présent immédiat que détermine la violence asservissante de l’ « agréable ».
[Le spectateur populaire] attend de l’œuvre d’art que, finalité sans autre fin qu’elle-même, elle traite le spectateur conformément à l’impératif kantien, c’est-à-dire comme une fin et non comme un moyen. Ainsi le principe de goût pur n’est autre chose qu’un refus ou mieux, un dégoût, dégoût des objets imposant la jouissance et dégoût du goût grossier et vulgaire qui se complaît dans cette jouissance imposée.
[…] les œuvres « vulgaires » ne sont pas seulement une sorte d’insulte au raffinement des raffinés, une manière d’offense au public « difficile » qui n’entend pas qu’on lui offre des choses « faciles » […] ; elles suscitent le malaise et le dégoût par les méthodes de séduction, ordinairement dénoncées comme « basses », « dégradantes », « avilissantes » qu’elles mettent en œuvre, donnant au spectateur le sentiment d’être traité comme le premier venu, qu’on peut séduire avec des charmes de pacotille, l’invitant à régresser vers les formes les plus primitives et les plus élémentaires du plaisir, qu’il s’agisse des satisfactions passives du goût enfantin pour les liquides doux et sucrés […] ou des gratifications quasi animales du désir sexuel.
Les groupes ont partie liée avec les mots qui les désignent : en effet le pouvoir d’imposer la reconnaissance dépend de l’aptitude à se mobiliser autour d’un nom, « prolétariat », « classe ouvrière », « cadres », donc à s’approprier un nom commun et à communier dans un nom propre et à mobiliser ainsi la force que fait l’union, celle que crée le pouvoir unificateur du nom, du mot d’ordre.
[…] l’intérêt pour l’aspect aperçu n’est jamais complètement indépendant de l’intérêt à l’apercevoir.
[…] les dominés tendent d’abord à s ‘attribuer ce que la distribution leur attribue, refusant ce qui leur est refusé (« ce n’est pas pour nous »), se contentant de ce qui leur est octroyé, mesurant leurs espérances à leurs chances, se définissant comme l’ordre établi les définit, reproduisant dans le verdict qu’ils portent sur eux-mêmes le verdict que porte sur eux l’économie, se vouant en un mot à ce qui leur revient […], acceptant d’être ce qu’ils ont à être, « modestes », « humbles » et « obscurs ».
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Pierre Bourdieu (64)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelques questions sur Pierre Bourdieu
En quelle année était-il né ?
1920
1930
1940
1950
7 questions
42 lecteurs ont répondu
Thème :
Pierre BourdieuCréer un quiz sur ce livre42 lecteurs ont répondu