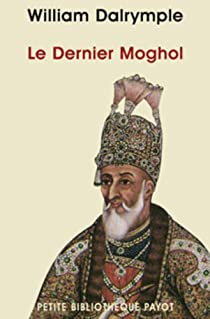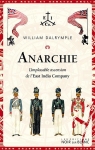Citations sur Le Dernier Moghol (10)
Griffiths n'avait rien d'un pacifiste bêlant, mais il fut profondément pertubé par cette rencontre :
" Mon vieux camarade de classe était devenu quelqu'un d'autre [...] Je l'avais rencontré dans une rue après notre entrée dans la ville. Prenant mes mains dans les siennes, il me dit qu'il avait tué tous les rebelles qu'il avait trouvés sur son chemin, femmes et enfants compris, et à sa surexcitation comme à son apparence - son uniforme était taché de sang - je le crus sur parole. [...] Il y avait d'autres officiers au cantonnement qui avaient perdu des épouses et des membres de leur famille à Delhi et se conduisaient de la même manière que Clifford."
" Mon vieux camarade de classe était devenu quelqu'un d'autre [...] Je l'avais rencontré dans une rue après notre entrée dans la ville. Prenant mes mains dans les siennes, il me dit qu'il avait tué tous les rebelles qu'il avait trouvés sur son chemin, femmes et enfants compris, et à sa surexcitation comme à son apparence - son uniforme était taché de sang - je le crus sur parole. [...] Il y avait d'autres officiers au cantonnement qui avaient perdu des épouses et des membres de leur famille à Delhi et se conduisaient de la même manière que Clifford."
Le 21 au matin, « une salve de coups de canon proclama que Delhi dépendait de nouveau de la couronne britannique ». Mais la cité reconquise par les Britanniques – l’ancienne capitale de l’Hindoustan, la prestigieuse métropole moghole – n’était plus qu’une ville morte, seulement peuplée de pillards anglais pris de boisson. Le commandant William Ireland, qui ne s’était pas privé de critiquer pendant l’assaut la brutalité de ses propres collègues, fut horrifié par le spectacle qu’offrait la ville « libérée » :
« La dévastation de cette illustre cité en disait long sur les horreurs de la guerre, écrit-il. Hormis les abords immédiats des demeures où étaient cantonnés nos soldats, tout était silencieux et désert. Il n’y avait plus de marchands assis dans les bazars ; plus de caravanes de chameaux ni de chars à bœufs franchissant les portes de la ville ; plus de passants dans les rues ; plus d’hommes en grande conversation sur le pas de leur porte ; plus d’enfants jouant dans la poussière ; plus de voix de femmes derrière les écrans de bois sculpté. Des meubles de toutes sortes encombraient la chaussée.
Ce spectacle était rendu encore plus poignant par les traces que les habitants avaient laissées derrière eux. La cendre noircissait l’âtre des cheminées et les animaux domestiques erraient à la recherche de leurs défunts maîtres. Ça et là des maisons avaient été incendiées ou ravagées par des boules de canon, des éclats d’obus jonchaient le sol, et de temps à autre on tombait sur des cadavres décomposés, à moitié dévorés par les corbeaux et les chacals. Les marchands étaient restés jusqu’au bout dans leurs échoppes : seuls le pilonnage de la ville et les rumeurs des atrocités commises par nos soldats les en avaient chassés. »
Le lieutenant Ommaney du corps des Guides, qui avait étudié l’ourdou, le persan, et l’histoire de Delhi, fut lui aussi effaré par ce qu’il découvrit au lever du jour :
« Toute la ville est dépeuplée, nota-t-il. Ne passent dans les rues que de rares groupes d’une soixantaine d’hommes et de femmes, qui se rendent vers l’une des portes pour s’enfuir ; les cipayes et les habitants sont invisibles. On ne voit que nos soldats occupés à piller les maisons, c’est tout. Les cent cinquante mille habitants sont presque tous partis. Même lors de la conquête de Delhi par Nadir Shah, il n’en fut pas ainsi. » (pp. 480-481)
« La dévastation de cette illustre cité en disait long sur les horreurs de la guerre, écrit-il. Hormis les abords immédiats des demeures où étaient cantonnés nos soldats, tout était silencieux et désert. Il n’y avait plus de marchands assis dans les bazars ; plus de caravanes de chameaux ni de chars à bœufs franchissant les portes de la ville ; plus de passants dans les rues ; plus d’hommes en grande conversation sur le pas de leur porte ; plus d’enfants jouant dans la poussière ; plus de voix de femmes derrière les écrans de bois sculpté. Des meubles de toutes sortes encombraient la chaussée.
Ce spectacle était rendu encore plus poignant par les traces que les habitants avaient laissées derrière eux. La cendre noircissait l’âtre des cheminées et les animaux domestiques erraient à la recherche de leurs défunts maîtres. Ça et là des maisons avaient été incendiées ou ravagées par des boules de canon, des éclats d’obus jonchaient le sol, et de temps à autre on tombait sur des cadavres décomposés, à moitié dévorés par les corbeaux et les chacals. Les marchands étaient restés jusqu’au bout dans leurs échoppes : seuls le pilonnage de la ville et les rumeurs des atrocités commises par nos soldats les en avaient chassés. »
Le lieutenant Ommaney du corps des Guides, qui avait étudié l’ourdou, le persan, et l’histoire de Delhi, fut lui aussi effaré par ce qu’il découvrit au lever du jour :
« Toute la ville est dépeuplée, nota-t-il. Ne passent dans les rues que de rares groupes d’une soixantaine d’hommes et de femmes, qui se rendent vers l’une des portes pour s’enfuir ; les cipayes et les habitants sont invisibles. On ne voit que nos soldats occupés à piller les maisons, c’est tout. Les cent cinquante mille habitants sont presque tous partis. Même lors de la conquête de Delhi par Nadir Shah, il n’en fut pas ainsi. » (pp. 480-481)
Au palais, dans ses appartements de la tour Shah Burj donnant sur le fleuve, Mirza Fakhru se consacrait à la calligraphie ou à l’écriture de son Histoire des rois et des prophètes, tandis que ses frères cadets faisaient leurs devoirs, tâche que les Moghols prenaient très au sérieux :
« Tous doivent continuellement étudier, et sous étroite surveillance, nota un visiteur. Aucun autre prince des Indes ou presque n’égale les membres de la famille impériale [de Delhi], ni par les compétences acquises ni par ces qualités intellectuelles qui sont en général un don de la nature, et la conséquence d’une éducation vertueuse. »
A l’époque, toute éducation princière digne de ce nom mettait l’accent sur l’étude de la logique, de la philosophie, des mathématiques, de l’astronomie, du droit et de la médecine. Comme chez les souverains de la Renaissance, on attendait aussi d’un prince véritablement cultivé qu’il sache composer des vers, et Le Jardin de la poésie, dictionnaire biographie des poètes ourdous paru en 1850, ne mentionne pas moins de cinquante proches de Zafar, dont plusieurs femmes. L’évêque Reginald Heber ne manqua d’ailleurs pas de relever l’importance attachée par Zafar à l’éducation des jeunes filles au palais.
Dans sa jeunesse, Zafar avait lui-même était l’un de ces humanistes dignes de la Renaissance qu’une bonne éducation moghole cherchait à produire : il parlait couramment l’ourdou, l’arabe et le persan, et maîtrisait suffisamment le braj basha et le pendjabi pour écrire des vers dans ces deux langues(1). A l’âge de trente-trois ans, il avait déjà publié un recueil de poèmes, un long commentaire linéaire du Gulistan (Le Roseraie) de Sa’adi, « un dictionnaire de prosodie en trois tomes », ainsi qu’un traité sur les langues du Deccan. Toujours dans son jeune temps, il s’était fait un nom comme cavalier, comme bretteur et comme archer, et resta une fine gâchette jusqu’à un âge avancé. Même Charles Metcalfe, le frère aîné de Sir Thomas, concédait, malgré son peu de sympathie pour la cour moghole, que Zafar « était le plus respectable et le plus accompli des princes ».
(1) Zafar composa même un recueil en quatre langues, ne laissant de côté que l’arabe. (pp. 142-144)
« Tous doivent continuellement étudier, et sous étroite surveillance, nota un visiteur. Aucun autre prince des Indes ou presque n’égale les membres de la famille impériale [de Delhi], ni par les compétences acquises ni par ces qualités intellectuelles qui sont en général un don de la nature, et la conséquence d’une éducation vertueuse. »
A l’époque, toute éducation princière digne de ce nom mettait l’accent sur l’étude de la logique, de la philosophie, des mathématiques, de l’astronomie, du droit et de la médecine. Comme chez les souverains de la Renaissance, on attendait aussi d’un prince véritablement cultivé qu’il sache composer des vers, et Le Jardin de la poésie, dictionnaire biographie des poètes ourdous paru en 1850, ne mentionne pas moins de cinquante proches de Zafar, dont plusieurs femmes. L’évêque Reginald Heber ne manqua d’ailleurs pas de relever l’importance attachée par Zafar à l’éducation des jeunes filles au palais.
Dans sa jeunesse, Zafar avait lui-même était l’un de ces humanistes dignes de la Renaissance qu’une bonne éducation moghole cherchait à produire : il parlait couramment l’ourdou, l’arabe et le persan, et maîtrisait suffisamment le braj basha et le pendjabi pour écrire des vers dans ces deux langues(1). A l’âge de trente-trois ans, il avait déjà publié un recueil de poèmes, un long commentaire linéaire du Gulistan (Le Roseraie) de Sa’adi, « un dictionnaire de prosodie en trois tomes », ainsi qu’un traité sur les langues du Deccan. Toujours dans son jeune temps, il s’était fait un nom comme cavalier, comme bretteur et comme archer, et resta une fine gâchette jusqu’à un âge avancé. Même Charles Metcalfe, le frère aîné de Sir Thomas, concédait, malgré son peu de sympathie pour la cour moghole, que Zafar « était le plus respectable et le plus accompli des princes ».
(1) Zafar composa même un recueil en quatre langues, ne laissant de côté que l’arabe. (pp. 142-144)
Très vite, les garçons les plus âgés s’élançaient dans les ruelles pour être à l’heure à la medersa. Au programme : mémorisation du Coran, élucidation de ses mystères par le maulvi, à moins que la journée ne soit consacrée à l’étude de la philosophie, de la théologie ou de la rhétorique. Loin d’y avoir une corvée, beaucoup se passionnaient pour ces enseignements : un étudiant particulièrement enthousiaste venait chaque jour, de sa bourgade sur la Grand Trunk Road, suivre des cours à la merdersa i-Rahmiyya de Delhi, même en pleine mousson, transportant ses livres dans une marmite pour les protéger de la pluie. Le vénérable Zakaullah se rappelait encore à quelle vitesse il courait dans les galis de Sahahjahanabad, si grande était sa curiosité pour ce nouveau savoir – surtout les mathématiques – enseigné au collège de Delhi. Même le colonel William Sleeman, célèbre pour avoir débarrassé le pays des étrangleurs et pour sa critique du fonctionnement des tribunaux indiens, concéda que les medersas de Delhi dispensaient un enseignement tout à fait remarquable :
« Sans doute existe-t-il peu de communautés de par le monde où l’instruction est plus généreusement prodiguée que chez les musulmans indiens, nota-t-il lors d’un séjour dans la capitale moghole. Le fonctionnaire payé vingt roupies par mois donne couramment à ses fils une éducation digne de celle d’un futur Premier ministre. Ils apprennent, par le truchement des langues arabe et persane, la même chose que les jeunes gens de nos universités en étudiant le grec et le latin – c’est-à-dire la grammaire, la rhétorique et la logique. Après sept années d’études, le jeune mahométan noue son turban autour d’une tête presque aussi bien remplie de tous les sujets relatifs à ces disciplines que celle d’un jeune homme frais émoulu d’Oxford : il peut parler avec la même autorité de Socrate et d’Aristote, de Platon et d’Hippocrate, de Galien et d’Avicenne (alias Sokrat, Aristotalis, Aflatun, Bokrat, Jalinus et Bu Ali Sena) ; en outre, grand avantage pour lui en Inde, les langues dans lesquelles il a acquis ce savoir sont celles qui lui sont les plus utiles dans l’existence. »
La réputation des medersas de Delhi était suffisamment bonne, en tout cas, pour que le jeune poète Atal Hussain Ali fuie le mariage qui l’attendait à Panipat et parcoure à pied les quatre-vingt-cinq kilomètres qui le séparaient de Delhi, seul, sans argent et dormant à la belle étoile, afin de réaliser son rêve d’étudier dans l’un des prestigieux collèges de la capitale. « Tout le monde voulait que je cherche un emploi, écrivit-il plus tard, mais ma passion pour l’étude l’a emporté. » Delhi était après tout un centre intellectuel renommé, et le début des années 1850 marquait l’apogée de sa vitalité culturelle. Elle possédait six medersas réputées et au moins quatre de moindre importance, neuf journaux en ourdou et en persan, cinq revues savantes publiées par le collège de Delhi, d’innombrables imprimeries et maison d’édition, et pas moins de cent trente médecins de la tradition yunani. (pp. 136-137)
« Sans doute existe-t-il peu de communautés de par le monde où l’instruction est plus généreusement prodiguée que chez les musulmans indiens, nota-t-il lors d’un séjour dans la capitale moghole. Le fonctionnaire payé vingt roupies par mois donne couramment à ses fils une éducation digne de celle d’un futur Premier ministre. Ils apprennent, par le truchement des langues arabe et persane, la même chose que les jeunes gens de nos universités en étudiant le grec et le latin – c’est-à-dire la grammaire, la rhétorique et la logique. Après sept années d’études, le jeune mahométan noue son turban autour d’une tête presque aussi bien remplie de tous les sujets relatifs à ces disciplines que celle d’un jeune homme frais émoulu d’Oxford : il peut parler avec la même autorité de Socrate et d’Aristote, de Platon et d’Hippocrate, de Galien et d’Avicenne (alias Sokrat, Aristotalis, Aflatun, Bokrat, Jalinus et Bu Ali Sena) ; en outre, grand avantage pour lui en Inde, les langues dans lesquelles il a acquis ce savoir sont celles qui lui sont les plus utiles dans l’existence. »
La réputation des medersas de Delhi était suffisamment bonne, en tout cas, pour que le jeune poète Atal Hussain Ali fuie le mariage qui l’attendait à Panipat et parcoure à pied les quatre-vingt-cinq kilomètres qui le séparaient de Delhi, seul, sans argent et dormant à la belle étoile, afin de réaliser son rêve d’étudier dans l’un des prestigieux collèges de la capitale. « Tout le monde voulait que je cherche un emploi, écrivit-il plus tard, mais ma passion pour l’étude l’a emporté. » Delhi était après tout un centre intellectuel renommé, et le début des années 1850 marquait l’apogée de sa vitalité culturelle. Elle possédait six medersas réputées et au moins quatre de moindre importance, neuf journaux en ourdou et en persan, cinq revues savantes publiées par le collège de Delhi, d’innombrables imprimeries et maison d’édition, et pas moins de cent trente médecins de la tradition yunani. (pp. 136-137)
Chez les habitants de Delhi, si répandu était la croyance selon laquelle les Anglais seraient le produit d’une union contre nature entre des singes et des femmes du Sri Lanka (voire entre « des singes et des porcs ») que le plus célèbre théologien de la ville, Shah Abdul Aziz, fut obligé d’édicter une fatwa où il rappelait qu’une telle opinion ne reposait sur aucun texte du Coran ni des hadith, et que, malgré leur comportement bizarre, les firangis n’en étaient pas moins des chrétiens, et donc des gens du Livre. Dès lors qu’ils ne vous servaient pas de porc ni de vin, il était tout à fait permis de les fréquenter (si, pour des raisons mystérieuses, on en avait le désir), et même de partager leur repas(1).
En partie à cause du manque de contacts réguliers avec les Européens, Delhi restait une ville pleine d’assurance, fière de sa splendeur et de son tahzib, cette urbanité faite d’un mélange de culture et de bonnes manières. Elle n’avait pas encore connu la crise de confiance qui survient inévitablement après l’instauration d’un colonialisme autoritaire et débridé. Au contraire, elle était encore à plus d’un titre une bulle de traditionalisme moghol dans une Inde où les changements s’accéléraient déjà. Lorsqu’un habitant de Shahjahanabad souhaitait chanter les louanges d’un autre, il puisait toujours dans la rhétorique de l’islam médiéval, émaillé de tropes séculaires : les femmes de Delhi étaient aussi élancées que des cyprès, les hommes aussi généraux que Faridun, aussi cultivés que Platon, aussi sages que Salomon, et leurs médecins aussi talentueux que Galien. L’un des plus prompts à vanter les mérites de sa ville natale et de ses habitants était le jeune Sayyid Ahmad Khan :
« L’eau de Delhi est suave au goût, l’air excellent, et il n’y a pratiquement aucune maladie. Grâce à Dieu les habitants sont aussi aimables qu’avenants, et remarquablement séduisants dans leur jeunesse. Nul habitant d’une autre cité ne peut rivaliser avec eux. […] Les hommes de la ville, en particulier, s’intéressent à la science et cultivent les arts, passant leurs jours et leurs nuits à lire et à écrire. Si l’on détaillait chacun de leurs traits de caractère, on obtiendrait un traité des bonnes manières. »
(1) Shah Abdul Aziz considérait également que la charia autorisait les musulmans à travailler pour des chrétiens. En revanche, il doutait de l’intelligence des Britanniques et méprisait leur incapacité à saisir les subtilités de la théologie musulmane. Chaque race a ses propres aptitudes, écrivait-il : « Les hindous ont un don pour les mathématiques, les Francs pour l’industrie et la technologie. Mais, à quelques exceptions près, leur esprit ne peut comprendre les nuances les plus subtiles de la logique, de la théologie et de la philosophie. » Cité par Khalid Masud dans : The World of Shah Abdul Aziz, 1746-1824, p. 304, et repris par Jamal Malik dans : Perspectives of Mutual Encounters in South Asian History, 1760-1860 (Leiden, 2000). (pp. 64-65)
En partie à cause du manque de contacts réguliers avec les Européens, Delhi restait une ville pleine d’assurance, fière de sa splendeur et de son tahzib, cette urbanité faite d’un mélange de culture et de bonnes manières. Elle n’avait pas encore connu la crise de confiance qui survient inévitablement après l’instauration d’un colonialisme autoritaire et débridé. Au contraire, elle était encore à plus d’un titre une bulle de traditionalisme moghol dans une Inde où les changements s’accéléraient déjà. Lorsqu’un habitant de Shahjahanabad souhaitait chanter les louanges d’un autre, il puisait toujours dans la rhétorique de l’islam médiéval, émaillé de tropes séculaires : les femmes de Delhi étaient aussi élancées que des cyprès, les hommes aussi généraux que Faridun, aussi cultivés que Platon, aussi sages que Salomon, et leurs médecins aussi talentueux que Galien. L’un des plus prompts à vanter les mérites de sa ville natale et de ses habitants était le jeune Sayyid Ahmad Khan :
« L’eau de Delhi est suave au goût, l’air excellent, et il n’y a pratiquement aucune maladie. Grâce à Dieu les habitants sont aussi aimables qu’avenants, et remarquablement séduisants dans leur jeunesse. Nul habitant d’une autre cité ne peut rivaliser avec eux. […] Les hommes de la ville, en particulier, s’intéressent à la science et cultivent les arts, passant leurs jours et leurs nuits à lire et à écrire. Si l’on détaillait chacun de leurs traits de caractère, on obtiendrait un traité des bonnes manières. »
(1) Shah Abdul Aziz considérait également que la charia autorisait les musulmans à travailler pour des chrétiens. En revanche, il doutait de l’intelligence des Britanniques et méprisait leur incapacité à saisir les subtilités de la théologie musulmane. Chaque race a ses propres aptitudes, écrivait-il : « Les hindous ont un don pour les mathématiques, les Francs pour l’industrie et la technologie. Mais, à quelques exceptions près, leur esprit ne peut comprendre les nuances les plus subtiles de la logique, de la théologie et de la philosophie. » Cité par Khalid Masud dans : The World of Shah Abdul Aziz, 1746-1824, p. 304, et repris par Jamal Malik dans : Perspectives of Mutual Encounters in South Asian History, 1760-1860 (Leiden, 2000). (pp. 64-65)
Le prisonnier d’État auquel fait allusion Davies s’appelait officiellement Bahadur Shah II, également connu sous son nom de plume, Zafar, qui signifie Victoire. Zafar était le dernier empereur moghol, descendant direct de Gengis Khan et de Tamerlan, d’Akbar, de Jahangir et de Shah Jahan. Il naquit en 1775, à une époque où les Britanniques ne représentaient encore qu’une force relativement modeste (…) de son vivant, il vit sa dynastie réduite à une insignifiance humiliante tandis que les Britanniques, à l’origine simple courtiers vulnérables, se transformaient en une puissance militaire.
(…)
Calligraphe accompli, bon connaisseur du soufisme, grand protecteur des peintres de miniatures, créateur inspiré de jardins et passionné d’architecture, ce fut l’un des souverains les plus doués, les plus tolérants et les plus attachants de sa dynastie. C’était en outre un authentique poète mystique, qui écrivait non seulement en persan et en ourdou, mais aussi en braj basha et en penjabi, et dont le mécénat permit sans doute la plus grande renaissance littéraire de toute l’histoire de l’Inde moderne.
(…)
La grande capitale mogole, alors le théâtre d’une extraordinaire renaissance culturelle, fut transformée du jour au lendemain en champ de bataille.
(…)
Les survivants furent chassés de la ville et durent trouver refuge dans la campagne environnante. Delhi vidée de sa population n’était plus qu’un champ de ruines. Malgré la reddition sans résistance de la famille royale, les seize fils de l’empereur furent pour la plupart capturés, jugés et pendus, trois d’entre eux même abattus de sang-froid après avoir volontairement rendu les armes et reçu l’ordre de se dévêtir :
« En vingt-quatre heures j’éliminai les principaux membres de la dynastie de Tamerlan le Tartare, écrivit le lendemain le capitaine William Hodson à sa sœur. Je ne suis pas d’un naturel cruel, mais j’avoue avoir goûté l’occasion qui m’était donnée de débarrasser la terre de ces misérables. »
Même Zafar fut exhibé en public, montré « comme un fauve en cage » selon un officier britannique. (pp. 26-29)
(…)
Calligraphe accompli, bon connaisseur du soufisme, grand protecteur des peintres de miniatures, créateur inspiré de jardins et passionné d’architecture, ce fut l’un des souverains les plus doués, les plus tolérants et les plus attachants de sa dynastie. C’était en outre un authentique poète mystique, qui écrivait non seulement en persan et en ourdou, mais aussi en braj basha et en penjabi, et dont le mécénat permit sans doute la plus grande renaissance littéraire de toute l’histoire de l’Inde moderne.
(…)
La grande capitale mogole, alors le théâtre d’une extraordinaire renaissance culturelle, fut transformée du jour au lendemain en champ de bataille.
(…)
Les survivants furent chassés de la ville et durent trouver refuge dans la campagne environnante. Delhi vidée de sa population n’était plus qu’un champ de ruines. Malgré la reddition sans résistance de la famille royale, les seize fils de l’empereur furent pour la plupart capturés, jugés et pendus, trois d’entre eux même abattus de sang-froid après avoir volontairement rendu les armes et reçu l’ordre de se dévêtir :
« En vingt-quatre heures j’éliminai les principaux membres de la dynastie de Tamerlan le Tartare, écrivit le lendemain le capitaine William Hodson à sa sœur. Je ne suis pas d’un naturel cruel, mais j’avoue avoir goûté l’occasion qui m’était donnée de débarrasser la terre de ces misérables. »
Même Zafar fut exhibé en public, montré « comme un fauve en cage » selon un officier britannique. (pp. 26-29)
Par une soirée étouffante du milieu du mois de mai, un groupe d'officiers de la colonne mobile de Nicholson, assis dans la tente servant de mess, attendait le dîner, affamé. La nourriture aurait du être là une heure plus tôt, mais un messager envoyé à la tente des cuisines était revenu prévenir que le repas serait servi avec un peu de retard. Enfin apparut la haute silhouette de Nicholson, qui toussota pour obtenir le silence et présenta ses excuses :
Désolé de vous avoir infligé cette attente, messieurs, mais je viens de faire pendre vos cuisiniers.
Désolé de vous avoir infligé cette attente, messieurs, mais je viens de faire pendre vos cuisiniers.
Le collège uiniversitaire de Delhi, plutôt une medersa au départ qu'une université à l'occidentale, fut réformé par l'East India Company en 1828 demanière à offrir, en plus des études orientales, des cours de langue et de littérature anglaises. L'objectif était d''"éclairer" ceux que le nouvel conseil d'administration du collège voyait comme les "habitants ignares et semi-barbares de l'Inde."
Cette initiative était due à Charles Trevelyan, beau-frère et disciple de Thomas Babingdon Macaulay, celui-là même qui s'était illustré en affirmant qu'"une étagère d'une bonne bibliothèque européenne valait à elle seule toute la littérature indigène de l'Inde et de l'Arabie."
Cette initiative était due à Charles Trevelyan, beau-frère et disciple de Thomas Babingdon Macaulay, celui-là même qui s'était illustré en affirmant qu'"une étagère d'une bonne bibliothèque européenne valait à elle seule toute la littérature indigène de l'Inde et de l'Arabie."
Sous le règne de Zafar, le journal de la cour mentionnait des visites quasi hebdomadaires aux vieux sanctuaires soufis (…) d’ailleurs, Zafar lui-même était considéré comme un pir (maître) soufi, et acceptait régulièrement de prendre des élèves, ou murids. Le très loyal Dihli Urdu Akhbar allait jusqu’à voir en lui « l’un des plus grands saints de l’époque, reconnu par la cour divine ». Zafar s’habillait en conséquence, et dans sa jeunesse, avant son accession au trône, il mettait même un point d’honneur à vivre comme un pauvre derviche doublé d’un érudit, formant un contraste saisissant avec ses trois jeunes frères, Mirza Jahangir, Salim et Babur, notoirement plus élégants : « C’était un homme grand et maigre, simplement vêtu, presque misérablement », nota le major Archer en 1828, alors que Zafar, âgé de cinquante-trois ans, devrait attendre encore une décennie avant de monter sur le trône. (p. 116)
Le portrait de Zafar donne l’image d’un vieillard digne et réservé, plutôt bel homme avec son nez aquilin et sa barbe soigneusement taillée. Malgré sa haute stature et sa carrure imposante, douceur et bienveillance se lisent dans ses grands yeux bruns aux longs cils. Adolescent, Zafar apparaissait sur ses portraits comme un prince un peu gauche à la barbe duveteuse, visiblement mal à l’aise dans son corps massif. Avec la maturité ses traits s’étaient affirmés, et la vieillesse venue il avait contre toute attente gagné en beauté. Âgé à présent d’environ soixante-quinze ans, il avait le teint plus cireux, le nez plus arqué, un pot de tête plus impérial. Pourtant, alors que le vieux monarque agenouillé égrène son chapelet d’un geste las, l’expression de son regard sombre garde quelque chose d’indéniablement mélancolique : dans le pli de ses lèvres charnues on retrouve la tristesse et la résignation perceptibles dans les premiers portraits. (p. 59)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de William Dalrymple (12)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3191 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3191 lecteurs ont répondu