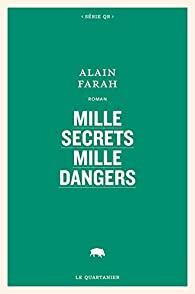>
Critique de Thaddeus
Le début du texte dépeint la jeunesse de Shafik Elias, père d'Alain Farah, d'origine libanaise qui a grandi en Égypte avant d'immigrer à Montréal. Dans les années 1960, l'Égypte est particulièrement houleuse - les guerres et les régimes politique se succèdent. On sent une attention aux détails, une volonté de réalisme dans la description historique. Avec la mise en place des nombreux convives invités au mariage, je voyais là une annonce d'une grande fresque familiale à travers l'histoire. Détrompez-vous, nous avons plutôt droit à un autoportrait d'Alain Farah, un ego portrait chamarré, par-ci par-là, de quelques membres importants dans la vie de l'auteur.
Malgré les belles pages, malgré un talent indéniable de l'auteur, les défauts du « roman » sont nombreux. En fait, on n'a pas l'impression de faire affaire ici à un romancier. Je m'explique. le vrai romancier perd indubitablement le contrôle de son oeuvre parce qu'il est la victime, autant que l'auteur de son roman. le (bon) roman dévie de la vision de son auteur, il va ailleurs, il devient indépendant. Dans « Mille secrets mille dangers », on ne ressent (entendez subit) que trop bien l'autorité, le contrôle d'A. Farah. Notez qu'il n'y a pas de digressions, pas de débordements. Il n'a tout simplement aucune idée vraiment intéressante. L'auto dérision est minimale. L'auteur est bien trop scrupuleux pour laisser une zone d'ombre s'immiscer dans son oeuvre. Par exemple : le discours islamophobe du dentiste Wali (p. 298) est tout de suite discrédité par le narrateur (p. 301), comme pour s'assurer que l'on comprenne qu'il est absolument en désaccord avec ces propos. Bref, c'est un faux dialogue. Il ne veut que se conforter dans ses propres opinions.
L'autorité de l'auteur se fait surtout sentir dans sa volonté de se mettre de l'avant : « Alain, lui, adorait se mettre en scène...» (p. 340) Cette mise en scène se trouve même dans les pages les plus chargées d'émotions. Myriam E., dédicataire du roman rappelons-le, et dont l'histoire de l'amitié avec Virginie est relatée dans chapitre VII, est victime d'un cancer fulgurant. Dans le dernier chapitre, A. Farah revient sur le déroulement de la maladie et les funérailles de celle qui était la grande amie du couple. C'est triste et émouvant, comme l'est toujours la mort d'un être cher, d'une personne dans la fleur de l'âge, qui, de plus, laisse derrière elle une fillette de quatre ans. Dans ces situations, l'incompréhension et la colère abolissent toute raison. Ce sont donc des pages très personnelles qu'écrit A. Farah. Mais il va trop loin dans le narcissisme. Il décrit SES affres et SES souffrances (pp. 480 à 484). On comprend qu'il se libère grâce à l'écriture. Il le dit lui-même : « Ce travail de tant d'années, ce travail d'écriture et de lecture de moi-même par la parole m'aidera à comprendre comment, prisonnier de la colère, de la honte et du déni, j'ai construit un récit où me cacher, où me mettre à l'abri de la vérité. » (p. 484) le livre entier est en quelque sorte une thérapie pour son auteur. Quelle passion vulgaire que celle de soi-même !
Ceci n'est pas un roman, mais plutôt un récit romancé, une suite de souvenirs entremêlée, à l'occasion, de quelques beaux portraits et de mots judicieux. Pour ainsi dire, l'auteur ne fait que dérouler la bobine de sa vie. le Québec produit beaucoup (trop) de ces « romans » à intrigue minimale qui sont comme des journaux personnels saturés d'égotisme superficiel, des thérapies censées apporter un repos à l'âme éprouvée de l'auteur, et des récits intimes où tout ce qui compte c'est le « JE ». La situation d'A. Farah est peut-être particulière en ce qui concerne sa maladie auto-immune, pourtant elle ne méritait pas autant de place. Franchement, le culte du moi, c'est ennuyeux pour le lecteur. Gilles Marcotte avait raison de dire que « l'empyrée de la médiocrité larmoyante, au Québec, est décidément surpeuplé. »
Personnellement, je n'en revient tout simplement pas. Comment quelqu'un qui étudie la littérature depuis tant d'années, qui, de surcroit, l'enseigne, (professeur agrégé de l'université Mc Gill !) peut-il produire ce genre de texte? Je comprends que l'inspiration d'Alain Farah est l'Ulysse de James Joyce, mais encore faut-il en avoir le génie. le lecteur est emporté, ad nauseam, comme un bout de bois dans un flot déchaîné de banalités. C'est en lisant des ouvrages comme celui-ci que l'on repense avec plaisir aux romanciers qui, comme Balzac, Stendhal, Dostoïevski, Faulkner, Kafka, Rushdie, Grass, Garcia Marquez et bien d'autres, créent des mondes plus grands que nature, des personnages complexes, voire contradictoires, qui ficellent des intrigues riches et abordent des questions qui dépassent les petites avanies de la vie quotidienne. À la critique littéraire du Québec qui a encensé presque unanimement ce texte, je dis : il y a plus que l'autofiction !
Malgré les belles pages, malgré un talent indéniable de l'auteur, les défauts du « roman » sont nombreux. En fait, on n'a pas l'impression de faire affaire ici à un romancier. Je m'explique. le vrai romancier perd indubitablement le contrôle de son oeuvre parce qu'il est la victime, autant que l'auteur de son roman. le (bon) roman dévie de la vision de son auteur, il va ailleurs, il devient indépendant. Dans « Mille secrets mille dangers », on ne ressent (entendez subit) que trop bien l'autorité, le contrôle d'A. Farah. Notez qu'il n'y a pas de digressions, pas de débordements. Il n'a tout simplement aucune idée vraiment intéressante. L'auto dérision est minimale. L'auteur est bien trop scrupuleux pour laisser une zone d'ombre s'immiscer dans son oeuvre. Par exemple : le discours islamophobe du dentiste Wali (p. 298) est tout de suite discrédité par le narrateur (p. 301), comme pour s'assurer que l'on comprenne qu'il est absolument en désaccord avec ces propos. Bref, c'est un faux dialogue. Il ne veut que se conforter dans ses propres opinions.
L'autorité de l'auteur se fait surtout sentir dans sa volonté de se mettre de l'avant : « Alain, lui, adorait se mettre en scène...» (p. 340) Cette mise en scène se trouve même dans les pages les plus chargées d'émotions. Myriam E., dédicataire du roman rappelons-le, et dont l'histoire de l'amitié avec Virginie est relatée dans chapitre VII, est victime d'un cancer fulgurant. Dans le dernier chapitre, A. Farah revient sur le déroulement de la maladie et les funérailles de celle qui était la grande amie du couple. C'est triste et émouvant, comme l'est toujours la mort d'un être cher, d'une personne dans la fleur de l'âge, qui, de plus, laisse derrière elle une fillette de quatre ans. Dans ces situations, l'incompréhension et la colère abolissent toute raison. Ce sont donc des pages très personnelles qu'écrit A. Farah. Mais il va trop loin dans le narcissisme. Il décrit SES affres et SES souffrances (pp. 480 à 484). On comprend qu'il se libère grâce à l'écriture. Il le dit lui-même : « Ce travail de tant d'années, ce travail d'écriture et de lecture de moi-même par la parole m'aidera à comprendre comment, prisonnier de la colère, de la honte et du déni, j'ai construit un récit où me cacher, où me mettre à l'abri de la vérité. » (p. 484) le livre entier est en quelque sorte une thérapie pour son auteur. Quelle passion vulgaire que celle de soi-même !
Ceci n'est pas un roman, mais plutôt un récit romancé, une suite de souvenirs entremêlée, à l'occasion, de quelques beaux portraits et de mots judicieux. Pour ainsi dire, l'auteur ne fait que dérouler la bobine de sa vie. le Québec produit beaucoup (trop) de ces « romans » à intrigue minimale qui sont comme des journaux personnels saturés d'égotisme superficiel, des thérapies censées apporter un repos à l'âme éprouvée de l'auteur, et des récits intimes où tout ce qui compte c'est le « JE ». La situation d'A. Farah est peut-être particulière en ce qui concerne sa maladie auto-immune, pourtant elle ne méritait pas autant de place. Franchement, le culte du moi, c'est ennuyeux pour le lecteur. Gilles Marcotte avait raison de dire que « l'empyrée de la médiocrité larmoyante, au Québec, est décidément surpeuplé. »
Personnellement, je n'en revient tout simplement pas. Comment quelqu'un qui étudie la littérature depuis tant d'années, qui, de surcroit, l'enseigne, (professeur agrégé de l'université Mc Gill !) peut-il produire ce genre de texte? Je comprends que l'inspiration d'Alain Farah est l'Ulysse de James Joyce, mais encore faut-il en avoir le génie. le lecteur est emporté, ad nauseam, comme un bout de bois dans un flot déchaîné de banalités. C'est en lisant des ouvrages comme celui-ci que l'on repense avec plaisir aux romanciers qui, comme Balzac, Stendhal, Dostoïevski, Faulkner, Kafka, Rushdie, Grass, Garcia Marquez et bien d'autres, créent des mondes plus grands que nature, des personnages complexes, voire contradictoires, qui ficellent des intrigues riches et abordent des questions qui dépassent les petites avanies de la vie quotidienne. À la critique littéraire du Québec qui a encensé presque unanimement ce texte, je dis : il y a plus que l'autofiction !