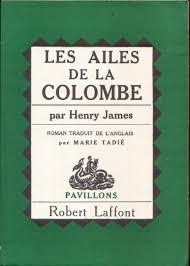>
Critique de Creisifiction
Dans mon expérience de lecteur, la célèbre expression «tradutore, traditore!» («traducteur, traitre !») – elle-même par ailleurs intraduisible, en tout cas pour ce qui relève de sa saveur particulière due à une paronomase impossible en dehors de la langue de Dante - ne s'était jamais vu illustrée avec autant d'acuité (et peut-être aussi, de raffinement…) qu'à l'occasion de cette lecture de LES AILES DE LA COLOMBE, un des trois grands romans (avec « Les Ambassadeurs » et « La Coupe d'Or ») où le génie littéraire de Henry James semble avoir été au faîte de son art.
Fasciné par le style pointu de ce roman issu de la pleine maturité de la plume de l'auteur, quoique très intrigué d'entrée de jeu, pour ne pas dire déstabilisé par ses incroyables contorsions syntaxiques, parfois à la limite d'un agacement provoqué par le désagrément de relire trois fois un même paragraphe pour, en fin de compte, constater ne pas en avoir compris grand-chose des tenants et aboutissants… je finirais par me poser de très sérieuses questions concernant la traduction de Marie Tadié, parue en 1952 (Robert Laffont) par laquelle j'avais commencé la lecture du roman.
Disposé enfin, après avoir conscieusement parcouru une centaine de pages, à me lancer dans une enquête de fond, et m'ayant à cette fin procuré une traduction plus récente du roman par Jean Pavans (2020 – le Bruit du Temps), je poursuivrais donc ma lecture en compagnie des mes deux principaux suspects de haute trahison littéraire... Tout au moins, espérais-je pouvoir ainsi désigner, en toute impartialité, le responsable de mes déboires personnels et de cet autre délit, tout aussi impardonnable à mes yeux, de «lèse-chef-d ‘oeuvre» envers ma sensibilité de lecteur (car malgré les écueils rencontrés jusque-lors, et mon découragement croissant, mon intuition m'en faisait subodorer un, bien à mon goût…). Seule solution envisageable, puisque en raison de mes insuffisances en matière de langue anglaise, je me trouvais, hélas, dans l'impossibilité de procéder directement à une autopsie du texte original !
Quel verdict au terme de cette lecture comparative? Difficile à résumer… ou même à le prononcer d'une manière inéquivoque. Je n'ai cessé de naviguer entre une version et une autre, j'ai relu de nombreux paragraphes chez l'une et chez l'autre, puis chez l'autre et chez l'une, surtout lorsque j'avais l'impression que quelque chose d'important m'échappait. A titre d'illustration, juste pour donner une idée du type de questions que je me suis posé (mais sans vouloir néanmoins ouvrir un débat qui outrepasserait le cadre de ce billet, et pour lequel, d'ailleurs, je ne possède pas toutes les compétences requises), lors d'un passage où James évoque encore une fois ce qui semble constituer un des leitmotivs majeurs de son roman, à savoir, «que veut-on les uns des autres ?»– se traduisant en l'occurrence par cette question «Qu'offrez-vous donc, qu'offrez-vous donc ?» qu'un des personnages, au cours d'un dîner au sein de la très bonne société anglaise, entend comme bourdonner ironiquement, dans la salle, à son intention- Jean Pavans transcrit ainsi la phrase qui suit juste ce propos : «L'ironie consistait en des allusions répétées à des tractations manifestes (…)», alors que Marie Tadié, elle, inscrit : « L'ironie consistait dans l'allusion renouvelée à des banaux appâts (…)» ? Certes, l'on peut dire qu'après tout, dans le contexte général, ce n'est ni tout à fait incompatible, ni crucial, mais enfin, «tractation » n'est pas exactement un synonyme d' «appât», ni «manifeste» de «banal» (?) Quels ont été les mots employés au démarrage par Henry James ? Aussi, se serait-il servi d'une tournure suffisamment ambiguë pouvant donner lieu à des interprétations à ce point divergentes chez ses potentiels lecteurs et traducteurs ? Je ne saurais le dire...Je me permettrai toutefois d'avancer que la traduction de Marie Tadié m'a paru beaucoup plus soucieuse d'expliquer et d'«interpréter», motivée moins par la beauté de la langue, que par l'idée de simplifier la syntaxe de James, avec, il faut le dire, plus ou moins de réussite selon les passages- et ce jusqu'à donner parfois l'impression de s'emmêler complètement les pieds dans le tapis et de devenir malgré tout franchement brouillonne. M. Pavans, qui affirme en revanche avoir voulu avant tout respecter l'intégrité de la pensée méandreuse et le souffle particulier du phrasé jamesien, nous livre une version (toujours par comparaison à celle de sa consoeur), qui, tout en étant de mon point de vue plus soutenue et élégante, donne a contrario, peut-être justement par son souci exagéré de fidélité à l'original, l'impression de devenir à certains passages trop appuyée, à la limite du «maniéré», résultant en tournures artificielles ou un peu bizarres en français… Enfin, en ce qui me concerne, je préfère nettement la traduction de ce dernier, que je choisirai, dans la mesure du possible, lors de mes futures lectures de Henry James (Jean Pavans s'étant lancé depuis quelques années en une vaste entreprise de retraduction de l'oeuvre de Henry James, ses versions de l'ensemble des Nouvelles et de quelques-uns des plus grands romans de l'auteur sont disponibles à ce jour).
Cela étant, rien n'a l'air simple à un tel niveau artistique, en de tels sommets si rarement égalés par le roman réaliste et psychologique (Virginia Woolf et Marcel Proust surtout, ont souvent été rapprochés, à juste titre, de Henry James) : art consommé de la nuance psychologique, poussée ici à son paroxysme dans l'analyse de la subjectivité des personnages, art du maintien quasiment en apesanteur d'une intrigue pourtant à l'apparence assez simple, réaliste et classique. Cette suspension s'exerçant non seulement sur la temporalité de la narration, mais surtout, chez Henry James, au niveau du jugement, que ce soit celui des personnages vis-à-vis de la motivation profonde de leurs actes, de leurs pensées et sentiments envers les autres, ou bien encore celui du lecteur lui-même, dont le discernement ne cesse d'être mis en doute quant à sa capacité d'appréhender les ressorts intimes des personnages au fur et à mesure que le récit se déploie. Habité comme eux par une sorte de perplexité sous-jacente au caractère changeant, fugace, incongru, contradictoire de leurs actes et pensées, confronté comme eux à ces mobiles «infiniment subtiles et inévitablement dérisoires» de la vie psychique servant de matière première à Henry James pour la construction de son roman, le lecteur se demande souvent s'il a vraiment bien compris ce qu'il croit avoir compris.
Au regard de l'éphémère qui semble marquer tout essai d'arrêt sur images sur le terrain en glissement perpétuel de notre subjectivité, Les Ailes de la Colombe puise ainsi une grande partie de son charme justement dans l'exploration de ces territoires psychiques provisoires, bercés de ces «douces illusions générales et délibérées d'où toute spécification serait chassée comme une bête sauvage». Malgré les motivations au départ clairement affichées par les protagonistes du roman, le lecteur se rend compte qu'il ignore de plus en plus vers quelle direction exactement les choses vont s'orienter ; lui aussi, à l'instar des premiers, se verra avancer en terra incognita, avec un vague sentiment de déambuler au bord de ces gouffres psychiques crées par le fait qu'on ne sait jamais «ce que [l'autre] pense vraiment de de ce que [moi] peut lui donner à penser». le discernement se voit ainsi régulièrement congédié, ou en tout cas, aura de plus en plus de difficultés à désigner de manière unilatérale, parmi les acteurs d'une histoire où pourtant l'hypocrisie sociale, la convoitise et les rapports de domination sont très prégnants et apparemment identifiables, quels seraient en défintive les «bons» et les «méchants», les «sincères» et les «manipulateurs» , les «faibles» ou les «forts», les «innocents» ou les «coupables»…
La pensée insiste toujours, pourtant, à vouloir restituer les choses en «des termes simples, sous prétexte de commodité de compréhension». Et à Henry James de nous faire alors brillamment, tout au long de cette histoire, en déconstruisant subtilement et patiemment les «tractations manifestes» et les convictions intimes des uns et des autres, la démonstration imparable de cette tension insupportable créée par la suspension du jugement, nous conduisant dans le meilleur des cas, à force de maladresses répétées et de compromissions malavisées, à accepter qu'on ne peut pas avoir tout le temps les bons rôles, que ceux-ci sont voués à être interchangeables et, surtout, à admettre, in fine et résignés, que «les relations personnelles reposent sur un leurre partagé».
Milly, personnage central du roman (inspiré de la cousine bien-aimée de l'auteur, Minny Temple, morte prématurément de la tuberculose), est cette colombe du titre, à la fois celle «qu'on essaie de retenir entre ses mains et la princesse avec qui il fallait observer les formes». Jeune américaine fortunée voyageant en Europe, et selon les mots de son auteur lors d'une préface à une édition du roman datant de 1909, «désirant passionnément éprouver avant sa disparition autant de fines vibrations que possible», Milly est condamnée par une maladie autour de laquelle se tramera une véritable «conspiration du silence». Qu'a-t-elle à offrir, cette colombe fragile, à la société qui l'accueille bras ouverts ? Déjouant tous les pièges qui lui seront tendus afin de l'apprivoiser, elle finira par déployer ses ailes en une apothéose inoubliable, magnifiée par la beauté mélancolique des décors vénitiens et par la puissance romantique de son majestueux envol.
Si LES AILES DE LA COLOMBE est par principe une lecture «d'une autre époque» et située dans un contexte très particulier - par ailleurs récurrent chez l'auteur : des riches héritiers américains en voyage, souvent des femmes, confrontés aux valeurs déclinantes de la vielle société aristocratique européenne-, il ne s'agit absolument pas d'un roman «daté» ou «suranné», comme l'on pourrait juger trop rapidement ou superficiellement. En revanche, il s'agit bien d'un roman exigeant, demandant à s'investir dans une temporalité particulière de lecture, à laquelle, il est vrai, nous ne sommes plus habitués, à nous aligner sur son rythme propre de construction méticuleusement ouvragée, nécessitant, entre autres, qu'on accepte de relire, parfois à plusieurs reprises, certains passages, certains paragraphes (et ce probablement aussi dans sa version anglaise, d'origine…mais ceci, bien sûr, je ne peux que le supposer !). Un roman enfin qu'on ne pourrait en aucun cas «dévorer», comme il arrive assez souvent avec les fictions actuelles ; qu'on devrait surtout pouvoir apprécier lentement, comme un plat rare et exquis, aux saveurs multiples s'ouvrant délicatement. Si l'on y parvient, quel délectation nous réservera-t-il alors, par sa finesse d'analyse, par son intelligence, par sa puissance émotionnelle et, à la toute fin de son parcours, par un dénouement magistralement orchestré! Tout simplement sublime.
Fasciné par le style pointu de ce roman issu de la pleine maturité de la plume de l'auteur, quoique très intrigué d'entrée de jeu, pour ne pas dire déstabilisé par ses incroyables contorsions syntaxiques, parfois à la limite d'un agacement provoqué par le désagrément de relire trois fois un même paragraphe pour, en fin de compte, constater ne pas en avoir compris grand-chose des tenants et aboutissants… je finirais par me poser de très sérieuses questions concernant la traduction de Marie Tadié, parue en 1952 (Robert Laffont) par laquelle j'avais commencé la lecture du roman.
Disposé enfin, après avoir conscieusement parcouru une centaine de pages, à me lancer dans une enquête de fond, et m'ayant à cette fin procuré une traduction plus récente du roman par Jean Pavans (2020 – le Bruit du Temps), je poursuivrais donc ma lecture en compagnie des mes deux principaux suspects de haute trahison littéraire... Tout au moins, espérais-je pouvoir ainsi désigner, en toute impartialité, le responsable de mes déboires personnels et de cet autre délit, tout aussi impardonnable à mes yeux, de «lèse-chef-d ‘oeuvre» envers ma sensibilité de lecteur (car malgré les écueils rencontrés jusque-lors, et mon découragement croissant, mon intuition m'en faisait subodorer un, bien à mon goût…). Seule solution envisageable, puisque en raison de mes insuffisances en matière de langue anglaise, je me trouvais, hélas, dans l'impossibilité de procéder directement à une autopsie du texte original !
Quel verdict au terme de cette lecture comparative? Difficile à résumer… ou même à le prononcer d'une manière inéquivoque. Je n'ai cessé de naviguer entre une version et une autre, j'ai relu de nombreux paragraphes chez l'une et chez l'autre, puis chez l'autre et chez l'une, surtout lorsque j'avais l'impression que quelque chose d'important m'échappait. A titre d'illustration, juste pour donner une idée du type de questions que je me suis posé (mais sans vouloir néanmoins ouvrir un débat qui outrepasserait le cadre de ce billet, et pour lequel, d'ailleurs, je ne possède pas toutes les compétences requises), lors d'un passage où James évoque encore une fois ce qui semble constituer un des leitmotivs majeurs de son roman, à savoir, «que veut-on les uns des autres ?»– se traduisant en l'occurrence par cette question «Qu'offrez-vous donc, qu'offrez-vous donc ?» qu'un des personnages, au cours d'un dîner au sein de la très bonne société anglaise, entend comme bourdonner ironiquement, dans la salle, à son intention- Jean Pavans transcrit ainsi la phrase qui suit juste ce propos : «L'ironie consistait en des allusions répétées à des tractations manifestes (…)», alors que Marie Tadié, elle, inscrit : « L'ironie consistait dans l'allusion renouvelée à des banaux appâts (…)» ? Certes, l'on peut dire qu'après tout, dans le contexte général, ce n'est ni tout à fait incompatible, ni crucial, mais enfin, «tractation » n'est pas exactement un synonyme d' «appât», ni «manifeste» de «banal» (?) Quels ont été les mots employés au démarrage par Henry James ? Aussi, se serait-il servi d'une tournure suffisamment ambiguë pouvant donner lieu à des interprétations à ce point divergentes chez ses potentiels lecteurs et traducteurs ? Je ne saurais le dire...Je me permettrai toutefois d'avancer que la traduction de Marie Tadié m'a paru beaucoup plus soucieuse d'expliquer et d'«interpréter», motivée moins par la beauté de la langue, que par l'idée de simplifier la syntaxe de James, avec, il faut le dire, plus ou moins de réussite selon les passages- et ce jusqu'à donner parfois l'impression de s'emmêler complètement les pieds dans le tapis et de devenir malgré tout franchement brouillonne. M. Pavans, qui affirme en revanche avoir voulu avant tout respecter l'intégrité de la pensée méandreuse et le souffle particulier du phrasé jamesien, nous livre une version (toujours par comparaison à celle de sa consoeur), qui, tout en étant de mon point de vue plus soutenue et élégante, donne a contrario, peut-être justement par son souci exagéré de fidélité à l'original, l'impression de devenir à certains passages trop appuyée, à la limite du «maniéré», résultant en tournures artificielles ou un peu bizarres en français… Enfin, en ce qui me concerne, je préfère nettement la traduction de ce dernier, que je choisirai, dans la mesure du possible, lors de mes futures lectures de Henry James (Jean Pavans s'étant lancé depuis quelques années en une vaste entreprise de retraduction de l'oeuvre de Henry James, ses versions de l'ensemble des Nouvelles et de quelques-uns des plus grands romans de l'auteur sont disponibles à ce jour).
Cela étant, rien n'a l'air simple à un tel niveau artistique, en de tels sommets si rarement égalés par le roman réaliste et psychologique (Virginia Woolf et Marcel Proust surtout, ont souvent été rapprochés, à juste titre, de Henry James) : art consommé de la nuance psychologique, poussée ici à son paroxysme dans l'analyse de la subjectivité des personnages, art du maintien quasiment en apesanteur d'une intrigue pourtant à l'apparence assez simple, réaliste et classique. Cette suspension s'exerçant non seulement sur la temporalité de la narration, mais surtout, chez Henry James, au niveau du jugement, que ce soit celui des personnages vis-à-vis de la motivation profonde de leurs actes, de leurs pensées et sentiments envers les autres, ou bien encore celui du lecteur lui-même, dont le discernement ne cesse d'être mis en doute quant à sa capacité d'appréhender les ressorts intimes des personnages au fur et à mesure que le récit se déploie. Habité comme eux par une sorte de perplexité sous-jacente au caractère changeant, fugace, incongru, contradictoire de leurs actes et pensées, confronté comme eux à ces mobiles «infiniment subtiles et inévitablement dérisoires» de la vie psychique servant de matière première à Henry James pour la construction de son roman, le lecteur se demande souvent s'il a vraiment bien compris ce qu'il croit avoir compris.
Au regard de l'éphémère qui semble marquer tout essai d'arrêt sur images sur le terrain en glissement perpétuel de notre subjectivité, Les Ailes de la Colombe puise ainsi une grande partie de son charme justement dans l'exploration de ces territoires psychiques provisoires, bercés de ces «douces illusions générales et délibérées d'où toute spécification serait chassée comme une bête sauvage». Malgré les motivations au départ clairement affichées par les protagonistes du roman, le lecteur se rend compte qu'il ignore de plus en plus vers quelle direction exactement les choses vont s'orienter ; lui aussi, à l'instar des premiers, se verra avancer en terra incognita, avec un vague sentiment de déambuler au bord de ces gouffres psychiques crées par le fait qu'on ne sait jamais «ce que [l'autre] pense vraiment de de ce que [moi] peut lui donner à penser». le discernement se voit ainsi régulièrement congédié, ou en tout cas, aura de plus en plus de difficultés à désigner de manière unilatérale, parmi les acteurs d'une histoire où pourtant l'hypocrisie sociale, la convoitise et les rapports de domination sont très prégnants et apparemment identifiables, quels seraient en défintive les «bons» et les «méchants», les «sincères» et les «manipulateurs» , les «faibles» ou les «forts», les «innocents» ou les «coupables»…
La pensée insiste toujours, pourtant, à vouloir restituer les choses en «des termes simples, sous prétexte de commodité de compréhension». Et à Henry James de nous faire alors brillamment, tout au long de cette histoire, en déconstruisant subtilement et patiemment les «tractations manifestes» et les convictions intimes des uns et des autres, la démonstration imparable de cette tension insupportable créée par la suspension du jugement, nous conduisant dans le meilleur des cas, à force de maladresses répétées et de compromissions malavisées, à accepter qu'on ne peut pas avoir tout le temps les bons rôles, que ceux-ci sont voués à être interchangeables et, surtout, à admettre, in fine et résignés, que «les relations personnelles reposent sur un leurre partagé».
Milly, personnage central du roman (inspiré de la cousine bien-aimée de l'auteur, Minny Temple, morte prématurément de la tuberculose), est cette colombe du titre, à la fois celle «qu'on essaie de retenir entre ses mains et la princesse avec qui il fallait observer les formes». Jeune américaine fortunée voyageant en Europe, et selon les mots de son auteur lors d'une préface à une édition du roman datant de 1909, «désirant passionnément éprouver avant sa disparition autant de fines vibrations que possible», Milly est condamnée par une maladie autour de laquelle se tramera une véritable «conspiration du silence». Qu'a-t-elle à offrir, cette colombe fragile, à la société qui l'accueille bras ouverts ? Déjouant tous les pièges qui lui seront tendus afin de l'apprivoiser, elle finira par déployer ses ailes en une apothéose inoubliable, magnifiée par la beauté mélancolique des décors vénitiens et par la puissance romantique de son majestueux envol.
Si LES AILES DE LA COLOMBE est par principe une lecture «d'une autre époque» et située dans un contexte très particulier - par ailleurs récurrent chez l'auteur : des riches héritiers américains en voyage, souvent des femmes, confrontés aux valeurs déclinantes de la vielle société aristocratique européenne-, il ne s'agit absolument pas d'un roman «daté» ou «suranné», comme l'on pourrait juger trop rapidement ou superficiellement. En revanche, il s'agit bien d'un roman exigeant, demandant à s'investir dans une temporalité particulière de lecture, à laquelle, il est vrai, nous ne sommes plus habitués, à nous aligner sur son rythme propre de construction méticuleusement ouvragée, nécessitant, entre autres, qu'on accepte de relire, parfois à plusieurs reprises, certains passages, certains paragraphes (et ce probablement aussi dans sa version anglaise, d'origine…mais ceci, bien sûr, je ne peux que le supposer !). Un roman enfin qu'on ne pourrait en aucun cas «dévorer», comme il arrive assez souvent avec les fictions actuelles ; qu'on devrait surtout pouvoir apprécier lentement, comme un plat rare et exquis, aux saveurs multiples s'ouvrant délicatement. Si l'on y parvient, quel délectation nous réservera-t-il alors, par sa finesse d'analyse, par son intelligence, par sa puissance émotionnelle et, à la toute fin de son parcours, par un dénouement magistralement orchestré! Tout simplement sublime.