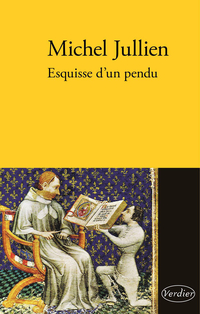Michel Jullien nous décrit par le menu la fin d'un règne, celui de Charles V, et celui des copistes, nommés aussi «écrivains», de manuscrits sur parchemin. Il le fait à travers le quotidien de Raoulet d'Orléans l'un des copistes attitrés de Charles V.
Lassé de se voir proposer des bibles, Raoulet est convoqué pour une nouvelle commande, dans la tour où le roi a établi sa «librairie» (bibliothèque) et conserve ses précieux manuscrits enluminés. Ce sera à la retranscription des chroniques royales qu'il va devoir désormais s'atteler.
Et ce ne sont pas les livres seuls qui sont enluminées mais aussi les figures, il faudrait dire les tronches ou les trognes que nous décrit avec une verve parfois rabelaisienne Michel Jullien, dans la relation de la vie de Raoulet , de sa femme Maroise, de Oudette l'unique servante qui nourrit tout le petit monde des employés de l'atelier sis à Paris dans la rue Boutebrie.
«Maroise faisait les encres. Les noix de galle les plus fripées sont les meilleures, un apothicaire de l'île les lui choisissait, écartant les vesses-de-loup lisses, les bulbes fermes, lui réservant les avachies, sporulantes.» p 65
Dans une prose truculente, l'écrivain manipule la langue en démiurge. En utilisant des mots rares, goûteux, «des dégelées de verbes» qu'on a plaisir à savourer il sait donner à son récit puissance évocatrice et précision. Quelques métaphores surprenantes surgissent qui viennent nous relier au temps présent : nous décrivant Raoulet, «ses oreilles disquées, cernées du bel ourlet de leur circuit» l'auteur ajoute «Mais on ne les voyait pas, perdues sous ... son encoiffade exceptionnelle, fortement tignassée, à l'orange luminescent, d'un feu, d'un roux équivalent à ce que sont de nos jours les clignotants d'automobile.» P45 46
L'auteur nous rend palpable tout un monde disparu où la fabrication du livre et la vie de ceux qui participaient à son écriture et sa mise en forme se mêlaient pour ne faire qu'un, dans un mélange charnel d'odeurs fortes, de sons, un lien physique profond, direct qui va s'éteindre progressivement avec Gutenberg et disparaître complètement de nos jours.
Toute la vie grouillante du quartier où habite Raoulet d'Orléans participe aussi de son travail sans oublier l'ombre de Villon quand apparaît «la Machine» le gibet de Monfaucon qui occupe le premier chapitre (peut-être un peu long), et la fin de ce livre qui sort de l'ordinaire.
Toute avancée technique n'a pas que du mauvais : quelques manuscrits copiés par Raoulet d'Orléans, réservés à l'entourage royal, sont désormais accessibles dans leur intégralité et téléchargeables sur le site Gallica de la Bnf. S'interrompre dans la lecture «d'Esquisse d'un pendu» pour aller les feuilleter et mieux comprendre le travail de cet homme et des aides de son atelier est vraiment un superbe complément apporté à cette lecture en elle-même déjà passionnante.
Lassé de se voir proposer des bibles, Raoulet est convoqué pour une nouvelle commande, dans la tour où le roi a établi sa «librairie» (bibliothèque) et conserve ses précieux manuscrits enluminés. Ce sera à la retranscription des chroniques royales qu'il va devoir désormais s'atteler.
Et ce ne sont pas les livres seuls qui sont enluminées mais aussi les figures, il faudrait dire les tronches ou les trognes que nous décrit avec une verve parfois rabelaisienne Michel Jullien, dans la relation de la vie de Raoulet , de sa femme Maroise, de Oudette l'unique servante qui nourrit tout le petit monde des employés de l'atelier sis à Paris dans la rue Boutebrie.
«Maroise faisait les encres. Les noix de galle les plus fripées sont les meilleures, un apothicaire de l'île les lui choisissait, écartant les vesses-de-loup lisses, les bulbes fermes, lui réservant les avachies, sporulantes.» p 65
Dans une prose truculente, l'écrivain manipule la langue en démiurge. En utilisant des mots rares, goûteux, «des dégelées de verbes» qu'on a plaisir à savourer il sait donner à son récit puissance évocatrice et précision. Quelques métaphores surprenantes surgissent qui viennent nous relier au temps présent : nous décrivant Raoulet, «ses oreilles disquées, cernées du bel ourlet de leur circuit» l'auteur ajoute «Mais on ne les voyait pas, perdues sous ... son encoiffade exceptionnelle, fortement tignassée, à l'orange luminescent, d'un feu, d'un roux équivalent à ce que sont de nos jours les clignotants d'automobile.» P45 46
L'auteur nous rend palpable tout un monde disparu où la fabrication du livre et la vie de ceux qui participaient à son écriture et sa mise en forme se mêlaient pour ne faire qu'un, dans un mélange charnel d'odeurs fortes, de sons, un lien physique profond, direct qui va s'éteindre progressivement avec Gutenberg et disparaître complètement de nos jours.
Toute la vie grouillante du quartier où habite Raoulet d'Orléans participe aussi de son travail sans oublier l'ombre de Villon quand apparaît «la Machine» le gibet de Monfaucon qui occupe le premier chapitre (peut-être un peu long), et la fin de ce livre qui sort de l'ordinaire.
Toute avancée technique n'a pas que du mauvais : quelques manuscrits copiés par Raoulet d'Orléans, réservés à l'entourage royal, sont désormais accessibles dans leur intégralité et téléchargeables sur le site Gallica de la Bnf. S'interrompre dans la lecture «d'Esquisse d'un pendu» pour aller les feuilleter et mieux comprendre le travail de cet homme et des aides de son atelier est vraiment un superbe complément apporté à cette lecture en elle-même déjà passionnante.
Partons à Paris vers 1375 pour faire connaissance de Raoulet.
Raoulet d'Orléans est copiste, son atelier, composé de laïcs, travaille pour le roi Charles V, il fait partie de ces artisans relieurs, enlumineurs, libraires, qui travaillent par privilège royal
Raoulet n'est pas un patron très sage, non c'est plutôt un joyeux luron au gosier en pente et aimant la bonne chair, un de ses passe-temps favori est de courir les tripots de la ville, bouges, ribaudes n'ont pas de secrets pour lui, parfois curieux il assiste au spectacle donné à Montfaucon.
le roi lui passe commande de deux livres peu ordinaires, finit les Bibles à répétition, le voilà charger de codex prestigieux un texte d'Aristote traduit pour la première fois en français, et Les Grandes Chroniques de France.
Deux livres très différents, un reflet de la pensée grecque, une oeuvre universelle et de l'autre, un livre de commande destiné à servir la gloire du roi et de ses prédécesseurs, moins noble, mais qui peut assurer la richesse du copiste.
Le travail sera long surtout que par sécurité Raoulet fait faire une seconde copie à son atelier, une sécurité, une assurance sur l'avenir.
Un travail long, après le travail des copistes le livre passe en atelier d'enluminure, une faute, une tâche, une coquille et toute une page est à refaire, la commande peut prendre du retard.
Le maître d'oeuvre est attentif à tout faux pas, c'est lui qui apposera sa marque, le « congé de l'écrivain » dans un « cul de lampe » à la dernière feuille. Pas question que cette signature soit entachée d'erreur ou pire d'irrégularité. Il en fait parfois des cauchemars surtout lorsqu'un soupçon de contrefaçon lui vient. Plagiaires et faussaires font leur apparition au mépris du risque encouru : une place sur le gibet de Montfaucon !!
Raoulet mène l'enquête, ne pensez pas pour autant être dans un polar, non rien à voir, Michel Jullien préfère plutôt la parabole.
Il met en scène un métier qui est sur le point de disparaître, tout près se profile la presse de Gutenberg qui va à jamais ruiner les ateliers de copistes
Raoulet est un peu inquiet mais cache cela derrière une jovialité moqueuse, quoique dangereux ce papier cet « attrape-nigaud » ne saurait perdurer n'est-ce pas ?
Le vocabulaire est d'une grande richesse et d'une grande précision, souvent on devine le sens des mots, d'autres exigent le recours au dictionnaire et de temps à autre les mots du moyen-âge viennent se frotter aux mots d'aujourd'hui avec un anachronisme réjouissant.
Le roman interroge l'époque actuelle : le moyen-âge connut le passage du livre réservé aux puissants à ce qui deviendra le livre pour tous. L'imprimerie a chassé les copistes, le numérique chassera-t-il le papier ?
Lien : http://asautsetagambades.hau..
Raoulet d'Orléans est copiste, son atelier, composé de laïcs, travaille pour le roi Charles V, il fait partie de ces artisans relieurs, enlumineurs, libraires, qui travaillent par privilège royal
Raoulet n'est pas un patron très sage, non c'est plutôt un joyeux luron au gosier en pente et aimant la bonne chair, un de ses passe-temps favori est de courir les tripots de la ville, bouges, ribaudes n'ont pas de secrets pour lui, parfois curieux il assiste au spectacle donné à Montfaucon.
le roi lui passe commande de deux livres peu ordinaires, finit les Bibles à répétition, le voilà charger de codex prestigieux un texte d'Aristote traduit pour la première fois en français, et Les Grandes Chroniques de France.
Deux livres très différents, un reflet de la pensée grecque, une oeuvre universelle et de l'autre, un livre de commande destiné à servir la gloire du roi et de ses prédécesseurs, moins noble, mais qui peut assurer la richesse du copiste.
Le travail sera long surtout que par sécurité Raoulet fait faire une seconde copie à son atelier, une sécurité, une assurance sur l'avenir.
Un travail long, après le travail des copistes le livre passe en atelier d'enluminure, une faute, une tâche, une coquille et toute une page est à refaire, la commande peut prendre du retard.
Le maître d'oeuvre est attentif à tout faux pas, c'est lui qui apposera sa marque, le « congé de l'écrivain » dans un « cul de lampe » à la dernière feuille. Pas question que cette signature soit entachée d'erreur ou pire d'irrégularité. Il en fait parfois des cauchemars surtout lorsqu'un soupçon de contrefaçon lui vient. Plagiaires et faussaires font leur apparition au mépris du risque encouru : une place sur le gibet de Montfaucon !!
Raoulet mène l'enquête, ne pensez pas pour autant être dans un polar, non rien à voir, Michel Jullien préfère plutôt la parabole.
Il met en scène un métier qui est sur le point de disparaître, tout près se profile la presse de Gutenberg qui va à jamais ruiner les ateliers de copistes
Raoulet est un peu inquiet mais cache cela derrière une jovialité moqueuse, quoique dangereux ce papier cet « attrape-nigaud » ne saurait perdurer n'est-ce pas ?
Le vocabulaire est d'une grande richesse et d'une grande précision, souvent on devine le sens des mots, d'autres exigent le recours au dictionnaire et de temps à autre les mots du moyen-âge viennent se frotter aux mots d'aujourd'hui avec un anachronisme réjouissant.
Le roman interroge l'époque actuelle : le moyen-âge connut le passage du livre réservé aux puissants à ce qui deviendra le livre pour tous. L'imprimerie a chassé les copistes, le numérique chassera-t-il le papier ?
Lien : http://asautsetagambades.hau..
Foin de douceur dès le début, mais la fascinante découverte de la Machine, à savoir le gibet de Mont faucon, extraordinairement et précisément décrit. Gibet disparu bien sûr, qui se trouvait en gros dans les environs du canal Saint-Martin.
"La Machine se dresse à la vue comme une tour de Babel à pendus, un gigantesque Rubik's Cube serti en plein pâtis, enraciné sur son écrin de tumulus."
"On y rencontre des contorsionnistes à jambes rebindaines, des équilibristes, des cabotins interdits de décubitus post mortem, on assiste à des numéros de trapèze, à des cabrioles d''estrangelez' qui ne sont pas sans rappeler les planches de Vésale, ses anatomies dégingandées, élastiques, arrimées à hue, retenues à dia, titubant contre un échalas, encagés dans les marges de la gravure comme les corps de Montfaucon sont empagés dans leurs fenêtres de pierre. C'est une forme de drive in en plein champ, sans billet d'entrée, un aquarium à pendus, un 'accrochage', un happening. Un grand code-barres mis en volume dans le décor."
Vers 1375, sous le règne de CharlesV. Raoulet d'Orléans est stationnaire rue Boutebrie. Son atelier s'attèle pour de longs mois à la copie de manuscrits, car Gutenberg est encore un nom inconnu. Son métier est associé à celui de parchemineur, enlumineur, relieur.
"C'est qu'avant la machine le manuscrit servant de guide au scribe, une fois copié, n'aboutit à rien d'autre qu'à un manuscrit, que le producteur d'idées fait oeuvre d'écrivain comme après lui le tâcheron des copies continue de s'appeler écrivain. Les lettres de fer scinderont le verbe, feraient plus, diviseraient le geste : l'auteur demeurera assis, jusqu'à nos jours encore, quand le copiste, celui de 1368, sur le point de se lever de son siège, deviendra l'ouvrier typographe, travaillant debout, pour ne plus s'asseoir (du moins pendant six cents ans, jusqu'à l'intronisation de l'ordinateur, nouvel outil le priant de se rasseoir.)"
Raoulet a parfaitement existé. En dernière feuille de ses manuscrits, on peut lire son congé d'écrivain, fignolé à chaque fois, par exemple:
"Si fu prince sus nommé
Ce livre baillé et donné
Par le dit Jehan que je ne mente
L'an mil CCC XII et soixante."
Et l'histoire? Mis à part une vivante description de la vie de cet atelier? Tout simplement qu'en accomplissant une commande du roi lui-même, à savoir recopier les Chroniques de France (et pour Raoulet habitué à copier des Bibles, l'impression de voir le passé tout proche caracoler derrière son épaule, comme nous lisons sur internet les dernières dépêches), Raoulet s'aperçoit que quelqu'un en profite pour exécuter une copie pirate. Et ça, cela ne doit pas être! Comme une sorte de plagiat. Sa profession a des règles!
Ce roman historique à la langue si drue, à l'érudition digeste, ne pouvait que me plaire!
Lien : http://enlisantenvoyageant.b..
"La Machine se dresse à la vue comme une tour de Babel à pendus, un gigantesque Rubik's Cube serti en plein pâtis, enraciné sur son écrin de tumulus."
"On y rencontre des contorsionnistes à jambes rebindaines, des équilibristes, des cabotins interdits de décubitus post mortem, on assiste à des numéros de trapèze, à des cabrioles d''estrangelez' qui ne sont pas sans rappeler les planches de Vésale, ses anatomies dégingandées, élastiques, arrimées à hue, retenues à dia, titubant contre un échalas, encagés dans les marges de la gravure comme les corps de Montfaucon sont empagés dans leurs fenêtres de pierre. C'est une forme de drive in en plein champ, sans billet d'entrée, un aquarium à pendus, un 'accrochage', un happening. Un grand code-barres mis en volume dans le décor."
Vers 1375, sous le règne de CharlesV. Raoulet d'Orléans est stationnaire rue Boutebrie. Son atelier s'attèle pour de longs mois à la copie de manuscrits, car Gutenberg est encore un nom inconnu. Son métier est associé à celui de parchemineur, enlumineur, relieur.
"C'est qu'avant la machine le manuscrit servant de guide au scribe, une fois copié, n'aboutit à rien d'autre qu'à un manuscrit, que le producteur d'idées fait oeuvre d'écrivain comme après lui le tâcheron des copies continue de s'appeler écrivain. Les lettres de fer scinderont le verbe, feraient plus, diviseraient le geste : l'auteur demeurera assis, jusqu'à nos jours encore, quand le copiste, celui de 1368, sur le point de se lever de son siège, deviendra l'ouvrier typographe, travaillant debout, pour ne plus s'asseoir (du moins pendant six cents ans, jusqu'à l'intronisation de l'ordinateur, nouvel outil le priant de se rasseoir.)"
Raoulet a parfaitement existé. En dernière feuille de ses manuscrits, on peut lire son congé d'écrivain, fignolé à chaque fois, par exemple:
"Si fu prince sus nommé
Ce livre baillé et donné
Par le dit Jehan que je ne mente
L'an mil CCC XII et soixante."
Et l'histoire? Mis à part une vivante description de la vie de cet atelier? Tout simplement qu'en accomplissant une commande du roi lui-même, à savoir recopier les Chroniques de France (et pour Raoulet habitué à copier des Bibles, l'impression de voir le passé tout proche caracoler derrière son épaule, comme nous lisons sur internet les dernières dépêches), Raoulet s'aperçoit que quelqu'un en profite pour exécuter une copie pirate. Et ça, cela ne doit pas être! Comme une sorte de plagiat. Sa profession a des règles!
Ce roman historique à la langue si drue, à l'érudition digeste, ne pouvait que me plaire!
Lien : http://enlisantenvoyageant.b..
1370, atelier laïque de copie et grand gibet de Montfaucon, dans une langue minutieuse et savoureuse
Publié en ce début 2013, le troisième texte de Michel Jullien chez Verdier peut désarçonner, voire légèrement agacer par moments, mais s'impose in fine comme un bien beau moment d'écriture.
C'est à une immersion intégrale dans une tranche de vie parisienne de 1370 que nous sommes conviés, en suivant Raoulet, artisan copiste tenant le haut du pavé, à l'atelier duquel le roi Charles V le Sage vient de confier la réalisation de deux volumes, une traduction de la "Politique" d'Aristote, et la mise à jour des "Chroniques royales" (précieux manuscrit aujourd'hui pieusement conservé à la BNF).
C'est donc l'occasion de plonger avec volupté dans ce monde ignoré, celui de l'univers laïque du manuscrit, avec tous ces professionnels gravitant autour de la mission de la propagation de l'écrit, support du savoir, à quelques années de l'arrivée de l'imprimerie. Loin de l'atmosphère monacale des ateliers religieux consacrés par l'imagerie du Moyen-Âge, Raoulet est un bon vivant, qui, tout en montrant un dévouement sans bornes à son métier, n'aime rien tant que se promener, rencontrer ses confrères, clients, intermédiaires et fournisseurs, arpentant le pavé (encore peu répandu d'ailleurs) parisien, d'estaminet en estaminet, pour finir souvent dans les tavernes hors enceinte de l'immense, monumental, gibet de Montfaucon, qui joue bien un rôle essentiel à la fois dans le paysage et dans l'intrigue quasiment policière qui va se développer sous nos yeux, d'abord comme incidemment, autour des enjeux cruciaux de la reproduction illicite de manuscrits...
Le travail d'immersion par le détail du vocabulaire, authentiquement recherché ou réinventé, est sidérant, et au premier abord, presque exagéré, d'autant que les quelques sauts métaphoriques tout à fait contemporains et les quelques maniérismes dans les comparaisons (avec d'obscurs jazzmen, par exemple) frôlent parfois l'accident d'écriture dans les 100 premières pages. Mais la constance et la qualité du propos, l'humour implicite des personnages et des situations, le sérieux de la reconstitution, parviennent à s'imposer face aux réticences éventuelles, pour ne laisser que le charme indéniable de cette histoire autre et pourtant si familière. L'apothéose finale, qui viendra comme boucler le cycle et justifier la surprenante introduction, en est un témoignage magnifique.
"Pour d'autres visées - compilation de génie civil -, l'opuscule servit encore Viollet-le-Duc, duquel il puisa l'essentiel de la trame afin de mettre au point, à la lettre F, entre "Four" et "Frise" de son Dictionnaire de l'architecture, l'entrée "Fourches patibulaires"."
"Retour à Montfaucon, parfois, Raoulet revit ce bagage aux allures de punching-ball, l'oeil fier, son gros secret, son rébus d'écrivain suspendu à l'empyrée de son casier particulier. Un jour prochain il y pensait, la besace ne serait plus, remplacée par un pendu flambant. Un jour bientôt mais comment s'en douter, à la veille de se perdre, le codex ne serait plus. Viendrait le livre, sa machinerie, l'imprimé, ses âges jusqu'à l'abus, son temps d'intérim puis d'autres suppléances après lui."
Publié en ce début 2013, le troisième texte de Michel Jullien chez Verdier peut désarçonner, voire légèrement agacer par moments, mais s'impose in fine comme un bien beau moment d'écriture.
C'est à une immersion intégrale dans une tranche de vie parisienne de 1370 que nous sommes conviés, en suivant Raoulet, artisan copiste tenant le haut du pavé, à l'atelier duquel le roi Charles V le Sage vient de confier la réalisation de deux volumes, une traduction de la "Politique" d'Aristote, et la mise à jour des "Chroniques royales" (précieux manuscrit aujourd'hui pieusement conservé à la BNF).
C'est donc l'occasion de plonger avec volupté dans ce monde ignoré, celui de l'univers laïque du manuscrit, avec tous ces professionnels gravitant autour de la mission de la propagation de l'écrit, support du savoir, à quelques années de l'arrivée de l'imprimerie. Loin de l'atmosphère monacale des ateliers religieux consacrés par l'imagerie du Moyen-Âge, Raoulet est un bon vivant, qui, tout en montrant un dévouement sans bornes à son métier, n'aime rien tant que se promener, rencontrer ses confrères, clients, intermédiaires et fournisseurs, arpentant le pavé (encore peu répandu d'ailleurs) parisien, d'estaminet en estaminet, pour finir souvent dans les tavernes hors enceinte de l'immense, monumental, gibet de Montfaucon, qui joue bien un rôle essentiel à la fois dans le paysage et dans l'intrigue quasiment policière qui va se développer sous nos yeux, d'abord comme incidemment, autour des enjeux cruciaux de la reproduction illicite de manuscrits...
Le travail d'immersion par le détail du vocabulaire, authentiquement recherché ou réinventé, est sidérant, et au premier abord, presque exagéré, d'autant que les quelques sauts métaphoriques tout à fait contemporains et les quelques maniérismes dans les comparaisons (avec d'obscurs jazzmen, par exemple) frôlent parfois l'accident d'écriture dans les 100 premières pages. Mais la constance et la qualité du propos, l'humour implicite des personnages et des situations, le sérieux de la reconstitution, parviennent à s'imposer face aux réticences éventuelles, pour ne laisser que le charme indéniable de cette histoire autre et pourtant si familière. L'apothéose finale, qui viendra comme boucler le cycle et justifier la surprenante introduction, en est un témoignage magnifique.
"Pour d'autres visées - compilation de génie civil -, l'opuscule servit encore Viollet-le-Duc, duquel il puisa l'essentiel de la trame afin de mettre au point, à la lettre F, entre "Four" et "Frise" de son Dictionnaire de l'architecture, l'entrée "Fourches patibulaires"."
"Retour à Montfaucon, parfois, Raoulet revit ce bagage aux allures de punching-ball, l'oeil fier, son gros secret, son rébus d'écrivain suspendu à l'empyrée de son casier particulier. Un jour prochain il y pensait, la besace ne serait plus, remplacée par un pendu flambant. Un jour bientôt mais comment s'en douter, à la veille de se perdre, le codex ne serait plus. Viendrait le livre, sa machinerie, l'imprimé, ses âges jusqu'à l'abus, son temps d'intérim puis d'autres suppléances après lui."
je n'ai pas aimé du tout ce livre truffé de synonymes ,ampoulé,très désagréable â lire.C'est plus un exercice de style comme si l'auteur voulait nous convaincre de sa connaissance de la langue médiévale.il fait un rapprochement avec le numérique mais que de déception ! je l'ai lu dans le cadre du prix jeand'heurs spécifique à ma région.
À quoi pouvait bien ressembler Paris au Moyen-Âge ? On pense bien sûr à Notre-Dame (Victor Hugo oblige), mais aussi à ces deux chefs-d'oeuvre de l'art "supplicien" qu'étaient le gibet de Montfaucon et la place de Grèves. C'est ce Paris, celui du quatorzième (siècle, pas arrondissement), que nous fait découvrir Michel Jullien à travers l'histoire de Raoulet d'Orléans, copiste et enlumineur de son état en son échoppe de la rue Boutebrie, en plein coeur du Quartier Latin. Armés d'un lourd corpus d'érudition, mêlant le langage des temps passés aux références les plus actuelles, nous voici transportés dans le quotidien d'un de ces métiers d'art depuis longtemps disparus, ne survivant plus qu'au travers de la restauration des reliques du passé. Hélas, ce qui aurait pu être un agréable voyage dans le temps s'avère un pensum assez indigeste, malgré les efforts de l'auteur pour multiplier clins d'oeil et jeux de mots à la manière d'un Prévert ou d'un Audiard. Comme la plupart de ces mots nous sont inconnus, sauf à posséder un Littré (le "grand", de préférence) ou avoir fait une thèse de doctorat sur les langues romanes, le divertissement se transforme vite en parcours du combattant. Reste la musique de l'écriture, assez belle il est vrai. À déconseiller sur la plage, peut-être à réserver aux très longues soirées d'hiver…
description "infernale" du gibet de Montfaucont..................
.................................................................................................
.............................................................................................
..........................................................................................
à rapprocher de la "ballade des pendue " de François Villon
.................................................................................................
.............................................................................................
..........................................................................................
à rapprocher de la "ballade des pendue " de François Villon
Très déçu par ce roman. Si le sujet et les personnages sont brillants, si l'atmosphère et les inquiétudes du XIVème siècle sont bien saisies, le style, ampoulé à l'extrême, n'a même pas l'alibi du vocabulaire médiéval. On pourrait croire que l'auteur a écrit son roman avec un dictionnaire de synonymes, s'efforçant à chaque phrase d'utiliser un mot rare, un anachronisme assumé, une tournure aussi précieuse que ridicule. Cela sent le procédé, cela agace.
Magie de la langue française, rarement aussi bien maitrisée.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Michel Jullien (9)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3249 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3249 lecteurs ont répondu