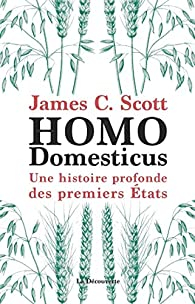>
Critique de JeanLibremont
Ce livre est une synthese aussi riche que passionnante de nos connaissances sur le vaste theme de l'émergeance des États. Moins innovateur mais plus facile a lire que le génial et un peu brouillon "Au commencement était..." de David Graeber et David Wengrow auquel il est absolument complémentaire. Les deux ouvrages sont devenus indispensables pour ceux que la thématique anthropologique et historique de l'aube des civilisations interpelle. Tout comme je l'avais fait pour le livre de Graeber et Wengrow, je préfere donner ici le compte-rendu d'un vrai spécialiste que je ne pourrais certainement pas égaler en qualité, celui en l'occurrence du chercheur Léo Montaz, libre de droits d'auteurs et disponible ici (excellente adresse): https://journals.openedition.org/lectures/32442
Dans la perspective de renverser les connaissances sur les premiers États, James C. Scott propose dans Homo-Domesticus une pertinente relecture de l'histoire ancienne. Partant du constat que, dans le « récit civilisationnel », l'émergence des premières cités-États, en particulier Uruk (-4000 à -2000 ans av. J.C.), est généralement associée à celle d'une humanité plus juste et plus sûre, James Scott se demande si ce n'est pas plutôt « l'effondrement » de ces premiers États qui a constitué un gain de bien-être pour l'humanité, mais également si les populations désignées cyniquement comme « barbares » – celles sans États – n'ont pas préféré rester en dehors d'un dispositif d'État « parce que les conditions de vie y étaient meilleures » (p. 13).
L'ouvrage s'ouvre sur une brève préface de Jean-Paul Demoule (professeur en protohistoire) qui a l'intérêt de bien situer cet opus dans l'oeuvre de James C. Scott, mais aussi dans le courant dit de « l'anthropologie anarchiste » auquel l'auteur est affilié, avec des figures telles que Marshall Sahlins et David Graeber. La réflexion au coeur d'Homo-domesticus s'inscrit dans le prolongement des réflexions classiques de ce courant, notamment celles de Pierre Clastres qui, dans La société contre l'État, interrogeait les stratégies de contournement des sociétés sans État pour échapper à l'emprise de ce dernier. Précisons dès maintenant que les réflexions de James C. Scott sur l'État sont anciennes et que la plupart des éléments exposés dans ce livre ne sont ni nouveaux ni sensiblement originaux. On retrouvera par exemple les grandes lignes de son raisonnement dans l'un de ses précédents ouvrages, Zomia, ou l'art de ne pas être gouverné. Tout l'intérêt d'Homo-Domesticus, au demeurant très accessible – écriture claire, ciselée et synthétique –, est d'assembler sous une forme proche du cours magistral un vaste ensemble de connaissances contemporaines sur la naissance des premiers États et d'interroger le « récit civilisationnel » dans une perspective critique, en prenant le point de vue des populations « non étatiques ». James C. Scott indique à juste titre en introduction que si l'État nous paraît historiquement une forme stable, c'est avant tout parce qu'il est la forme historique qui a laissé le plus de traces archéologiques : « Malgré la puissance et la centralité dont l'affublent la plupart des récits traditionnels, il faut bien reconnaître que pendant les milliers d'années qui ont suivi son apparition initiale, l'État n'a pas été une constante, mais une variable – et une variable assez mineure dans l'existence d'une bonne partie de l'humanité » (p. 32). On peut restituer synthétiquement les apports de cet ouvrage à travers les trois retournements de perspective qu'il propose : sur la domestication de la nature par les humains, sur le rôle protecteur des premiers États vis–à-vis du monde extérieur et sur la notion même de « civilisé », associée à la vie dans la cité.
Le questionnement relatif à la domestication s'exprime dès l'introduction à travers une formule bien trouvée : « Est-ce nous qui avons domestiqué le chien ou est-ce le chien qui nous a domestiqués ? Ce n'est pas si clair […] La question de savoir qui est au service de qui est presque métaphysique, du moins jusqu'à l'heure du déjeuner » (p. 35). En effet, qui gagne le plus à vivre dans la domus, ce complexe sédentaire dans lequel les hommes cherchent à faire cohabiter l'ensemble des ressources de subsistances qui lui sont nécessaires ? Les animaux y gagnent considérablement en confort de vie : ils sont logés, protégés, nourris, et cela sans fournir le moindre effort, si ce n'est celui de supporter leur mise à mort. Quant aux espèces cultivées, elles gagnent d'être soignées, protégées des mauvaises herbes et des espèces envahissantes, sélectionnées pour donner un meilleur rendement, au prix d'un travail très important des humains. On sait depuis longtemps que le travail agricole est bien plus chronophage que la chasse et la cueillette. Dans cette perspective, la pertinence de l'idée de domestication de la nature par l'homme peut être largement interrogée. En effet, quel est le gain réel de ces travaux pour les humains sédentaires, par rapport à la vie des chasseurs-cueilleurs, qui se contentent de prélever les ressources nécessaires ? Comme le dit l'auteur : « C'est “nous” qui avons domestiqué le blé, le riz, les moutons, les cochons, les chèvres. Mais si l'on examine la question sous un angle légèrement différent, on pourrait argumenter que c'est nous qui avons été domestiqués » (p. 101). Pire, la domestication de la nature s'accompagne aussi de l'apparition incontrôlée de nuisibles, de parasites et de maladies devant lesquels les humains sont impuissants. C'est un aspect longuement développé par l'auteur dans les chapitres 3 et 6 : le développement de maladies inconnues dans la domus puis dans les cités est probablement la conséquence la plus dramatique du regroupement humain, qui explique à elle seule une grande partie des cas « d'effondrement » de cités-États, lorsque des épidémies sont venues décimer en quelques semaines des populations entières. La vie dans la domus s'accompagnerait donc d'une perte substantielle en bien-être humain : les traces osseuses tendent par ailleurs à montrer que les groupes de chasseurs-cueilleurs, du fait de leur activité, étaient en meilleure santé et plus musclés que les populations sédentaires.
Le deuxième retournement de perspective, celui selon lequel la vie dans la cité-État serait plus sûre et plus juste que la vie dans la nature, permet à l'auteur de développer l'une de ses thèses centrales, déjà énoncée dans Zomia et qui donne son titre original à l'ouvrage – Against the grain. Il défend en effet l'idée que le développement de l'agriculture céréalière est au fondement de l'existence de l'État, caractérisé ici par l'existence d'un corps de fonctionnaires chargé de prélever l'impôt et d'administrer la population. James C. Scott démontre que les qualités intrinsèques aux céréales facilitent le fonctionnement de l'État (chapitres 2 et 4). Tout d'abord, les céréales sont aisément transportables, ce qui permet d'en faire une monnaie d'échange. Leur cycle de croissance est prévisible, simplifiant grandement le travail du percepteur d'impôt qui sait à quel moment venir chercher son dû. Elles peuvent être stockées dans des greniers pour anticiper les disettes, et peuvent aussi être de nouveau taxées en cas de nécessité, comme en période de guerre. Enfin, les stocks de céréales peuvent être comptabilisés, ce qui rend leur administration relativement précise. À l'appui de cette idée, James C. Scott observe que les premières traces d'écriture en Mésopotamie sont des tablettes qui comptabilisaient des céréales. En contrepartie de cette organisation « complexe », dans laquelle le percepteur d'impôt joue un rôle central pour l'État, quel surplus de sécurité et de bien-être gagnent réellement les populations ? Les individus étant soumis à une force coercitive qui prélève un impôt, leur sécurité n'est possible qu'en échange de ce dû ; lorsqu'ils ne peuvent pas payer l'impôt, ils deviennent des sujets endettés, passibles de travail forcé ou de violences. Leur liberté de se mouvoir est alors considérablement réduite. Dans l'ancienne Mésopotamie, par exemple, on peut penser avec l'auteur que les murs d'enceinte d'Uruk servaient tout autant à protéger la cité-État des envahisseurs qu'à empêcher les sujets d'en sortir. Enfin, le surplus de la production n'alimentait pas seulement la caste des gens au pouvoir, mais aussi leurs alliés et leurs ennemis, lorsque ces derniers prélevaient une partie des richesses en échange de la paix. Dans cette perspective, l'agriculture sédentaire n'apparaît donc plus comme une forme pacifiée de regroupement des populations, mais bien plutôt comme un asservissement à l'État. le chapitre 5 est d'ailleurs tout entier consacré à la question de l'asservissement et de l'esclavagisme, pratiques qui se sont considérablement développées dès lors que les premières cités ont eu besoin de main-d'oeuvre, renforçant ainsi l'idée que c'est l'homme lui-même qui a été domestiqué (p. 197).
Enfin, le troisième retournement concerne directement la notion de « civilisation ». La période de la naissance des États, au lieu d'être celle de la naissance de la civilisation, n'est-elle pas plutôt « l'âge d'or des barbares » ? En effet, pour ces derniers, la présence d'une cité-État à proximité pouvait présenter de nombreuses opportunités : celle de faire des razzias et de s'accaparer en quelques heures du produit d'un travail de plusieurs mois ou années (dans la logique de la « cueillette »), ou encore celle de se faire payer en échange de leur « protection » – avant tout contre eux-mêmes. L'auteur traite également des gains que les « bandes barbares » pouvaient obtenir en échange du contrôle des routes et des centres de commerce, et du rôle central de celles-ci comme passeuses de ressources, en particulier d'esclaves. James C. Scott observe que toutes ces activités de « partenariat » avec les États ne donnaient lieu à aucune forme d'impôt. Il défend donc l'idée que, tant que les États n'étaient t pas assez forts pour faire face aux invasions de barbares, leur existence permettait à ces derniers de multiplier les opportunités de s'approvisionner et de vivre dans de meilleures conditions que si leurs ressources se limitaient à la chasse et la cueillette. Il relativise cependant ce propos tout au long de l'ouvrage en rappelant par exemple que les risques épidémiologiques étaient plus forts pour ceux qui vivaient en dehors de l'État que pour les « citoyens », ces derniers développant au fil du temps des anticorps contre les maladies répandues dans la cité. Il rappelle aussi que la concurrence entre bandes rivales pour s'accaparer les surplus des cités devait être à la source de nombreuses guerres.
En somme, même si l'ouvrage de James C. Scott reprend des données bien connues des spécialistes et n'apporte pas de théories nouvelles par rapport à ses précédents travaux, sa grande clarté et sa volonté d'exhaustivité en font une excellente entrée dans l'oeuvre de son auteur et, plus largement, dans la problématique de l'émergence des États. Si l'on peut partager les critiques déjà connues sur l'aspect trop dichotomique de la distinction entre les sociétés à État et les sociétés sans État, qui a le défaut d'exclure les autres formes de gouvernance telles que les systèmes lignagers et les chefferies, cela n'enlève rien à la richesse de la réflexion de l'auteur et à sa salutaire remise en question du « récit civilisationnel », trop peu interrogé.
Dans la perspective de renverser les connaissances sur les premiers États, James C. Scott propose dans Homo-Domesticus une pertinente relecture de l'histoire ancienne. Partant du constat que, dans le « récit civilisationnel », l'émergence des premières cités-États, en particulier Uruk (-4000 à -2000 ans av. J.C.), est généralement associée à celle d'une humanité plus juste et plus sûre, James Scott se demande si ce n'est pas plutôt « l'effondrement » de ces premiers États qui a constitué un gain de bien-être pour l'humanité, mais également si les populations désignées cyniquement comme « barbares » – celles sans États – n'ont pas préféré rester en dehors d'un dispositif d'État « parce que les conditions de vie y étaient meilleures » (p. 13).
L'ouvrage s'ouvre sur une brève préface de Jean-Paul Demoule (professeur en protohistoire) qui a l'intérêt de bien situer cet opus dans l'oeuvre de James C. Scott, mais aussi dans le courant dit de « l'anthropologie anarchiste » auquel l'auteur est affilié, avec des figures telles que Marshall Sahlins et David Graeber. La réflexion au coeur d'Homo-domesticus s'inscrit dans le prolongement des réflexions classiques de ce courant, notamment celles de Pierre Clastres qui, dans La société contre l'État, interrogeait les stratégies de contournement des sociétés sans État pour échapper à l'emprise de ce dernier. Précisons dès maintenant que les réflexions de James C. Scott sur l'État sont anciennes et que la plupart des éléments exposés dans ce livre ne sont ni nouveaux ni sensiblement originaux. On retrouvera par exemple les grandes lignes de son raisonnement dans l'un de ses précédents ouvrages, Zomia, ou l'art de ne pas être gouverné. Tout l'intérêt d'Homo-Domesticus, au demeurant très accessible – écriture claire, ciselée et synthétique –, est d'assembler sous une forme proche du cours magistral un vaste ensemble de connaissances contemporaines sur la naissance des premiers États et d'interroger le « récit civilisationnel » dans une perspective critique, en prenant le point de vue des populations « non étatiques ». James C. Scott indique à juste titre en introduction que si l'État nous paraît historiquement une forme stable, c'est avant tout parce qu'il est la forme historique qui a laissé le plus de traces archéologiques : « Malgré la puissance et la centralité dont l'affublent la plupart des récits traditionnels, il faut bien reconnaître que pendant les milliers d'années qui ont suivi son apparition initiale, l'État n'a pas été une constante, mais une variable – et une variable assez mineure dans l'existence d'une bonne partie de l'humanité » (p. 32). On peut restituer synthétiquement les apports de cet ouvrage à travers les trois retournements de perspective qu'il propose : sur la domestication de la nature par les humains, sur le rôle protecteur des premiers États vis–à-vis du monde extérieur et sur la notion même de « civilisé », associée à la vie dans la cité.
Le questionnement relatif à la domestication s'exprime dès l'introduction à travers une formule bien trouvée : « Est-ce nous qui avons domestiqué le chien ou est-ce le chien qui nous a domestiqués ? Ce n'est pas si clair […] La question de savoir qui est au service de qui est presque métaphysique, du moins jusqu'à l'heure du déjeuner » (p. 35). En effet, qui gagne le plus à vivre dans la domus, ce complexe sédentaire dans lequel les hommes cherchent à faire cohabiter l'ensemble des ressources de subsistances qui lui sont nécessaires ? Les animaux y gagnent considérablement en confort de vie : ils sont logés, protégés, nourris, et cela sans fournir le moindre effort, si ce n'est celui de supporter leur mise à mort. Quant aux espèces cultivées, elles gagnent d'être soignées, protégées des mauvaises herbes et des espèces envahissantes, sélectionnées pour donner un meilleur rendement, au prix d'un travail très important des humains. On sait depuis longtemps que le travail agricole est bien plus chronophage que la chasse et la cueillette. Dans cette perspective, la pertinence de l'idée de domestication de la nature par l'homme peut être largement interrogée. En effet, quel est le gain réel de ces travaux pour les humains sédentaires, par rapport à la vie des chasseurs-cueilleurs, qui se contentent de prélever les ressources nécessaires ? Comme le dit l'auteur : « C'est “nous” qui avons domestiqué le blé, le riz, les moutons, les cochons, les chèvres. Mais si l'on examine la question sous un angle légèrement différent, on pourrait argumenter que c'est nous qui avons été domestiqués » (p. 101). Pire, la domestication de la nature s'accompagne aussi de l'apparition incontrôlée de nuisibles, de parasites et de maladies devant lesquels les humains sont impuissants. C'est un aspect longuement développé par l'auteur dans les chapitres 3 et 6 : le développement de maladies inconnues dans la domus puis dans les cités est probablement la conséquence la plus dramatique du regroupement humain, qui explique à elle seule une grande partie des cas « d'effondrement » de cités-États, lorsque des épidémies sont venues décimer en quelques semaines des populations entières. La vie dans la domus s'accompagnerait donc d'une perte substantielle en bien-être humain : les traces osseuses tendent par ailleurs à montrer que les groupes de chasseurs-cueilleurs, du fait de leur activité, étaient en meilleure santé et plus musclés que les populations sédentaires.
Le deuxième retournement de perspective, celui selon lequel la vie dans la cité-État serait plus sûre et plus juste que la vie dans la nature, permet à l'auteur de développer l'une de ses thèses centrales, déjà énoncée dans Zomia et qui donne son titre original à l'ouvrage – Against the grain. Il défend en effet l'idée que le développement de l'agriculture céréalière est au fondement de l'existence de l'État, caractérisé ici par l'existence d'un corps de fonctionnaires chargé de prélever l'impôt et d'administrer la population. James C. Scott démontre que les qualités intrinsèques aux céréales facilitent le fonctionnement de l'État (chapitres 2 et 4). Tout d'abord, les céréales sont aisément transportables, ce qui permet d'en faire une monnaie d'échange. Leur cycle de croissance est prévisible, simplifiant grandement le travail du percepteur d'impôt qui sait à quel moment venir chercher son dû. Elles peuvent être stockées dans des greniers pour anticiper les disettes, et peuvent aussi être de nouveau taxées en cas de nécessité, comme en période de guerre. Enfin, les stocks de céréales peuvent être comptabilisés, ce qui rend leur administration relativement précise. À l'appui de cette idée, James C. Scott observe que les premières traces d'écriture en Mésopotamie sont des tablettes qui comptabilisaient des céréales. En contrepartie de cette organisation « complexe », dans laquelle le percepteur d'impôt joue un rôle central pour l'État, quel surplus de sécurité et de bien-être gagnent réellement les populations ? Les individus étant soumis à une force coercitive qui prélève un impôt, leur sécurité n'est possible qu'en échange de ce dû ; lorsqu'ils ne peuvent pas payer l'impôt, ils deviennent des sujets endettés, passibles de travail forcé ou de violences. Leur liberté de se mouvoir est alors considérablement réduite. Dans l'ancienne Mésopotamie, par exemple, on peut penser avec l'auteur que les murs d'enceinte d'Uruk servaient tout autant à protéger la cité-État des envahisseurs qu'à empêcher les sujets d'en sortir. Enfin, le surplus de la production n'alimentait pas seulement la caste des gens au pouvoir, mais aussi leurs alliés et leurs ennemis, lorsque ces derniers prélevaient une partie des richesses en échange de la paix. Dans cette perspective, l'agriculture sédentaire n'apparaît donc plus comme une forme pacifiée de regroupement des populations, mais bien plutôt comme un asservissement à l'État. le chapitre 5 est d'ailleurs tout entier consacré à la question de l'asservissement et de l'esclavagisme, pratiques qui se sont considérablement développées dès lors que les premières cités ont eu besoin de main-d'oeuvre, renforçant ainsi l'idée que c'est l'homme lui-même qui a été domestiqué (p. 197).
Enfin, le troisième retournement concerne directement la notion de « civilisation ». La période de la naissance des États, au lieu d'être celle de la naissance de la civilisation, n'est-elle pas plutôt « l'âge d'or des barbares » ? En effet, pour ces derniers, la présence d'une cité-État à proximité pouvait présenter de nombreuses opportunités : celle de faire des razzias et de s'accaparer en quelques heures du produit d'un travail de plusieurs mois ou années (dans la logique de la « cueillette »), ou encore celle de se faire payer en échange de leur « protection » – avant tout contre eux-mêmes. L'auteur traite également des gains que les « bandes barbares » pouvaient obtenir en échange du contrôle des routes et des centres de commerce, et du rôle central de celles-ci comme passeuses de ressources, en particulier d'esclaves. James C. Scott observe que toutes ces activités de « partenariat » avec les États ne donnaient lieu à aucune forme d'impôt. Il défend donc l'idée que, tant que les États n'étaient t pas assez forts pour faire face aux invasions de barbares, leur existence permettait à ces derniers de multiplier les opportunités de s'approvisionner et de vivre dans de meilleures conditions que si leurs ressources se limitaient à la chasse et la cueillette. Il relativise cependant ce propos tout au long de l'ouvrage en rappelant par exemple que les risques épidémiologiques étaient plus forts pour ceux qui vivaient en dehors de l'État que pour les « citoyens », ces derniers développant au fil du temps des anticorps contre les maladies répandues dans la cité. Il rappelle aussi que la concurrence entre bandes rivales pour s'accaparer les surplus des cités devait être à la source de nombreuses guerres.
En somme, même si l'ouvrage de James C. Scott reprend des données bien connues des spécialistes et n'apporte pas de théories nouvelles par rapport à ses précédents travaux, sa grande clarté et sa volonté d'exhaustivité en font une excellente entrée dans l'oeuvre de son auteur et, plus largement, dans la problématique de l'émergence des États. Si l'on peut partager les critiques déjà connues sur l'aspect trop dichotomique de la distinction entre les sociétés à État et les sociétés sans État, qui a le défaut d'exclure les autres formes de gouvernance telles que les systèmes lignagers et les chefferies, cela n'enlève rien à la richesse de la réflexion de l'auteur et à sa salutaire remise en question du « récit civilisationnel », trop peu interrogé.