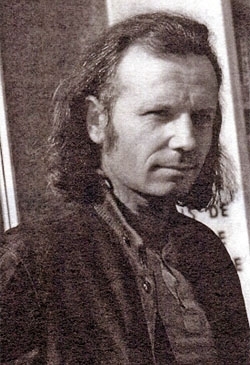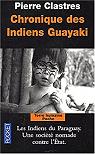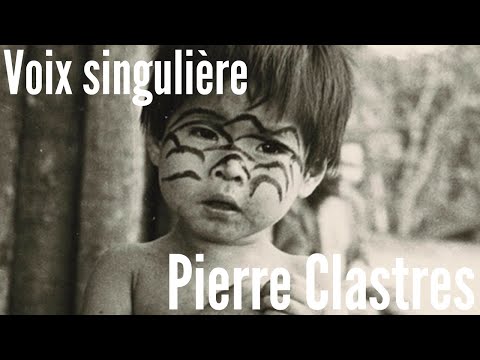Nationalité : France
Né(e) à : Paris , le 17/05/1934
Mort(e) à : Gabriac, Lozère , le 29/07/1977
Ajouter des informations
Né(e) à : Paris , le 17/05/1934
Mort(e) à : Gabriac, Lozère , le 29/07/1977
Biographie :
Pierre Clastres est un anthropologue et ethnologue français.
Philosophe de formation, il s'est intéressé à l'anthropologie américaniste sous l'influence de Claude Lévi-Strauss et d'Alfred Métraux. Il place d'emblée son œuvre dans le sillage du Discours de la servitude volontaire d'Étienne de La Boétie dont il se réclame.
Pierre Clastres a effectué de nombreux travaux de terrain. Il passe l'année 1963 auprès des indiens Guayaki au Paraguay. En 1965, il est en mission chez les Guarani, de nouveau au Paraguay. Il se rend à deux reprise chez les Chulupi en 1966 puis 1968. Il effectue en 1970 un court séjour chez les Yanomami avec son collègue Jacques Lizot. Enfin, il séjourne brièvement en 1974 chez les Guarani du Brésil.
En 1974, il est chercheur au CNRS, et publie le recueil d'articles La société contre l'État.
En 1975, il est directeur d'études à la cinquième section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes.
En 1977, il meurt prématurément dans un accident de la route laissant son œuvre inachevée et éparpillée.
+ Voir plusPierre Clastres est un anthropologue et ethnologue français.
Philosophe de formation, il s'est intéressé à l'anthropologie américaniste sous l'influence de Claude Lévi-Strauss et d'Alfred Métraux. Il place d'emblée son œuvre dans le sillage du Discours de la servitude volontaire d'Étienne de La Boétie dont il se réclame.
Pierre Clastres a effectué de nombreux travaux de terrain. Il passe l'année 1963 auprès des indiens Guayaki au Paraguay. En 1965, il est en mission chez les Guarani, de nouveau au Paraguay. Il se rend à deux reprise chez les Chulupi en 1966 puis 1968. Il effectue en 1970 un court séjour chez les Yanomami avec son collègue Jacques Lizot. Enfin, il séjourne brièvement en 1974 chez les Guarani du Brésil.
En 1974, il est chercheur au CNRS, et publie le recueil d'articles La société contre l'État.
En 1975, il est directeur d'études à la cinquième section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes.
En 1977, il meurt prématurément dans un accident de la route laissant son œuvre inachevée et éparpillée.
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (1)
Voir plusAjouter une vidéo
Pierre Clastres - Voix singulière - INA - Document France Culture Chronique des Indiens Guayaki // 1972 Une société contre l'Etat // 1974
Citations et extraits (34)
Voir plus
Ajouter une citation
Rien de plus tenace que cette vision de la société primitive, et rien de plus faux en même temps. Si l'on a pu récemment parler des groupes de chasseurs-collecteurs paléolithiques comme des « premières sociétés d'abondance », que n'en sera-t-il pas des agriculteurs néolithiques ? […] Bon nombre de ces sociétés archaïques « à économie de subsistance », en Amérique du Sud par exemple, produisaient une quantité de SURPLUS alimentaire souvent ÉQUIVALENTE à la masse nécessaire à la consommation annuelle de la communauté : production donc capable de satisfaire doublement les besoins, ou de nourrir une population deux fois plus importante. Cela ne signifie évidemment pas que les sociétés archaïques ne sont pas archaïques ; il s'agit simplement de pointer la vanité " scientifique " du concept d'économie de subsistance qui traduit beaucoup plus les attitudes et habitudes des observateurs occidentaux face aux sociétés primitives que la réalité économique sur quoi repose ces cultures. Ce n'est en tout cas pas de ce que leur économie était de subsistance que les sociétés archaïques « ont vécu en état d'extrême sous-développement jusqu'à nos jours ». Il nous semble même qu'à ce compte-là c'est plutôt le prolétariat européen du XIXe siècle, illettré et sous-alimenté, qu'il faudrait qualifier d'archaïque. En réalité, l'idée d'économie de subsistance ressortit au champ idéologique de l'Occident moderne, et nullement à l'arsenal conceptuel d'une science. Et il est paradoxal de voir l'ethnologie elle-même victime d'une mystification aussi grossière, et d'autant plus redoutable qu'elle a contribué à orienter la stratégie des nations industrielles vis-à-vis du monde dit sous-développé.
[…] La même perspective qui fait parler des primitifs comme « d'hommes vivant péniblement en économie de subsistance, en état de sous-développement technique… » détermine aussi le sens et la valeur du discours familier sur le politique et le pouvoir. Familier en ce que, de tout temps, la rencontre entre l'Occident et les Sauvages fut l'occasion de répéter sur eux le même discours. En témoigne par exemple ce que disaient les premiers découvreurs européens du Brésil des Indiens Tupinamba : « Gens sans foi, sans loi, sans roi. » Leurs mburuvicha, leurs chefs, ne jouissaient en effet d'aucun " pouvoir ". Quoi de plus étrange, pour des gens issus de sociétés où l'autorité culminait dans les monarchies absolues de France, de Portugal ou d'Espagne ?
Chapitre 1 : Copernic et les sauvages.
[…] La même perspective qui fait parler des primitifs comme « d'hommes vivant péniblement en économie de subsistance, en état de sous-développement technique… » détermine aussi le sens et la valeur du discours familier sur le politique et le pouvoir. Familier en ce que, de tout temps, la rencontre entre l'Occident et les Sauvages fut l'occasion de répéter sur eux le même discours. En témoigne par exemple ce que disaient les premiers découvreurs européens du Brésil des Indiens Tupinamba : « Gens sans foi, sans loi, sans roi. » Leurs mburuvicha, leurs chefs, ne jouissaient en effet d'aucun " pouvoir ". Quoi de plus étrange, pour des gens issus de sociétés où l'autorité culminait dans les monarchies absolues de France, de Portugal ou d'Espagne ?
Chapitre 1 : Copernic et les sauvages.
L'éventail des sociétés considérées est impressionnant ; assez largement ouvert en tout cas pour ôter le lecteur exigeant de tout doute éventuel quant au caractère exhaustif de l'échantillonnage, puisque l'analyse s'exerce sur des exemples pris en Afrique, dans les trois Amériques, en Océanie, Sibérie, etc. Bref, une récollection quasi complète, par sa variété géographique et typologique, de ce que le monde " primitif " pouvait offrir de différences au regard de l'horizon non archaïque, sur fond de quoi se dessine la figure du pouvoir politique en notre culture. […]
On imagine aisément que ces dizaines de sociétés " archaïques " ne possèdent en commun que la seule détermination de leur archaïsme précisément, […] qu'établissent l'absence d'écriture et l'économie dite de subsistance. Les sociétés archaïques peuvent profondément différer entre elles, aucune en fait ne ressemble à une autre et l'on est loin de la morne répétition qui ferait gris tous les Sauvages. Il faut alors introduire un minimum d'ordre en cette multiplicité afin de permettre la comparaison entre les unités qui la composent, et c'est pourquoi M. Lapierre, […] envisage cinq grands types « en partant des sociétés archaïques dans lesquelles le pouvoir politique est le plus développé pour arriver finalement à celles qui présentent… presque pas, voire pas du tout de pouvoir proprement politique ». On ordonne donc les cultures primitives en une typologie fondée en somme sur la plus ou moins grande " quantité " de pouvoir politique que chacune d'entre elles offre à l'observation, cette quantité de pouvoir pouvant tendre vers zéro, « … certains groupements humains, dans des conditions de vie déterminées qui leur permettaient de subsister en petites " sociétés closes ", ont pu se passer de pouvoir politique ».
Chapitre 1 : Copernic et les sauvages.
On imagine aisément que ces dizaines de sociétés " archaïques " ne possèdent en commun que la seule détermination de leur archaïsme précisément, […] qu'établissent l'absence d'écriture et l'économie dite de subsistance. Les sociétés archaïques peuvent profondément différer entre elles, aucune en fait ne ressemble à une autre et l'on est loin de la morne répétition qui ferait gris tous les Sauvages. Il faut alors introduire un minimum d'ordre en cette multiplicité afin de permettre la comparaison entre les unités qui la composent, et c'est pourquoi M. Lapierre, […] envisage cinq grands types « en partant des sociétés archaïques dans lesquelles le pouvoir politique est le plus développé pour arriver finalement à celles qui présentent… presque pas, voire pas du tout de pouvoir proprement politique ». On ordonne donc les cultures primitives en une typologie fondée en somme sur la plus ou moins grande " quantité " de pouvoir politique que chacune d'entre elles offre à l'observation, cette quantité de pouvoir pouvant tendre vers zéro, « … certains groupements humains, dans des conditions de vie déterminées qui leur permettaient de subsister en petites " sociétés closes ", ont pu se passer de pouvoir politique ».
Chapitre 1 : Copernic et les sauvages.
Si, dans les sociétés à État, la parole est le droit du pouvoir, dans les sociétés sans État, au contraire, la parole est le devoir du pouvoir.
Le monde environnant n'est pas, pour les Indiens, un pur espace neutre, mais le prolongement vivant de l'univers humain : ce qui se produit en celui-ci affecte toujours celui-là. Lorsqu'une femme accouche, la situation du groupe s'en trouve profondément transformée, mais le désordre atteint également la nature, la vie même de la forêt reçoit une impulsion nouvelle.
Archaïques, les sociétés amérindiennes le furent, mais si l'on peut dire, négativement et selon nos critères européens. Doit-on pour autant qualifier d'immobiles des cultures dont le devenir ne se conforme pas à nos propres schémas? Faut-il voir en elles des sociétés sans histoire? Pour que la question ait un sens, encore faut-il la poser de telle sorte qu'une réponse soit possible, c'est à dire sans postuler l'universalité du modèle occidental.
Parler, c’est avant tout détenir le pouvoir de parler.
L'histoire des peuples qui ont une histoire est, dit-on, l'histoire de la lutte des classes. L'histoire des peuples sans histoire, c'est, dira-t-on avec autant de vérité au moins, l'histoire de leur lutte contre l'Etat.
De deux choses l'une : ou bien l'homme des sociétés primitives, américaines et autres, vit en économie de subsistance et passe le plus clair de son temps dans la recherche de nourriture; ou bien il il ne vit pas en économie de subsistance et peut donc se permettre des loisirs prolongés en fumant dans son hamac. C'est ce qui frappa, sans ambiguïté, les premiers observateurs européens des indiens du Brésil. Grande était la réprobation à constater que des gaillards pleins de santé préféraient s'attifer comme des femmes de peintures et de plumes au lieu de transpirer sur leurs jardins.
Gens donc qui ignoraient délibérément qu'il faut gagner son pain à la sueur de son front. C'en était trop, et cela ne dura pas : on mit rapidement les Indiens au travail, et ils en périrent.
Deux axiomes en effet paraissent guider la marche de la civilisation occidentale, dès son aurore : le premier pose que la vraie société se déploie à l'ombre de l’État; le second énonce un impératif catégorique : il faut travailler.
Les indiens ne consacraient effectivement que peu de temps à ce que l'on appelle le travail. Et ils ne mouraient pas de faim néanmoins. Les chroniques de l'époque sont unanimes à décrire la belle apparence des adultes, la bonne santé des nombreux enfants, l'abondance et la variété des ressources alimentaires. Par conséquent, l'économie de subsistance qui était celle des tribus indiennes n'impliquait nullement la recherche angoissée, à temps complet, de la nourriture.
Gens donc qui ignoraient délibérément qu'il faut gagner son pain à la sueur de son front. C'en était trop, et cela ne dura pas : on mit rapidement les Indiens au travail, et ils en périrent.
Deux axiomes en effet paraissent guider la marche de la civilisation occidentale, dès son aurore : le premier pose que la vraie société se déploie à l'ombre de l’État; le second énonce un impératif catégorique : il faut travailler.
Les indiens ne consacraient effectivement que peu de temps à ce que l'on appelle le travail. Et ils ne mouraient pas de faim néanmoins. Les chroniques de l'époque sont unanimes à décrire la belle apparence des adultes, la bonne santé des nombreux enfants, l'abondance et la variété des ressources alimentaires. Par conséquent, l'économie de subsistance qui était celle des tribus indiennes n'impliquait nullement la recherche angoissée, à temps complet, de la nourriture.
Il faut accepter l’idée que négation ne signifie pas néant, et que lorsque le miroir ne nous renvoie pas notre image, cela ne prouve pas qu’il n’y ait rien à regarder. Plus simplement : de même que notre culture a fini par reconnaître que l’homme primitif n’est pas un enfant mais, individuellement, un adulte, de même progressera-t-elle un peu si elle lui reconnaît une équivalente maturité collective.
La capacité égale chez tous, de satisfaire les besoins matériels, et l'échange des biens et services, qui empêchent constamment l'accumulation privée des biens, rendent tout simplement impossible l'éclosion d'un tel désir, désir de possession qui est en fait désir de pouvoir. La société primitive, première société d'abondance, ne laisse aucune place au désir de surabondance.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Pierre Clastres
Quiz
Voir plus
Harry Potter pour les nuls (niveau facile)
Combien de tomes contient la série Harry Potter
6
7
8
9
7 questions
17047 lecteurs ont répondu
Thème : Harry Potter, tome 1 : Harry Potter à l'école des sorciers de
J. K. RowlingCréer un quiz sur cet auteur17047 lecteurs ont répondu