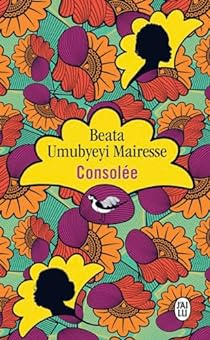Pourquoi avoir attendu de longs mois avant d'ouvrir Consolée ? Je me le demande. J'ai lu presque d'une traite les 300 page de ce livre passionnant et tellement émouvant. J'ai découvert Beata Umubyeyi Mairesse cette année avec « Tous tes enfants dispersés » que j'avais beaucoup aimé. Ce nouveau livre m'a encore plus convaincu car il traite des questions d'exil mais aussi de racisme avec énormément d'intelligence.
En 1954, au Rwanda, Consolée, une enfant issue d'un père blanc et d'une mère rwandaise est envoyée dans une école pour « enfant mulâtres ». Retirée à sa famille et confiée aux soins de religieuses, elle découvre brutalement une nouvelle culture et de nouvelles règles. Soixante-cinq ans plus tard, Ramata arrive dans une maison de retraite pour y animer des ateliers d'art thérapie. Parmi les pensionnaires, l'une d'elle l'intrigue. Il s'agit de madame Astrida, une métisse atteinte d'Alzheimer qui oublie progressivement le français au profil d'une langue inconnue. Ramata tente de retrouver le passé de cette femme et ce confronte en même temps à sa propre histoire.
En suivant le destin d'Astrida et de Ramata, nous reconstituons progressivement le puzzle de vie marquée par le déracinement et le racisme. L'autrice explore la manière dont les préjugés et la xénophobie influent sur le destin des personnes. Ramata comme Astrida se construisent avec le poids de la haine et des attentes des autres. Ramata, progressivement, change son regard sur sa propre personne, prend conscience de ce qui l'amené à devenir cette femme là. Elle réfléchit au racisme ordinaire et à l'impact qu'il a eut sur sa vie. Elle regarde ces enfants et voit les chemins différents qu'ils empruntent pour trouver leur place dans ce pays où ils sont nés mais qui ne les accepte pas complètement.
L'histoire de Consolée met en lumière les rapports ambiguës que les Belges ont entretenu avec les enfants métisses. Issus d'un parent blanc, ils ont chercher à la éduquer comme des blancs mais sans pour autant les considérer totalement comme leur semblable. Avec un volonté de charité teinté de racisme, les autorités arrachent des enfants à leur mère et les privent ainsi de leurs racines. Ces enfants au sang mêlé, fruit d'amours désapprouvés, n'ont leur place nulle part.
Les héroïnes de ce roman m'ont émue par leurs questionnements et leurs errances. Elles ont vécu plusieurs vies, changée de trajectoire pour mieux rebondir. Elles sont en constante réinvention, prisonnière du regard d'une société qui ne réussit pas à faire le deuil de ses colonies. Leur rencontre fait émerger des questionnements intéressants, des discussions importantes. Si l'autrice ne propose pas de réponse, elle ouvre des pistes de réflexions salutaires. Elle montre avec force les obstacles et les dilemmes qui jalonnent la vie des français issues de immigration. J'ai pris énormément de plaisir à lire ce livre pour ces personnages attachants mais aussi pour son sujet si bien traité.
En 1954, au Rwanda, Consolée, une enfant issue d'un père blanc et d'une mère rwandaise est envoyée dans une école pour « enfant mulâtres ». Retirée à sa famille et confiée aux soins de religieuses, elle découvre brutalement une nouvelle culture et de nouvelles règles. Soixante-cinq ans plus tard, Ramata arrive dans une maison de retraite pour y animer des ateliers d'art thérapie. Parmi les pensionnaires, l'une d'elle l'intrigue. Il s'agit de madame Astrida, une métisse atteinte d'Alzheimer qui oublie progressivement le français au profil d'une langue inconnue. Ramata tente de retrouver le passé de cette femme et ce confronte en même temps à sa propre histoire.
En suivant le destin d'Astrida et de Ramata, nous reconstituons progressivement le puzzle de vie marquée par le déracinement et le racisme. L'autrice explore la manière dont les préjugés et la xénophobie influent sur le destin des personnes. Ramata comme Astrida se construisent avec le poids de la haine et des attentes des autres. Ramata, progressivement, change son regard sur sa propre personne, prend conscience de ce qui l'amené à devenir cette femme là. Elle réfléchit au racisme ordinaire et à l'impact qu'il a eut sur sa vie. Elle regarde ces enfants et voit les chemins différents qu'ils empruntent pour trouver leur place dans ce pays où ils sont nés mais qui ne les accepte pas complètement.
L'histoire de Consolée met en lumière les rapports ambiguës que les Belges ont entretenu avec les enfants métisses. Issus d'un parent blanc, ils ont chercher à la éduquer comme des blancs mais sans pour autant les considérer totalement comme leur semblable. Avec un volonté de charité teinté de racisme, les autorités arrachent des enfants à leur mère et les privent ainsi de leurs racines. Ces enfants au sang mêlé, fruit d'amours désapprouvés, n'ont leur place nulle part.
Les héroïnes de ce roman m'ont émue par leurs questionnements et leurs errances. Elles ont vécu plusieurs vies, changée de trajectoire pour mieux rebondir. Elles sont en constante réinvention, prisonnière du regard d'une société qui ne réussit pas à faire le deuil de ses colonies. Leur rencontre fait émerger des questionnements intéressants, des discussions importantes. Si l'autrice ne propose pas de réponse, elle ouvre des pistes de réflexions salutaires. Elle montre avec force les obstacles et les dilemmes qui jalonnent la vie des français issues de immigration. J'ai pris énormément de plaisir à lire ce livre pour ces personnages attachants mais aussi pour son sujet si bien traité.
C'est l'histoire d'une langue perdue et d'une langue retrouvée. Mme Astrida est une vieille dame métisse en fin de vie dans un EHPAD, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Au fur et à mesure que sa mémoire s'envole, elle perd l'usage de son français alors qu'une langue inconnue de tous émerge. Ramata, quinquagénaire noire en reconversion professionnelle, propose un stage d'art-thérapie dans cet EHPAD. Irrésistiblement attirée par Mme Astrida, elle décide d'enquêter sur elle, remontant progressivement vers la vérité de racines de l'histoire de la vieille femme, à l'époque de la colonisation belge en Afrique centrale.
Beata Unubyeyi Mairesse met un lumière une réalité médicale d'une ampleur importante mais méconnuz du grand public. Les personnes d'origine immigrée - qu'elles soient africaines, asiatiques ou européennes - atteintes de maladie neuro-dégénérative, oublient leur français lorsque c'est leur deuxième langue, et ne s'expriment plus que dans leur langue maternelle, même si cette dernière n'était plus pratiquée depuis des décennies. Les pays anglo-saxons ont déjà mis sur pied des programmes spécifiques pour améliorer la prise en charge de ces patients. En France, cette approche interculturelle du soin gérontologique tarde, comme si on n'avait jamais pensé aux immigrés comme des personnes susceptibles de vieillir dans leur pays d'accueil.
Mme Astrida est née au Rwanda et à l'instar de près de 20.000 autres enfants, elle a été placée dans un orphelinat pour mulâtres ( pères blancs, mères noires ) où des missionnaires les ont coupés de leur culture africaine, de leur langue, avant de les déporter en Belgique pour les faire adopter sans l'accord de leurs parents en 1959, juste avant l'indépendance du pays. Ramata, elle, est née au Sénégal et a immigré en France en 1975 pour suivre un père ouvrier dans l'usine Ford de Bordeaux. Elle aussi a connu le déracinement linguistique :
« Quand on émigre, les visages changent, les paysages sont remplacés par d'autres, les goûts se transforment mais on oublie souvent de dire combien les sons aussi nous perdent, nous devons fermer le rideau ondulant des voyelles et apprendre à grimper sur un mur de consonnes gutturales et, en passant de l'un à l'autre, nous nous trouvons affublées d'un boitement disgracieux qui s'incrustera durablement dans notre prononciation d'exilées. Comment pouvait-on changer d'environnement sonore en une seule vie, passer d'un monde à l'autre, s'adapter toujours sans devenir muet ? »
Par l'alternance des chapitres 1954 / 2019, l'autrice fait résonner les vies de Mme Astrida et de Ramata. L'Histoire ne se découpe pas en tranches distinctes, elle tisse des liens entre passé et présent, le passé irriguant certains traumatismes toujours très actuels. C'est la langue qui est au coeur de ce très riche récit qui questionne plus largement, avec beaucoup de justesse, les questions sensibles qui gravitent autour de l'immigration, du racisme, de la colonisation et de la transmission générationnelle.
Les chapitres sur Mme Astrida, notamment ceux évoquant son paradis perdu, plein de couleurs, de saveurs et d'oiseaux avant le chagrin dans l'orphelinat de Save, qui m'ont le plus touchés. Mme Astrida est un très beau personnage dont le parcours ne peut que toucher.
Par contre, j'ai trouvé le reste du casting moins convaincant car on sent trop qu'il a été construit pour démontrer. Ils font « personnages » et l'autrice a tendance à surexpliquer leur profil : Ramata, la femme noire transfuge de classe qui étouffe sous le conditionnement des injonctions de sa mère ( « Tais-toi, écoute, surtout ne te fais pas remarquer, on n'est pas chez nous » ) et qui affiche une méritocratie color blind avant de faire un burn out ; son mari musulman comme elle mais d'origine maghrébine, plus stoïque face au racisme qu'il a pu subir ; et surtout leur fille.
Inès aurait pu être un personnage passionnant, étudiante brillante qui décide de se voiler après les attentats de Charlie Hebdo pour affirmer son identité et ne plus raser les murs comme ses parents. Mais au final, je trouve ce personnage de trop dans le récit qu'il alourdit alors que tout ce qu'en dit Beata Unubyeyi Mairesse est pertinent et fort. Dans doute le roman étreint-il trop d'intentions comme s'il visait une quasi exhaustivité sur les sujets de l'immigration et du racisme. J'aurais préféré qu'il se concentre sur Mme Astrida à laquelle il offre un très belle fin, apaisante et lumineuse.
Beata Unubyeyi Mairesse met un lumière une réalité médicale d'une ampleur importante mais méconnuz du grand public. Les personnes d'origine immigrée - qu'elles soient africaines, asiatiques ou européennes - atteintes de maladie neuro-dégénérative, oublient leur français lorsque c'est leur deuxième langue, et ne s'expriment plus que dans leur langue maternelle, même si cette dernière n'était plus pratiquée depuis des décennies. Les pays anglo-saxons ont déjà mis sur pied des programmes spécifiques pour améliorer la prise en charge de ces patients. En France, cette approche interculturelle du soin gérontologique tarde, comme si on n'avait jamais pensé aux immigrés comme des personnes susceptibles de vieillir dans leur pays d'accueil.
Mme Astrida est née au Rwanda et à l'instar de près de 20.000 autres enfants, elle a été placée dans un orphelinat pour mulâtres ( pères blancs, mères noires ) où des missionnaires les ont coupés de leur culture africaine, de leur langue, avant de les déporter en Belgique pour les faire adopter sans l'accord de leurs parents en 1959, juste avant l'indépendance du pays. Ramata, elle, est née au Sénégal et a immigré en France en 1975 pour suivre un père ouvrier dans l'usine Ford de Bordeaux. Elle aussi a connu le déracinement linguistique :
« Quand on émigre, les visages changent, les paysages sont remplacés par d'autres, les goûts se transforment mais on oublie souvent de dire combien les sons aussi nous perdent, nous devons fermer le rideau ondulant des voyelles et apprendre à grimper sur un mur de consonnes gutturales et, en passant de l'un à l'autre, nous nous trouvons affublées d'un boitement disgracieux qui s'incrustera durablement dans notre prononciation d'exilées. Comment pouvait-on changer d'environnement sonore en une seule vie, passer d'un monde à l'autre, s'adapter toujours sans devenir muet ? »
Par l'alternance des chapitres 1954 / 2019, l'autrice fait résonner les vies de Mme Astrida et de Ramata. L'Histoire ne se découpe pas en tranches distinctes, elle tisse des liens entre passé et présent, le passé irriguant certains traumatismes toujours très actuels. C'est la langue qui est au coeur de ce très riche récit qui questionne plus largement, avec beaucoup de justesse, les questions sensibles qui gravitent autour de l'immigration, du racisme, de la colonisation et de la transmission générationnelle.
Les chapitres sur Mme Astrida, notamment ceux évoquant son paradis perdu, plein de couleurs, de saveurs et d'oiseaux avant le chagrin dans l'orphelinat de Save, qui m'ont le plus touchés. Mme Astrida est un très beau personnage dont le parcours ne peut que toucher.
Par contre, j'ai trouvé le reste du casting moins convaincant car on sent trop qu'il a été construit pour démontrer. Ils font « personnages » et l'autrice a tendance à surexpliquer leur profil : Ramata, la femme noire transfuge de classe qui étouffe sous le conditionnement des injonctions de sa mère ( « Tais-toi, écoute, surtout ne te fais pas remarquer, on n'est pas chez nous » ) et qui affiche une méritocratie color blind avant de faire un burn out ; son mari musulman comme elle mais d'origine maghrébine, plus stoïque face au racisme qu'il a pu subir ; et surtout leur fille.
Inès aurait pu être un personnage passionnant, étudiante brillante qui décide de se voiler après les attentats de Charlie Hebdo pour affirmer son identité et ne plus raser les murs comme ses parents. Mais au final, je trouve ce personnage de trop dans le récit qu'il alourdit alors que tout ce qu'en dit Beata Unubyeyi Mairesse est pertinent et fort. Dans doute le roman étreint-il trop d'intentions comme s'il visait une quasi exhaustivité sur les sujets de l'immigration et du racisme. J'aurais préféré qu'il se concentre sur Mme Astrida à laquelle il offre un très belle fin, apaisante et lumineuse.
Je vais le dire je pense à chacun de ces livres, mais une histoire particulière s'est nouée entre cette auteure et moi. Je l'ai découverte par un recueil de nouvelles et j'ai depuis suivi son parcours, attendant chaque prochaine étape avec impatience. Nous voici à celle du deuxième roman, étape essentielle s'il en est, presque aussi importante que le premier. L'étape de la confirmation, de l'installation dans ce genre qui reste phare dans notre littérature, cette capacité à s'installer dans une histoire longue, à y emmener avec elle son lecteur.
Telle une championne olympique de littérature, Beata transforme l'essai (oui je sais c'est au rugby qui n'est pas olympique, mais l'auteure a fait sa vie en France à Bordeaux, donc le lien est aussi logique). Après la lecture de Tous tes enfants dispersés, je n'avais plus la crainte du passage à la forme longue. Ici, pour le coup, elle prend ses aises, gagne encore une centaine de pages sans en avoir l'air, conserve toute la force de sa phrase que j'aime dire complexe dans sa simplicité.Ce style contamine d'ailleurs heureusement ses thématiques, puisque d'un résumé qui pourrait paraître simple, abordant majoritairement les questions du métissage et de la migration, elle y mêle des passages essentiels sur la façon dont on traite nos ainés (précédant sans doute le scandale Orpea vu le temps que prend la rédaction d'un livre), sur la maladie d'Alzheimer, sur le burn out et la reconversion, sur le voile, sur le multilinguisme...
Alors que dans le premier roman on pouvait identifier assez aisément les parts autobiographiques, Beata brouille un peu les pistes, se diffusant au sein de son histoire en laissant prendre à ses personnages le premier plan, qu'il s'agisse d'Astrida la grand-mère isolée dans son EHPAD, de Ramata la Sénégalaise rêvant tellement d'intégration qu'elle s'en est désintégrée, de Consolée l'enfant métisse du Rwanda qui donne son titre au livre et sa conclusion à l'histoire. Comme dans le premier roman, la narration à plusieurs voix convient bien au style comme à l'histoire. On met du temps à comprendre le sens de l'enquête de Ramata auprès d'Astrida alors qu'on a l'impression d'avoir déjà tout compris en lecteur omniscient... mais les boîtes de photos cachent bien des secrets qui ne nous seront d'ailleurs révélés qu'à nous, parce que contrairement à ces personnages enfermés dans le petit monde qu'elle a créé, nous avons de notre côté l'insigne honneur de vivre dans le même monde que Mme Umubyeyi Mairesse (oui je reprend la solennité du nom de famille pour la fin).
J'espère fortement qu'elle me fera le plaisir de revenir à la Comédie du Livre en 2023 après son passage uniquement virtuel (cause COVID) à celle de 2021. J'ai quatre livres à faire dédicacer, des conversations rêvées sur le sens des prénoms et des noms de famille, sur la vie à Lille et à Bordeaux (deux villes que le hasard a mis sur nos deux routes) et surtout sur les émotions dans lesquelles son écriture me transporte à chaque lecture.
Telle une championne olympique de littérature, Beata transforme l'essai (oui je sais c'est au rugby qui n'est pas olympique, mais l'auteure a fait sa vie en France à Bordeaux, donc le lien est aussi logique). Après la lecture de Tous tes enfants dispersés, je n'avais plus la crainte du passage à la forme longue. Ici, pour le coup, elle prend ses aises, gagne encore une centaine de pages sans en avoir l'air, conserve toute la force de sa phrase que j'aime dire complexe dans sa simplicité.Ce style contamine d'ailleurs heureusement ses thématiques, puisque d'un résumé qui pourrait paraître simple, abordant majoritairement les questions du métissage et de la migration, elle y mêle des passages essentiels sur la façon dont on traite nos ainés (précédant sans doute le scandale Orpea vu le temps que prend la rédaction d'un livre), sur la maladie d'Alzheimer, sur le burn out et la reconversion, sur le voile, sur le multilinguisme...
Alors que dans le premier roman on pouvait identifier assez aisément les parts autobiographiques, Beata brouille un peu les pistes, se diffusant au sein de son histoire en laissant prendre à ses personnages le premier plan, qu'il s'agisse d'Astrida la grand-mère isolée dans son EHPAD, de Ramata la Sénégalaise rêvant tellement d'intégration qu'elle s'en est désintégrée, de Consolée l'enfant métisse du Rwanda qui donne son titre au livre et sa conclusion à l'histoire. Comme dans le premier roman, la narration à plusieurs voix convient bien au style comme à l'histoire. On met du temps à comprendre le sens de l'enquête de Ramata auprès d'Astrida alors qu'on a l'impression d'avoir déjà tout compris en lecteur omniscient... mais les boîtes de photos cachent bien des secrets qui ne nous seront d'ailleurs révélés qu'à nous, parce que contrairement à ces personnages enfermés dans le petit monde qu'elle a créé, nous avons de notre côté l'insigne honneur de vivre dans le même monde que Mme Umubyeyi Mairesse (oui je reprend la solennité du nom de famille pour la fin).
J'espère fortement qu'elle me fera le plaisir de revenir à la Comédie du Livre en 2023 après son passage uniquement virtuel (cause COVID) à celle de 2021. J'ai quatre livres à faire dédicacer, des conversations rêvées sur le sens des prénoms et des noms de famille, sur la vie à Lille et à Bordeaux (deux villes que le hasard a mis sur nos deux routes) et surtout sur les émotions dans lesquelles son écriture me transporte à chaque lecture.
Après avoir travaillé 14 ans en gériatrie, je ne pouvais qu'être séduite par ce roman se déroulant dans un Ehpad. Des personnes, comme Astrida, qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, j'ai pu en croiser de nombreuses fois. Ces personnalités sont touchantes. Ayant perdu le fil de leur mémoire, elles tentent de se raccrocher au moindre souvenir.
Dans cette histoire, le passé douloureux du Rwanda des années 50 est reconstitué par Ramata, art-thérapeute. Nous plongeant dans les conditions de vie des enfants d'immigrés, l'autrice fait de ce texte une réflexion sur les origines et l'importance des mémoires.
Consolée, émouvant, qui se dévore sans hésiter. Les pages défilent, les récits s'alternent aisément pour marquer les esprits d'un destin si particulier. N'oublions pas que ces institutions pour ‘enfants mulâtres' ont vraiment existé !
« C'est le nom qui les regroupe tous et toutes dans cette grande maison où les teints divers, les cheveux châtains bouclés ou noirs crépus, les peaux plus sombres ou plus claires, tout l'éventail des possibles entre le rose de leurs pères et le marron de leurs mères constitue une étrange volière d'oiseaux bigarrés. »
http://www.mesecritsdunjour.com/archives/2022/11/03/39695329.html
Lien : http://www.mesecritsdunjour...
Dans cette histoire, le passé douloureux du Rwanda des années 50 est reconstitué par Ramata, art-thérapeute. Nous plongeant dans les conditions de vie des enfants d'immigrés, l'autrice fait de ce texte une réflexion sur les origines et l'importance des mémoires.
Consolée, émouvant, qui se dévore sans hésiter. Les pages défilent, les récits s'alternent aisément pour marquer les esprits d'un destin si particulier. N'oublions pas que ces institutions pour ‘enfants mulâtres' ont vraiment existé !
« C'est le nom qui les regroupe tous et toutes dans cette grande maison où les teints divers, les cheveux châtains bouclés ou noirs crépus, les peaux plus sombres ou plus claires, tout l'éventail des possibles entre le rose de leurs pères et le marron de leurs mères constitue une étrange volière d'oiseaux bigarrés. »
http://www.mesecritsdunjour.com/archives/2022/11/03/39695329.html
Lien : http://www.mesecritsdunjour...
Tout d'abord, merci à Babelio et aux Éditions Autrement pour l'envoi de ce titre dans le cadre d'une opération Masse Critique. Il me tardait de découvrir l'écriture de cette autrice franco-rwandaise.
Consolée est un roman à plusieurs voix.
D'un côté, nous suivons l'histoire de Consolée, née au Rwanda alors sous tutelle belge (1954), d'un père Blanc dont elle ne sait rien et d'une mère Rwandaise. Quelques années plus tard, elle est retirée à sa famille et placée dans une institution pour « enfants mulâtres ».
De l'autre, nous sommes en 2019, dans une maison de repos du Sud de la France et nous faisons la rencontre de Ramata, ancienne femme d'affaire en reconversion professionnelle d'art-thérapie et d'origine sénégalaise. Dans le cadre de son stage, elle fait la connaissance d'Astrida, une vieille femme métisse atteinte d'Alzheimer. Délaissant de plus en plus le français, elle s'exprime régulièrement dans une langue inconnue. Ramata va se prendre d'affection pour elle et, en tentant d'éclaircir les mystères de sa vie, va se confronter à sa propre histoire.
Consolée est un roman que j'ai lu plus pour son fond que pour sa forme. En effet, si le sujet des conséquences de la colonisation, du point de vue intérieur, est de plus en plus souvent abordé (et c'est tant mieux), je n'avais par contre jamais rien lu au sujet de ces enfants retirés à leur famille. Comment se construire quand on a vécu un tel déracinement familial et culturel ? le contexte historique est intéressant. L'autrice aborde également d'autres sujets comme par exemple la privatisation des homes pour personnes âgées, la rentabilité imposée aux “soignant-es”.
Quant à la forme, l'écriture est fluide et sans fioriture, ce qui rend ce roman très accessible. Si sa lecture est assez rapide et a le mérite d'ouvrir la réflexion, mon sentiment global reste un chouias mitigé. D'un point de vue totalement personnel, je préfère les constructions où une certaine tension est présente, où l'on donnerait n'importe quoi pour connaître les raisons d'un état / le dénouement d'une histoire. Plus j'avançais dans ce récit, plus mon intérêt décroissait. Une fois le contexte historique exposé et la psychologie des personnages comprise, la suite m'est apparue moins intéressante, voire parfois tirée en longueur.
Consolée est un roman à plusieurs voix.
D'un côté, nous suivons l'histoire de Consolée, née au Rwanda alors sous tutelle belge (1954), d'un père Blanc dont elle ne sait rien et d'une mère Rwandaise. Quelques années plus tard, elle est retirée à sa famille et placée dans une institution pour « enfants mulâtres ».
De l'autre, nous sommes en 2019, dans une maison de repos du Sud de la France et nous faisons la rencontre de Ramata, ancienne femme d'affaire en reconversion professionnelle d'art-thérapie et d'origine sénégalaise. Dans le cadre de son stage, elle fait la connaissance d'Astrida, une vieille femme métisse atteinte d'Alzheimer. Délaissant de plus en plus le français, elle s'exprime régulièrement dans une langue inconnue. Ramata va se prendre d'affection pour elle et, en tentant d'éclaircir les mystères de sa vie, va se confronter à sa propre histoire.
Consolée est un roman que j'ai lu plus pour son fond que pour sa forme. En effet, si le sujet des conséquences de la colonisation, du point de vue intérieur, est de plus en plus souvent abordé (et c'est tant mieux), je n'avais par contre jamais rien lu au sujet de ces enfants retirés à leur famille. Comment se construire quand on a vécu un tel déracinement familial et culturel ? le contexte historique est intéressant. L'autrice aborde également d'autres sujets comme par exemple la privatisation des homes pour personnes âgées, la rentabilité imposée aux “soignant-es”.
Quant à la forme, l'écriture est fluide et sans fioriture, ce qui rend ce roman très accessible. Si sa lecture est assez rapide et a le mérite d'ouvrir la réflexion, mon sentiment global reste un chouias mitigé. D'un point de vue totalement personnel, je préfère les constructions où une certaine tension est présente, où l'on donnerait n'importe quoi pour connaître les raisons d'un état / le dénouement d'une histoire. Plus j'avançais dans ce récit, plus mon intérêt décroissait. Une fois le contexte historique exposé et la psychologie des personnages comprise, la suite m'est apparue moins intéressante, voire parfois tirée en longueur.
Avec Consolée, Beata Umubyeyi Mairesse remonte encore davantage le temps qu'avec Tous tes enfants dispersés, et nous conte cette fois une autre part sombre du Rwanda, faisant partie à l'époque, en 1954, de la colonie belge nommée Ruanda-Urundi, dans laquelle les enfants issus de femmes rwandaises et d'hommes principalement belges, mais aussi grecs, italiens..., étaient retirés à leur mère pour être envoyés dans des institutions destinées à les éduquer à la mode occidentale.
Ainsi de Consolée, petite fille qui devra quitter subitement sa mère, plus encore son grand-père adoré, pour devenir l'une de ces enfants mulâtres sans famille, qui va découvrir un autre univers, bien plus dur, et plus que déshumanisant. Dans le même temps, soixante-cinq ans plus tard, Ramata, devenue depuis peu art-thérapeute suite à un burn-out alors qu'elle était cadre dans une administration, rencontre dans l'EHPAD où elle réalise son stage Astrida, vieille dame à la maladie d'Alzheimer, qui parle de plus en plus en raison de sa maladie une langue inconnue, et qui va rapidement l'intriguer.
Avec ce nouveau roman, j'ai été une fois de plus bercée par la beauté poétique dont sait si bien faire preuve l'autrice pour nous conter pourtant tout sauf la beauté, du moins dans le sort qui a été réservé à ces enfants, car ce roman, au contraire du précédent, est profondément moins violent : la douceur d'Astrida, contrebalançant une partie de la vie volée de Consolée, y est peut-être pour quelque chose. de même que l'alternance des voix entre les trois femmes/enfant centrales de celui-ci, qui décrit avec beaucoup de justesse la condition noire - Amata est d'origine sénégalaise - ou métisse, soulevant les mêmes préjugés, les mêmes remarques, les mêmes comportements plus ou moins consciemment racistes, au fil des époques, aborde toutes ces thématiques avec une certaine douceur paradoxale, et invite à la réflexion avec beaucoup de justesse et de sagesse.
Troisième lecture, troisième superbe découverte. Vivement le prochain !
Ainsi de Consolée, petite fille qui devra quitter subitement sa mère, plus encore son grand-père adoré, pour devenir l'une de ces enfants mulâtres sans famille, qui va découvrir un autre univers, bien plus dur, et plus que déshumanisant. Dans le même temps, soixante-cinq ans plus tard, Ramata, devenue depuis peu art-thérapeute suite à un burn-out alors qu'elle était cadre dans une administration, rencontre dans l'EHPAD où elle réalise son stage Astrida, vieille dame à la maladie d'Alzheimer, qui parle de plus en plus en raison de sa maladie une langue inconnue, et qui va rapidement l'intriguer.
Avec ce nouveau roman, j'ai été une fois de plus bercée par la beauté poétique dont sait si bien faire preuve l'autrice pour nous conter pourtant tout sauf la beauté, du moins dans le sort qui a été réservé à ces enfants, car ce roman, au contraire du précédent, est profondément moins violent : la douceur d'Astrida, contrebalançant une partie de la vie volée de Consolée, y est peut-être pour quelque chose. de même que l'alternance des voix entre les trois femmes/enfant centrales de celui-ci, qui décrit avec beaucoup de justesse la condition noire - Amata est d'origine sénégalaise - ou métisse, soulevant les mêmes préjugés, les mêmes remarques, les mêmes comportements plus ou moins consciemment racistes, au fil des époques, aborde toutes ces thématiques avec une certaine douceur paradoxale, et invite à la réflexion avec beaucoup de justesse et de sagesse.
Troisième lecture, troisième superbe découverte. Vivement le prochain !
« Au moment où leurs silhouettes atteignent le sommet de la colline, une araignée entreprend de tisser une toile qui scintillera bientôt sous la lune, entre les branches les plus basses du ficus centenaire. »
Une araignée élaborant sa toile comme l'écrivaine aura tissé son texte…, l'image surgissant dans les très émouvantes dernières pages du roman (mais c'est promis, on ne vous en dira pas plus, sur cette fin !) a d'autant plus valeur métaphorique que la trame du récit est complexe, jonglant avec les temporalités, sur plus de soixante ans d'écart, comme avec les espaces, entre les deux côtés de l'Afrique, la Belgique et la région de Bordeaux, sans que jamais, pourtant, l'on ne s'y perde. Mais cette toile narrative est aussi un piège, comme celle de l'araignée, puisque, au-delà du plaisir que l'on éprouve à lire cette histoire, c'est tout un faisceau de questions qu'elle fait naître, nous invitant à reconsidérer les effets – les méfaits…- du colonialisme et le racisme vécu par les immigrés, comme à découvrir la difficulté du travail de mémoire et de transmission pour les plus âgés d'entre eux. Une toile, enfin, brodée d'une poésie capable de concilier gravité et humour, tendresse et violence, un texte tressé d'un fil d'écriture tendu de Consolée à Astrida – ou peut-être est-ce l'inverse ? – sur lequel pourrait venir se poser l'oiseau Sakabaka, le messager du grand-père rwandais…
En 2019, alors qu'elle atteint la cinquantaine, Ramata, une femme d'origine sénégalaise, ayant fait toute sa carrière comme cadre dans une collectivité territoriale avant d'y être victime de harcèlement et d'un burn-out, décide d'abandonner cette vie professionnelle pour devenir art-thérapeute. Au cours d'un stage dans un Ehpad du Sud-Ouest, elle rencontre, parmi ses patients, Astrida, une vieille femme métisse, atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui semble perdre peu à peu, en même temps que la mémoire proche, l'usage du français, y substituant une langue inconnue. Intriguée par cette femme qui manifeste d'emblée de l'affection à son égard, elle décide d'enquêter sur son passé…
le récit, dès lors, fait alterner d'un chapitre à l'autre l'évocation de cette quête de Ramata - qui découvre qu'en fouillant l'histoire d'Astrida, c'est aussi la propre histoire de sa famille qui remonte à la surface, de l'arrivée de son père sénégalais en France et du racisme vécu alors au quotidien à la révolte de sa fille Inès, toujours confrontée au renvoi à son « origine », et dont elle ne partage pas le choix du voile, en passant par son mariage avec Khalil, le maghrébin, lui-même obligé de se battre contre la xénophobie – et les réminiscences du passé d'Astrida, la petite fille rwandaise, baptisée Consolée, à qui l'on impose ce nouveau prénom lorsqu'on la conduit à l'institut pour enfants « mulâtres » de Save, afin de la préserver des préjugés des villageois, dans une société où les métisses, fruit des abus sexuels des colons, sont mal considérés. Au fil des pages, dans ce décor de l'Ehpad auquel Beata Umubyeyi Mairesse sait pleinement donner vie, évoquant la réalité du quotidien et les souffrances des patients ou des soignants, s'instaure ainsi tout un jeu d'échos entre les destins de Ramata et de sa famille sénégalaise et celui de Consolée-Astrida, la rwandaise rapatriée d'urgence en Belgique peu avant l'indépendance de son pays natal et qui, adoptée par un couple de flamands, construira peu à peu son autonomie dans une Belgique puis une France encore hantées par les fantômes et les fantasmes de leur passé colonial. En recomposant l'aventure de vie d'Astrida, c'est bien son propre chemin d'existence que retrouve Ramata, montrant à quel,point notre société peut rendre encore ces parcours d'intégration difficiles à qui vient de loin. Un texte qui nous engage, de la sorte, à corriger notre regard, mais qui, en même temps, porté par la délicatesse des mots de Beata Umubyeyi Mairesse, se dévore avec plaisir… N'hésitez plus, allez à la rencontre de Consolée !
Une araignée élaborant sa toile comme l'écrivaine aura tissé son texte…, l'image surgissant dans les très émouvantes dernières pages du roman (mais c'est promis, on ne vous en dira pas plus, sur cette fin !) a d'autant plus valeur métaphorique que la trame du récit est complexe, jonglant avec les temporalités, sur plus de soixante ans d'écart, comme avec les espaces, entre les deux côtés de l'Afrique, la Belgique et la région de Bordeaux, sans que jamais, pourtant, l'on ne s'y perde. Mais cette toile narrative est aussi un piège, comme celle de l'araignée, puisque, au-delà du plaisir que l'on éprouve à lire cette histoire, c'est tout un faisceau de questions qu'elle fait naître, nous invitant à reconsidérer les effets – les méfaits…- du colonialisme et le racisme vécu par les immigrés, comme à découvrir la difficulté du travail de mémoire et de transmission pour les plus âgés d'entre eux. Une toile, enfin, brodée d'une poésie capable de concilier gravité et humour, tendresse et violence, un texte tressé d'un fil d'écriture tendu de Consolée à Astrida – ou peut-être est-ce l'inverse ? – sur lequel pourrait venir se poser l'oiseau Sakabaka, le messager du grand-père rwandais…
En 2019, alors qu'elle atteint la cinquantaine, Ramata, une femme d'origine sénégalaise, ayant fait toute sa carrière comme cadre dans une collectivité territoriale avant d'y être victime de harcèlement et d'un burn-out, décide d'abandonner cette vie professionnelle pour devenir art-thérapeute. Au cours d'un stage dans un Ehpad du Sud-Ouest, elle rencontre, parmi ses patients, Astrida, une vieille femme métisse, atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui semble perdre peu à peu, en même temps que la mémoire proche, l'usage du français, y substituant une langue inconnue. Intriguée par cette femme qui manifeste d'emblée de l'affection à son égard, elle décide d'enquêter sur son passé…
le récit, dès lors, fait alterner d'un chapitre à l'autre l'évocation de cette quête de Ramata - qui découvre qu'en fouillant l'histoire d'Astrida, c'est aussi la propre histoire de sa famille qui remonte à la surface, de l'arrivée de son père sénégalais en France et du racisme vécu alors au quotidien à la révolte de sa fille Inès, toujours confrontée au renvoi à son « origine », et dont elle ne partage pas le choix du voile, en passant par son mariage avec Khalil, le maghrébin, lui-même obligé de se battre contre la xénophobie – et les réminiscences du passé d'Astrida, la petite fille rwandaise, baptisée Consolée, à qui l'on impose ce nouveau prénom lorsqu'on la conduit à l'institut pour enfants « mulâtres » de Save, afin de la préserver des préjugés des villageois, dans une société où les métisses, fruit des abus sexuels des colons, sont mal considérés. Au fil des pages, dans ce décor de l'Ehpad auquel Beata Umubyeyi Mairesse sait pleinement donner vie, évoquant la réalité du quotidien et les souffrances des patients ou des soignants, s'instaure ainsi tout un jeu d'échos entre les destins de Ramata et de sa famille sénégalaise et celui de Consolée-Astrida, la rwandaise rapatriée d'urgence en Belgique peu avant l'indépendance de son pays natal et qui, adoptée par un couple de flamands, construira peu à peu son autonomie dans une Belgique puis une France encore hantées par les fantômes et les fantasmes de leur passé colonial. En recomposant l'aventure de vie d'Astrida, c'est bien son propre chemin d'existence que retrouve Ramata, montrant à quel,point notre société peut rendre encore ces parcours d'intégration difficiles à qui vient de loin. Un texte qui nous engage, de la sorte, à corriger notre regard, mais qui, en même temps, porté par la délicatesse des mots de Beata Umubyeyi Mairesse, se dévore avec plaisir… N'hésitez plus, allez à la rencontre de Consolée !
Mon année littéraire 2019 s'était achevée sur un énorme coup de coeur grâce à Tous tes enfants dispersés (2019), le premier roman de l'autrice franco-rwandaise Beata Umubyeyi Mairesse. Je vous laisse imaginer ma joie lorsque j'ai appris la publication de son deuxième roman.
Avec Consolée (2022), Beata Umubyeyi Mairesse (1979) signe un nouveau roman très fort et bouleversant d'humanité autour de ses thèmes de prédilection que sont d'une part l'exil, la perte de repères et la quête/crise identitaire et d'autre part, le langage, la mémoire, la filiation et la (non) transmission familiale.
Consolée se déroule en partie au sein d'un établissement d'hébergement bordelais pour personnes âgées dépendantes et s'articule successivement autour du quotidien de deux femmes venues d'ailleurs, la première étant une résidente septuagénaire métisse atteinte de troubles du langage et d'un début de démence, la seconde une stagiaire quinquagénaire noire en reconversion professionnelle.
A travers l'histoire de Consolée/Astrida Papailiaki qu'elle relate à la troisième personne du singulier en alternant son enfance dans les années cinquante au Ruanda-Urundi (actuel Rwanda) et sa fin de vie dans un Ehpad bordelais en 2019, Beata Umubyeyi Mairesse revient sur un pan méconnu et particulièrement sombre de l'histoire coloniale belge.
Des milliers d'enfants métis issus en grande majorité d'unions entre hommes blancs et femmes noires furent en effet victimes de la politique de ségrégation instaurée par la Belgique au sein de ses colonies africaines. Ces enfants furent volés, arrachés, à leurs mères noires pour être enfermés dans des missions religieuses où ils devaient renier leurs racines en oubliant leurs noms, leurs familles et leurs langues. Au moment des indépendances, ces milliers d'enfants furent rapatriés de force en Belgique où beaucoup d'entre eux, à défaut d'être mis sous tutelle comme annoncé, vécurent une vie de misère. En 2015, ce scandale d'Etat et d'Eglise longtemps tenu secret éclata en Belgique et fut porté devant les politiques par les Métis de Belgique regroupés en association.
Aujourd'hui, Consolée/Madame Astrida est une vieille femme à « la mémoire emmêlée » perdant progressivement l'usage du français. Elle ne s'exprime plus guère qu'en borborygmes et les quelques mots qu'elle prononce encore le sont dans une langue inconnue des soignants. Une stagiaire en art-thérapie, intriguée par la seule résidente « à la peau cuivrée », prend à coeur de découvrir l'histoire de cette femme solitaire délaissée par les soignants et de l'aider à sortir du silence avant qu'il ne soit trop tard, « que la maladie efface [sa] vie de femme, toute la mémoire d'une histoire dont elle était peut-être la dernière dépositaire, la seule survivante ».
Parallèlement à l'histoire de Consolée, Beata Umubyeyi Mairesse relate, à la première personne du singulier, le parcours de vie de Ramata Barry, une quinquagénaire française d'origine sénégalaise en reconversion professionnelle. Après son « grand effondrement », cette ancienne directrice dans une collectivité territoriale a ressenti le besoin de repartir de zéro pour reprendre sa vie en main et c'est en tant que art-thérapeute auprès des personnages âgées dépendantes qu'elle a choisi de se reconstruire.
A travers le parcours professionnel et familial de Ramata, l'autrice questionne de façon très intéressante les thématiques de la migration, de l'intégration et de l'assimilation. Bounty aliénée à la « mentalité de caméléon », Ramata se retrouve bien malgré elle confrontée aux difficultés d'être noire en France aujourd'hui. Bien qu'elle ait longtemps (sur)vécu grâce à une « armure, de diplômes d'abord, d'assurance ensuite, de négation enfin », toutes ses certitudes ont été progressivement remises en cause après son burn out, dans son nouveau milieu professionnel bien sûr mais également et de façon bien plus difficile au sein de sa propre famille. En effet, malgré sa lucidité nouvellement acquise, elle ne réussit pas à se positionner aux côtés de sa fille militante et encore moins à comprendre et accepter la décision radicale que celle-ci a prise.
A travers cette jeune femme qui revendique haut et fort ses racines sénégalaises et algériennes et se définit avec fierté comme une afro-descendante, Beata Umubyeyi Mairesse évoque la « politique de respectabilité », le « poids de l'illégitimité » et questionne le modèle d'intégration imposé à leurs enfants par les migrants de la première génération désireux de se fondre dans la masse sans faire de vagues. Si la mère est d'avis qu'il faut tourner la page de la colonisation et de l'esclavage, qu'il faut pardonner pour avancer, la fille remet fermement en question l'ascenseur social et la réussite professionnelle de sa mère. Au prix de quels renoncements et de quels mensonges a-t'elle réussi? En obéissant sans broncher aux injonctions d'effacement et d'excellence inculquées par ses parents, sa mère en apparence parfaite s'est trahie, reniant l'essence même de son existence.
« La religion de l'amnésie, c'est bien ton truc ça. Vous avez tous réussi votre vie, c'est clair! C'est pour ça que tu as pété un câble à ton boulot, que tu as dû te faire licencier pour inaptitude. Toi inapte? Toi le bourreau de travail qui faisait passer tes dossiers avant ta famille, qui as tant sacrifié -tes cheveux, ton sommeil, ton identité- pour gagner la respectabilité de ces gens qui à la première faille t'ont mise au placard puis à la poubelle? Wéééé, elle me fait pas envie ta réussite, maman, ta Lafrance là c'est un beau mirage. »
En confrontant le vécu de Consolée avec celui de Ramata, Beata Umubyeyi Mairesse aborde les questions douloureuses des racines, de l'appartenance culturelle et de la quête et/ou la crise identitaire. Si elles ont des parcours totalement opposés, Consolée et Ramata sont pourtant liées entre elles par une même aliénation familiale, culturelle ou encore linguistique. Alors que Consolée est confrontée à « l'effritement de sa mémoire » et cherche autant que possible à se raccrocher à des bribes de son enfance au Ruanda-Urundi, Ramata en revanche a volontairement occulté toutes traces de son passé et de ses racines. Paradoxalement, c'est pourtant elle qui démarre des recherches visant à faire la lumière sur le passé de Consolée.
Enfin, en situant son roman dans un Ehpad bordelais, l'un de ces nombreux « mouroir pour déglingués », l'autrice aborde le sort des personnes âgées et dénonce le « business de la vieillesse ». Elle met ainsi en exergue les mesures d'économies crasses prises au détriment de la santé des résidents, les mensonges révoltants servis aux familles, les réalités abjectes cachées derrières les images dorées.
Elle évoque par ailleurs les problèmes linguistiques croissants des résidents âgés dont le français n'est pas la langue maternelle et qui perdent progressivement l'acquisition de cette langue et s'interroge sur la pertinence de dispenser les soins gérontologiques en y intégrant une dimension interculturelle. Elle écrit de magnifiques passages sur l'importance de la langue en tant que vecteur social et culturel, sur la douleur liée à la parole sacrifiée et sur le besoin, en fin de vie, de retourner aux racines, à la langue d'origine.
Consolée est un roman d'une très grande richesse et d'une profonde et bouleversante humanité, un roman intelligent et lucide, sensible et généreux, un roman porté par une voix poétique, une voix qui me bouleverse et me touche à chaque fois en plein coeur.
Beata Umubyeyi Mairesse a encore une fois écrit un roman précieux, d'une beauté douloureuse, qui restera gravé dans mon coeur.
(A lire également sur le blog)
Lien : https://livrescapades.com/20..
Avec Consolée (2022), Beata Umubyeyi Mairesse (1979) signe un nouveau roman très fort et bouleversant d'humanité autour de ses thèmes de prédilection que sont d'une part l'exil, la perte de repères et la quête/crise identitaire et d'autre part, le langage, la mémoire, la filiation et la (non) transmission familiale.
Consolée se déroule en partie au sein d'un établissement d'hébergement bordelais pour personnes âgées dépendantes et s'articule successivement autour du quotidien de deux femmes venues d'ailleurs, la première étant une résidente septuagénaire métisse atteinte de troubles du langage et d'un début de démence, la seconde une stagiaire quinquagénaire noire en reconversion professionnelle.
A travers l'histoire de Consolée/Astrida Papailiaki qu'elle relate à la troisième personne du singulier en alternant son enfance dans les années cinquante au Ruanda-Urundi (actuel Rwanda) et sa fin de vie dans un Ehpad bordelais en 2019, Beata Umubyeyi Mairesse revient sur un pan méconnu et particulièrement sombre de l'histoire coloniale belge.
Des milliers d'enfants métis issus en grande majorité d'unions entre hommes blancs et femmes noires furent en effet victimes de la politique de ségrégation instaurée par la Belgique au sein de ses colonies africaines. Ces enfants furent volés, arrachés, à leurs mères noires pour être enfermés dans des missions religieuses où ils devaient renier leurs racines en oubliant leurs noms, leurs familles et leurs langues. Au moment des indépendances, ces milliers d'enfants furent rapatriés de force en Belgique où beaucoup d'entre eux, à défaut d'être mis sous tutelle comme annoncé, vécurent une vie de misère. En 2015, ce scandale d'Etat et d'Eglise longtemps tenu secret éclata en Belgique et fut porté devant les politiques par les Métis de Belgique regroupés en association.
Aujourd'hui, Consolée/Madame Astrida est une vieille femme à « la mémoire emmêlée » perdant progressivement l'usage du français. Elle ne s'exprime plus guère qu'en borborygmes et les quelques mots qu'elle prononce encore le sont dans une langue inconnue des soignants. Une stagiaire en art-thérapie, intriguée par la seule résidente « à la peau cuivrée », prend à coeur de découvrir l'histoire de cette femme solitaire délaissée par les soignants et de l'aider à sortir du silence avant qu'il ne soit trop tard, « que la maladie efface [sa] vie de femme, toute la mémoire d'une histoire dont elle était peut-être la dernière dépositaire, la seule survivante ».
Parallèlement à l'histoire de Consolée, Beata Umubyeyi Mairesse relate, à la première personne du singulier, le parcours de vie de Ramata Barry, une quinquagénaire française d'origine sénégalaise en reconversion professionnelle. Après son « grand effondrement », cette ancienne directrice dans une collectivité territoriale a ressenti le besoin de repartir de zéro pour reprendre sa vie en main et c'est en tant que art-thérapeute auprès des personnages âgées dépendantes qu'elle a choisi de se reconstruire.
A travers le parcours professionnel et familial de Ramata, l'autrice questionne de façon très intéressante les thématiques de la migration, de l'intégration et de l'assimilation. Bounty aliénée à la « mentalité de caméléon », Ramata se retrouve bien malgré elle confrontée aux difficultés d'être noire en France aujourd'hui. Bien qu'elle ait longtemps (sur)vécu grâce à une « armure, de diplômes d'abord, d'assurance ensuite, de négation enfin », toutes ses certitudes ont été progressivement remises en cause après son burn out, dans son nouveau milieu professionnel bien sûr mais également et de façon bien plus difficile au sein de sa propre famille. En effet, malgré sa lucidité nouvellement acquise, elle ne réussit pas à se positionner aux côtés de sa fille militante et encore moins à comprendre et accepter la décision radicale que celle-ci a prise.
A travers cette jeune femme qui revendique haut et fort ses racines sénégalaises et algériennes et se définit avec fierté comme une afro-descendante, Beata Umubyeyi Mairesse évoque la « politique de respectabilité », le « poids de l'illégitimité » et questionne le modèle d'intégration imposé à leurs enfants par les migrants de la première génération désireux de se fondre dans la masse sans faire de vagues. Si la mère est d'avis qu'il faut tourner la page de la colonisation et de l'esclavage, qu'il faut pardonner pour avancer, la fille remet fermement en question l'ascenseur social et la réussite professionnelle de sa mère. Au prix de quels renoncements et de quels mensonges a-t'elle réussi? En obéissant sans broncher aux injonctions d'effacement et d'excellence inculquées par ses parents, sa mère en apparence parfaite s'est trahie, reniant l'essence même de son existence.
« La religion de l'amnésie, c'est bien ton truc ça. Vous avez tous réussi votre vie, c'est clair! C'est pour ça que tu as pété un câble à ton boulot, que tu as dû te faire licencier pour inaptitude. Toi inapte? Toi le bourreau de travail qui faisait passer tes dossiers avant ta famille, qui as tant sacrifié -tes cheveux, ton sommeil, ton identité- pour gagner la respectabilité de ces gens qui à la première faille t'ont mise au placard puis à la poubelle? Wéééé, elle me fait pas envie ta réussite, maman, ta Lafrance là c'est un beau mirage. »
En confrontant le vécu de Consolée avec celui de Ramata, Beata Umubyeyi Mairesse aborde les questions douloureuses des racines, de l'appartenance culturelle et de la quête et/ou la crise identitaire. Si elles ont des parcours totalement opposés, Consolée et Ramata sont pourtant liées entre elles par une même aliénation familiale, culturelle ou encore linguistique. Alors que Consolée est confrontée à « l'effritement de sa mémoire » et cherche autant que possible à se raccrocher à des bribes de son enfance au Ruanda-Urundi, Ramata en revanche a volontairement occulté toutes traces de son passé et de ses racines. Paradoxalement, c'est pourtant elle qui démarre des recherches visant à faire la lumière sur le passé de Consolée.
Enfin, en situant son roman dans un Ehpad bordelais, l'un de ces nombreux « mouroir pour déglingués », l'autrice aborde le sort des personnes âgées et dénonce le « business de la vieillesse ». Elle met ainsi en exergue les mesures d'économies crasses prises au détriment de la santé des résidents, les mensonges révoltants servis aux familles, les réalités abjectes cachées derrières les images dorées.
Elle évoque par ailleurs les problèmes linguistiques croissants des résidents âgés dont le français n'est pas la langue maternelle et qui perdent progressivement l'acquisition de cette langue et s'interroge sur la pertinence de dispenser les soins gérontologiques en y intégrant une dimension interculturelle. Elle écrit de magnifiques passages sur l'importance de la langue en tant que vecteur social et culturel, sur la douleur liée à la parole sacrifiée et sur le besoin, en fin de vie, de retourner aux racines, à la langue d'origine.
Consolée est un roman d'une très grande richesse et d'une profonde et bouleversante humanité, un roman intelligent et lucide, sensible et généreux, un roman porté par une voix poétique, une voix qui me bouleverse et me touche à chaque fois en plein coeur.
Beata Umubyeyi Mairesse a encore une fois écrit un roman précieux, d'une beauté douloureuse, qui restera gravé dans mon coeur.
(A lire également sur le blog)
Lien : https://livrescapades.com/20..
Quel beau roman! J'avais lu précédemment EJO de la même auteure et avais déjà été plus que ravie de cette lecture et là, plonger dans l'Histoire du Rwanda via l'histoire d'une enfant mulâtre sous la domination belge des années 50/60 est extrêmement intéressant et touchant aussi.
Ramata, la cinquantaine, sort d'un burn-out et s'est engagée dans une reconversion professionnelle pour être art-thérapeute. Elle effectue un stage dans un EPHAD, Les Oiseaux, à Bordeaux. Et c'est dans ce lieu qu'elle rencontre Madame Astrida, perdue dans ses pensées et le nez tourné vers le ciel, en attente de quelque chose. Madame Astrida est atteinte de la maladie d'Alzheimer et cette femme va intriguer Ramata par plusieurs biais. Aider de la psychologue de l'EPHAD et de sa famille, Ramata va chercher à comprendre Madame Astrida, car celle-ci, à cause de sa maladie, ne se souvient que très peu du français appris et parle de plus en plus dans sa langue primaire. Mais quelle est-elle?
C'est un roman sur les racines, sur l'intolérance induite de la colonisation, de l'intégration forcée, du racisme "ordinaire". Ces enfants mulâtres existent jusqu'à un certain point et leur histoire familiale volée réapparait au fur et à mesure des archives ouvertes.
C'est aussi un formidable roman sur l'influence de l'immigration dans son attitude au quotidien pour s'intégrer mais aussi jusqu'où également peut-on accepté la "dissolution" dans le nouveau pays d'accueil?
Le personnage de Madame Astrida est extrêmement touchant et celui de Ramata et de sa fille sont puissants et révélateurs de ce qui peut se passer aujourd'hui dans notre société.
Il apporte beaucoup de matières à réflexions ce roman, j'ai vraiment beaucoup aimé me confronter à ce regard et ces mots qui posent tant de questions sociétales.
Laissez-vous emmener dans l'histoire de Madame Astrida, ça vaut le coup!
Merci aux Editions Autrement et à Masse Critique Babelio de m'avoir offert cette lecture si enrichissante!
Ramata, la cinquantaine, sort d'un burn-out et s'est engagée dans une reconversion professionnelle pour être art-thérapeute. Elle effectue un stage dans un EPHAD, Les Oiseaux, à Bordeaux. Et c'est dans ce lieu qu'elle rencontre Madame Astrida, perdue dans ses pensées et le nez tourné vers le ciel, en attente de quelque chose. Madame Astrida est atteinte de la maladie d'Alzheimer et cette femme va intriguer Ramata par plusieurs biais. Aider de la psychologue de l'EPHAD et de sa famille, Ramata va chercher à comprendre Madame Astrida, car celle-ci, à cause de sa maladie, ne se souvient que très peu du français appris et parle de plus en plus dans sa langue primaire. Mais quelle est-elle?
C'est un roman sur les racines, sur l'intolérance induite de la colonisation, de l'intégration forcée, du racisme "ordinaire". Ces enfants mulâtres existent jusqu'à un certain point et leur histoire familiale volée réapparait au fur et à mesure des archives ouvertes.
C'est aussi un formidable roman sur l'influence de l'immigration dans son attitude au quotidien pour s'intégrer mais aussi jusqu'où également peut-on accepté la "dissolution" dans le nouveau pays d'accueil?
Le personnage de Madame Astrida est extrêmement touchant et celui de Ramata et de sa fille sont puissants et révélateurs de ce qui peut se passer aujourd'hui dans notre société.
Il apporte beaucoup de matières à réflexions ce roman, j'ai vraiment beaucoup aimé me confronter à ce regard et ces mots qui posent tant de questions sociétales.
Laissez-vous emmener dans l'histoire de Madame Astrida, ça vaut le coup!
Merci aux Editions Autrement et à Masse Critique Babelio de m'avoir offert cette lecture si enrichissante!
Rentrée Littéraire 2022 Prix Talents Cultura 2022
Ramata, la cinquantaine, a quitté le Sénégal encore enfant pour la France. Elle a fait de brillantes études, a occupé de hautes fonctions dans une entreprise. Malgré tout, elle ne s'est jamais sentie intégrée, ni à sa place.
Elle a fini par faire un burn-out, a quitté son emploi et s'est tournée vers une reconversion professionnelle : l'art-thérapie.
C'est ainsi qu'elle se retrouve à faire un stage dans un Ehpad et à proposer des activités aux pensionnaires. le comportement d'une résidente l'interpelle. Madame Astrida, vieille femme métisse atteinte de la maladie d'Alzheimer, semble perdre l'usage du français et parle dans une langue inconnue.
Touchée par l'isolement de cette vieille dame, Ramata va tenter d'en savoir plus afin de pouvoir l'aider.
Elle va ainsi découvrir que Madame Astrida, est née au Rwanda d'un Blanc et d'une Rwandaise ; que selon la politique menée par le gouvernement belge pendant la colonisation, elle a été enlevée à sa mère pour être placée dans une institution pour enfant mulâtres.
L'autrice, Rwandaise elle-même et ayant échappé au génocide des Tutsi, révèle les atrocités commises envers ces enfants qui ont été traités comme des marchandises que l'on voulait faire disparaître du paysage et qui, par la suite, ont été adoptés par des couples en Belgique.
« Mais quand les hommes retournaient en Belgique ou changeaient d'affectation, les enfants nés de ces relations ‘interraciales » restaient là, trop visibles au sein de leurs familles maternelles noires. L'autorité coloniale se méfiait de ces métis et les considérait comme une dégénérescence pour la race blanche. Les « mulâtres » comme on disait alors, constituaient un problème que la Belgique n'avait pas prévu dans ses colonies. Leur nombre croissant inquiétait, car il mettait en danger la hiérarchie raciale, qui était le socle de l'organisation coloniale. «
Si la mise au jour de ce pan de l'histoire est nécessaire, c'est un autre aspect qui a le plus retenu mon attention.
Des études sur les compétences cognitives démontrent que les personnes âgées multilingues développent des troubles langagiers en priorité sur les langues tardivement acquises. La personne âgée ne sait plus s'exprimer que dans sa langue maternelle et n'est parfois plus compris par son conjoint (si couple mixte) ni même par ses enfants si ceux-ci n'ont pas appris la langue de leurs parents.
Dans notre monde de migration, choisie ou forcée, un nouveau problème de société est en train d'être révélé par des chercheurs en neurosciences canadiens.
» Consolée » est un roman qui parle de réparation symbolique, des langues qui constituent un être humain, nous fait découvrir l'histoire coloniale du Rwanda et met également en lumière les parcours des enfants issus de l'immigration en recherche d'intégration.
Un très beau roman dont Beate Umubyey Mairesse a remarquablement parlé lors de la remise des Talents Cultura le 8 Septembre dernier.
Je remercie les Editions Autrement et Cultura pour cette découverte.
Ramata, la cinquantaine, a quitté le Sénégal encore enfant pour la France. Elle a fait de brillantes études, a occupé de hautes fonctions dans une entreprise. Malgré tout, elle ne s'est jamais sentie intégrée, ni à sa place.
Elle a fini par faire un burn-out, a quitté son emploi et s'est tournée vers une reconversion professionnelle : l'art-thérapie.
C'est ainsi qu'elle se retrouve à faire un stage dans un Ehpad et à proposer des activités aux pensionnaires. le comportement d'une résidente l'interpelle. Madame Astrida, vieille femme métisse atteinte de la maladie d'Alzheimer, semble perdre l'usage du français et parle dans une langue inconnue.
Touchée par l'isolement de cette vieille dame, Ramata va tenter d'en savoir plus afin de pouvoir l'aider.
Elle va ainsi découvrir que Madame Astrida, est née au Rwanda d'un Blanc et d'une Rwandaise ; que selon la politique menée par le gouvernement belge pendant la colonisation, elle a été enlevée à sa mère pour être placée dans une institution pour enfant mulâtres.
L'autrice, Rwandaise elle-même et ayant échappé au génocide des Tutsi, révèle les atrocités commises envers ces enfants qui ont été traités comme des marchandises que l'on voulait faire disparaître du paysage et qui, par la suite, ont été adoptés par des couples en Belgique.
« Mais quand les hommes retournaient en Belgique ou changeaient d'affectation, les enfants nés de ces relations ‘interraciales » restaient là, trop visibles au sein de leurs familles maternelles noires. L'autorité coloniale se méfiait de ces métis et les considérait comme une dégénérescence pour la race blanche. Les « mulâtres » comme on disait alors, constituaient un problème que la Belgique n'avait pas prévu dans ses colonies. Leur nombre croissant inquiétait, car il mettait en danger la hiérarchie raciale, qui était le socle de l'organisation coloniale. «
Si la mise au jour de ce pan de l'histoire est nécessaire, c'est un autre aspect qui a le plus retenu mon attention.
Des études sur les compétences cognitives démontrent que les personnes âgées multilingues développent des troubles langagiers en priorité sur les langues tardivement acquises. La personne âgée ne sait plus s'exprimer que dans sa langue maternelle et n'est parfois plus compris par son conjoint (si couple mixte) ni même par ses enfants si ceux-ci n'ont pas appris la langue de leurs parents.
Dans notre monde de migration, choisie ou forcée, un nouveau problème de société est en train d'être révélé par des chercheurs en neurosciences canadiens.
» Consolée » est un roman qui parle de réparation symbolique, des langues qui constituent un être humain, nous fait découvrir l'histoire coloniale du Rwanda et met également en lumière les parcours des enfants issus de l'immigration en recherche d'intégration.
Un très beau roman dont Beate Umubyey Mairesse a remarquablement parlé lors de la remise des Talents Cultura le 8 Septembre dernier.
Je remercie les Editions Autrement et Cultura pour cette découverte.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Beata Umubyeyi Mairesse (9)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'Afrique dans la littérature
Dans quel pays d'Afrique se passe une aventure de Tintin ?
Le Congo
Le Mozambique
Le Kenya
La Mauritanie
10 questions
292 lecteurs ont répondu
Thèmes :
afriqueCréer un quiz sur ce livre292 lecteurs ont répondu