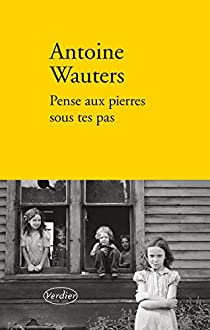>
Critique de odileriffaud
« Pense aux pierres sous tes pas » ou comment écrire une oeuvre littéraire au XXIe siècle
« Pense aux pierres sous tes pas », pense à « ce monde minéral suspendu dans l'espace »[1]. le livre qu'Antoine Wauters vient de publier aux éditions Verdier fait appel à la poésie et au conte pour décrire une utopie contemporaine. Où l'enjeu au XXIe siècle est d'atteindre le décentrement de l'homme vis-à-vis de son environnement ; de retrouver le sens du collectif loin des lieux de pouvoir ; de se réapproprier le langage pour qu'émerge l'oeuvre littéraire. Et si la littérature après le XXe siècle avait l'ambition d'être une « petite littérature » ?
Un « horizon primitif »
En préambule, le roman commence avec une carte intitulée « Entre ici et ailleurs, petite topographie de notre pays ». Un croquis qui représente par des traits de crayons enfantins un pays imaginaire. le situer « entre ici et ailleurs », c'est-à-dire ne pas le situer, c'est recréer « le pays imaginaire ». Bienvenue sur une île dont on ne sait pas le nom, dans un monde où la modernité est synonyme de destruction. Ouvrir le livre d'Antoine Wauters c'est comme observer par au-dessus une dictature miniature « massacrant la nature et piétinant le monde » (p. 176) qui serait située dans une autre unité de temps et de lieu – où les habitants ont leur propre dialecte, dont les sonorités empruntent au sarde ou au corse – pour mieux nous enseigner la radicalité du temps présent : la seule chose que l'on a sans jamais la posséder – ça et les autres. Cette utopie qui plaide pour un décentrement anthropologique, pour que l'homme repense sa place dans son environnement, est le lieu d'un roman initiatique où les héros n'apprendront pas tant sur eux-mêmes que sur eux-mêmes en tant qu'ils sont avec les autres.
Au coeur d'une région rurale reculée de ce pays imaginaire en proie à la dictature, vit une famille pauvre d'agriculteurs dans « une petite ferme crasseuse, un taudis » (p. 13). le père, la mère et leurs deux enfants, un frère et une soeur jumeaux (la narratrice de l'histoire) sont des humains à l'état de nature, pourrait-on dire, dont le travail harassant en fait des bêtes de somme. « Ce qu'on avait toujours été : de la pâtée pour les cochons » (p. 61). le rapport à la nature est ici ambigu, tantôt il se donne à lire comme un scandale, celui d'être réduit à l'état animal, tantôt comme une soif, une nécessité vitale d'être en contact charnel avec elle : « mon ventre se craquelait d'envie : je rêvais de m'enfuir avec eux et, comme eux, de toucher le ventre des bêtes. » (p. 11). Cette ambiguïté suggère un « horizon primitif »[2] vu comme quelque chose d'accepté, d'évident. En fait la dialectique sale-propre revient tout au long du roman, et la tension ontologique entre nature et culture est ici confisquée par la politique : « Les gens n'avaient pratiquement rien, trimaient mais n'avaient rien, ni passions, ni plaisirs, tandis qu'au Nord tout était calme, propre. » (p. 27) le propre c'est au Nord, du côté des lieux de pouvoir, là où s'exerce le totalitarisme. Cet encouragement, « pense aux pierres sous tes pas », est une incitation à se réapproprier la dialectique nature-culture pour la subsumer : relier la tête aux pieds, notre pensée à la sensualité et au contact physique, charnel.
« Parce que cette utopie a clairement partie liée avec l'enfance, elle entraîne le roman en direction du domaine retrouvé du conte »[3], dit Philippe Forest d'un étrange et fascinant roman de Kenzaburô Ôé, « Arrachez les bourgeons, tirez sur les enfants » (éd. Gallimard, 1996), où la saleté et l'animalité sont féroces. Chez Antoine Wauters, en fait de conte, il arrive que la mère dise à son mari « on devrait la perdre dans les bois » (p. 32) à propos de sa fille, mais au lieu de « Il était une fois » l'histoire commence par « On était nés jumeaux ». le « on » indéfini ouvre sur une fable dont l'enjeu est bien plus collectif que chez Ôé. L'auteur dédie son livre « Aux séparés » : au début du roman, ce qui préoccupe les parents des jumeaux c'est précisément de les séparer – au nom de l'interdit de l'inceste car dans leurs jeux interdits ils en viennent à se travestir et échanger les genres. Dans cet anti-jardin d'Eden, où la nature est aussi belle que sale, où l'humain connaît la violence, la sueur, le travail, le trivial, l'homme et la femme sont ici frère et soeur, fusionnent et sont interchangeables. Plus tard l'héroïne parle de « quelque chose de terrible, comme aller nue sous le regard de Dieu » (p. 89). Revisiter le mythe d'Adam et Ève c'est pour l'auteur revenir là où Dieu sépara la lumière des ténèbres, puis les eaux du ciel et de la terre, etc. « Comme on ne séparait pas les choses – que la vie sans le travail n'était pas concevable – on pouvait rire et se marrer tout en besognant » (p. 13), dit avec candeur la jeune narratrice. Revenir à la Genèse, là où Dieu nomme, c'est aussi aller aux origines du langage. Dans cette histoire, il existe des personnages aux allures légendaires, qui ont des noms de fable : il y a « L'homme-dégoûté-de-lui-même » ou « L'Homme-mortadelle ». Des noms naïfs et amusants, des noms avant le nom. Comme en écho au texte de Camille de Toledo : « Homme-panthère, homme-hyène… Dans l'entre des langues qui porte la mémoire de notre immersion. Souvenir d'un en-deçà des mots, où nous sommes reliés. Souvenir enfantin d'un âge d'avant la langue, dans l'entre, où nous sommes reliés »[4].
Une fable politique, éloge de la désobéissance
« Quand tu marches, pense aux pierres sous tes pas. Dis-toi que chacune d'elles compte et qu'en dehors, eh bien, il n'y a rien » (p. 90). Tel un mantra, « pense aux pierres sous tes pas » est un appel au décentrement politique. Quand la collectivité villageoise décide de déserter Castel Posino pour atteindre au sud la région de la Habdourga, ils doivent traverser le désert des Marodu. L'écrivain convoque le mythe de la traversée du désert vers la terre promise (à la fin on évoque Moïse, le prophète de l'Exode et figure centrale pour les trois monothéismes) « jusqu'à ce que tout redevienne simple et pur comme la vie en son premier jour » (p. 84). Mais, en fait de confiance aveugle en un dieu et / ou son prophète, place est laissée à l'interrogation : « Reste-t-il quelque chose, à la fin, quand on arrive au bout ? Ou alors c'est le vide et le silence encore ? le manque ? » (p. 157)
Le « Régime » que fuient les héros du livre et tout le village avec eux, c'est la modernité ou « le règne de la sueur, règne de la cuisse musclée et de la chemise blanche au sortir des douches. Règne des dents blanches. de l'audace et de l'estime de soi. » (p. 75) Un « pop fascism »[5] dirait Camille de Toledo, où la dictature est l'oeuvre d'un tyran « recru de modernité » (p. 148) qui promet « la richesse pour tous ici et maintenant » et « le bonheur universel » (p. 29). « C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal » (H. Arendt), dans la séparation des mots et du sens, dans les discours signifiants sans signifiés empreints de messianisme : « Moi je vous montrerai la lumière » (p. 72), dit le dictateur Bokwangu. Dans son livre Antoine Wauters ne cesse de souligner le lien étroit entre politique et littérature. « Leur langue à eux rétrécissait tout » (p. 35), écrit-il – comprendre : l'usage moderne de la langue où s'inscrit le mal, « les mots nations, identités, assurance, médicaments. La somme des prélèvements sémantiques qui font de nous des bêtes dociles »[6]. En réponse à la lumière éblouissante et vaine promise par le dictateur, le narrateur oppose « quelque chose qui te fait croire en la vie… une lumière telle qui t'accompagne » (p. 100). Il est très souvent question d'espoir dans ce roman, « le bonheur est dans chaque pas, chaque minuscule seconde » (p. 149). L'écrivain se fait souvent poète pour nous dire que le sens est là, qu'il est minuscule et que chacun peut le saisir. Il est à « notre portée » comme le dit Camille de Toledo. En somme, « survivre à ce règne technocratique et animal de la modernité »[7], c'est possible parce que le sens n'a pas disparu, sans doute faut-il le lire ailleurs. En cela le roman de Wauters est un encouragement, il décrit non pas un ailleurs idéal, non pas « la possibilité d'une île », mais un en-soi précieux, bien réel, minuscule et intouchable.
L'histoire que raconte Wauters est celle d'une société repensée par ses membres, qui se réapproprient le politique. Exit le régime des réponses faciles et des faux prophètes. Dans « L'inquiétude d'être au monde », Camille de Toledo nous donne une image de l'après : « Nous avons quitté le temps des certitudes et je ne serai pas votre maître »[10]. Antoine Wauters non plus ne se fera pas notre maître. Dans un chapitre intitulé « L'autre exercice », sa narratrice raconte : « Il y avait un autre exercice, consistant, lui, à répéter des groupes de mots que Mama Luna imaginait tout spécialement pour nous. D'après elle, tout commençait par là. C'était la base… Ces, mots, vous n'imaginez pas comme le seul fait de les dire nous égayait. » (p. 153) Mama Luna, la mère lune : c'est elle la prophétesse. Son rôle est de faire grandir en faisant émerger les mots. Il s'agit de renouer avec la verticalité du langage.
Quitter le XXe siècle, vers une « petite littérature »
La traversée du désert des Marodu est une manière de s'éloigner de la capitale, Sassaru : un projet politique loin des lieux de pouvoir, une oeuvre collective de décentrement. C'est ici le moment de faire appel au concept de « petite littérature » qu'analyse Pascale Casanova comme « l'invention de la liberté littéraire des espaces dominés »[8]. Si ce concept redit les liens étroits entre littérature et politique, il faudra en partie s'en détacher (du concept). « La structure inégale qui organise l'univers littéraire oppose donc les « grands » aux « petits » espaces littéraires et place souvent les écrivains des « petits » pays dans des situations à la fois intenables et tragiques. » Surtout pour nos héros il faudra prendre garde à éviter la pesanteur « de l'appartenance nationale ». « En réalité l'appartenance nationale est l'une des déterminations les plus pesantes »[9]. Quand Antoine Wauters diversifie les narrateurs, il trouve là une façon de se libérer de toute pesanteur. À Léo, l'héroïne, est confiée la narration principale du récit, parfois son frère Marcio prend la parole ; Antoine Wauters juxtapose aussi les formes de textes, le récit est entrecoupé d'interludes, et incorpore la correspondance de ses personnages. Il y a enfin les listes façon journal intime – les « Règles pour survivre à sa propre famille – Mesures contre la peine », particulièrement touchantes et poétiques.
Dans son essai « Après la littérature » (éd. Puf), Johan Faerber décrit « un monde qui, entêté, poursuit son messianisme et se sait pétri avant tout de culture, où tout est déjà écrit, tout est déjà filmé, où tout est déjà image » (p. 88). Tout au long de son livre, Antoine Wauters questionne le temps – « le temps hors du temps », « le temps de l'enfance », « L'ère du changement », « Quelque chose d'immédiatement bon » sont quelques uns de ses titres de chapitres. Avec ce questionnement, celui de la possibilité de créer, de recréer, de réinventer. « Les mots que vous venez de lire sont noirs » (p. 35) dit la narratrice au début du roman, pour évoquer la tonalité tragique des premières pages du livre. Les mots « noirs » comme l'obscurité dans laquelle se trouvent des personnages sans avenir. Mais l'adjectif peut être compris au sens littéral, il décrit la couleur de l'encre ; partant, celui de la page. Dans son essai, Johan Faerber parle de la « page noire », noircie à l'ère moderne de tout ce qui a déjà été dit, comme un effet de saturation puisque l'ère de la modernité et de la post-modernité c'est dire que l'on a tout dit et que la Littérature est morte. Mais la page noire n'est pas la fin. « La page noire doit avant tout s'appréhender, de manière troublante, comme son expérience première au monde, son expérience pariétale à l'écriture : le pathos, comme préambule nécessaire à tout écrire. »[11]
Antoine Wauters revisite le mythe biblique de l'arrivée en Terre promise par un retour au pays natal : il ne s'agit pas de faire table rase du passé, ni d'effacer les mythes, « on a fabriqué une croix comme pour Moïse » (p. 182) – anachronisme naïf revendiqué pour dire que les mythes sont toujours là, mais que l'important est de retrouver le présent : tout au long de son livre le romancier décrit la littérature en train de se faire : « Je vous en parlerai plus tard, ou alors ce sera Léo. On verra bien. » (p. 79) écrit-il en note de bas de page. Il y a même un jeu d'écho entre une phrase dite par l'un des personnages, en l'occurrence la prophétesse Mama Luna, qui dit : « Ce suspense remplace l'éternité » (p. 150), en écho à une note de bas de page qui précède : « Patience vous saurez dans le chapitre suivant tout ce qu'il faut savoir. En attendant il est bon de ne pas savoir. Ce suspens remplace l'éternité. » (p. 127) Récit et métalangage entremêlés qui opèrent une tension, une inquiétude métaphysique, mais avec laquelle il est bon de renouer. L'auteur insiste sur le temps de l'écriture qui est le présent incarné, le seul où l'on se trouve. Comme en écho avec cette très belle phrase d'Antonio Moresco : « En ce moment il y a un homme absolument seul qui déplace son corps parmi ces dépouilles de pierre sur lesquelles le tourment végétal des plantes grimpantes ne cesse jamais, ni le jour ni la nuit »[12]. Quel plaisir de lire des écrivains qui ne cherchent pas à jouer les faux prophètes en installant leur lecteur dans un confort ! Ils nous parlent d'un temps suspendu comme d'un inconfort nécessaire, presque salutaire. Car le maître-mot chez Wauters, ne l'oublions pas, c'est l'espoir.
Et si au XXIe siècle, le nouveau paradigme c'était les interstices, les failles, le minuscule, l'obscurité de l'intime, l'universalité du très soi ? « Moi je suis petit »[13] revendique un personnage d'Antonio Moresco. Troublante revendication d'une petite histoire. L'échelle du minuscule et de l'infiniment petit, c'est là où se trame le tout premier récit, là où avant les mots, se juxtaposent et s'interpénètrent sensations, sentiments, perceptions, intuitions, « sous les lignes de la terre, dans les mille et mille radicelles »[14]. Et si, débarrassés des pesanteurs en -isme du XXe siècle on plaidait pour une petite littérature ? À l'heure où l'espèce humaine détruisant son environnement se voit elle-même menacée d'extinction, le petitisme (si toutefois il faut du -isme) sonne comme la seule issue.
------------------------
[1] Antonio Moresco, « La petite lumière », p. 11, éd. Verdier, 2014
[2] Philippe Forest, « Ôé Kenzaburô – Légendes anciennes et nouvelles d'un romancier japonais », p. 26, éd. Cécile Defaut, 2012
[3] id., p. 34
[4] Camille de Toledo, « L'inquiétude d'être au monde », p. 35, éd. Verdier, 2010
[5] id., p. 22
[6] id., p. 30
[7] id., p. 15
[8] Pascale Casanova, « La République mondiale des Lettres », p. 260, éd. Points, 2008
[9] id., p. 261
[10] Camille de Toledo, « L'inquiétude d'être au monde », p. 39, éd. Verdier, 2010
[11] Johan Faerber, « Après la littérature – Écrire le contemporain », p. 85, éd. PUF, 2018
[12] Antonio Moresco, « La petite lumière », p. 12, éd. Verdier, 2014
[13] id., p. 87
[14] id., p. 15
Lien : https://lecolophonblog.wordp..
« Pense aux pierres sous tes pas », pense à « ce monde minéral suspendu dans l'espace »[1]. le livre qu'Antoine Wauters vient de publier aux éditions Verdier fait appel à la poésie et au conte pour décrire une utopie contemporaine. Où l'enjeu au XXIe siècle est d'atteindre le décentrement de l'homme vis-à-vis de son environnement ; de retrouver le sens du collectif loin des lieux de pouvoir ; de se réapproprier le langage pour qu'émerge l'oeuvre littéraire. Et si la littérature après le XXe siècle avait l'ambition d'être une « petite littérature » ?
Un « horizon primitif »
En préambule, le roman commence avec une carte intitulée « Entre ici et ailleurs, petite topographie de notre pays ». Un croquis qui représente par des traits de crayons enfantins un pays imaginaire. le situer « entre ici et ailleurs », c'est-à-dire ne pas le situer, c'est recréer « le pays imaginaire ». Bienvenue sur une île dont on ne sait pas le nom, dans un monde où la modernité est synonyme de destruction. Ouvrir le livre d'Antoine Wauters c'est comme observer par au-dessus une dictature miniature « massacrant la nature et piétinant le monde » (p. 176) qui serait située dans une autre unité de temps et de lieu – où les habitants ont leur propre dialecte, dont les sonorités empruntent au sarde ou au corse – pour mieux nous enseigner la radicalité du temps présent : la seule chose que l'on a sans jamais la posséder – ça et les autres. Cette utopie qui plaide pour un décentrement anthropologique, pour que l'homme repense sa place dans son environnement, est le lieu d'un roman initiatique où les héros n'apprendront pas tant sur eux-mêmes que sur eux-mêmes en tant qu'ils sont avec les autres.
Au coeur d'une région rurale reculée de ce pays imaginaire en proie à la dictature, vit une famille pauvre d'agriculteurs dans « une petite ferme crasseuse, un taudis » (p. 13). le père, la mère et leurs deux enfants, un frère et une soeur jumeaux (la narratrice de l'histoire) sont des humains à l'état de nature, pourrait-on dire, dont le travail harassant en fait des bêtes de somme. « Ce qu'on avait toujours été : de la pâtée pour les cochons » (p. 61). le rapport à la nature est ici ambigu, tantôt il se donne à lire comme un scandale, celui d'être réduit à l'état animal, tantôt comme une soif, une nécessité vitale d'être en contact charnel avec elle : « mon ventre se craquelait d'envie : je rêvais de m'enfuir avec eux et, comme eux, de toucher le ventre des bêtes. » (p. 11). Cette ambiguïté suggère un « horizon primitif »[2] vu comme quelque chose d'accepté, d'évident. En fait la dialectique sale-propre revient tout au long du roman, et la tension ontologique entre nature et culture est ici confisquée par la politique : « Les gens n'avaient pratiquement rien, trimaient mais n'avaient rien, ni passions, ni plaisirs, tandis qu'au Nord tout était calme, propre. » (p. 27) le propre c'est au Nord, du côté des lieux de pouvoir, là où s'exerce le totalitarisme. Cet encouragement, « pense aux pierres sous tes pas », est une incitation à se réapproprier la dialectique nature-culture pour la subsumer : relier la tête aux pieds, notre pensée à la sensualité et au contact physique, charnel.
« Parce que cette utopie a clairement partie liée avec l'enfance, elle entraîne le roman en direction du domaine retrouvé du conte »[3], dit Philippe Forest d'un étrange et fascinant roman de Kenzaburô Ôé, « Arrachez les bourgeons, tirez sur les enfants » (éd. Gallimard, 1996), où la saleté et l'animalité sont féroces. Chez Antoine Wauters, en fait de conte, il arrive que la mère dise à son mari « on devrait la perdre dans les bois » (p. 32) à propos de sa fille, mais au lieu de « Il était une fois » l'histoire commence par « On était nés jumeaux ». le « on » indéfini ouvre sur une fable dont l'enjeu est bien plus collectif que chez Ôé. L'auteur dédie son livre « Aux séparés » : au début du roman, ce qui préoccupe les parents des jumeaux c'est précisément de les séparer – au nom de l'interdit de l'inceste car dans leurs jeux interdits ils en viennent à se travestir et échanger les genres. Dans cet anti-jardin d'Eden, où la nature est aussi belle que sale, où l'humain connaît la violence, la sueur, le travail, le trivial, l'homme et la femme sont ici frère et soeur, fusionnent et sont interchangeables. Plus tard l'héroïne parle de « quelque chose de terrible, comme aller nue sous le regard de Dieu » (p. 89). Revisiter le mythe d'Adam et Ève c'est pour l'auteur revenir là où Dieu sépara la lumière des ténèbres, puis les eaux du ciel et de la terre, etc. « Comme on ne séparait pas les choses – que la vie sans le travail n'était pas concevable – on pouvait rire et se marrer tout en besognant » (p. 13), dit avec candeur la jeune narratrice. Revenir à la Genèse, là où Dieu nomme, c'est aussi aller aux origines du langage. Dans cette histoire, il existe des personnages aux allures légendaires, qui ont des noms de fable : il y a « L'homme-dégoûté-de-lui-même » ou « L'Homme-mortadelle ». Des noms naïfs et amusants, des noms avant le nom. Comme en écho au texte de Camille de Toledo : « Homme-panthère, homme-hyène… Dans l'entre des langues qui porte la mémoire de notre immersion. Souvenir d'un en-deçà des mots, où nous sommes reliés. Souvenir enfantin d'un âge d'avant la langue, dans l'entre, où nous sommes reliés »[4].
Une fable politique, éloge de la désobéissance
« Quand tu marches, pense aux pierres sous tes pas. Dis-toi que chacune d'elles compte et qu'en dehors, eh bien, il n'y a rien » (p. 90). Tel un mantra, « pense aux pierres sous tes pas » est un appel au décentrement politique. Quand la collectivité villageoise décide de déserter Castel Posino pour atteindre au sud la région de la Habdourga, ils doivent traverser le désert des Marodu. L'écrivain convoque le mythe de la traversée du désert vers la terre promise (à la fin on évoque Moïse, le prophète de l'Exode et figure centrale pour les trois monothéismes) « jusqu'à ce que tout redevienne simple et pur comme la vie en son premier jour » (p. 84). Mais, en fait de confiance aveugle en un dieu et / ou son prophète, place est laissée à l'interrogation : « Reste-t-il quelque chose, à la fin, quand on arrive au bout ? Ou alors c'est le vide et le silence encore ? le manque ? » (p. 157)
Le « Régime » que fuient les héros du livre et tout le village avec eux, c'est la modernité ou « le règne de la sueur, règne de la cuisse musclée et de la chemise blanche au sortir des douches. Règne des dents blanches. de l'audace et de l'estime de soi. » (p. 75) Un « pop fascism »[5] dirait Camille de Toledo, où la dictature est l'oeuvre d'un tyran « recru de modernité » (p. 148) qui promet « la richesse pour tous ici et maintenant » et « le bonheur universel » (p. 29). « C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal » (H. Arendt), dans la séparation des mots et du sens, dans les discours signifiants sans signifiés empreints de messianisme : « Moi je vous montrerai la lumière » (p. 72), dit le dictateur Bokwangu. Dans son livre Antoine Wauters ne cesse de souligner le lien étroit entre politique et littérature. « Leur langue à eux rétrécissait tout » (p. 35), écrit-il – comprendre : l'usage moderne de la langue où s'inscrit le mal, « les mots nations, identités, assurance, médicaments. La somme des prélèvements sémantiques qui font de nous des bêtes dociles »[6]. En réponse à la lumière éblouissante et vaine promise par le dictateur, le narrateur oppose « quelque chose qui te fait croire en la vie… une lumière telle qui t'accompagne » (p. 100). Il est très souvent question d'espoir dans ce roman, « le bonheur est dans chaque pas, chaque minuscule seconde » (p. 149). L'écrivain se fait souvent poète pour nous dire que le sens est là, qu'il est minuscule et que chacun peut le saisir. Il est à « notre portée » comme le dit Camille de Toledo. En somme, « survivre à ce règne technocratique et animal de la modernité »[7], c'est possible parce que le sens n'a pas disparu, sans doute faut-il le lire ailleurs. En cela le roman de Wauters est un encouragement, il décrit non pas un ailleurs idéal, non pas « la possibilité d'une île », mais un en-soi précieux, bien réel, minuscule et intouchable.
L'histoire que raconte Wauters est celle d'une société repensée par ses membres, qui se réapproprient le politique. Exit le régime des réponses faciles et des faux prophètes. Dans « L'inquiétude d'être au monde », Camille de Toledo nous donne une image de l'après : « Nous avons quitté le temps des certitudes et je ne serai pas votre maître »[10]. Antoine Wauters non plus ne se fera pas notre maître. Dans un chapitre intitulé « L'autre exercice », sa narratrice raconte : « Il y avait un autre exercice, consistant, lui, à répéter des groupes de mots que Mama Luna imaginait tout spécialement pour nous. D'après elle, tout commençait par là. C'était la base… Ces, mots, vous n'imaginez pas comme le seul fait de les dire nous égayait. » (p. 153) Mama Luna, la mère lune : c'est elle la prophétesse. Son rôle est de faire grandir en faisant émerger les mots. Il s'agit de renouer avec la verticalité du langage.
Quitter le XXe siècle, vers une « petite littérature »
La traversée du désert des Marodu est une manière de s'éloigner de la capitale, Sassaru : un projet politique loin des lieux de pouvoir, une oeuvre collective de décentrement. C'est ici le moment de faire appel au concept de « petite littérature » qu'analyse Pascale Casanova comme « l'invention de la liberté littéraire des espaces dominés »[8]. Si ce concept redit les liens étroits entre littérature et politique, il faudra en partie s'en détacher (du concept). « La structure inégale qui organise l'univers littéraire oppose donc les « grands » aux « petits » espaces littéraires et place souvent les écrivains des « petits » pays dans des situations à la fois intenables et tragiques. » Surtout pour nos héros il faudra prendre garde à éviter la pesanteur « de l'appartenance nationale ». « En réalité l'appartenance nationale est l'une des déterminations les plus pesantes »[9]. Quand Antoine Wauters diversifie les narrateurs, il trouve là une façon de se libérer de toute pesanteur. À Léo, l'héroïne, est confiée la narration principale du récit, parfois son frère Marcio prend la parole ; Antoine Wauters juxtapose aussi les formes de textes, le récit est entrecoupé d'interludes, et incorpore la correspondance de ses personnages. Il y a enfin les listes façon journal intime – les « Règles pour survivre à sa propre famille – Mesures contre la peine », particulièrement touchantes et poétiques.
Dans son essai « Après la littérature » (éd. Puf), Johan Faerber décrit « un monde qui, entêté, poursuit son messianisme et se sait pétri avant tout de culture, où tout est déjà écrit, tout est déjà filmé, où tout est déjà image » (p. 88). Tout au long de son livre, Antoine Wauters questionne le temps – « le temps hors du temps », « le temps de l'enfance », « L'ère du changement », « Quelque chose d'immédiatement bon » sont quelques uns de ses titres de chapitres. Avec ce questionnement, celui de la possibilité de créer, de recréer, de réinventer. « Les mots que vous venez de lire sont noirs » (p. 35) dit la narratrice au début du roman, pour évoquer la tonalité tragique des premières pages du livre. Les mots « noirs » comme l'obscurité dans laquelle se trouvent des personnages sans avenir. Mais l'adjectif peut être compris au sens littéral, il décrit la couleur de l'encre ; partant, celui de la page. Dans son essai, Johan Faerber parle de la « page noire », noircie à l'ère moderne de tout ce qui a déjà été dit, comme un effet de saturation puisque l'ère de la modernité et de la post-modernité c'est dire que l'on a tout dit et que la Littérature est morte. Mais la page noire n'est pas la fin. « La page noire doit avant tout s'appréhender, de manière troublante, comme son expérience première au monde, son expérience pariétale à l'écriture : le pathos, comme préambule nécessaire à tout écrire. »[11]
Antoine Wauters revisite le mythe biblique de l'arrivée en Terre promise par un retour au pays natal : il ne s'agit pas de faire table rase du passé, ni d'effacer les mythes, « on a fabriqué une croix comme pour Moïse » (p. 182) – anachronisme naïf revendiqué pour dire que les mythes sont toujours là, mais que l'important est de retrouver le présent : tout au long de son livre le romancier décrit la littérature en train de se faire : « Je vous en parlerai plus tard, ou alors ce sera Léo. On verra bien. » (p. 79) écrit-il en note de bas de page. Il y a même un jeu d'écho entre une phrase dite par l'un des personnages, en l'occurrence la prophétesse Mama Luna, qui dit : « Ce suspense remplace l'éternité » (p. 150), en écho à une note de bas de page qui précède : « Patience vous saurez dans le chapitre suivant tout ce qu'il faut savoir. En attendant il est bon de ne pas savoir. Ce suspens remplace l'éternité. » (p. 127) Récit et métalangage entremêlés qui opèrent une tension, une inquiétude métaphysique, mais avec laquelle il est bon de renouer. L'auteur insiste sur le temps de l'écriture qui est le présent incarné, le seul où l'on se trouve. Comme en écho avec cette très belle phrase d'Antonio Moresco : « En ce moment il y a un homme absolument seul qui déplace son corps parmi ces dépouilles de pierre sur lesquelles le tourment végétal des plantes grimpantes ne cesse jamais, ni le jour ni la nuit »[12]. Quel plaisir de lire des écrivains qui ne cherchent pas à jouer les faux prophètes en installant leur lecteur dans un confort ! Ils nous parlent d'un temps suspendu comme d'un inconfort nécessaire, presque salutaire. Car le maître-mot chez Wauters, ne l'oublions pas, c'est l'espoir.
Et si au XXIe siècle, le nouveau paradigme c'était les interstices, les failles, le minuscule, l'obscurité de l'intime, l'universalité du très soi ? « Moi je suis petit »[13] revendique un personnage d'Antonio Moresco. Troublante revendication d'une petite histoire. L'échelle du minuscule et de l'infiniment petit, c'est là où se trame le tout premier récit, là où avant les mots, se juxtaposent et s'interpénètrent sensations, sentiments, perceptions, intuitions, « sous les lignes de la terre, dans les mille et mille radicelles »[14]. Et si, débarrassés des pesanteurs en -isme du XXe siècle on plaidait pour une petite littérature ? À l'heure où l'espèce humaine détruisant son environnement se voit elle-même menacée d'extinction, le petitisme (si toutefois il faut du -isme) sonne comme la seule issue.
------------------------
[1] Antonio Moresco, « La petite lumière », p. 11, éd. Verdier, 2014
[2] Philippe Forest, « Ôé Kenzaburô – Légendes anciennes et nouvelles d'un romancier japonais », p. 26, éd. Cécile Defaut, 2012
[3] id., p. 34
[4] Camille de Toledo, « L'inquiétude d'être au monde », p. 35, éd. Verdier, 2010
[5] id., p. 22
[6] id., p. 30
[7] id., p. 15
[8] Pascale Casanova, « La République mondiale des Lettres », p. 260, éd. Points, 2008
[9] id., p. 261
[10] Camille de Toledo, « L'inquiétude d'être au monde », p. 39, éd. Verdier, 2010
[11] Johan Faerber, « Après la littérature – Écrire le contemporain », p. 85, éd. PUF, 2018
[12] Antonio Moresco, « La petite lumière », p. 12, éd. Verdier, 2014
[13] id., p. 87
[14] id., p. 15
Lien : https://lecolophonblog.wordp..