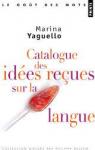Citations sur Les mots et les femmes : Essai d'approche sociolingui.. (23)
L’usage de l’euphémisme est en grande partie responsable de cette situation. L’euphémisme, on le sait, sert à masquer la réalité, mais, une fois implanté dans l’usage, il finit par se substituer complètement au mot qu’il est censé remplacer, d’où un changement de sens qui nécessite le recours à un nouvel euphémisme. Un euphémisme chasse l’autre. (Voir la déformation, déjà très ancienne, de « courtisane », ou celle, plus récente, de maîtresse, et même, dans certains contextes, de amie et de fiancée.
Mais l’euphémisme a également une valeur de provocation ou de dérision.
« L’euphémisme, qui a soi-disant pour fonction de protéger la pudeur, en fait, la compromet en détournant de leur sens des expressions innocentes et qui en deviennent d’autant plus choquantes. Il constitue une provocation. De même que l’hyperbole habille la jeune fille en putain, l’euphémisme déguise la putain en jeune fille, voire en petite fille. » (Guiraud, p. 110).
Mais l’euphémisme a également une valeur de provocation ou de dérision.
« L’euphémisme, qui a soi-disant pour fonction de protéger la pudeur, en fait, la compromet en détournant de leur sens des expressions innocentes et qui en deviennent d’autant plus choquantes. Il constitue une provocation. De même que l’hyperbole habille la jeune fille en putain, l’euphémisme déguise la putain en jeune fille, voire en petite fille. » (Guiraud, p. 110).
La péjoration de la femme est omniprésente dans la langue, à tous les niveaux et dans tous les registres. Dès l’enfance, chacun apprend que certains mots sont porteurs de prestige alors que d’autres évoquent le ridicule, la faiblesse, la honte.
La langue du mépris est souvent, dans une large mesure, intériorisée par l’opprimé, tout particulièrement les femmes, dans la mesure où elles ne constituent jamais un groupe social séparé.
La langue nous renvoie une certaine image de la société et des rapports de force qui la régissent.
C’est la structuration du domaine lexical qui sert à qualifier les femmes et à les dénigrer, et qui fait d’elles et de leurs corps, métaphoriquement, la source inépuisable des injures et des jurons qui font l’objet de ce chapitre.
Remarque préliminaire : l’oppresseur dispose généralement 150 d’un registre de mépris infiniment plus étendu vis-à-vis de l’opprimé que celui-ci vis-à-vis de l’oppresseur. Ainsi, les Blancs vis-à-vis des Noirs ou des Arabes, les Aryens vis-à-vis des Juifs, les hommes vis-à-vis des femmes. Le droit de nommer est une prérogative du groupe dominant sur le groupe dominé. Ainsi les hommes ont-ils des milliers de mots pour désigner les femmes, dont l’immense majorité sont péjoratifs. L’inverse n’est pas vrai. La dissymétrie, à la fois quantitative et qualitative, est flagrante.
C’est la structuration du domaine lexical qui sert à qualifier les femmes et à les dénigrer, et qui fait d’elles et de leurs corps, métaphoriquement, la source inépuisable des injures et des jurons qui font l’objet de ce chapitre.
Remarque préliminaire : l’oppresseur dispose généralement 150 d’un registre de mépris infiniment plus étendu vis-à-vis de l’opprimé que celui-ci vis-à-vis de l’oppresseur. Ainsi, les Blancs vis-à-vis des Noirs ou des Arabes, les Aryens vis-à-vis des Juifs, les hommes vis-à-vis des femmes. Le droit de nommer est une prérogative du groupe dominant sur le groupe dominé. Ainsi les hommes ont-ils des milliers de mots pour désigner les femmes, dont l’immense majorité sont péjoratifs. L’inverse n’est pas vrai. La dissymétrie, à la fois quantitative et qualitative, est flagrante.
En résumé, d’où viennent les résistances? Très rarement de la morphologie (le seul cas difficile est témoin). Lorsque le procédé de dérivation n’est plus productif, la langue trouve un substitut acceptable du point de vue morphologique : cheftaine, cheftesse (il y a dissymétrie sémantique, mais c’est une autre histoire). Les résistances viennent pour une part de l’immobilisme linguistique et très souvent des femmes elles-mêmes et du corps social tout entier qui fait encore aux femmes une place à part. s’il y a dissymétrie, c’est que soit on refuse d’utiliser la forme disponible, soit on l’utilise en lui conférant des connotations dépréciatives ou facétieuses (poétesse, philosophesse, soldate, chéfesse, etc.). Notons au passage que c’est dans les professions scientifiques, qui bénéficient de nombreuses désignations épicènes et où les préjugés sont peut-être moins enracinés, que la discrimination est la moins grande.
Pourtant, ce qui est grave, ce n’est pas tellement la dissymétrie en soi (après tout, la langue en comporte bien d’autres), mais bien le fait qu’elle joue toujours dans le même sens, c’est-à-dire au détriment de l’image et du statut de la femme. D’ailleurs, on va le voir, par le jeu des connotations, la symétrie morphologique ne garantit en rien la symétrie sémantique.
Pourtant, ce qui est grave, ce n’est pas tellement la dissymétrie en soi (après tout, la langue en comporte bien d’autres), mais bien le fait qu’elle joue toujours dans le même sens, c’est-à-dire au détriment de l’image et du statut de la femme. D’ailleurs, on va le voir, par le jeu des connotations, la symétrie morphologique ne garantit en rien la symétrie sémantique.
Tant que les mentalités ne changeront pas, la langue restera à la traîne.
Ce qui frappe, dans tout cela, c’est l’immobilisme fondamental du français, sa peur de l’innovation (voir la façon dont sont stigmatisés les néologismes), qui va jusqu’à refuser de faire usage des structures morphologiques existantes.
Ainsi la langue populaire, la langue vivante n’était jamais en peine pour féminiser les noms d’agent. La correspondance féminin/masculin étant une contrainte absolue de la langue française, l’absence de féminins dans la langue moderne est une anomalie qui représente toujours une gêne.
2. « On peut, certes, se moquer, avec Molière, des Précieuses, de leurs excès, de leurs outrances ; […]
En fait, ce qu'attaque Molière, ce n'est pas seulement le purisme poussé jusqu'au ridicule, le langage édulcoré jusqu'à devenir un squelette, à quoi s'opposent la vigueur, la verdeur de sa propre langue, c'est bien aussi la prétention des femmes à vouloir prendre la parole, donc le pouvoir idéologique. Et puis, avouons-le, les Précieuses faisaient montre de créativité linguistique, trait qui est généralement dénié aux femmes. » (p. 48)
En fait, ce qu'attaque Molière, ce n'est pas seulement le purisme poussé jusqu'au ridicule, le langage édulcoré jusqu'à devenir un squelette, à quoi s'opposent la vigueur, la verdeur de sa propre langue, c'est bien aussi la prétention des femmes à vouloir prendre la parole, donc le pouvoir idéologique. Et puis, avouons-le, les Précieuses faisaient montre de créativité linguistique, trait qui est généralement dénié aux femmes. » (p. 48)
1. « La langue est un système symbolique engagé dans des rapports sociaux ; aussi faut-il rejeter l'idée d'une langue "neutre" et souligner les rapports conflictuels. En effet, la langue n'est pas faite uniquement pour faciliter la communication ; elle permet aussi la censure, le mensonge, la violence, le mépris, l'oppression, de même qu'elle le plaisir, la jouissance, le jeu, le défi, la révolte. Elle est ainsi tantôt lieu de refoulement (par l'intériorisation des règles et des tabous), tantôt lieu de défoulement ou exutoire. » (p. 7)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Marina Yaguello (14)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les emmerdeuses de la littérature
Les femmes écrivains ont souvent rencontré l'hostilité de leurs confrères. Mais il y a une exception parmi eux, un homme qui les a défendues, lequel?
Houellebecq
Flaubert
Edmond de Goncourt
Maupassant
Eric Zemmour
10 questions
570 lecteurs ont répondu
Thèmes :
écriture
, féminisme
, luttes politiquesCréer un quiz sur ce livre570 lecteurs ont répondu