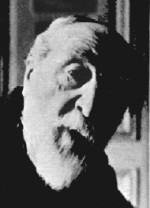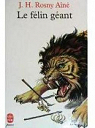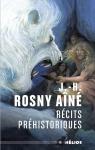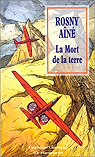Critiques de J.-H. Rosny aîné (227)
La suite de ‘’La Guerre du feu’’ n’est pas très connue. Il faut dire que ‘’Le félin géant’’ est loin d’avoir le même niveau d’ambition. A l’épopée grandiose d’un Prométhée préhistorique sauvant sa tribu et assurant l’avenir de l’humanité, succèdent les aventures d’un fils las de vivre dans l’ombre de son père, voulant prouver lui aussi sa valeur, et cherchant désespérément une noble cause à laquelle apporter sa massue.
Ce qui n’empêche pas l’écriture de J.H. Rosny aîné d’être toujours aussi magnifique et prenante. On retrouve avec plaisir la savane, ses fauves redoutables, ses paisibles herbivores et ses sources limpides. On suit avec tout autant de plaisir les aventures et les combats du jeune chasseur ; il n’est pas désagréable non plus d’avoir affaire à un personnage plus complexe que son père Nao, tout aussi puissant physiquement mais solitaire, traversé de doute, bref assez loin du leader-né. Pas le même niveau d’ambition, non plus. L’un partira conquérir le feu et apprivoisera des mammouths ; l’autre sauvera une poignée de femmes errantes, et se contentera d’un lion.
Ce qui ne l’empêche pas d’avoir de très bonnes idées, comme ce peuple où hommes et femmes vivent en tribus séparées qui ne se rencontrent qu’occasionnellement, ou le rapport complexe du héros avec sa tribu, qui vénère son père Nao mais se méfie du fils et de son tempérament bizarre.
Une suite intéressante, plaisante à lire, pas du niveau de l’opus précédent mais c’est, en un sens, assumé.
Ce qui n’empêche pas l’écriture de J.H. Rosny aîné d’être toujours aussi magnifique et prenante. On retrouve avec plaisir la savane, ses fauves redoutables, ses paisibles herbivores et ses sources limpides. On suit avec tout autant de plaisir les aventures et les combats du jeune chasseur ; il n’est pas désagréable non plus d’avoir affaire à un personnage plus complexe que son père Nao, tout aussi puissant physiquement mais solitaire, traversé de doute, bref assez loin du leader-né. Pas le même niveau d’ambition, non plus. L’un partira conquérir le feu et apprivoisera des mammouths ; l’autre sauvera une poignée de femmes errantes, et se contentera d’un lion.
Ce qui ne l’empêche pas d’avoir de très bonnes idées, comme ce peuple où hommes et femmes vivent en tribus séparées qui ne se rencontrent qu’occasionnellement, ou le rapport complexe du héros avec sa tribu, qui vénère son père Nao mais se méfie du fils et de son tempérament bizarre.
Une suite intéressante, plaisante à lire, pas du niveau de l’opus précédent mais c’est, en un sens, assumé.
C'est fou quand on y pense que le roman de référence sur la Préhistoire ait plus de cent ans. Depuis on en a écrit à la pelle, dont quelques-uns de très bons, mais aucun n'a jamais réussi à remplacer ‘'La guerre du feu''. Même son adaptation au cinéma reste indétrônable dans la catégorie (il est vrai que la concurrence est faiblissime) ! Pourquoi ? Deux éléments, à l'évidence : le talent de conteur, et la simplicité de l'histoire.
La plume de J.H. Rosny-Ainé a étonnamment peu vieilli. Très élégante et lyrique, elle présente peu de lourdeurs et de longueurs inutiles. Les descriptions de la savane sont magnifiques ; on croit entendre le piétinement des herbivores dans le lointain, le feulement du machairodus rôdant autour de notre frêle abri. Il plane sur ces pages une poésie sauvage et primitive, poésie de la proie et du fauve, du sang et de la griffe, poésie d'une nature vierge et indomptée où se joue, jour après jour, l'éternel combat pour la vie. L'homme, frêle, farouche, brutal, tente non seulement de survivre, mais de s'élever. Il a engagé une lutte sans pitié, contre le carnivore qui veut sa chair, contre le froid et la nuit, contre son semblable même. Dans sa simplicité, l'histoire prend les caractères d'une épopée.
Est-elle dépassée au regard des connaissances actuelles ? Oui et non. Cent ans après on connait certes bien plus de choses sur la Préhistoire, mais beaucoup de certitudes ont aussi été battues en brèche. Qui plus est, le principal anachronisme était connu dès le début, et dans le récit il est assumé en filigrane : faire cohabiter à la même époques plusieurs cultures séparées par des centaines de millénaires d'écarts. Cela permettait de faire découvrir au lecteur, en une histoire, un panorama de l'évolution humaine de –500 000 à -15 000. Cela étant, de récentes découvertes (Florès, Callao) ont montré que certaines populations avaient perduré bien plus longtemps que ce qu'on pensait !
Inégalé, insurpassé, ‘'La guerre du feu'' a acquis le statut d'Illiade préhistorique, et ne semble guère prêt d'être détrôné.
La plume de J.H. Rosny-Ainé a étonnamment peu vieilli. Très élégante et lyrique, elle présente peu de lourdeurs et de longueurs inutiles. Les descriptions de la savane sont magnifiques ; on croit entendre le piétinement des herbivores dans le lointain, le feulement du machairodus rôdant autour de notre frêle abri. Il plane sur ces pages une poésie sauvage et primitive, poésie de la proie et du fauve, du sang et de la griffe, poésie d'une nature vierge et indomptée où se joue, jour après jour, l'éternel combat pour la vie. L'homme, frêle, farouche, brutal, tente non seulement de survivre, mais de s'élever. Il a engagé une lutte sans pitié, contre le carnivore qui veut sa chair, contre le froid et la nuit, contre son semblable même. Dans sa simplicité, l'histoire prend les caractères d'une épopée.
Est-elle dépassée au regard des connaissances actuelles ? Oui et non. Cent ans après on connait certes bien plus de choses sur la Préhistoire, mais beaucoup de certitudes ont aussi été battues en brèche. Qui plus est, le principal anachronisme était connu dès le début, et dans le récit il est assumé en filigrane : faire cohabiter à la même époques plusieurs cultures séparées par des centaines de millénaires d'écarts. Cela permettait de faire découvrir au lecteur, en une histoire, un panorama de l'évolution humaine de –500 000 à -15 000. Cela étant, de récentes découvertes (Florès, Callao) ont montré que certaines populations avaient perduré bien plus longtemps que ce qu'on pensait !
Inégalé, insurpassé, ‘'La guerre du feu'' a acquis le statut d'Illiade préhistorique, et ne semble guère prêt d'être détrôné.
La tribu des Oulhamrs vient de subir une terrible défaite et la tribu rivale a détruit les trois cages contenant le feu. Depuis des générations, ils entretenaient la source du feu dans ces cages avec maintes précautions et un grand savoir-faire car ils étaient incapables de le faire surgir spontanément. Ils vont se retrouver obligés de se nourrir de viande crue et de grelotter la nuit. Après s’être retiré pour réfléchir, Faouhm, chef de la tribu promet sa nièce Gammla et sa succession à la tête de la tribu à celui qui leur rapportera le feu. Aussitôt, Naoh, le guerrier le plus grand et le plus agile, se porte volontaire car Gammla l’attire depuis des lunes. Mais un autre guerrier s’avance et tente de faire reculer Naoh. C’est Aghoo le velu, fils de l’Auroch, dont la force est légendaire.
Faouhm déclare que chacun des deux guerriers partira de son côté avec ses assistants et que le premier qui reviendra avec le feu deviendra le maître de Gammla et de la tribu.
S’ensuit un périple ponctué de maints obstacles. Entre l’ours gris, le tigre, le lion-tigre et la tigresse, les hommes des arbres, les mammouths, les Nains rouges, les Wah et pour finir Aghoo le velu et ses frères, Naoh, Nam et Gaw, les intrépides, devront faire preuve de ruse plus que de force pour arriver vainqueurs au bout de l’aventure.
La Guerre du feu, constamment réédité depuis sa première parution est un grand classique de ce qu’on appelle les romans préhistoriques, dans le genre Merveilleux scientifique, ancêtre de la science-fiction. Merveilleux parce que l’auteur avait toute latitude pour inventer des personnages et des interactions dont il ne restait aucune trace, scientifique parce qu’il fallait avoir des connaissances en paléontologie pour assoir le récit. D’autres auteurs se sont essayés dans le genre du roman préhistorique : Fernand Mysor dont nous avons publié dans Gandahar n°2 l’excellent roman Les Semeurs d’épouvante qui nous plonge dans la terreur permanente que vivaient les humains de cette époque face à une faune sauvage en pleine liberté, Claude Cenac et son cycle de la rivière rouge, Pierre Pelot avec Le Rêve de Lucy et la série Sous le vent du monde, Jean Auel et son célèbre Les Enfants de la terre, l’anthropologue Élisabeth Marshall Thomas avec La Lune des rennes et La femme sauvage… Ce ne sont que des exemples, il y en a bien d’autres.
Ce qui distingue Joseph Rosny Aîné, c’est son style, épique, poétique, qui donne à son récit un souffle magique, une puissance de vie extraordinaire. Le lecteur se glisse avec une grande facilité dans la peau de Naoh, son héros, l’un des premiers super-héros qui a influencé les jeux de nombreux petits garçons et suscité des vocations de paléontologues, comme celle de l’auteur Francis Carsac.
Les pages qui décrivent la nature et les animaux dénotent une connaissance approfondie de ces sujets et sont d’une grande beauté poétique :
« Le fleuve roulait dans sa force. À travers mille pays de pierres, d’herbes et d’arbres, il avait bu les sources, englouti les ruisseaux, dévoré les rivières. Les glaciers s’accumulaient pour lui dans les plis chagrins de la montagne, les sources filtraient aux cavernes, les torrents pourchassaient les granits, les grès ou les calcaires, les nuages dégorgeaient leurs éponges immenses et légères, les nappes se hâtaient sur leurs lits d’argile. Frais, écumeux et vite, lorsqu’il était dompté par les rives, il s’élargissait en lacs sur les terres plates ou distillait des marécages ; il fourchait autour des îles ; il rugissait en cataractes et sanglotait en rapides. Plein de vie, il fécondait la vie intarissable. Des régions tièdes aux régions fraîches, des alluvions nourries de forces myriadaires aux sols pauvres, surgissaient les peuples lourds de l’arbre : les hordes de figuiers, d’oliviers, de pins, de térébinthes, d’yeuses, les tribus de sycomores, de platanes, de châtaigniers, d’érables, de hêtres et de chênes, les troupeaux de noyers, d’abiès, de frênes, de bouleaux, les files de peupliers blancs, de peupliers noirs, de peupliers grisaille, de peupliers argentés, de peupliers trembles et les clans d’aulnes, de saules blancs, de saules pourpres, de saules glauques et de saules pleureurs. Dans sa profondeur s’agitait la multitude muette des mollusques, tapis dans leurs demeures de chaux et de nacre, des crustacés aux armures articulées, des poissons de course, qu’une flexion lance à travers l’eau pesante, aussi vite que la frégate sur les nues, des poissons flasques qui barbotent lentement dans la fange, des reptiles souples comme les roseaux ou opaques, rugueux et denses. Selon les saisons, les hasards de la tempête, des cataclysmes ou de la guerre, s’abattaient les masses triangulaires des grues, les troupes grasses des oies, les compagnies de canards verts, de sarcelles, de macreuses, de pluviers et de hérons, les peuplades d’hirondelles, de mouettes et de chevaliers ; les outardes, les cigognes, les cygnes, les flandrins, les courlis, les râles, les martins-pêcheurs et la foule inépuisable des passereaux. Vautours, corbeaux et corneilles s’éjouissaient aux charognes abondantes ; les aigles veillaient à la corne des nuages ; les faucons planaient sur leurs ailes tranchantes ; les éperviers ou les crécerelles filaient au-dessus des hautes cimes ; les milans surgissaient, furtifs, imprévus et lâches, et le grand duc, la chevêche, l’effraie trouaient les ténèbres sur leurs ailes de silence. »
Rosny Aîné est le pseudonyme littéraire de Joseph Henri Boex, écrivain d’origine belge, né à Bruxelles en 1856 et mort à Paris en 1940. Il collabora jusqu’en 1908, avec son frère – Rosny jeune – sous le pseudonyme commun de J.H. Rosny. Tout d’abord séduit par le naturalisme (Nell Horn, 1886), Rosny Aîné rompit bientôt avec Émile Zola (Manifeste contre la Terre, 1887) pour laisser libre cours à sa fertile imagination. Empreint d’une « passion poétique » pour la science, il se place aux deux extrémités du temps puisqu’il écrivit principalement des romans d’anticipation, qui font de lui un des précurseurs de la science-fiction en France (Les Xipéhuz, 1887 ; la Mort de la Terre, 1910 ; Les Navigateurs de l’infini, 1927 ; les Compagnons du cosmos, 1934), et des romans préhistoriques, qui évoquent l’humanité à ses débuts (Vamireh, 1892 ; Eyrimah, 1895 ; Les Origines, 1895 ; la Guerre du feu, 1911 ; Le Félin géant, 1920).
La Guerre du feu a été repris en bandes dessinées (2012 à 2014) et adapté pour la deuxième fois à l’écran par Jean-Jacques Annaud en 1981. Même si l’on sait maintenant qu’à l’époque où se situe ce roman, les hommes n’étaient pas de monstrueux hommes-singes agressifs et munis de gourdins mais plutôt de paisibles chasseurs-cueilleurs, ce roman n’a pas pris une ride et son succès ne se dément pas, encore aujourd’hui. CB
Chronique parue dans Gandahar 26 en décembre 2020
Lien : https://www.gandahar.net
Faouhm déclare que chacun des deux guerriers partira de son côté avec ses assistants et que le premier qui reviendra avec le feu deviendra le maître de Gammla et de la tribu.
S’ensuit un périple ponctué de maints obstacles. Entre l’ours gris, le tigre, le lion-tigre et la tigresse, les hommes des arbres, les mammouths, les Nains rouges, les Wah et pour finir Aghoo le velu et ses frères, Naoh, Nam et Gaw, les intrépides, devront faire preuve de ruse plus que de force pour arriver vainqueurs au bout de l’aventure.
La Guerre du feu, constamment réédité depuis sa première parution est un grand classique de ce qu’on appelle les romans préhistoriques, dans le genre Merveilleux scientifique, ancêtre de la science-fiction. Merveilleux parce que l’auteur avait toute latitude pour inventer des personnages et des interactions dont il ne restait aucune trace, scientifique parce qu’il fallait avoir des connaissances en paléontologie pour assoir le récit. D’autres auteurs se sont essayés dans le genre du roman préhistorique : Fernand Mysor dont nous avons publié dans Gandahar n°2 l’excellent roman Les Semeurs d’épouvante qui nous plonge dans la terreur permanente que vivaient les humains de cette époque face à une faune sauvage en pleine liberté, Claude Cenac et son cycle de la rivière rouge, Pierre Pelot avec Le Rêve de Lucy et la série Sous le vent du monde, Jean Auel et son célèbre Les Enfants de la terre, l’anthropologue Élisabeth Marshall Thomas avec La Lune des rennes et La femme sauvage… Ce ne sont que des exemples, il y en a bien d’autres.
Ce qui distingue Joseph Rosny Aîné, c’est son style, épique, poétique, qui donne à son récit un souffle magique, une puissance de vie extraordinaire. Le lecteur se glisse avec une grande facilité dans la peau de Naoh, son héros, l’un des premiers super-héros qui a influencé les jeux de nombreux petits garçons et suscité des vocations de paléontologues, comme celle de l’auteur Francis Carsac.
Les pages qui décrivent la nature et les animaux dénotent une connaissance approfondie de ces sujets et sont d’une grande beauté poétique :
« Le fleuve roulait dans sa force. À travers mille pays de pierres, d’herbes et d’arbres, il avait bu les sources, englouti les ruisseaux, dévoré les rivières. Les glaciers s’accumulaient pour lui dans les plis chagrins de la montagne, les sources filtraient aux cavernes, les torrents pourchassaient les granits, les grès ou les calcaires, les nuages dégorgeaient leurs éponges immenses et légères, les nappes se hâtaient sur leurs lits d’argile. Frais, écumeux et vite, lorsqu’il était dompté par les rives, il s’élargissait en lacs sur les terres plates ou distillait des marécages ; il fourchait autour des îles ; il rugissait en cataractes et sanglotait en rapides. Plein de vie, il fécondait la vie intarissable. Des régions tièdes aux régions fraîches, des alluvions nourries de forces myriadaires aux sols pauvres, surgissaient les peuples lourds de l’arbre : les hordes de figuiers, d’oliviers, de pins, de térébinthes, d’yeuses, les tribus de sycomores, de platanes, de châtaigniers, d’érables, de hêtres et de chênes, les troupeaux de noyers, d’abiès, de frênes, de bouleaux, les files de peupliers blancs, de peupliers noirs, de peupliers grisaille, de peupliers argentés, de peupliers trembles et les clans d’aulnes, de saules blancs, de saules pourpres, de saules glauques et de saules pleureurs. Dans sa profondeur s’agitait la multitude muette des mollusques, tapis dans leurs demeures de chaux et de nacre, des crustacés aux armures articulées, des poissons de course, qu’une flexion lance à travers l’eau pesante, aussi vite que la frégate sur les nues, des poissons flasques qui barbotent lentement dans la fange, des reptiles souples comme les roseaux ou opaques, rugueux et denses. Selon les saisons, les hasards de la tempête, des cataclysmes ou de la guerre, s’abattaient les masses triangulaires des grues, les troupes grasses des oies, les compagnies de canards verts, de sarcelles, de macreuses, de pluviers et de hérons, les peuplades d’hirondelles, de mouettes et de chevaliers ; les outardes, les cigognes, les cygnes, les flandrins, les courlis, les râles, les martins-pêcheurs et la foule inépuisable des passereaux. Vautours, corbeaux et corneilles s’éjouissaient aux charognes abondantes ; les aigles veillaient à la corne des nuages ; les faucons planaient sur leurs ailes tranchantes ; les éperviers ou les crécerelles filaient au-dessus des hautes cimes ; les milans surgissaient, furtifs, imprévus et lâches, et le grand duc, la chevêche, l’effraie trouaient les ténèbres sur leurs ailes de silence. »
Rosny Aîné est le pseudonyme littéraire de Joseph Henri Boex, écrivain d’origine belge, né à Bruxelles en 1856 et mort à Paris en 1940. Il collabora jusqu’en 1908, avec son frère – Rosny jeune – sous le pseudonyme commun de J.H. Rosny. Tout d’abord séduit par le naturalisme (Nell Horn, 1886), Rosny Aîné rompit bientôt avec Émile Zola (Manifeste contre la Terre, 1887) pour laisser libre cours à sa fertile imagination. Empreint d’une « passion poétique » pour la science, il se place aux deux extrémités du temps puisqu’il écrivit principalement des romans d’anticipation, qui font de lui un des précurseurs de la science-fiction en France (Les Xipéhuz, 1887 ; la Mort de la Terre, 1910 ; Les Navigateurs de l’infini, 1927 ; les Compagnons du cosmos, 1934), et des romans préhistoriques, qui évoquent l’humanité à ses débuts (Vamireh, 1892 ; Eyrimah, 1895 ; Les Origines, 1895 ; la Guerre du feu, 1911 ; Le Félin géant, 1920).
La Guerre du feu a été repris en bandes dessinées (2012 à 2014) et adapté pour la deuxième fois à l’écran par Jean-Jacques Annaud en 1981. Même si l’on sait maintenant qu’à l’époque où se situe ce roman, les hommes n’étaient pas de monstrueux hommes-singes agressifs et munis de gourdins mais plutôt de paisibles chasseurs-cueilleurs, ce roman n’a pas pris une ride et son succès ne se dément pas, encore aujourd’hui. CB
Chronique parue dans Gandahar 26 en décembre 2020
Lien : https://www.gandahar.net
J.-H. Rosny-Aîsné, le mot « cavernes » dans le titre, ni une ni deux je suis persuadé d’avoir affaire à une nouvelle préhistorique. Chouette ! Tout plein de points pour le challenge historique.
Que nenni !
En fait il s’agit bel et bien d’un récit fantastico-sciencefictionnesque de la famille du Monde Perdu de Conan Doyle. Sauf que le pays préhistorique caché est remplacé par… autre chose, un monde souterrain d’une grande beauté et aussi d’un grand danger. Sur l’intrigue, je n’en dirai pas plus.
J’ai rapproché Rosny-Aîsné de Doyle, je les éloigne à présent, car si le second mêle à son récit de puissantes épices d’humour anglais, le premier n’en a pas une once. A la place, il fait chanter la langue dans un registre lyrique puissant. C’est voluptueux, riche et parfois un peu « too much ». Mais ça nourrit bien l’imagination. Les scènes d’action sont parfaitement maîtrisées, que ce soit celle de la jungle avec les jaguars ou celle de la nuit terrible dans les cavernes. Un suspense à me faire ronger les quelques ongles qui résistent.
Cette nouvelle appartient au recueil Les Profondeurs de Kyamo, publié à la fin du 19ème siècle. Comme les explorateurs du récit, j’ai donc découvert tout un nouveau monde. Il ne tient qu’à moi de me lancer dans sa découverte.
Que nenni !
En fait il s’agit bel et bien d’un récit fantastico-sciencefictionnesque de la famille du Monde Perdu de Conan Doyle. Sauf que le pays préhistorique caché est remplacé par… autre chose, un monde souterrain d’une grande beauté et aussi d’un grand danger. Sur l’intrigue, je n’en dirai pas plus.
J’ai rapproché Rosny-Aîsné de Doyle, je les éloigne à présent, car si le second mêle à son récit de puissantes épices d’humour anglais, le premier n’en a pas une once. A la place, il fait chanter la langue dans un registre lyrique puissant. C’est voluptueux, riche et parfois un peu « too much ». Mais ça nourrit bien l’imagination. Les scènes d’action sont parfaitement maîtrisées, que ce soit celle de la jungle avec les jaguars ou celle de la nuit terrible dans les cavernes. Un suspense à me faire ronger les quelques ongles qui résistent.
Cette nouvelle appartient au recueil Les Profondeurs de Kyamo, publié à la fin du 19ème siècle. Comme les explorateurs du récit, j’ai donc découvert tout un nouveau monde. Il ne tient qu’à moi de me lancer dans sa découverte.
Par manque de temps, j'avais envie de quelque chose de court. Je me suis donc tout naturellement tournée vers un classique de la littérature et J. H. Rosny dont La Guerre du Feu ne doit pas vous être inconnue.
Ces nouvelles parues chez Moutons Électriques en 2018 sont un joli florilège d'histoires préhistoriques, alternant récits de guerre, de chasse, de territoires, d'amour et de survie aux Origines du monde... Même si on est loin de l'exactitude scientifique d'une J. Auel, que ces nouvelles se cantonnent à chanter la terre et les bêtes, c'est une fabuleuse plongée dans le monde d'avant ! C'est d'ailleurs ce qui fait leur force : leur pouvoir d'évocation. Quel incroyable retour en arrière aux côtés de femmes et d'hommes hors du commun qui luttent chaque jour pour leur survie, "bêtes" devenues "verticales" rassurées par le feu à la fois "doux et dévorant" qui les accompagne et bouleverse leur vie.
Le style est merveilleux, il vous donnera envie de renouer avec les grands bouquins de votre enfance (La Guerre du Feu, La force Mystérieuse et autres Félin Géant) L'immersion est totale grâce aux nombreux rebondissements, à la poésie omniprésente qui loue les relations hommes-bêtes dans leur prodigieuse complexité. Les descriptions sont magnifiques, que l'on évolue dans la savane, aux pieds des montagne, chez les lacustres ou sur les rives d'un torrent.
La violence côtoie la compréhension de la terre et de la faune sauvage et ce mélange de rudesse et de beauté m'a complètement subjuguée, notamment dans "Le lion géant et la Tigresse". Megacéros, mammouths, tigres à dent de sabre, urus, lion géant, ours gris, hémione et autres colosses antédiluviens se succèdent au fil des pages de Rosny Aîné.
Un moment tumultueux et hors du temps qui permet de suivre le parcours de l'homme, ses luttes acharnées et son évolution au fil de ses decouvertes, qu'il soit chasseur, pêcheur, stratège, guérisseur. Mais pas seulement. Derrière les combats, la brutalité des clans, les tueries nécessaires à la survie, l'auteur révèle l'ébauche de l'être humain qu'il deviendra grâce à la prise de conscience de ce qui l'entoure et la réflexion qui le voit grandir.
Peuplé de tribulations passionnantes, on dévore ce recueil comme une excellente succession d'aventures primitives. À découvrir.
Ces nouvelles parues chez Moutons Électriques en 2018 sont un joli florilège d'histoires préhistoriques, alternant récits de guerre, de chasse, de territoires, d'amour et de survie aux Origines du monde... Même si on est loin de l'exactitude scientifique d'une J. Auel, que ces nouvelles se cantonnent à chanter la terre et les bêtes, c'est une fabuleuse plongée dans le monde d'avant ! C'est d'ailleurs ce qui fait leur force : leur pouvoir d'évocation. Quel incroyable retour en arrière aux côtés de femmes et d'hommes hors du commun qui luttent chaque jour pour leur survie, "bêtes" devenues "verticales" rassurées par le feu à la fois "doux et dévorant" qui les accompagne et bouleverse leur vie.
Le style est merveilleux, il vous donnera envie de renouer avec les grands bouquins de votre enfance (La Guerre du Feu, La force Mystérieuse et autres Félin Géant) L'immersion est totale grâce aux nombreux rebondissements, à la poésie omniprésente qui loue les relations hommes-bêtes dans leur prodigieuse complexité. Les descriptions sont magnifiques, que l'on évolue dans la savane, aux pieds des montagne, chez les lacustres ou sur les rives d'un torrent.
La violence côtoie la compréhension de la terre et de la faune sauvage et ce mélange de rudesse et de beauté m'a complètement subjuguée, notamment dans "Le lion géant et la Tigresse". Megacéros, mammouths, tigres à dent de sabre, urus, lion géant, ours gris, hémione et autres colosses antédiluviens se succèdent au fil des pages de Rosny Aîné.
Un moment tumultueux et hors du temps qui permet de suivre le parcours de l'homme, ses luttes acharnées et son évolution au fil de ses decouvertes, qu'il soit chasseur, pêcheur, stratège, guérisseur. Mais pas seulement. Derrière les combats, la brutalité des clans, les tueries nécessaires à la survie, l'auteur révèle l'ébauche de l'être humain qu'il deviendra grâce à la prise de conscience de ce qui l'entoure et la réflexion qui le voit grandir.
Peuplé de tribulations passionnantes, on dévore ce recueil comme une excellente succession d'aventures primitives. À découvrir.
Pendant la préhistoire, les Oulhamir ne maîtrisent pas le feu. Naoh avec l'aide de Nam et de Gaw promet de ramener le feu à la tribut. Court roman de J.H. Rosny Ainé sur les hommes préhistoriques. Certains chapitres sont splendides (la bataille entre les aurochs et les mammouths par exemple) mais les combats de Naoh se succèdent et se répètent créant un sentiment de lassitude.
Après La guerre du feu ce roman complète l'histoire de l'évolution de l'homme sur terre. Il est condamné à disparaître pour laisser place aux "ferromagnétaux" alors que les oiseaux acquièrent le langage.
Auteur à redécouvrir en ces temps de crise climatique et sanitaire !
Auteur à redécouvrir en ces temps de crise climatique et sanitaire !
Je qualifierais La guerre du feu de livre charmant et légèrement désuet. Il est plaisant à lire, bien qu'un peu répétitif et fait la part belle à la découverte de cette période de l'histoire humaine très méconnue (et encore plus à l'époque à laquelle est sorti le livre !) dont le potentiel littéraire et cinématographique est à mon avis sous-estimé. Il est fascinant de lire un roman se passant à cette période dont on sait à la fois beaucoup via les nombreuses traces archéologiques qui ont été retrouvées, et à la fois si peu, du fait de l'absence d'écriture. Les suppositions que l'on peut faire laisse la part belle à l'imagination, mâtinée d'anachronismes forcément, et Rosny Aîné relève décemment le défi.
La guerre du feu est un roman un peu déroutant. Dans l'ensemble, j'ai trouvé cette lecture un peu ennuyeuse. le sujet n'est pourtant pas dénué d'intérêt.
A la Préhistoire (qui s'étend entre 3 millions d'années et 3500 avant J.-C., mais la domestication du feu a 1 million d'années) la tribu des Oulhamrs perd le feu au cours d'une attaque par une tribu ennemie. Ils sont capables d'entretenir le feu mais pas de le créer. le chef des Oulhamrs, Faouhm, promet à qui ramènera le feu sa nièce Gammla ainsi que le commandement de la tribu.
Naoh, fils du Léopard, se porte volontaire et propose d'emmener avec lui les guerriers Gaw et Nam. Un autre trio concurrent se forme avec Aghoo-le-velu (fils de l'Auroch) et ses deux frères mais l'histoire se concentre sur Naoh et ses acolytes.
Vivre à l'époque de la Préhistoire est loin d'être une sinécure, c'est une lutte incessante pour la survie dans une nature brute (faune et flore).
J'ai un peu eu du mal à imaginer les différentes tribus rencontrées comme les Kzamms ou les Nains Rouges.
Quoi qu'il en soit, j'ai quand même bien apprécié l'écriture qui n'était pas exempte de poésie. Cela ne m'a pas donné envie de voir le film mais j'ai vu qu'il y avait une adaptation en bande dessinée en 3 tomes par Emmanuel Roudier (2012-2014).
Challenge SFFF 2021
Challenge livre historique 2021
A la Préhistoire (qui s'étend entre 3 millions d'années et 3500 avant J.-C., mais la domestication du feu a 1 million d'années) la tribu des Oulhamrs perd le feu au cours d'une attaque par une tribu ennemie. Ils sont capables d'entretenir le feu mais pas de le créer. le chef des Oulhamrs, Faouhm, promet à qui ramènera le feu sa nièce Gammla ainsi que le commandement de la tribu.
Naoh, fils du Léopard, se porte volontaire et propose d'emmener avec lui les guerriers Gaw et Nam. Un autre trio concurrent se forme avec Aghoo-le-velu (fils de l'Auroch) et ses deux frères mais l'histoire se concentre sur Naoh et ses acolytes.
Vivre à l'époque de la Préhistoire est loin d'être une sinécure, c'est une lutte incessante pour la survie dans une nature brute (faune et flore).
J'ai un peu eu du mal à imaginer les différentes tribus rencontrées comme les Kzamms ou les Nains Rouges.
Quoi qu'il en soit, j'ai quand même bien apprécié l'écriture qui n'était pas exempte de poésie. Cela ne m'a pas donné envie de voir le film mais j'ai vu qu'il y avait une adaptation en bande dessinée en 3 tomes par Emmanuel Roudier (2012-2014).
Challenge SFFF 2021
Challenge livre historique 2021
Le grand public l'a oublié mais, en son temps, J.H. Rosny aîné jouait dans la même cours qu'un Jules Vernes ou un Herbert Georges Wells. A l'instar de ses illustres contemporains, il peut être considéré comme un des précurseur de la SF. Mais, curieusement, sa popularité déclina après la deuxième guerre mondiale, pour ne rester vivace que dans le cœur des initiés, et ce malgré la très bonne adaptation cinématographique de la Guerre du Feu, réalisée par Jean-Jacques Annaud, en 1981. Heureusement que le travail de quelques anthologistes passionnés, dont Jean-Baptiste Baronian, qui publia en 1973 chez Marabout un recueil des récits de Rosny aîné, a su maintenir la flamme en vie.
Cette "Guerre des Règnes" s'inspire d'ailleurs beaucoup de ce recueil, puisqu'on y trouve pratiquement les mêmes textes. Au passage, on ne peut que saluer le travail de Laurent Genefort, à la tête de la collection Les Trésors de la SF, chez Bragelonne, puisqu'il perpétue l'héritage de cette SF française, à la fois populaire et de qualité et ce, donc, jusqu'aux origines du genre, en proposant le présent recueil.
Alors bien sûr, on trouve ici du très bon ("la Guerre du Feu", "la Mort de la Terre"), du bon ("Nymphée", "la Jeune Vampire" ou encore "un Autre Monde") mais aussi du moins bon ("le Trésor dans la Neige"), voire du mauvais ("les Navigateurs de l'Infini", "le Cataclysme"). Et on balaye aussi bien le versant préhistorique de l'œuvre de Rosny aîné, que le "merveilleux scientifique", typique de la fin du XIXème siècle, ou encore la proto science-fiction et le fantastique. L'ensemble est utilement complété par une postface de Serge Lehman, qui est à la fois une mise en perspective et un cri d'amour adressé à l'auteur.
Un tome 2 mettant en avant les 4 autres romans préhistoriques de l'auteur est-il en projet ? Si c'est le cas, moi je signe toute de suite.
Cette "Guerre des Règnes" s'inspire d'ailleurs beaucoup de ce recueil, puisqu'on y trouve pratiquement les mêmes textes. Au passage, on ne peut que saluer le travail de Laurent Genefort, à la tête de la collection Les Trésors de la SF, chez Bragelonne, puisqu'il perpétue l'héritage de cette SF française, à la fois populaire et de qualité et ce, donc, jusqu'aux origines du genre, en proposant le présent recueil.
Alors bien sûr, on trouve ici du très bon ("la Guerre du Feu", "la Mort de la Terre"), du bon ("Nymphée", "la Jeune Vampire" ou encore "un Autre Monde") mais aussi du moins bon ("le Trésor dans la Neige"), voire du mauvais ("les Navigateurs de l'Infini", "le Cataclysme"). Et on balaye aussi bien le versant préhistorique de l'œuvre de Rosny aîné, que le "merveilleux scientifique", typique de la fin du XIXème siècle, ou encore la proto science-fiction et le fantastique. L'ensemble est utilement complété par une postface de Serge Lehman, qui est à la fois une mise en perspective et un cri d'amour adressé à l'auteur.
Un tome 2 mettant en avant les 4 autres romans préhistoriques de l'auteur est-il en projet ? Si c'est le cas, moi je signe toute de suite.
"La Mort de la Terre" est Thanatos, quand "la Guerre du Feu" est Eros... 100 000 mille ans dans le futur, J.-H. Rosny aîné nous conte la fin de l'humanité.
Comme dans son célèbre roman préhistorique, l'auteur adopte un style lyrique et poétique, mais ici c'est une mélancolie insondable, teintée d'une résignation définitive, qui domine.
L'humanité, après avoir largement dominée le monde, grâce à sa technologie qu'elle croyait sans limites et propre à l'élever au-delà de la nature, survit désormais dans de petites oasis éparses, au milieu de gigantesques déserts, alors que l'eau disparait peu à peu, sous l'effet de tremblements de terre récurrents.
L'auteur nous narre, à travers le personnage de Targ, les derniers instants de la vie humaine sur terre, alors que le Règne des ferromagnétiques (des créatures minérales, qui ne sont pas sans rappeler celles du roman les Xipéhuz) est amené à lui succéder.
"la Fin de la Terre" et la "Guerre du Feu" sont les deux faces d'une même médaille, qui ausculte, non pas des personnages, mais l'espèce tout entière. Une œuvre en forme de conte et dont on pourra aisément reprocher l'absence d'approche romanesque, voire la langue surannée. Cette langue ne fait pas mouche à tout les coups ("les Navigateurs de l'Infini", par exemple), mais elle n'est jamais aussi efficace que lorsque l'auteur prend cette hauteur de vue, teintée d'humanisme, qui lui fait embrasser tous ses semblables.
C'est beau comme ça...Ca aurait été très bien aussi en forme de "planet opéra" au monde fouillé. Mais gardons à l'esprit que, sans J.-H. Rosny aîné, et quelques autres, il n'y aurait point de "planet opéra" aujourd'hui.
Comme dans son célèbre roman préhistorique, l'auteur adopte un style lyrique et poétique, mais ici c'est une mélancolie insondable, teintée d'une résignation définitive, qui domine.
L'humanité, après avoir largement dominée le monde, grâce à sa technologie qu'elle croyait sans limites et propre à l'élever au-delà de la nature, survit désormais dans de petites oasis éparses, au milieu de gigantesques déserts, alors que l'eau disparait peu à peu, sous l'effet de tremblements de terre récurrents.
L'auteur nous narre, à travers le personnage de Targ, les derniers instants de la vie humaine sur terre, alors que le Règne des ferromagnétiques (des créatures minérales, qui ne sont pas sans rappeler celles du roman les Xipéhuz) est amené à lui succéder.
"la Fin de la Terre" et la "Guerre du Feu" sont les deux faces d'une même médaille, qui ausculte, non pas des personnages, mais l'espèce tout entière. Une œuvre en forme de conte et dont on pourra aisément reprocher l'absence d'approche romanesque, voire la langue surannée. Cette langue ne fait pas mouche à tout les coups ("les Navigateurs de l'Infini", par exemple), mais elle n'est jamais aussi efficace que lorsque l'auteur prend cette hauteur de vue, teintée d'humanisme, qui lui fait embrasser tous ses semblables.
C'est beau comme ça...Ca aurait été très bien aussi en forme de "planet opéra" au monde fouillé. Mais gardons à l'esprit que, sans J.-H. Rosny aîné, et quelques autres, il n'y aurait point de "planet opéra" aujourd'hui.
LA MORT DE LA TERRE
Ce court roman de 1911 est le plus lu de Rosny Aîné après La Guerre du feu.
Il est dans la droite ligne de certaines de ses plus anciennes nouvelles, de la fin des années 1880, précurseurs de la science-fiction, que l'on appelait alors le "merveilleux scientifique", terme que l'auteur emploie lui-même dans l'avertissement (intéressant d'ailleurs, il y parle de HG Wells et défend l'anglo-saxon, visiblement accusé à tort de l'avoir plagié).
Bon, on va pas se mentir : c'est pas très gai tout ça. D'ailleurs, le livre aurait pu s'appeler "la mort des hommes" plutôt que la mort de la terre, et ce n'est pas trop spoiler que de dire que tout cela va très très mal finir, car on en a une assez nette idée dès le début, tant cette prose a quelque chose d'inexorable, de résigné et de résolu.
C'est un livre de son époque, très lyrique, parfois même suranné, et j'ai eu du mal à me représenter certaines choses, comme ces fameux ferromagnétaux, sortes de créatures minérales qui anémient les hommes jusqu'à la mort. J'ai donc mis un peu de temps à accrocher.
Mais on ne peut que s'incliner devant le côté incroyablement visionnaire de l'auteur, qui anticipe déjà les dégâts de la radioactivité alors qu'elle venait à peine d'être découverte, et qui ressent déjà le destin exterminateur de l'espèce humaine, à la fois sur la faune et sur la flore, et le fait qu'elle est en train de se condamner elle-même.
Un livre que l'on pourrait conseiller à pas mal de gens d'aujourd'hui, afin de leur rappeler que nous ne sommes finalement qu'un pet de mouche dans l'histoire de la Terre, une espèce de passage qui ne vivra sûrement pas aussi longtemps que les dinosaures, et certainement pas la plus glorieuse. Afin de retrouver un peu d'humilité, tout simplement, si tant est que ce soit possible.
CONTES
Le roman précédent étant trop court pour les standards de l'édition à l'époque peut-être, il s'accompagne de 32 "contes" très courts, de véritables "novelettes" qui se lisent quasi toutes en moins de cinq minutes.
Aucun rapport avec la science-fiction, il s'agit de petites histoires réalistes dépeignant les mœurs de l'époque de l'auteur, tout particulièrement les mœurs bourgeoises.
Écrits dans un style flamboyant et souvent très juste, ces contes sont souvent intéressants et force est de constater que l'auteur excelle dans ce format, même si on devine souvent la fin dès le début, ce qui paraît normal pour des textes aussi courts.
Le principal reproche qu'on pourra faire à ces textes est la grande redondance des thèmes abordés, au point de flirter parfois avec l'obsession.
- L'héritage : abordé de manière analogue dans La mère, L'oncle Antoine, et de façon nettement plus originale dans L'avare.
- L'accident mortel qui vient gâcher une vie partie pour être merveilleuse : La petite aventure, la plus belle mort, au fond des bois.
- Le sauvetage : le sauveteur, après le naufrage, le sauvetage de Népomucène, le lion et le taureau
- Les actes de générosité désintéressés qui finissent par rejaillir sur leur auteur : le vieux biffin, les pommes de terre sous la cendre, le dormeur (2è série), un soir, la jeune saltimbanque... Certaines de la liste étant d’ailleurs liées également au thème de l'héritage.
La morale bourgeoise et l'obsession de l'argent sont souvent omniprésentes, avec une ressemblance parfois frappante avec les nouvelles de Maupassant.
Les textes peuvent aussi être très critiques vis-à-vis des habitudes bourgeoises, ainsi du dégoût de l'oisiveté rentière dans La marchande de fleurs, et de l'immoralité des nobliaux désargentés dans La fille du menuisier, toutes les deux excellentes.
"Mon ennemi" est une bonne histoire de western.
"Le dormeur" (1è série) donne une version horrifique de ce que peut donner une bêtise d'enfant.
"Le condamné à mort" est une belle diatribe contre la peine capitale, avec des accents hugoliens.
"La bonne blague " est touchante.
"Le clou" est une bonne histoire de vengeance dans le cadre de la guerre de 70, très maupassantesque elle aussi.
"La bataille", enfin, est une assez bluffante prospective sur la première guerre mondiale à venir, la seule du recueil ayant un élément de science-fiction, mettant en scène une guerre austro-ottomane où l'auteur analyse très bien le risque de conflagration résultant des alliances. Hélas, elle se termine un peu brutalement.
Ce court roman de 1911 est le plus lu de Rosny Aîné après La Guerre du feu.
Il est dans la droite ligne de certaines de ses plus anciennes nouvelles, de la fin des années 1880, précurseurs de la science-fiction, que l'on appelait alors le "merveilleux scientifique", terme que l'auteur emploie lui-même dans l'avertissement (intéressant d'ailleurs, il y parle de HG Wells et défend l'anglo-saxon, visiblement accusé à tort de l'avoir plagié).
Bon, on va pas se mentir : c'est pas très gai tout ça. D'ailleurs, le livre aurait pu s'appeler "la mort des hommes" plutôt que la mort de la terre, et ce n'est pas trop spoiler que de dire que tout cela va très très mal finir, car on en a une assez nette idée dès le début, tant cette prose a quelque chose d'inexorable, de résigné et de résolu.
C'est un livre de son époque, très lyrique, parfois même suranné, et j'ai eu du mal à me représenter certaines choses, comme ces fameux ferromagnétaux, sortes de créatures minérales qui anémient les hommes jusqu'à la mort. J'ai donc mis un peu de temps à accrocher.
Mais on ne peut que s'incliner devant le côté incroyablement visionnaire de l'auteur, qui anticipe déjà les dégâts de la radioactivité alors qu'elle venait à peine d'être découverte, et qui ressent déjà le destin exterminateur de l'espèce humaine, à la fois sur la faune et sur la flore, et le fait qu'elle est en train de se condamner elle-même.
Un livre que l'on pourrait conseiller à pas mal de gens d'aujourd'hui, afin de leur rappeler que nous ne sommes finalement qu'un pet de mouche dans l'histoire de la Terre, une espèce de passage qui ne vivra sûrement pas aussi longtemps que les dinosaures, et certainement pas la plus glorieuse. Afin de retrouver un peu d'humilité, tout simplement, si tant est que ce soit possible.
CONTES
Le roman précédent étant trop court pour les standards de l'édition à l'époque peut-être, il s'accompagne de 32 "contes" très courts, de véritables "novelettes" qui se lisent quasi toutes en moins de cinq minutes.
Aucun rapport avec la science-fiction, il s'agit de petites histoires réalistes dépeignant les mœurs de l'époque de l'auteur, tout particulièrement les mœurs bourgeoises.
Écrits dans un style flamboyant et souvent très juste, ces contes sont souvent intéressants et force est de constater que l'auteur excelle dans ce format, même si on devine souvent la fin dès le début, ce qui paraît normal pour des textes aussi courts.
Le principal reproche qu'on pourra faire à ces textes est la grande redondance des thèmes abordés, au point de flirter parfois avec l'obsession.
- L'héritage : abordé de manière analogue dans La mère, L'oncle Antoine, et de façon nettement plus originale dans L'avare.
- L'accident mortel qui vient gâcher une vie partie pour être merveilleuse : La petite aventure, la plus belle mort, au fond des bois.
- Le sauvetage : le sauveteur, après le naufrage, le sauvetage de Népomucène, le lion et le taureau
- Les actes de générosité désintéressés qui finissent par rejaillir sur leur auteur : le vieux biffin, les pommes de terre sous la cendre, le dormeur (2è série), un soir, la jeune saltimbanque... Certaines de la liste étant d’ailleurs liées également au thème de l'héritage.
La morale bourgeoise et l'obsession de l'argent sont souvent omniprésentes, avec une ressemblance parfois frappante avec les nouvelles de Maupassant.
Les textes peuvent aussi être très critiques vis-à-vis des habitudes bourgeoises, ainsi du dégoût de l'oisiveté rentière dans La marchande de fleurs, et de l'immoralité des nobliaux désargentés dans La fille du menuisier, toutes les deux excellentes.
"Mon ennemi" est une bonne histoire de western.
"Le dormeur" (1è série) donne une version horrifique de ce que peut donner une bêtise d'enfant.
"Le condamné à mort" est une belle diatribe contre la peine capitale, avec des accents hugoliens.
"La bonne blague " est touchante.
"Le clou" est une bonne histoire de vengeance dans le cadre de la guerre de 70, très maupassantesque elle aussi.
"La bataille", enfin, est une assez bluffante prospective sur la première guerre mondiale à venir, la seule du recueil ayant un élément de science-fiction, mettant en scène une guerre austro-ottomane où l'auteur analyse très bien le risque de conflagration résultant des alliances. Hélas, elle se termine un peu brutalement.
Rosny Ainé est l’auteur de la célèbre Guerre du feu parfaitement mise en images par Jean-Jacques Annaud. Il y évoque ce qu’on nomme Les âges farouches de l’Humanité naissante. Deux ans après son édition, il aborde la fin de cette même Humanité agonisante. Entre les deux époques, plus de 100.000 ans se seraient passés…
La terre s’est transformée, et l’Homme l’a bien aidée pour cela. Les océans ont disparu, le paysage est devenu chaotique et désert. Quelques poches d’humanité survivent tant bien que mal auprès des rares sources encore existantes. Leur technologie très développée les retient encore de sombrer définitivement, mais la fin semble inévitable.
Targ, celui qu’on appelle le veilleur, veut encore y croire. C’est sans compter sur l’inéluctable. Une nouvelle forme de vie s’apprête à prendre la place des hommes, les ferromagnétaux, espèce en voie de développement et parfaitement adaptée à ce nouvel environnement.
Court et concis, ce texte écologique avant l’heure brosse un état des lieux désespérant où le retour en arrière n’est plus de mise. Malgré tout l’attachement qu’on peut éprouver pour ces derniers hommes, le lecteur ne peut qu’assister à cette accélération dramatique qui pousse l’Humanité vers la sortie.
Cette réflexion sur la finitude obligée des choses, cet inévitable passage de témoin d’un cycle à l’autre est magnifié par une écriture poétique où chaque mot semble compté à son juste poids et son propre sens. Le mode de vie de ces derniers hommes est bien anecdotique comparé à la rudesse de cette extrême noirceur. Les dernières palpitations d’une espèce en voie de disparition sont montrées avec pudeur et pourtant sans ménagement.
Ce beau texte éclaire de façon sublime ce que la biologie telle que nous la connaissons aujourd’hui sous forme d’espèces nombreuses et variées, doit à un équilibre précaire né d’une forme de hasard cosmique, équilibre si fragile qu’une seule espèce peut largement contribuer à rompre sans retour possible.
En lisant cet ouvrage, je n’ai pu m’empêcher également de faire le parallèle avec l’excellent roman de Jean-Pierre Andrevon intitulé Le Monde enfin, où il est question d’une pandémie ravageuse qui mettra fin à l’Humanité et signera le nouveau règne animal.
Rosny Ainé est à sa façon un précurseur de l’écologie moderne et son scénario pessimiste vient faire écho à la situation que nous vivons actuellement. Nos jours difficiles sous le règne de la Covid-19 ne sonneraient-ils pas comme un mauvais présage, un avertissement ?
Michelangelo 18/12/2020
Voici la fin crépusculaire du dernier homme sur Terre imaginée par Rosny Ainé :
La nuit venait. Le firmament montra ces feux charmants qu’avaient connus les yeux de trillions d’hommes. Il ne restait que deux yeux pour les contempler !… Targ dénombra ceux qu’il avait préférés aux autres, puis il vit encore se lever l’astre ruineux, l’astre troué, argentin et légendaire, vers lequel il leva ses mains tristes…
Il eut un dernier sanglot ; la mort entra dans son cœur et, se refusant à l’euthanasie, il sortit des ruines, il alla s’étendre dans l’oasis, parmi les ferromagnétaux.
Ensuite, humblement, quelques parcelles de la dernière vie humaine entrèrent dans la vie nouvelle.
Lien : http://jaimelireetecrire.ove..
La terre s’est transformée, et l’Homme l’a bien aidée pour cela. Les océans ont disparu, le paysage est devenu chaotique et désert. Quelques poches d’humanité survivent tant bien que mal auprès des rares sources encore existantes. Leur technologie très développée les retient encore de sombrer définitivement, mais la fin semble inévitable.
Targ, celui qu’on appelle le veilleur, veut encore y croire. C’est sans compter sur l’inéluctable. Une nouvelle forme de vie s’apprête à prendre la place des hommes, les ferromagnétaux, espèce en voie de développement et parfaitement adaptée à ce nouvel environnement.
Court et concis, ce texte écologique avant l’heure brosse un état des lieux désespérant où le retour en arrière n’est plus de mise. Malgré tout l’attachement qu’on peut éprouver pour ces derniers hommes, le lecteur ne peut qu’assister à cette accélération dramatique qui pousse l’Humanité vers la sortie.
Cette réflexion sur la finitude obligée des choses, cet inévitable passage de témoin d’un cycle à l’autre est magnifié par une écriture poétique où chaque mot semble compté à son juste poids et son propre sens. Le mode de vie de ces derniers hommes est bien anecdotique comparé à la rudesse de cette extrême noirceur. Les dernières palpitations d’une espèce en voie de disparition sont montrées avec pudeur et pourtant sans ménagement.
Ce beau texte éclaire de façon sublime ce que la biologie telle que nous la connaissons aujourd’hui sous forme d’espèces nombreuses et variées, doit à un équilibre précaire né d’une forme de hasard cosmique, équilibre si fragile qu’une seule espèce peut largement contribuer à rompre sans retour possible.
En lisant cet ouvrage, je n’ai pu m’empêcher également de faire le parallèle avec l’excellent roman de Jean-Pierre Andrevon intitulé Le Monde enfin, où il est question d’une pandémie ravageuse qui mettra fin à l’Humanité et signera le nouveau règne animal.
Rosny Ainé est à sa façon un précurseur de l’écologie moderne et son scénario pessimiste vient faire écho à la situation que nous vivons actuellement. Nos jours difficiles sous le règne de la Covid-19 ne sonneraient-ils pas comme un mauvais présage, un avertissement ?
Michelangelo 18/12/2020
Voici la fin crépusculaire du dernier homme sur Terre imaginée par Rosny Ainé :
La nuit venait. Le firmament montra ces feux charmants qu’avaient connus les yeux de trillions d’hommes. Il ne restait que deux yeux pour les contempler !… Targ dénombra ceux qu’il avait préférés aux autres, puis il vit encore se lever l’astre ruineux, l’astre troué, argentin et légendaire, vers lequel il leva ses mains tristes…
Il eut un dernier sanglot ; la mort entra dans son cœur et, se refusant à l’euthanasie, il sortit des ruines, il alla s’étendre dans l’oasis, parmi les ferromagnétaux.
Ensuite, humblement, quelques parcelles de la dernière vie humaine entrèrent dans la vie nouvelle.
Lien : http://jaimelireetecrire.ove..
Ce court roman de 1911 est le plus lu de Rosny Aîné après La Guerre du feu.
Il est dans la droite ligne de certaines de ses plus anciennes nouvelles, de la fin des années 1880, précurseurs de la science-fiction, que l'on appelait alors le "merveilleux scientifique", terme que l'auteur emploie lui-même dans l'avertissement (intéressant d'ailleurs, il y parle de HG Wells et défend l'anglo-saxon, visiblement accusé à tort de l'avoir plagié).
Bon, on va pas se mentir : c'est pas très gai tout ça. D'ailleurs, le livre aurait pu s'appeler "la mort des hommes" plutôt que la mort de la terre, et ce n'est pas trop spoiler que de dire que tout cela va très très mal finir, car on en a une assez nette idée dès le début, tant cette prose a quelque chose d'inexorable, de résigné et de résolu.
C'est un livre de son époque, très lyrique, parfois même suranné, et j'ai eu du mal à me représenter certaines choses, comme ces fameux ferromagnétaux, sortes de créatures minérales qui anémient les hommes jusqu'à la mort. J'ai donc mis un peu de temps à accrocher.
Mais on ne peut que s'incliner devant le côté incroyablement visionnaire de l'auteur, qui anticipe déjà les dégâts de la radioactivité alors qu'elle venait à peine d'être découverte, et qui ressent déjà le destin exterminateur de l'espèce humaine, à la fois sur la faune et sur la flore, et le fait qu'elle est en train de se condamner elle-même.
Un livre que l'on pourrait conseiller à pas mal de gens d'aujourd'hui, afin de leur rappeler que nous ne sommes finalement qu'un pet de mouche dans l'histoire de la Terre, une espèce de passage qui ne vivra sûrement pas aussi longtemps que les dinosaures, et certainement pas la plus glorieuse. Afin de retrouver un peu d'humilité, tout simplement, si tant est que ce soit possible.
Il est dans la droite ligne de certaines de ses plus anciennes nouvelles, de la fin des années 1880, précurseurs de la science-fiction, que l'on appelait alors le "merveilleux scientifique", terme que l'auteur emploie lui-même dans l'avertissement (intéressant d'ailleurs, il y parle de HG Wells et défend l'anglo-saxon, visiblement accusé à tort de l'avoir plagié).
Bon, on va pas se mentir : c'est pas très gai tout ça. D'ailleurs, le livre aurait pu s'appeler "la mort des hommes" plutôt que la mort de la terre, et ce n'est pas trop spoiler que de dire que tout cela va très très mal finir, car on en a une assez nette idée dès le début, tant cette prose a quelque chose d'inexorable, de résigné et de résolu.
C'est un livre de son époque, très lyrique, parfois même suranné, et j'ai eu du mal à me représenter certaines choses, comme ces fameux ferromagnétaux, sortes de créatures minérales qui anémient les hommes jusqu'à la mort. J'ai donc mis un peu de temps à accrocher.
Mais on ne peut que s'incliner devant le côté incroyablement visionnaire de l'auteur, qui anticipe déjà les dégâts de la radioactivité alors qu'elle venait à peine d'être découverte, et qui ressent déjà le destin exterminateur de l'espèce humaine, à la fois sur la faune et sur la flore, et le fait qu'elle est en train de se condamner elle-même.
Un livre que l'on pourrait conseiller à pas mal de gens d'aujourd'hui, afin de leur rappeler que nous ne sommes finalement qu'un pet de mouche dans l'histoire de la Terre, une espèce de passage qui ne vivra sûrement pas aussi longtemps que les dinosaures, et certainement pas la plus glorieuse. Afin de retrouver un peu d'humilité, tout simplement, si tant est que ce soit possible.
Avant de faire une critique de ce livre, il faut garder en tête qu’il a été écrit il y a près de 100 ans. Les connaissances sur Mars étaient alors embryonnaires. Il en découle que tout ce qu’a décrit l’auteur à propos de la vie sur Mars est bien loin d’une réalité révélée il n’y a finalement que peu d’années. Je ne lui en tiens donc pas rigueur. Au contraire, l’effort d’imagination pour inventer une vie très dissemblable à celle existant sur Terre, bien qu’elle soit tout de même plutôt anthropocentrique, est à louer. J’ai été fasciné par ses zoomorphes et ses Ethéraux. En revanche, ses Tripèdes sont trop proches des humains pour éveiller une véritable curiosité, si ce n’est leur caractère fataliste et foncièrement non-violent. À noter aussi une touche singulière avec ce sentiment proche de l’amour qui naît entre le narrateur et la belle Tripède.
Pourtant l’intrigue se révèle bien pauvre. Elle n’est pas à la hauteur pour tirer cette œuvre au-delà d’un simple bestiaire martien.
Lien : https://www.pascific.fr/1925..
Pourtant l’intrigue se révèle bien pauvre. Elle n’est pas à la hauteur pour tirer cette œuvre au-delà d’un simple bestiaire martien.
Lien : https://www.pascific.fr/1925..
je suis incapable de dire de quoi ça parle mais je me souviens que j'avais adoré
Ce court roman est prenant, puissant et radical. J'ai découvert l'ouvrage grâce au site litteratureaudio.com La mise en voix est classieuse, soignée, très réussie. Le ton grave et précis du lecteur donne toute l'importance au propos. C'est éminemment moderne. Écrit en 1910 ! 110 ans et pourtant c'est très proche du mouvement de la collapsologie. L'eau manque atrocement. L'humanité réduite survit dans des oasis. Les ferromagnétiques pullulent. Puis la terre se fissure encore, faisant disparaître les dernières gouttes d'eau. Alors, l'euthanasie est l'ultime remède. Résumé comme cela c'est fade mais la langue vaut le détour. C'est baroque, grandiloquent, magistral et à la fois très humble, sage quelque part. Chapeau !
Cette courte nouvelle préhistorique est la meilleure de cet auteur que j'ai lue jusqu'à présent.
Écrite plus de 10 ans avant la Guerre du Feu, elle préfigure clairement le roman le plus connu de Rosny Aîné, tout en étant à mon sens meilleure, autant qu'une nouvelle puisse être comparée à un roman, parce qu'elle ne souffre pas de la même monotonie ni des mêmes redondances.
Je pense également que Jean-Jacques Annaud a dû la lire avant de tourner son adaptation de La Guerre du feu, car on retrouve dans le film cette notion d'amour naissant, d'animalité qui se transforme subrepticement en sentiments, dans quelques scènes entre Everett Mac Gill et Rae Dawn Chong, que l'on ne trouve pas tant que ça dans le roman La Guerre du feu.
Bon, certaines mauvaises langues diront que dans le film, cette mutation se limite au passage de la levrette au missionnaire, mais c'est un autre débat.
Écrite plus de 10 ans avant la Guerre du Feu, elle préfigure clairement le roman le plus connu de Rosny Aîné, tout en étant à mon sens meilleure, autant qu'une nouvelle puisse être comparée à un roman, parce qu'elle ne souffre pas de la même monotonie ni des mêmes redondances.
Je pense également que Jean-Jacques Annaud a dû la lire avant de tourner son adaptation de La Guerre du feu, car on retrouve dans le film cette notion d'amour naissant, d'animalité qui se transforme subrepticement en sentiments, dans quelques scènes entre Everett Mac Gill et Rae Dawn Chong, que l'on ne trouve pas tant que ça dans le roman La Guerre du feu.
Bon, certaines mauvaises langues diront que dans le film, cette mutation se limite au passage de la levrette au missionnaire, mais c'est un autre débat.
Cette courte nouvelle est parue en 1888, un an après les Xipéhuz, considérée par beaucoup comme fondatrice de la science-fiction au moins francophone.
Si l'intrigue est réduite au plus simple appareil, la description du cataclysme, en revanche, est assez remarquable, tant dans son originalité (notamment la manière dont le phénomène modifie la pesanteur et la perception du monde) que dans les sentiments attribués aux protagonistes.
Plutôt plaisant, donc , et à lire comme un "court-métrage catastrophe."
Si l'intrigue est réduite au plus simple appareil, la description du cataclysme, en revanche, est assez remarquable, tant dans son originalité (notamment la manière dont le phénomène modifie la pesanteur et la perception du monde) que dans les sentiments attribués aux protagonistes.
Plutôt plaisant, donc , et à lire comme un "court-métrage catastrophe."
Je continue ma découverte de l’œuvre de Rosny Aîné, avec cette courte nouvelle qui se lit en 10-15 mn, et sur laquelle j'ai quand même réussi à m'endormir.
Elle a été écrite en 1939, un an avant la mort de l'auteur, et ce n'est sans doute pas anodin puisque le héros, Abel, qui vit sur deux plans parallèles en même temps (dont un seul est habité par les hommes, ce qui veut dire que dans l'autre monde, il n'est pas un homme), meurt sur Terre à la fin, mais continue à vivre, de manière immortelle, dans l'autre monde et sous sa forme de "variant".
J'y ai vu une allégorie de la mort et de l'immortalité, mais si l'écriture n'est pas dénuée de poésie, l'ensemble est tout de même assez abscons, et de peu d'intérêt.
Elle a été écrite en 1939, un an avant la mort de l'auteur, et ce n'est sans doute pas anodin puisque le héros, Abel, qui vit sur deux plans parallèles en même temps (dont un seul est habité par les hommes, ce qui veut dire que dans l'autre monde, il n'est pas un homme), meurt sur Terre à la fin, mais continue à vivre, de manière immortelle, dans l'autre monde et sous sa forme de "variant".
J'y ai vu une allégorie de la mort et de l'immortalité, mais si l'écriture n'est pas dénuée de poésie, l'ensemble est tout de même assez abscons, et de peu d'intérêt.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de J.-H. Rosny aîné
Quiz
Voir plus
Louison et Mr Molière
Qui est Louison ?
Une fille qui se trouve magnifique pour son âge
Une fille qui veut devenir actrice
Une fille qui sd'en fiche de la vie
7 questions
427 lecteurs ont répondu
Thème : Louison et monsieur Molière de
Marie-Christine HelgersonCréer un quiz sur cet auteur427 lecteurs ont répondu