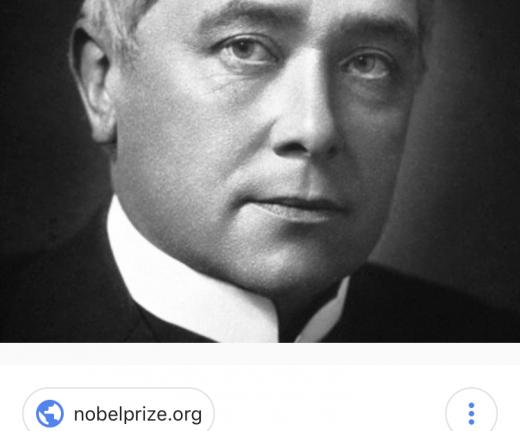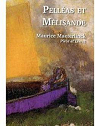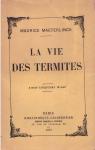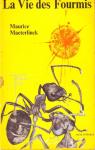Critiques de Maurice Maeterlinck (132)
Pièce faite d'une succession de tableaux quasiment immobiles, qui permettent de comprendre petit à petit la trame de cette tragédie.
L'auteur de la préface indique que pour lui chaque personnage de la pièce incarne un personnage de Shakespeare. Je n'irais pas jusque là.
A mon avis, l'engouement pour une telle pièce dépendra avant tout de l'ingéniosité de la mise en scène et du talent des acteurs à faire vivre tout le symbolisme sous-jacent.
Mais comme c'est un auteur belge, j'ai mis un petit plus.
L'auteur de la préface indique que pour lui chaque personnage de la pièce incarne un personnage de Shakespeare. Je n'irais pas jusque là.
A mon avis, l'engouement pour une telle pièce dépendra avant tout de l'ingéniosité de la mise en scène et du talent des acteurs à faire vivre tout le symbolisme sous-jacent.
Mais comme c'est un auteur belge, j'ai mis un petit plus.
L'ouvrage de Maurice Maeterlinck, réédité par les éditions Archipoche, le 9 janvier 2020, est essentiellement écrit d'un point de vue philosophique et éthologique suivant une prose magnifique.
Il demeure un classique indispensable pour qui s'intéresse aux abeilles et a conscience que leur disparition annoncée augure la fin de l'humanité bien avant l'extinction du soleil dans quelques milliards d'années (autrement dit, sur une telle échelle, là, maintenant, le temps de lire cet avis), si nous persistons à détruire cet insecte indispensable.
Pour une meilleure connaissance sur la vie et l'organisation des abeilles, je recommande l'ouvrage "Vie et moeurs des abeilles" de Karl von Fristch, ainsi que l'émission culte de J.C Ameisen, sur France Inter, "Sur les épaules de Darwin" ; le podcast est toujours disponible.
Bonne lecture et bonne écoute.
Michel.
Lien : http://fureur-de-lire.blogsp..
Il demeure un classique indispensable pour qui s'intéresse aux abeilles et a conscience que leur disparition annoncée augure la fin de l'humanité bien avant l'extinction du soleil dans quelques milliards d'années (autrement dit, sur une telle échelle, là, maintenant, le temps de lire cet avis), si nous persistons à détruire cet insecte indispensable.
Pour une meilleure connaissance sur la vie et l'organisation des abeilles, je recommande l'ouvrage "Vie et moeurs des abeilles" de Karl von Fristch, ainsi que l'émission culte de J.C Ameisen, sur France Inter, "Sur les épaules de Darwin" ; le podcast est toujours disponible.
Bonne lecture et bonne écoute.
Michel.
Lien : http://fureur-de-lire.blogsp..
Une œuvre bien profonde, on se sent un peu perdu au début de la lecture au risque d'abandonner mais au bout d'une infinité de temps, on se laisse emporter par ce voyage étrange, fantastique, philosophique, fabuleux et génial à la fois. Un voyage dans le plus profond de l'homme, dans le plus profond de la terre et de l'univers. L'oiseau bleu est une perception de l'homme dans sa puissance et aussi dans toutes ses faiblesses. On retrouve cette consigne donnée à l'homme: soit maître et possesseur de la nature, mais de quelle manière? Maurice Maeterlinck, dans une délicate plume rétablit la relation entre l'homme et la nature en personnifiant non pas seulement les éléments de son environnement mais aussi il met à nu le monde psychique de l'homme, le royaume de ses émotions, et c'est là le génial dans cette pièce de théâtre, on voit apparaitre des personnages comme l'amour maternel que j'ai beaucoup adoré... Maeterlinck prend le plaisir de nous faire miroiter le passé et le futur comme si l'homme présent n'était qu'une marionnette manipulé par l'univers et maudit tous les jours par la nature...
Lu dans le cadre du Challenge Nobel
Pièce de théâtre du belge Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande fut jouée pour la première fois en 1893, et fut également mise en musique, notamment par Claude Debussy.
Cette pièce est une tragédie en 5 actes, et une parfaite illustration du mouvement symboliste.
C’est une histoire classique de triangle amoureux et de jalousie qui, tragédie oblige, se termine mal.
Or donc, nous voici au cœur d’une forêt ; la toute jeune et fragile Mélisande pleure près d’une fontaine, où elle vient de jeter sa couronne d’or. Arrive Golaud, prince d’Allemonde, qui s’est égaré en chassant un sanglier. Il tente de réconforter la jeune fille effrayée, et sans rien savoir d’elle, l’emmène avec lui et l’épouse. Ils vont désormais vivre au château d’Arkel, roi et grand-père de Golaud, en compagnie de Pelléas, demi-frère de Golaud, de Geneviève, leur mère, et du petit Yniold, fils de Golaud et de sa première épouse décédée.
Dans cet endroit sombre, humide, auprès d’un époux plus âgé qu’elle, Mélisande est malheureuse. Grand amateur de chasse, Golaud est souvent absent, et la jeune femme se rapproche de Pelléas. Ils tombent amoureux, mais rien que de très chaste. Las ! un jour qu’ils s’embrassent enfin, ils sont surpris par Golaud, qui tue Pelléas et blesse mortellement Mélisande.
N’ayant pas trouvé les clés du symbolisme de cette œuvre, je me garderai bien de me lancer dans une interprétation hasardeuse de ce que Maeterlinck a voulu exprimer. J’avancerai seulement que le drame final est lié au constant jeu d’ombre et de lumière qui parcourt la pièce. Les relations de Pelléas et Mélisande sont racontées de façon elliptique, ce qui laisse penser que tout le monde ignore qu’ils sont amoureux, y compris eux-mêmes. Aussi longtemps que le discours reste allusif, on navigue dans un clair-obscur mélancolique et monotone mais sans danger. Mais lorsque survient l’aveu fatal, lorsque les sentiments sont exprimés ouvertement et que la vérité est révélée, « mise en lumière », la tragédie se noue… Toute vérité n’est pas bonne à dire…
Pour le reste, je n’ai pas réussi à éclairer ma lanterne…
Pièce de théâtre du belge Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande fut jouée pour la première fois en 1893, et fut également mise en musique, notamment par Claude Debussy.
Cette pièce est une tragédie en 5 actes, et une parfaite illustration du mouvement symboliste.
C’est une histoire classique de triangle amoureux et de jalousie qui, tragédie oblige, se termine mal.
Or donc, nous voici au cœur d’une forêt ; la toute jeune et fragile Mélisande pleure près d’une fontaine, où elle vient de jeter sa couronne d’or. Arrive Golaud, prince d’Allemonde, qui s’est égaré en chassant un sanglier. Il tente de réconforter la jeune fille effrayée, et sans rien savoir d’elle, l’emmène avec lui et l’épouse. Ils vont désormais vivre au château d’Arkel, roi et grand-père de Golaud, en compagnie de Pelléas, demi-frère de Golaud, de Geneviève, leur mère, et du petit Yniold, fils de Golaud et de sa première épouse décédée.
Dans cet endroit sombre, humide, auprès d’un époux plus âgé qu’elle, Mélisande est malheureuse. Grand amateur de chasse, Golaud est souvent absent, et la jeune femme se rapproche de Pelléas. Ils tombent amoureux, mais rien que de très chaste. Las ! un jour qu’ils s’embrassent enfin, ils sont surpris par Golaud, qui tue Pelléas et blesse mortellement Mélisande.
N’ayant pas trouvé les clés du symbolisme de cette œuvre, je me garderai bien de me lancer dans une interprétation hasardeuse de ce que Maeterlinck a voulu exprimer. J’avancerai seulement que le drame final est lié au constant jeu d’ombre et de lumière qui parcourt la pièce. Les relations de Pelléas et Mélisande sont racontées de façon elliptique, ce qui laisse penser que tout le monde ignore qu’ils sont amoureux, y compris eux-mêmes. Aussi longtemps que le discours reste allusif, on navigue dans un clair-obscur mélancolique et monotone mais sans danger. Mais lorsque survient l’aveu fatal, lorsque les sentiments sont exprimés ouvertement et que la vérité est révélée, « mise en lumière », la tragédie se noue… Toute vérité n’est pas bonne à dire…
Pour le reste, je n’ai pas réussi à éclairer ma lanterne…
Après Les Visions typhoïdes, encore un étrange petit texte des débuts de Materlinck, qui, une dizaine d'années avant les publications de Freud sur les rêves, traite précisément de ce sujet. On sait que, comme la linguistique a apporté la démarche scientifique de l'approche structuraliste à ce qui deviendra la psychanalyse, les symbolistes portaient en germe beaucoup de questions qui seraient posées en psychanalyse - comme déjà les romantiques avant eux, et les surréalistes après eux. Je ne sais pas d'ailleurs si Breton avait eu connaissance d'Onirologie, mais je suis persuadée que le texte avait tout pour l'intéresser. Cerise sur le gâteau, Maeterlinck écrira un essai intitulé Introduction à la psychologie des songes en 1892 (réédité en 1985 dans une anthologie), donc trois ans après Onirologie.
Des influences, Maeterlinck n'en manque pas. Il cite notamment de Quincey, et, de façon moins évidente, fait référence au Dr Amédée Dechambre, dont l'article "Songe" de son Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales est pour beaucoup dans Onirologie. Mais dans la construction même de l'histoire, on reconnaît très bien l'influence de Poe , de même que dans certaines des premières nouvelles de Lovecraft. L'utilisation, notamment, d'un personnage secondaire mystérieux, qui semble verser dans l'occultisme, mais dont on préfère ne pas nous parler : c'est du Poe tout craché. Même chose pour l'atmosphère angoissante due à la vue de deux moulins, et pour le personnage d'Annie, dont on ne saura rien sinon qu'elle mourra jeune, et probablement peu de temps après l’événement relaté ici. Car événement il y a.
Un jeune homme, qui souhaite cacher une certain nombre de choses sur son entourage et en oublié au moins autant, décide de relater une étrange expérience qu'il a subie. Après une soirée passée dans la forêt, au bord d'un bassin et en compagnie d'une jeune fille dont on imagine qu'il est amoureux, le narrateur rentre chez lui, s'endort et tombe dans une rêverie qu'il ne s'explique pas au réveil (jusque-là, rien de très étonnant), mais qui va lui laisser des souvenirs très nets et durables, le troublant. Jusqu'à ce qu'il découvre, alors qu'il est orphelin, expatrié, sans aucune famille ni aucun souvenir de son enfance, une lettre de sa mère qui rentre en totale résonance avec son rêve. Or, en 1889, date de publication d'Onirologie, il est évident qu'on ne peut pas se souvenir des événements liés à la petite enfance, et certainement pas quand cette enfance remonte à l'âge de quatre mois - depuis, la psychanalyse et les sciences cognitives ont un peu changé la donne. S'en suivra une enquête du narrateur sur les lieux de sa petite enfance.
Ce n'est pas tant le fait que le narrateur puisse avoir réactivé le souvenir d'une époque censée avoir été complètement effacée de sa mémoire qui frappera le lecteur d'aujourd'hui, étant donné les connaissances scientifiques actuelles, que sa réaction face à cette révélation. L'idée d'avoir accès à ce souvenir le plonge dans un maelström de sensations, dans un vertige de possibilités. Il y a là en germe tout ce qu'approfondira par la suite Maeterlinck : la possibilité d'accéder à un monde qui semble par essence inaccessible. Et ce n'est pas par hasard si on retrouve des motifs bien connus des lecteurs de Maeterlinck, comme la forêt, le bassin, l'anneau d'or laissé tomber dans l'eau par Annie, le reflet d'Annie plongeant son bras dans l'eau pour le rattraper.
Onirologie n'est que le début de toute une réflexion sur le monde le visible et le non visible. On est d'ailleurs souvent tenté d'utiliser la psychanalyse comme outil pour aider à la compréhension de Maeterlinck, et c'est bien normal. Là, pas de doute, on est en plein dedans, et pourtant on se situe avant l'avènement officiel de la discipline. Mais on comprend aussi que Maeterlinck, déjà, choisissait un chemin parallèle à la méthode psychanalytique, pas opposée, mais personnelle et différente, qui tendra à l'ésotérisme, ce qui me fait répéter qu'il est très proche en cela des surréalistes.
Onirologie est essentiellement un texte destiné aujourd'hui à qui s'intéresse à la psychanalyse, à la question des rêves et de l'inconscient qui émergeait avec beaucoup de force à la fin du XIXème siècle, particulièrement chez les symbolistes, et, bien entendu, au parcours littéraire de Maeterlinck. En tant qu'objet littéraire propre, il est inabouti - il fait partie de ses tout premiers textes publiés - et n'a surtout de valeur aujourd'hui qu'en tant que document éclairant en partie les reste de l'oeuvre de l'auteur.
Challenge Nobel
Des influences, Maeterlinck n'en manque pas. Il cite notamment de Quincey, et, de façon moins évidente, fait référence au Dr Amédée Dechambre, dont l'article "Songe" de son Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales est pour beaucoup dans Onirologie. Mais dans la construction même de l'histoire, on reconnaît très bien l'influence de Poe , de même que dans certaines des premières nouvelles de Lovecraft. L'utilisation, notamment, d'un personnage secondaire mystérieux, qui semble verser dans l'occultisme, mais dont on préfère ne pas nous parler : c'est du Poe tout craché. Même chose pour l'atmosphère angoissante due à la vue de deux moulins, et pour le personnage d'Annie, dont on ne saura rien sinon qu'elle mourra jeune, et probablement peu de temps après l’événement relaté ici. Car événement il y a.
Un jeune homme, qui souhaite cacher une certain nombre de choses sur son entourage et en oublié au moins autant, décide de relater une étrange expérience qu'il a subie. Après une soirée passée dans la forêt, au bord d'un bassin et en compagnie d'une jeune fille dont on imagine qu'il est amoureux, le narrateur rentre chez lui, s'endort et tombe dans une rêverie qu'il ne s'explique pas au réveil (jusque-là, rien de très étonnant), mais qui va lui laisser des souvenirs très nets et durables, le troublant. Jusqu'à ce qu'il découvre, alors qu'il est orphelin, expatrié, sans aucune famille ni aucun souvenir de son enfance, une lettre de sa mère qui rentre en totale résonance avec son rêve. Or, en 1889, date de publication d'Onirologie, il est évident qu'on ne peut pas se souvenir des événements liés à la petite enfance, et certainement pas quand cette enfance remonte à l'âge de quatre mois - depuis, la psychanalyse et les sciences cognitives ont un peu changé la donne. S'en suivra une enquête du narrateur sur les lieux de sa petite enfance.
Ce n'est pas tant le fait que le narrateur puisse avoir réactivé le souvenir d'une époque censée avoir été complètement effacée de sa mémoire qui frappera le lecteur d'aujourd'hui, étant donné les connaissances scientifiques actuelles, que sa réaction face à cette révélation. L'idée d'avoir accès à ce souvenir le plonge dans un maelström de sensations, dans un vertige de possibilités. Il y a là en germe tout ce qu'approfondira par la suite Maeterlinck : la possibilité d'accéder à un monde qui semble par essence inaccessible. Et ce n'est pas par hasard si on retrouve des motifs bien connus des lecteurs de Maeterlinck, comme la forêt, le bassin, l'anneau d'or laissé tomber dans l'eau par Annie, le reflet d'Annie plongeant son bras dans l'eau pour le rattraper.
Onirologie n'est que le début de toute une réflexion sur le monde le visible et le non visible. On est d'ailleurs souvent tenté d'utiliser la psychanalyse comme outil pour aider à la compréhension de Maeterlinck, et c'est bien normal. Là, pas de doute, on est en plein dedans, et pourtant on se situe avant l'avènement officiel de la discipline. Mais on comprend aussi que Maeterlinck, déjà, choisissait un chemin parallèle à la méthode psychanalytique, pas opposée, mais personnelle et différente, qui tendra à l'ésotérisme, ce qui me fait répéter qu'il est très proche en cela des surréalistes.
Onirologie est essentiellement un texte destiné aujourd'hui à qui s'intéresse à la psychanalyse, à la question des rêves et de l'inconscient qui émergeait avec beaucoup de force à la fin du XIXème siècle, particulièrement chez les symbolistes, et, bien entendu, au parcours littéraire de Maeterlinck. En tant qu'objet littéraire propre, il est inabouti - il fait partie de ses tout premiers textes publiés - et n'a surtout de valeur aujourd'hui qu'en tant que document éclairant en partie les reste de l'oeuvre de l'auteur.
Challenge Nobel
Un petit ovni dans la littérature - et le théâtre - du début du vingtième siècle, c'est l'impression que j'ai eue en relisant cette pièce vingt ans après. On ne peut pas vraiment relier cette oeuvre à un genre littéraire ni tout simplement l'associer à une époque!
Comme souvent mais très particulièrement ici, je me demande à quoi ressemble sur scène les indications de décor donnés. Dans l'Oiseau Bleu, Maeterlinck ne lésine pas sur la description de la scène et des vêtements, détaillant les tissus, leurs couleurs, les effets de lumière, les changements fréquents lors d'une même scène où les êtres se transforment à la vue des deux petits protagonistes. Rien que pour cela, j'aurais aimé être l'une des premières spectatrice de la pièce en 1911 pour pouvoir observer les subterfuges utilisés.
Quant à la pièce en elle-même, la lire c'est un peu comme parcourir un rêve. Elle se présente en plusieurs tableaux à fortes symboliques, bien que le message en reste implicite et demande réflexion.
J'avoue que les personnages et le récit ne m'ont pas captivée outre mesure, mais la scène des enfants à venir m'a interpellée, attristée aussi.
L'ingénuité de la pièce m'avait plu quand j'était ado, je la trouve un peu passée de charme aujourd'hui.
Comme souvent mais très particulièrement ici, je me demande à quoi ressemble sur scène les indications de décor donnés. Dans l'Oiseau Bleu, Maeterlinck ne lésine pas sur la description de la scène et des vêtements, détaillant les tissus, leurs couleurs, les effets de lumière, les changements fréquents lors d'une même scène où les êtres se transforment à la vue des deux petits protagonistes. Rien que pour cela, j'aurais aimé être l'une des premières spectatrice de la pièce en 1911 pour pouvoir observer les subterfuges utilisés.
Quant à la pièce en elle-même, la lire c'est un peu comme parcourir un rêve. Elle se présente en plusieurs tableaux à fortes symboliques, bien que le message en reste implicite et demande réflexion.
J'avoue que les personnages et le récit ne m'ont pas captivée outre mesure, mais la scène des enfants à venir m'a interpellée, attristée aussi.
L'ingénuité de la pièce m'avait plu quand j'était ado, je la trouve un peu passée de charme aujourd'hui.
Cette pièce de Maeterlinck est une merveille poétique. On connaît moins la forme théâtrale que la forme lyrique créée par Debussy. Pourtant, toute simple et d'ailleurs très proche du livret, elle se suffit à elle-même. Le style est très dépouillé, très anaphorique, ce qui suggère la noirceur de destin qui attend les deux amoureux. Dès le début il se prépare à frapper, on le sait, on le sent, et les héros aussi.
A quel point la simplicité d'une intrigue se met au service de la puissance de l'expression, tant dramatique, que sentimentale et mythologique, on ne le dira jamais assez : un amour illégitime, la punition de cet amour suffisent. Inutiles les grandes machineries, les rebondissements, les gesticulations, les imprévus qui affadiraient le propos. Toute la clarté et l'obscurité du destin humain dans une oeuvre débarrassée du superflu.
On pense aux textes fondamentaux : à l'Odyssée, à Racine, aux contes dans lesquels la fille du roi est enfermée dans une tour et fait de ses cheveux une échelle.
Et aussi aux chansons anciennes : "J'ai perdu mon amie sans l'avoir mérité, Pour un bouton de rose que je lui refusai…" ou " Ô fils du roi tu es méchant D'avoir tué mon canard blanc Toute la plume s'envole au vent "
A quel point la simplicité d'une intrigue se met au service de la puissance de l'expression, tant dramatique, que sentimentale et mythologique, on ne le dira jamais assez : un amour illégitime, la punition de cet amour suffisent. Inutiles les grandes machineries, les rebondissements, les gesticulations, les imprévus qui affadiraient le propos. Toute la clarté et l'obscurité du destin humain dans une oeuvre débarrassée du superflu.
On pense aux textes fondamentaux : à l'Odyssée, à Racine, aux contes dans lesquels la fille du roi est enfermée dans une tour et fait de ses cheveux une échelle.
Et aussi aux chansons anciennes : "J'ai perdu mon amie sans l'avoir mérité, Pour un bouton de rose que je lui refusai…" ou " Ô fils du roi tu es méchant D'avoir tué mon canard blanc Toute la plume s'envole au vent "
Melisande est une fille étonnante, recueilli dans les conditions les plus mystérieuses car Golaud la rencontre au bord d'une source en train de pleurer et en fait son épouse. Elle tombe amoureuse de Pelleas, le frère de Golaud, c'est un triangle amoureux qui va se jouer tout le long de la pièce jusqu'à la grande tragédie...
Un classique qui se lit encore très bien aujourd'hui, mais le personnage de Mélisande reste une énigme du début à la fin, elle apparait comme par un coup de Big Bang et disparait obscurément car sa blessure, attribuée par Galaud est aussi légère pour faire mourir un oiseau mais elle va mourir aussi mystérieusement comme si elle emportait avec elle la lumière qui a fait vivre un moment le vieux château sombre de Arkel, le roi d'Allemonde, et que quand celui-ci demande au docteur de quoi Méllisande meurt-elle finalement, quand bien même qu'elle soit parvenu à donner vie à une petite fille pendant son évanouissement, le docteur lui répond que Méllisande devrait mourir parce qu'elle était née sans raison et qu'elle doit aussi mourirsans raison...on ne saurra jamais qui elle était et d'où elle venait avant d'épouser Gollaud...mystère!
Un classique qui se lit encore très bien aujourd'hui, mais le personnage de Mélisande reste une énigme du début à la fin, elle apparait comme par un coup de Big Bang et disparait obscurément car sa blessure, attribuée par Galaud est aussi légère pour faire mourir un oiseau mais elle va mourir aussi mystérieusement comme si elle emportait avec elle la lumière qui a fait vivre un moment le vieux château sombre de Arkel, le roi d'Allemonde, et que quand celui-ci demande au docteur de quoi Méllisande meurt-elle finalement, quand bien même qu'elle soit parvenu à donner vie à une petite fille pendant son évanouissement, le docteur lui répond que Méllisande devrait mourir parce qu'elle était née sans raison et qu'elle doit aussi mourirsans raison...on ne saurra jamais qui elle était et d'où elle venait avant d'épouser Gollaud...mystère!
C'est Noël mais les Tyl, pauvres bûcherons, n'ont pas de quoi s'offrir une belle fête. Les enfants de la maison, Mytyl et Tyltyl, sont éveillés, un soir, par une grande lueur qui traverse les volets de leur chambre. Cette lumière provient de la maison d'en face où vit une riche famille : ils fêtent Noël en grande pompe avec gâteaux et tartes à la crème à volonté et quantité de jouets pour les plus jeunes.
Alors que Mytyl et Tyltyl font semblant de participer au festin, des coups résonnent soudain à la porte.
Une vieille fée très laide qui dit s'appeler Bérylune entre dans leur chambre et leur demande de partir à la recherche de l'oiseau bleu, seul volatile capable de guérir sa fille très malade.
Les deux enfants hésitent, mais Bérylune offre à Tyltyl un bonnet magique qui leur permettront, à lui et à sa sœur, de distinguer l'âme des choses qui les entourent. Ces dernières devraient les aider dans leur quête.
Tyltyl utilise le bonnet et réveille les âmes de la maisonnée : chien, chat, pain de sucre, eau, lumière et bien d'autres se portent volontaire pour accompagner les enfants.
Cette "Féerie en six actes et douze tableaux" nous replonge dans le monde merveilleux des contes de fées de notre enfance, même si le récit n'est pas si innocent qu'il n'y paraît.
Cette pièce de théâtre date de 1908 et peut sembler, au début, assez démodée. Les thèmes exploités par Maeterlinck (deux enfants pauvres embarqués dans un monde merveilleux par une vieille femme très laide qui se révèle être une fée magnifique) sont très communs. Mais malgré cela, on est très vite emportés par la plume de l'auteur et l'aventure de Mytyl et Tyltyl finit par nous tenir très à cœur.
La recherche de l'oiseau bleu ne se passe pas sans mal et les aléas auxquels les enfants et leurs accompagnateurs sont confrontés nous les rendent très attachants.
Le "voyage" se passe pendant la nuit, mais on a l'impression très nette qu'il dure plusieurs jours tant les aventures qui attendent nos héros sont multiples et variées. Des constantes sont pourtant à souligner : Tyltyl est le plus actif des deux enfants, Mytyl restant plus en retrait ; et où qu'ils se trouvent, la Chatte complote contre le projet des enfants et de leurs amis.
Ce caractère nocturne des péripéties des deux enfants permet à Maeterlinck de mettre en évidence le thème le plus important de la pièce : celui du rêve. Le récit s'ouvre d'ailleurs sur le sommeil des deux enfants ; la dernière scène de la pièce les voit une fois de plus endormis.
Les différents "mondes" visités par la petite troupe sont passionnants mais semblent également relever du domaine de la rêverie. De là à se demander si Maeterlinck ne nous raconte pas tout simplement le rêve du frère et de la sœur durant cette nuit de Noël, il n'y a qu'un pas. Plusieurs fois, on s'attend à ce que les enfants se réveillent en sursaut et se retrouvent dans leur pauvre chambre...
Une jolie découverte et un classique de la littérature belge, à découvrir sans hésiter.
Challenge 15 Nobel : 6/15
Alors que Mytyl et Tyltyl font semblant de participer au festin, des coups résonnent soudain à la porte.
Une vieille fée très laide qui dit s'appeler Bérylune entre dans leur chambre et leur demande de partir à la recherche de l'oiseau bleu, seul volatile capable de guérir sa fille très malade.
Les deux enfants hésitent, mais Bérylune offre à Tyltyl un bonnet magique qui leur permettront, à lui et à sa sœur, de distinguer l'âme des choses qui les entourent. Ces dernières devraient les aider dans leur quête.
Tyltyl utilise le bonnet et réveille les âmes de la maisonnée : chien, chat, pain de sucre, eau, lumière et bien d'autres se portent volontaire pour accompagner les enfants.
Cette "Féerie en six actes et douze tableaux" nous replonge dans le monde merveilleux des contes de fées de notre enfance, même si le récit n'est pas si innocent qu'il n'y paraît.
Cette pièce de théâtre date de 1908 et peut sembler, au début, assez démodée. Les thèmes exploités par Maeterlinck (deux enfants pauvres embarqués dans un monde merveilleux par une vieille femme très laide qui se révèle être une fée magnifique) sont très communs. Mais malgré cela, on est très vite emportés par la plume de l'auteur et l'aventure de Mytyl et Tyltyl finit par nous tenir très à cœur.
La recherche de l'oiseau bleu ne se passe pas sans mal et les aléas auxquels les enfants et leurs accompagnateurs sont confrontés nous les rendent très attachants.
Le "voyage" se passe pendant la nuit, mais on a l'impression très nette qu'il dure plusieurs jours tant les aventures qui attendent nos héros sont multiples et variées. Des constantes sont pourtant à souligner : Tyltyl est le plus actif des deux enfants, Mytyl restant plus en retrait ; et où qu'ils se trouvent, la Chatte complote contre le projet des enfants et de leurs amis.
Ce caractère nocturne des péripéties des deux enfants permet à Maeterlinck de mettre en évidence le thème le plus important de la pièce : celui du rêve. Le récit s'ouvre d'ailleurs sur le sommeil des deux enfants ; la dernière scène de la pièce les voit une fois de plus endormis.
Les différents "mondes" visités par la petite troupe sont passionnants mais semblent également relever du domaine de la rêverie. De là à se demander si Maeterlinck ne nous raconte pas tout simplement le rêve du frère et de la sœur durant cette nuit de Noël, il n'y a qu'un pas. Plusieurs fois, on s'attend à ce que les enfants se réveillent en sursaut et se retrouvent dans leur pauvre chambre...
Une jolie découverte et un classique de la littérature belge, à découvrir sans hésiter.
Challenge 15 Nobel : 6/15
Prisme de diamant merveilleux, l'oiseau bleu de Maeterlinck s'adresse aux petits et aux grands, la pièce permettant une lecture plus ou moins naïve selon le niveau de lecture. N'oubliez pas de tourner le diamant dans l'un ou l'autre sens afin de percevoir la féérie, le réel, l'ombre mais surtout la lumière, lumière qui se reflète dans les facettes du diamant comme dans les fossettes d'un enfant.
Très célèbre à son époque, lauréat du prix Nobel en 1911, associé au symbolisme, Maurice Maeterlinck est quelque peu tombé dans l’oubli, et ses œuvres ne sont pas tellement lues, ses pièces montées juste de temps en temps. Comme beaucoup, je le connaissais à cause de l’opéra de Debussy, Pelléas et Mélisande, pour lequel le compositeur a repris le texte de Maeterlinck, avec juste deux ou trois petites coupures. J’ai aussi lu par curiosité la pièce de l’auteur belge, mais sans la musique de Debussy qui magnifie le texte, elle m’a parue un peu datée.
En 1894, deux ans après Pelléas et Mélisande, Maeterlinck a écrit trois petites pièces destinées à être jouée par des marionnettes, La mort de Tintagiles est la troisième d’entre elles. A l’époque Maeterlinck cherche d’autres codes de représentation, s’interroge sur l’utilisation de masques. Il pense que l’acteur intercepte le libre imaginaire de la lecture, et essaie de trouver des moyens pour pallier à cela. Mais la pièce a attiré un certain nombre de metteurs en scène, qui lui ont donné vie par l’entremise d’acteurs de chair et de sang, les plus célèbres de ces mises en scène étant celles de Tadeusz Kantor.
Tintagiles, un jeune enfant vient d’arriver dans une mystérieuse île. Il y accueilli par une de ses sœurs, Ygraine. Ravie de le voir, elle est aussi très inquiète, car l’île vit dans l’ombre d’une tour menaçante, habitée par la grand-mère des enfants, très âgée. Des disparitions se produisent. Ygraine, sa sœur Bellangère et leur vieux maître Aglovale décident de protéger à tout prix Tintagiles. Ils veuillent la nuit, et gagnent un premier assauts. Mais les servantes de la reine, reviennent lorsque tout le monde est endormi, et emportent l’enfant. Ygraine part seule à sa recherche.
Nous plongeons dans l’univers de contes et de légendes. Tintagiles et Ygraine sont proches de Tintagel et Ygerne, issus de la légende arthurienne. Comme dans de nombreux contes, la peur et la mort sont présentes, les personnages affrontent des dangers qui les dépassent, le récit rappelle une initiation sacrée, un rituel du sacrifice.
Maeterlinck imagine un théâtre poétique, qui suggère l’indicible, tente de parler à l’imaginaire du lecteur et spectateur, plus qu’à sa raison. Des puissances inquiétantes sont à l’oeuvre, mais au final nous ne voyons rien, c’est à chacun de donner corps à ce que l’auteur ne fait qu’effleure avec ses mots, qui font surgir les peurs et les ombres tapies chez chacun.
Il faut être sensible à l’onirisme, aimer visiter les contrées des rêves (ou cauchemars) pour apprécier cette littérature, sinon on reste en chemin, et on trouve cela inconsistant, comme une fumée, une ombre.
En 1894, deux ans après Pelléas et Mélisande, Maeterlinck a écrit trois petites pièces destinées à être jouée par des marionnettes, La mort de Tintagiles est la troisième d’entre elles. A l’époque Maeterlinck cherche d’autres codes de représentation, s’interroge sur l’utilisation de masques. Il pense que l’acteur intercepte le libre imaginaire de la lecture, et essaie de trouver des moyens pour pallier à cela. Mais la pièce a attiré un certain nombre de metteurs en scène, qui lui ont donné vie par l’entremise d’acteurs de chair et de sang, les plus célèbres de ces mises en scène étant celles de Tadeusz Kantor.
Tintagiles, un jeune enfant vient d’arriver dans une mystérieuse île. Il y accueilli par une de ses sœurs, Ygraine. Ravie de le voir, elle est aussi très inquiète, car l’île vit dans l’ombre d’une tour menaçante, habitée par la grand-mère des enfants, très âgée. Des disparitions se produisent. Ygraine, sa sœur Bellangère et leur vieux maître Aglovale décident de protéger à tout prix Tintagiles. Ils veuillent la nuit, et gagnent un premier assauts. Mais les servantes de la reine, reviennent lorsque tout le monde est endormi, et emportent l’enfant. Ygraine part seule à sa recherche.
Nous plongeons dans l’univers de contes et de légendes. Tintagiles et Ygraine sont proches de Tintagel et Ygerne, issus de la légende arthurienne. Comme dans de nombreux contes, la peur et la mort sont présentes, les personnages affrontent des dangers qui les dépassent, le récit rappelle une initiation sacrée, un rituel du sacrifice.
Maeterlinck imagine un théâtre poétique, qui suggère l’indicible, tente de parler à l’imaginaire du lecteur et spectateur, plus qu’à sa raison. Des puissances inquiétantes sont à l’oeuvre, mais au final nous ne voyons rien, c’est à chacun de donner corps à ce que l’auteur ne fait qu’effleure avec ses mots, qui font surgir les peurs et les ombres tapies chez chacun.
Il faut être sensible à l’onirisme, aimer visiter les contrées des rêves (ou cauchemars) pour apprécier cette littérature, sinon on reste en chemin, et on trouve cela inconsistant, comme une fumée, une ombre.
L’un des plus beaux livres que j’aie lu jusque-là au niveau du message délivré. J’ai eu un peu de mal à y être sensible au début, comme si ce que l’auteur disait se déroulait bien au-dessus de moi, dans une sphère privilégiée et spirituelle, mais peu à peu, cette distance s’est atténuée et je me suis senti davantage « dans le texte ».
Ce livre recueille une série d’articles de Maeterlinck, écrit à différentes époques, avec pour sujet commun l’âme. Il considère cette âme comme la sphère humaine la plus importante, mais aussi celle qu’on refuse et refoule le plus. Il faudrait donc selon lui voir avec son âme, entre autres. Cette vision est intimement liée à la beauté, à l’amour et au silence. Ce sont les grandes idées principales que j’ai retenues de ce livre, mais il y en a bien d’autres : les articles se répètent parfois un peu ou se contredisent légèrement, ce qui rend cette œuvre difficile à résumer en quelques lignes. De plus, Maeterlinck pose plus de questions que de réponses, forçant donc ainsi en quelque sorte le lecteur à s’impliquer dans sa lecture et à mêler son opinion à celle de l’auteur. Enfin, c’est comme si ce texte avait parlé à mon âme, à ma sensibilité plutôt qu’à mon intellect, d’où cet avis un peu embrouillé et confus.
Une lecture que je ne peux que conseiller.
Ce livre recueille une série d’articles de Maeterlinck, écrit à différentes époques, avec pour sujet commun l’âme. Il considère cette âme comme la sphère humaine la plus importante, mais aussi celle qu’on refuse et refoule le plus. Il faudrait donc selon lui voir avec son âme, entre autres. Cette vision est intimement liée à la beauté, à l’amour et au silence. Ce sont les grandes idées principales que j’ai retenues de ce livre, mais il y en a bien d’autres : les articles se répètent parfois un peu ou se contredisent légèrement, ce qui rend cette œuvre difficile à résumer en quelques lignes. De plus, Maeterlinck pose plus de questions que de réponses, forçant donc ainsi en quelque sorte le lecteur à s’impliquer dans sa lecture et à mêler son opinion à celle de l’auteur. Enfin, c’est comme si ce texte avait parlé à mon âme, à ma sensibilité plutôt qu’à mon intellect, d’où cet avis un peu embrouillé et confus.
Une lecture que je ne peux que conseiller.
Paru en 1942, « L’autre monde ou le cadran stellaire » est le sixième et dernier volume de Maurice Maeterlinck dans le cadre d’une série que certains critiques ont baptisée à l’époque « la série pascalienne ». Les cinq précédents :
• « Avant le grand silence » (1934)
• « Le sablier » (1935)
• « L’ombre des ailes (1936)
• « Devant Dieu » (1937)
• « La grande porte (1938)
Un recueil de notes, plus que de pensées, si l’on en croit l’auteur lui-même dans son « ouverture » ; recueil qui, toujours de l’avis de l’auteur tourne « autour de Dieu, de l’univers, de l’infini et de l’éternité, du néant et des autres mondes, des destinées humaines, de l’inconnaissable, de la vie avant la naissance et après la tombe, de ce qui s’agite en nous au-dessus ou au-dessous de la raison ou de la conscience pratique et quotidienne du bonheur et du malheur, et en général de ce qu’on ne dit pas, de ce que l’on ne pense pas tous les jours, de ce qui atteint certaines régions que l’homme ne fréquente pas volontiers, de tout ce qu’on ne trouve pas dans les « best sellers » de l’industrie littéraire »…Déjà…
Je n’ai pas pu résister à transcrire cette longue présentation de l’auteur tant elle me parait, non seulement décrire l’ouvrage, mais également l’auteur Maurice Marterlinck : poète inspiré un temps du symbolisme, dramaturge, dont le Pelléas et Mélisande inspira Debussy et bien d’autres… Prix Nobel de littérature en 1911.
Mais revenons à l’ouvrage : une « collection » de notes, de pensées (n’en déplaise à l’auteur), d’aphorismes, séparés par une scénette, un court essai, un récit… Tout n’est pas génial, mais dans l’ensemble, le niveau est très élevé.
Souvenons-nous : « Si Dieu savait ce qu’il fait, il ne le ferait plus… », « La folie des hommes n’a d’égale que la folie des dieux qu’ils ont créés »… deux sentences connues de tous, mais pas toujours attribuées à Maeterlinck; Un sens certain de la formule : un régal !
• « Avant le grand silence » (1934)
• « Le sablier » (1935)
• « L’ombre des ailes (1936)
• « Devant Dieu » (1937)
• « La grande porte (1938)
Un recueil de notes, plus que de pensées, si l’on en croit l’auteur lui-même dans son « ouverture » ; recueil qui, toujours de l’avis de l’auteur tourne « autour de Dieu, de l’univers, de l’infini et de l’éternité, du néant et des autres mondes, des destinées humaines, de l’inconnaissable, de la vie avant la naissance et après la tombe, de ce qui s’agite en nous au-dessus ou au-dessous de la raison ou de la conscience pratique et quotidienne du bonheur et du malheur, et en général de ce qu’on ne dit pas, de ce que l’on ne pense pas tous les jours, de ce qui atteint certaines régions que l’homme ne fréquente pas volontiers, de tout ce qu’on ne trouve pas dans les « best sellers » de l’industrie littéraire »…Déjà…
Je n’ai pas pu résister à transcrire cette longue présentation de l’auteur tant elle me parait, non seulement décrire l’ouvrage, mais également l’auteur Maurice Marterlinck : poète inspiré un temps du symbolisme, dramaturge, dont le Pelléas et Mélisande inspira Debussy et bien d’autres… Prix Nobel de littérature en 1911.
Mais revenons à l’ouvrage : une « collection » de notes, de pensées (n’en déplaise à l’auteur), d’aphorismes, séparés par une scénette, un court essai, un récit… Tout n’est pas génial, mais dans l’ensemble, le niveau est très élevé.
Souvenons-nous : « Si Dieu savait ce qu’il fait, il ne le ferait plus… », « La folie des hommes n’a d’égale que la folie des dieux qu’ils ont créés »… deux sentences connues de tous, mais pas toujours attribuées à Maeterlinck; Un sens certain de la formule : un régal !
L’écriture est à la fois simple et sophistiquée ; l’histoire, à la fois sombre et lumineuse (l’amour et la mort se mêlent intimement) ; les personnages, beaux, sont à la fois proches de nous (Mélisande « c’était un pauvre petit être, comme tout le monde... ») et lointains, rudes et tendres.
Le silence dans ce royaume (Allemonde) semble y avoir été inventé pour permettre aux sentiments retenus de se faire entendre... tel un coeur qui bat… mais à tout rompre.
Une attente. De toute évidence quelque chose ne tourne pas rond, cela va mal finir. Au coeur de l’oeuvre, il y a un mystère. Il irradie et continue à émettre ses rayons même après le livre fermé, même après une énième lecture. Il y a du merveilleux dans cette pièce de théâtre. Il n’est pas étonnant que son charme agisse toujours!
Le silence dans ce royaume (Allemonde) semble y avoir été inventé pour permettre aux sentiments retenus de se faire entendre... tel un coeur qui bat… mais à tout rompre.
Une attente. De toute évidence quelque chose ne tourne pas rond, cela va mal finir. Au coeur de l’oeuvre, il y a un mystère. Il irradie et continue à émettre ses rayons même après le livre fermé, même après une énième lecture. Il y a du merveilleux dans cette pièce de théâtre. Il n’est pas étonnant que son charme agisse toujours!
Comme j'aime ces écrivains décadents, ces esthètes, ces avant-gardistes dont la fantaisie merveilleuse nous éloigne d'une réalité souvent toute prosaïque.
Maeterlinck est un artiste extraordinaire. J'ai beaucoup entendu parler de "L'oiseau bleu" autrefois. Au cours de ma lecture, j'ai imaginé ce qui se passerait précisément s’il s’agissait d'une performance théâtrale. Mon spectacle imaginaire serait à très gros budget - mes personnages seraient vêtus des tenues fantastiques les plus bizarres. Par exemple, j'aurais habillé l'âme du Feu en costume bobo orange et en noeud papillon et j’aurais engagé pour son rôle un acteur français tel Claude Brasseur. Je l’avoue, cette lecture de "L'oiseau bleu" est pour moi comme une évasion loin d'un quotidien ennuyeux.
C'est une pièce magique pour un lecteur ayant soif d'imagination.
Maeterlinck est un artiste extraordinaire. J'ai beaucoup entendu parler de "L'oiseau bleu" autrefois. Au cours de ma lecture, j'ai imaginé ce qui se passerait précisément s’il s’agissait d'une performance théâtrale. Mon spectacle imaginaire serait à très gros budget - mes personnages seraient vêtus des tenues fantastiques les plus bizarres. Par exemple, j'aurais habillé l'âme du Feu en costume bobo orange et en noeud papillon et j’aurais engagé pour son rôle un acteur français tel Claude Brasseur. Je l’avoue, cette lecture de "L'oiseau bleu" est pour moi comme une évasion loin d'un quotidien ennuyeux.
C'est une pièce magique pour un lecteur ayant soif d'imagination.
C'est dans une forêt que Golaud avait trouvé Mélisande, tandis qu'il s'était égaré en poursuivant une bête blessée. Séduit par sa beauté qui était comme le reflet de l'innocence, il l'épouse et l'emmène au château du Roi Arkel, son grand père, où vivent, en compagnie d'une suite de servantes, un père mourant, Geneviève, sa mère, Yniold, le fils qu'il avait eu d'une épouse décédée et, enfin, Pelléas, son jeune frère. Golaud, épris de chasse, s'absente souvent, et dans ce château qui semble constamment environné de mystères et de ténèbres, une complicité se crée entre Pelléas et Mélisande. Golaud ne restera pas longtemps aveugle et nous croyons dès lors assister à une tragédie, au choeur antique qui semble venir d'un autre monde et qui accompagne les puissances funestes d'un implacable destin : Mélisande en même temps que l'amour va découvrir la mort et se transforme en sainte dont on accompagne le dernier et si ténu souffle, après qu'elle eut perdu Pelléas, tué par son frère qui les avait surpris dans un embrassement qui était encore chaste, et donné naissance à une fille. Admirable drame donc que cette pièce écrite comme un long poème symboliste et que Debussy allait, quelques années après, accompagner en musique.
Trouvé par bonheur hier dans une boîte à Livres - Edition de 1926 quasi « neuve » !! La chance !
Ici nous avons affaire avec des termites qui n'ont connu aucun prédateur depuis des millénaires pour détruire leur termitière, grâce à leurs fabuleux moyens de défense et leurs divers soldats tous aveugles et pourtant proteiformes pour défendre leur vie.
Seul l'homme évidemment - unique créature destructrice de la Terre d'ailleurs - pourrait détruire leurs grandes architectures par des coups de pioche ou autres explosifs tant la carapace et dure et résistante à tout ennemi.
Selon Maeterlinck aucune créature au monde n'a développé autant de moyens de survivre à travers les âges que les termites, changeant tout à tour d'aspect, altruistes, généreux, obstinés, courageux. Des têtes énormes. Des pinces, des têtes en forme de poire de lavement qui pulvérise un gel mortel sur les attaquants éventuels, souvent des fourmis alors engluées et vouées à la mort !!
Une foule de noms d'insectes difficiles à retenir, mais évidemment un ouvrage de spécialiste écrit de la manière la plus modeste et la plus précise.
La science a peut être mis à jour , cent ans après la rédaction de cet ouvrage fondamental ,d'autres mystères sur cette population extraordinaire qui ne peut laisser personne indifférent
Ici nous avons affaire avec des termites qui n'ont connu aucun prédateur depuis des millénaires pour détruire leur termitière, grâce à leurs fabuleux moyens de défense et leurs divers soldats tous aveugles et pourtant proteiformes pour défendre leur vie.
Seul l'homme évidemment - unique créature destructrice de la Terre d'ailleurs - pourrait détruire leurs grandes architectures par des coups de pioche ou autres explosifs tant la carapace et dure et résistante à tout ennemi.
Selon Maeterlinck aucune créature au monde n'a développé autant de moyens de survivre à travers les âges que les termites, changeant tout à tour d'aspect, altruistes, généreux, obstinés, courageux. Des têtes énormes. Des pinces, des têtes en forme de poire de lavement qui pulvérise un gel mortel sur les attaquants éventuels, souvent des fourmis alors engluées et vouées à la mort !!
Une foule de noms d'insectes difficiles à retenir, mais évidemment un ouvrage de spécialiste écrit de la manière la plus modeste et la plus précise.
La science a peut être mis à jour , cent ans après la rédaction de cet ouvrage fondamental ,d'autres mystères sur cette population extraordinaire qui ne peut laisser personne indifférent
Première incursion dans l'œuvre de Maeterlinck.
Je n'ai pas lu la préface avant de commencer, histoire de me faire une opinion brute de la pièce.
Comme souvent avec le théâtre, je pense qu'il vaut mieux le voir jouer que le lire. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, dirais-je.
Donc, lecture très aisée puisque le vocabulaire est assez pauvre et répétitif. On y retrouve les marqueurs habituels des légendes, tragédies et autres fables: une princesse (dont on ne saura rien ou pas grand chose), un château, des fontaines, un vieux roi qui se meurt à l'étage, un mari et son frère, un anneau qu'on perd, un amour ambigu,...
Je sais qu'on est dans le symbolisme, donc j'y détecte assez aisément un rapport à l'eau, à la mort, à la lumière et l'obscurité...
On est fin du 19e siècle, donc, bien obligé, Mélisande est assez idiote et geignarde dans son genre. Je n'ai pas trouvé de toute façon que les hommes tiraient leur épingle du jeu. Entre le mari qui gagatise en ramenant tout aux enfants (de sa femme jusqu'aux moutons) et Pélléas qui voudrait bien mais qui ne peut point... Finalement, c'est l'ensemble des personnages qui se posent comme les marionnettes d'un destin qui leur échappe.
Une fois la préface lue, je comprends que je ne me suis pas trop trompée dans l'ensemble mais que pour tout comprendre il faudrait que je me plonge dans d'autres ouvrages du seul auteur belge nobélisé. Chose que je ne manquerai pas de faire à l'occasion (je trouverai bien un de ses ouvrages sur une prochaine brocante ou dans une bouquinerie).
Je n'ai pas lu la préface avant de commencer, histoire de me faire une opinion brute de la pièce.
Comme souvent avec le théâtre, je pense qu'il vaut mieux le voir jouer que le lire. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, dirais-je.
Donc, lecture très aisée puisque le vocabulaire est assez pauvre et répétitif. On y retrouve les marqueurs habituels des légendes, tragédies et autres fables: une princesse (dont on ne saura rien ou pas grand chose), un château, des fontaines, un vieux roi qui se meurt à l'étage, un mari et son frère, un anneau qu'on perd, un amour ambigu,...
Je sais qu'on est dans le symbolisme, donc j'y détecte assez aisément un rapport à l'eau, à la mort, à la lumière et l'obscurité...
On est fin du 19e siècle, donc, bien obligé, Mélisande est assez idiote et geignarde dans son genre. Je n'ai pas trouvé de toute façon que les hommes tiraient leur épingle du jeu. Entre le mari qui gagatise en ramenant tout aux enfants (de sa femme jusqu'aux moutons) et Pélléas qui voudrait bien mais qui ne peut point... Finalement, c'est l'ensemble des personnages qui se posent comme les marionnettes d'un destin qui leur échappe.
Une fois la préface lue, je comprends que je ne me suis pas trop trompée dans l'ensemble mais que pour tout comprendre il faudrait que je me plonge dans d'autres ouvrages du seul auteur belge nobélisé. Chose que je ne manquerai pas de faire à l'occasion (je trouverai bien un de ses ouvrages sur une prochaine brocante ou dans une bouquinerie).
Je viens d'assister à une représentation théâtrale de "La mort de Tintagile" de Maurice Maeterlinck et j'ai étonné mes amis en leur apprenant que l'auteur de "L'oiseau bleu" avait été un Bernard Werber avant l'heure en écrivant plusieurs ouvrages sur la vie des abeilles, des termites ou des fourmis !
Bon, Werber a adopté une approche totalement romanesque mais basée sur des études sérieuses d'entomologistes, Maeterlinck aussi mais avec les connaissances de son temps.
Autant dire que chez Maeterlinck l'imagination poétique prend parfois le dessus sur la véracité scientifique et prête souvent à sourire.
On sent chez l'écrivain la propension de son temps à projeter dans la fourmilière une société idéale et humaniste impossible à réaliser chez l'homme.
Mais peu importe, le talent de Maurice Maeterlinck réussit à rendre l'ouvrage passionnant de bout en bout et on est vite tenté d'aller chercher celui écrit sur les abeilles ou les termites.
Bon, Werber a adopté une approche totalement romanesque mais basée sur des études sérieuses d'entomologistes, Maeterlinck aussi mais avec les connaissances de son temps.
Autant dire que chez Maeterlinck l'imagination poétique prend parfois le dessus sur la véracité scientifique et prête souvent à sourire.
On sent chez l'écrivain la propension de son temps à projeter dans la fourmilière une société idéale et humaniste impossible à réaliser chez l'homme.
Mais peu importe, le talent de Maurice Maeterlinck réussit à rendre l'ouvrage passionnant de bout en bout et on est vite tenté d'aller chercher celui écrit sur les abeilles ou les termites.
Je voudrais avoir les mots qu'il faut pour décrire... ce trésor de la pensée.
C'est un texte sublime. Inspiré. Un écrit au-delà du temps.
De la pure poésie faite avec des mots de tous les jours.
Peut-être un peu trop triste.
C'est un texte sublime. Inspiré. Un écrit au-delà du temps.
De la pure poésie faite avec des mots de tous les jours.
Peut-être un peu trop triste.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Maurice Maeterlinck
Lecteurs de Maurice Maeterlinck (807)Voir plus
Quiz
Voir plus
Le Roi Arthur de michael morpugo
Comment le petit garcon est arrivé chez Arthur
il se promenait dans le coin
il s'etait noyer et Arthur la sauver
Merlin est apparu dans la tete du garcon pour lui dire que Arthur avait besion de lui
10 questions
1222 lecteurs ont répondu
Thème : Le roi Arthur de
Michael MorpurgoCréer un quiz sur cet auteur1222 lecteurs ont répondu