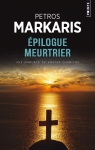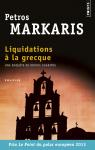Citations de Pétros Márkaris (312)
Soudain, l'argent s'est mis à affluer. Une grande partie de cet argent venait des privatisations que le gouvernement lançait à toute allure, à coups de procédures sommaires.
Les autres partis, retranchés dans leur coin, hurlaient : "Ils vendent l'argenterie du pays !", "Ils bradent la fortune nationale !" La réponse d'ETSI était la voix de la froide raison : "Quand tu as des dettes et pas d'argent, tu vends ton bien pour te désendetter. C'est ce que font tous les gens sérieux, même si cela fait mal."
Les autres partis, retranchés dans leur coin, hurlaient : "Ils vendent l'argenterie du pays !", "Ils bradent la fortune nationale !" La réponse d'ETSI était la voix de la froide raison : "Quand tu as des dettes et pas d'argent, tu vends ton bien pour te désendetter. C'est ce que font tous les gens sérieux, même si cela fait mal."
Lorsqu'un journaliste à la télévision leur demandait d'un ton supérieur : "Mais enfin, comment vous présenterez-vous aux élections sans programme ? Le citoyen ne doit-il pas savoir pour quoi il vote ? ", ils lui clouaient le bec avec cet argument immuable : "Jusqu'à présent le citoyen votait pour quelque chose et il arrivait autre chose. Ne vaut-il pas mieux ne pas promettre ce qui ne se réalisera pas ? N'est-il pas préférable que les électeurs fassent confiance à une équipe de jeunes politiciens, issus de tous les partis et affranchis de toute pesanteur idéologique ? Ce que nous proposons au citoyen grec. c'est en fait un gouvernement d'unité nationale, formé dès avant les élections."
Le trajet jusqu’au refuge est rapide. Zissis nous attend à l’entrée. À la buvette, une femme et deux hommes, tous dans les soixante ans, sont assis et discutent. Dès qu’ils voient les Africains, ils se lèvent et viennent dans le hall.
– Ils vont loger ici, ceux-là ? demande l’un des hommes.
– Oui, nous avons de la place pour eux, répond Zissis tranquillement.
– Alors maintenant on va habiter avec des Noirs ? demande la femme.
– Zoé, ici c’est un refuge pour tous les sans-abri, pas pour des Grecs sans abri, dit Zissis toujours aussi tranquillement. Nous accueillons tout le monde : les Noirs, les Jaunes, les Blancs – tout le monde.
– Moi, en tout cas, je ne dors pas dans la même chambre que des Noirs, déclare l’autre homme.
Entre-temps, d’autres sans-abri sont descendus et observent la scène depuis l’escalier.
– Ne râlez pas ! s’écrie un vieux. Au point où en est, on va dormir dans les bras des Noirs, faut se faire une raison.
– On va les installer dans la même chambre, pour qu’ils soient ensemble, explique Zissis. Pour ceux à qui ça ne plaît pas, il y a l’asile municipal, les hôtels ou les bancs publics.
– Lambros, tu es un type en or, lui crie une femme depuis l’escalier. Si seulement tu n’étais pas coco…
– Coco ou pas, tant que je suis là, chaque sans-abri trouvera un toit ici.
Les autres, voyant qu’ils n’arriveront à rien avec lui, se retirent dans leurs chambres pour discuter de la nouvelle situation.
– Il y a quelques années, j’en aurais pleuré, dit Katérina. Maintenant je suis furieuse, et je ne sais pas ce qui est le plus juste.
– Les gens ne changent pas du fait qu’ils sont à la rue, Katérina, répond Zissis. Toi, tu as de la chance, tu l’as compris jeune encore. Moi, je l’ai appris très tard.
– Venez, dit-il aux trois Africains, et il les emmène dans leur chambre.
Nous quittons le refuge. Katérina me tient le bras, la tête posée sur mon épaule.
– Ils vont loger ici, ceux-là ? demande l’un des hommes.
– Oui, nous avons de la place pour eux, répond Zissis tranquillement.
– Alors maintenant on va habiter avec des Noirs ? demande la femme.
– Zoé, ici c’est un refuge pour tous les sans-abri, pas pour des Grecs sans abri, dit Zissis toujours aussi tranquillement. Nous accueillons tout le monde : les Noirs, les Jaunes, les Blancs – tout le monde.
– Moi, en tout cas, je ne dors pas dans la même chambre que des Noirs, déclare l’autre homme.
Entre-temps, d’autres sans-abri sont descendus et observent la scène depuis l’escalier.
– Ne râlez pas ! s’écrie un vieux. Au point où en est, on va dormir dans les bras des Noirs, faut se faire une raison.
– On va les installer dans la même chambre, pour qu’ils soient ensemble, explique Zissis. Pour ceux à qui ça ne plaît pas, il y a l’asile municipal, les hôtels ou les bancs publics.
– Lambros, tu es un type en or, lui crie une femme depuis l’escalier. Si seulement tu n’étais pas coco…
– Coco ou pas, tant que je suis là, chaque sans-abri trouvera un toit ici.
Les autres, voyant qu’ils n’arriveront à rien avec lui, se retirent dans leurs chambres pour discuter de la nouvelle situation.
– Il y a quelques années, j’en aurais pleuré, dit Katérina. Maintenant je suis furieuse, et je ne sais pas ce qui est le plus juste.
– Les gens ne changent pas du fait qu’ils sont à la rue, Katérina, répond Zissis. Toi, tu as de la chance, tu l’as compris jeune encore. Moi, je l’ai appris très tard.
– Venez, dit-il aux trois Africains, et il les emmène dans leur chambre.
Nous quittons le refuge. Katérina me tient le bras, la tête posée sur mon épaule.
– Vous connaissez la différence entre le centre d’Athènes et Halandri, monsieur le commissaire ?
– Dis-moi.
– Au centre le malheur éclate. Ici on le cache. Au centre on tombe à chaque pas sur des gens qui fouillent les poubelles. Ici les magasins sont ouverts et les gens circulent dans les rues comme avant. Ils sont malheureux mais auraient honte que ça se voie. Les gens au centre n’ont même plus honte.
L’équipe s’est augmentée d’un policier qui pense, me dis-je. C’est bon pour l’équipe, mais je ne sais pas si c’est bon pour lui. Ça peut l’aider, comme ça peut le détruire. En Grèce, d’habitude, ceux qui réussissent dans la fonction publique se situent quelque part entre l’imbécile et le médiocre. Si tu as l’intelligence mais pas le piston, tu es rongé par une contradiction : tes pensées filent comme le vent et tu avances comme un escargot.
– Dis-moi.
– Au centre le malheur éclate. Ici on le cache. Au centre on tombe à chaque pas sur des gens qui fouillent les poubelles. Ici les magasins sont ouverts et les gens circulent dans les rues comme avant. Ils sont malheureux mais auraient honte que ça se voie. Les gens au centre n’ont même plus honte.
L’équipe s’est augmentée d’un policier qui pense, me dis-je. C’est bon pour l’équipe, mais je ne sais pas si c’est bon pour lui. Ça peut l’aider, comme ça peut le détruire. En Grèce, d’habitude, ceux qui réussissent dans la fonction publique se situent quelque part entre l’imbécile et le médiocre. Si tu as l’intelligence mais pas le piston, tu es rongé par une contradiction : tes pensées filent comme le vent et tu avances comme un escargot.
Avant de rentrer chez nous, je veux repasser par l’hôpital. Je descends au garage. La Seat démarre du premier coup. J’arrive à l’avenue Mesoyion quand mon portable sonne. L’inquiétude me reprend. Chat échaudé craint l’eau froid, comme disait ma mère. J’entends une voix d’homme inconnue.
– Calme ta fille, commissaire, la prochaine fois ça sera pire.
Et on raccroche.
J’avais raison de m’inquiéter, mais je ne m’attendais pas à ce coup-là. Comment ces salopards connaissent-ils mon numéro de portable ? S’ils m’appelaient au bureau, je comprendrais. Mais ceux qui ont mon numéro de portable se comptent sur les doigts des deux mains : Adriani, Katérina, Phanis, Mania, Zissis et quelques collègues. On a donc trouvé mon numéro à la Sûreté.
D’accord, je ne me fais pas d’illusions. Je sais que l’Aube dorée fricote avec la police. Il y a des flics ripous, et aussi des flics fachos. Mais de là à donner mon numéro à leurs potes… D’autant qu’on ne va sûrement pas se limiter au portable. On va sûrement livrer d’autres renseignements, allez savoir quoi.
Telles sont mes pensées quand j’arrive à l’Hôpital général et monte vers la chambre de Katérina. Adriani assise sur une chaise dans le couloir discute avec Phanis. À voir leurs têtes, je devine que tout va bien.
Adriani me le confirme.
– Elle dort.
– Nous lui avons donné des antalgiques et un tranquillisant, explique Phanis.
J’ouvre sans bruit la porte. Katérina dort tranquillement, couchée sur le côté. Je referme la porte et retourne vers ma femme et mon gendre.
– Tu la fais sortir quand ?
– Je veux que plusieurs confrères la voient demain matin. Un ORL surtout, car elle m’a dit que son oreille droite bourdonne. Puis je la ramènerai à la maison. J’espère la convaincre d’y rester quelques jours au lieu de courir tout de suite à son bureau.
– Elle va y courir, dit Adriani, catégorique. Elle est têtue comme son père.
– Donc c’est encore ma faute ? dis-je en souriant.
– Qu’est-ce que je peux dire, Kostas chéri ? Si je n’avais pas mise au monde, je dirais que tu l’as faite avec une autre femme. Elle n’a rien de moi.
– Dites-vous tout ça ce soir chez vous, mais pas devant votre gendre, dit Phanis en riant.
– Comme elle va rester ici ce soir, elle a peur d’oublier son sermon d’ici demain.
Adriani me jette l’un de ses regards méprisants, mais sans relever.
Je quitte l’hôpital soulagé, tranquille. Mais cette histoire de numéro de portable continue de me préoccuper.
– Calme ta fille, commissaire, la prochaine fois ça sera pire.
Et on raccroche.
J’avais raison de m’inquiéter, mais je ne m’attendais pas à ce coup-là. Comment ces salopards connaissent-ils mon numéro de portable ? S’ils m’appelaient au bureau, je comprendrais. Mais ceux qui ont mon numéro de portable se comptent sur les doigts des deux mains : Adriani, Katérina, Phanis, Mania, Zissis et quelques collègues. On a donc trouvé mon numéro à la Sûreté.
D’accord, je ne me fais pas d’illusions. Je sais que l’Aube dorée fricote avec la police. Il y a des flics ripous, et aussi des flics fachos. Mais de là à donner mon numéro à leurs potes… D’autant qu’on ne va sûrement pas se limiter au portable. On va sûrement livrer d’autres renseignements, allez savoir quoi.
Telles sont mes pensées quand j’arrive à l’Hôpital général et monte vers la chambre de Katérina. Adriani assise sur une chaise dans le couloir discute avec Phanis. À voir leurs têtes, je devine que tout va bien.
Adriani me le confirme.
– Elle dort.
– Nous lui avons donné des antalgiques et un tranquillisant, explique Phanis.
J’ouvre sans bruit la porte. Katérina dort tranquillement, couchée sur le côté. Je referme la porte et retourne vers ma femme et mon gendre.
– Tu la fais sortir quand ?
– Je veux que plusieurs confrères la voient demain matin. Un ORL surtout, car elle m’a dit que son oreille droite bourdonne. Puis je la ramènerai à la maison. J’espère la convaincre d’y rester quelques jours au lieu de courir tout de suite à son bureau.
– Elle va y courir, dit Adriani, catégorique. Elle est têtue comme son père.
– Donc c’est encore ma faute ? dis-je en souriant.
– Qu’est-ce que je peux dire, Kostas chéri ? Si je n’avais pas mise au monde, je dirais que tu l’as faite avec une autre femme. Elle n’a rien de moi.
– Dites-vous tout ça ce soir chez vous, mais pas devant votre gendre, dit Phanis en riant.
– Comme elle va rester ici ce soir, elle a peur d’oublier son sermon d’ici demain.
Adriani me jette l’un de ses regards méprisants, mais sans relever.
Je quitte l’hôpital soulagé, tranquille. Mais cette histoire de numéro de portable continue de me préoccuper.
L’ambulance s’arrête devant l’entrée. Les badauds s’écartent et Phanis descend le premier. Il me jette un bref regard et court vers Katérina. Il s’agenouille près d’elle et lui ouvre un œil. Il lui prend son pouls puis l’interroge :
– Katérina, c’est Phanis. Tu peux me parler ?
– Ils m’ont tabassée, Phanis.
Phanis ferme les yeux et pousse un soupir de soulagement.
Elle répète, « tabassée », et des larmes coulent de ses yeux.
– Eh oui, ça se voit, répond calmement Phanis. Je vais t’emmener à l’hôpital faire des examens. Je sais que tu as mal, mais bientôt tu te sentiras mieux.
Il fait signe aux brancardiers qui allongent Katérina sur la civière et l’emmènent dans l’ambulance.
– C’est grave ? dis-je à Phanis, tout en sachant qu’il est trop tôt pour répondre.
– À première vue, non. Mais pour savoir, il faut faire des radios.
Je remets à plus tard le coup de fil à Adriani et jette un coup d’œil autour de moi. Le spectacle est terminé, les spectateurs se dispersent. Il reste la femme qui a apporté son aide, les deux gardes de l’entrée, Vlassopoulos et deux immigrés africains. Un peu plus loin, une dame bien en chair, écouteurs aux oreilles, pérore d’une voix stridente.
– Qui êtes-vous ? demande Vlassopoulos aux Africains.
– Clients de Mme Charitou, répond l’un.
– Venir ensemble à tribunal, complète l’autre.
J’interviens :
– Vous venez d’où ?
– De Sénégal, dit le premier.
– Il faut venir déposer, dit Vlassopoulos.
L’un des gardes sort des menottes de sa poche arrière et s’approche de l’un des Africains.
– Qu’est-ce que tu fais ? demande Vlassopoulos, interloqué.
– Qui te dit que c’est pas eux qui l’ont cognée ? répond l’autre qui le prend de haut.
– Si c’était le cas, collègue, tu crois qu’ils attendraient qu’on vienne les arrêter ?
Le garde se trouble, cherche en vain une réponse et remet les menottes dans sa poche. Son acolyte, lui, veut faire le malin.
– Si tu veux mon avis, ils restent là pour jouer les innocents.
– C’est pas eux qui l’ont tabassée, c’est tes petits copains de l’Aube dorée ! s’écrie soudain la femme secourable. Je les ai vus de mes yeux !
– Qu’est-ce que tu as dit ? réplique le premier garde en marchant vers elle, menaçant.
Je leur crie :
– Arrêtez, ce n’est pas le moment de se battre !
Le garde s’arrête.
– Qu’avez-vous vu ? dis-je à la femme.
– J’attendais mon avocat devant l’entrée. La jeune femme est sortie avec ses clients. Soudain, deux jeunes types en noir ont surgi de nulle part sur un scooter. Ils sont montés sur le trottoir, l’un d’eux a mis pied à terre, a sauté sur la jeune femme et s’est mis à la frapper avec un poing américain. Les deux Africains ont voulu l’en empêcher, mais l’autre sur le scooter leur a crié : « Si vous bougez on vous bute, sales négros ! » Quand la jeune femme est tombée, le facho l’a laissée, est remonté à scooter et ils ont disparu entre les voitures.
Vlassopoulos demande aux gardes :
– Et vous, vous n’avez rien remarqué ?
– Nous, on faisait notre boulot. Et même si on avait vu du monde, ça nous aurait pas surpris, y a toujours du monde à l’entrée.
– On n’a même pas entendu des cris, ajoute le second.
– Ça, c’est vrai, confirme la femme. Je n’ai pas crié moi non plus, j’avais peur qu’ils me tombent dessus.
– Vous avez noté le numéro du scooter ? lui dis-je.
– De là où j’étais je ne le voyais pas. Ensuite ils ont filé comme l’éclair.
Vlassopoulos va interroger la dame aux écouteurs.
– Moi, je n’ai rien vu, je suis arrivée après.
Et elle ajoute :
– La malheureuse, elle avait besoin de prendre des clients noirs ? Elle n’a pas assez à faire avec les nôtres ?
Je ne sais pas ce qu’elle écoute, mais elle devrait changer de station.
– Katérina, c’est Phanis. Tu peux me parler ?
– Ils m’ont tabassée, Phanis.
Phanis ferme les yeux et pousse un soupir de soulagement.
Elle répète, « tabassée », et des larmes coulent de ses yeux.
– Eh oui, ça se voit, répond calmement Phanis. Je vais t’emmener à l’hôpital faire des examens. Je sais que tu as mal, mais bientôt tu te sentiras mieux.
Il fait signe aux brancardiers qui allongent Katérina sur la civière et l’emmènent dans l’ambulance.
– C’est grave ? dis-je à Phanis, tout en sachant qu’il est trop tôt pour répondre.
– À première vue, non. Mais pour savoir, il faut faire des radios.
Je remets à plus tard le coup de fil à Adriani et jette un coup d’œil autour de moi. Le spectacle est terminé, les spectateurs se dispersent. Il reste la femme qui a apporté son aide, les deux gardes de l’entrée, Vlassopoulos et deux immigrés africains. Un peu plus loin, une dame bien en chair, écouteurs aux oreilles, pérore d’une voix stridente.
– Qui êtes-vous ? demande Vlassopoulos aux Africains.
– Clients de Mme Charitou, répond l’un.
– Venir ensemble à tribunal, complète l’autre.
J’interviens :
– Vous venez d’où ?
– De Sénégal, dit le premier.
– Il faut venir déposer, dit Vlassopoulos.
L’un des gardes sort des menottes de sa poche arrière et s’approche de l’un des Africains.
– Qu’est-ce que tu fais ? demande Vlassopoulos, interloqué.
– Qui te dit que c’est pas eux qui l’ont cognée ? répond l’autre qui le prend de haut.
– Si c’était le cas, collègue, tu crois qu’ils attendraient qu’on vienne les arrêter ?
Le garde se trouble, cherche en vain une réponse et remet les menottes dans sa poche. Son acolyte, lui, veut faire le malin.
– Si tu veux mon avis, ils restent là pour jouer les innocents.
– C’est pas eux qui l’ont tabassée, c’est tes petits copains de l’Aube dorée ! s’écrie soudain la femme secourable. Je les ai vus de mes yeux !
– Qu’est-ce que tu as dit ? réplique le premier garde en marchant vers elle, menaçant.
Je leur crie :
– Arrêtez, ce n’est pas le moment de se battre !
Le garde s’arrête.
– Qu’avez-vous vu ? dis-je à la femme.
– J’attendais mon avocat devant l’entrée. La jeune femme est sortie avec ses clients. Soudain, deux jeunes types en noir ont surgi de nulle part sur un scooter. Ils sont montés sur le trottoir, l’un d’eux a mis pied à terre, a sauté sur la jeune femme et s’est mis à la frapper avec un poing américain. Les deux Africains ont voulu l’en empêcher, mais l’autre sur le scooter leur a crié : « Si vous bougez on vous bute, sales négros ! » Quand la jeune femme est tombée, le facho l’a laissée, est remonté à scooter et ils ont disparu entre les voitures.
Vlassopoulos demande aux gardes :
– Et vous, vous n’avez rien remarqué ?
– Nous, on faisait notre boulot. Et même si on avait vu du monde, ça nous aurait pas surpris, y a toujours du monde à l’entrée.
– On n’a même pas entendu des cris, ajoute le second.
– Ça, c’est vrai, confirme la femme. Je n’ai pas crié moi non plus, j’avais peur qu’ils me tombent dessus.
– Vous avez noté le numéro du scooter ? lui dis-je.
– De là où j’étais je ne le voyais pas. Ensuite ils ont filé comme l’éclair.
Vlassopoulos va interroger la dame aux écouteurs.
– Moi, je n’ai rien vu, je suis arrivée après.
Et elle ajoute :
– La malheureuse, elle avait besoin de prendre des clients noirs ? Elle n’a pas assez à faire avec les nôtres ?
Je ne sais pas ce qu’elle écoute, mais elle devrait changer de station.
– Les choses de l'esprit, aujourd'hui... les travailleurs de l'esprit n'existent plus, monsieur le commissaire. Nous n'avons plus que des intellectuels.
– Quelle est la différence ?
– Les travailleurs de l'esprit sont dans les bibliothèques, ils se consacrent à l 'étude, à la science. Les intellectuels sont spécialistes en généralités sur tous les sujets. Les travailleurs de l'esprit ont des connaissances, les intellectuels ont des points de vue, qu'ils aiment exposer à la moindre occasion. La présentation du point de vue est liée à deux éléments d'origine sexuelle.
– Sexuelle ?
Je n'en crois pas mes oreilles. Seferoglou a certainement décidé de me rendre fou.
– Eh oui, sexuelle. Il y a d'abord la volupté de l'analyse. Ils analysent tout. Ils souffrent d'une maladie qui n'a pas encore trouvé de thérapie : l'analysiomame. Ensuite, il y a le plaisir de l'autoécoute. S'écouter parler les ravit.
Il hoche tristement la tete.
– Et de même, il n'existe plus de professeurs d'université, monsieur le commissaire.
– Plus de... ?
Je suis sidéré. Avec qui ai-je donc parlé tous ces jours-ci?
– Il y a des universitaires, de même qu'il y a des
employés du fisc, des banquiers, des policiers comme vous, des militaires comme mon père. Les professeurs d'université se sont agrégés aux universitaires et les travailleurs de l'esprit aux intellectuels. La boucle est bouclée.
– Quelle est la différence ?
– Les travailleurs de l'esprit sont dans les bibliothèques, ils se consacrent à l 'étude, à la science. Les intellectuels sont spécialistes en généralités sur tous les sujets. Les travailleurs de l'esprit ont des connaissances, les intellectuels ont des points de vue, qu'ils aiment exposer à la moindre occasion. La présentation du point de vue est liée à deux éléments d'origine sexuelle.
– Sexuelle ?
Je n'en crois pas mes oreilles. Seferoglou a certainement décidé de me rendre fou.
– Eh oui, sexuelle. Il y a d'abord la volupté de l'analyse. Ils analysent tout. Ils souffrent d'une maladie qui n'a pas encore trouvé de thérapie : l'analysiomame. Ensuite, il y a le plaisir de l'autoécoute. S'écouter parler les ravit.
Il hoche tristement la tete.
– Et de même, il n'existe plus de professeurs d'université, monsieur le commissaire.
– Plus de... ?
Je suis sidéré. Avec qui ai-je donc parlé tous ces jours-ci?
– Il y a des universitaires, de même qu'il y a des
employés du fisc, des banquiers, des policiers comme vous, des militaires comme mon père. Les professeurs d'université se sont agrégés aux universitaires et les travailleurs de l'esprit aux intellectuels. La boucle est bouclée.
Ce n’est pas que l’on trouve chez nous moins de commerces de restauration mais, au contraire d’ici, les nôtres s’apparentent davantage à des fast-foods qu’à des comptoirs de vente à emporter : les mets sont présentés en vitrines derrière lesquelles se tiennent des hommes vêtus de blouses immaculées et coiffés de toques de cuisinier.
Adriani s’approche d’une vitrine. Au début, je me dis qu’elle souhaite commander un complément de repas vu que son appétit a été coupé net quand elle m’a vu sortir mon portable. En fait, je me trompe. Elle reste plantée là, à détailler la vitrine et les plats exposés. Elle rêvasse devant les préparations à l’huile, les boulettes de viande déclinées dans des formes variées, les riz divers et les viandes grillées. Elle regarde les colonnes alignées le long des murs des gyros qui tournent sur eux-mêmes pour cuire la viande dans laquelle on tranche le kebab. Elle semble incapable d’en détacher les yeux.
– Vous aimez la cuisine, madame Charitos ? lui demande gentiment Mme Mouratoglou.
– Comment avez-vous deviné ?
– À votre regard. Vous avez celui d’une spécialiste, répond-elle avant d’hésiter un instant. D’une spécialiste un tantinet envieuse.
Bien que Mme Mouratoglou ait répondu de manière amicale, sans aucune intention de blesser, je m’attends à ce qu’Adriani prenne la mouche et m’apprête d’ores et déjà à la contenir pour ne pas nous retrouver en froid avec la seule personne qui fait montre d’un peu d’affection pour nous ces derniers temps. Mais Adriani me surprend lorsqu’elle s’adresse en souriant à Mme Mouratoglou :
– Toutes les bonnes cuisinières sont un peu jalouses un jour ou l’autre, madame Mouratoglou. Ce qui me plaît tant, ici, c’est l’abondance. L’œil est autant rassasié que l’estomac.
Nous remontons Péra en direction de la place Taksim non sans difficulté à cause de la foule en sens inverse.
– Vos confrères, monsieur le commissaire, me murmure Mme Mouratoglou en me montrant discrètement une ruelle sur notre gauche.
En guise de confrères, je vois surtout une brigade de policiers en grande tenue de combat : casque, bouclier et matraque. Ils ont barré la ruelle sur toute sa largeur et sont prêts à intervenir au moindre accroc. J’imagine le sermon que nous aurait seriné le ministre, voire tous les membres du gouvernement réuni, si nous mettions en faction quelques membres des MAT rue Santaroza ou encore rue Charilaou Trikoupi, également fréquentées. Nous aurions eu droit à toute la gamme de noms d’oiseau, allant du gentil « flicaillons » jusqu’au dédaigneux « fascistes », en passant par un hostile « mercenaires ».
– Ils sont là tous les soirs ou il y a quelque chose en particulier aujourd’hui ? dis-je à Mme Mouratoglou dans l’espoir d’en apprendre davantage.
– Je ne viens pas ici tous les soirs, comme vous savez. Mais ils y sont chaque fois que je passe dans ce quartier.
Adriani s’approche d’une vitrine. Au début, je me dis qu’elle souhaite commander un complément de repas vu que son appétit a été coupé net quand elle m’a vu sortir mon portable. En fait, je me trompe. Elle reste plantée là, à détailler la vitrine et les plats exposés. Elle rêvasse devant les préparations à l’huile, les boulettes de viande déclinées dans des formes variées, les riz divers et les viandes grillées. Elle regarde les colonnes alignées le long des murs des gyros qui tournent sur eux-mêmes pour cuire la viande dans laquelle on tranche le kebab. Elle semble incapable d’en détacher les yeux.
– Vous aimez la cuisine, madame Charitos ? lui demande gentiment Mme Mouratoglou.
– Comment avez-vous deviné ?
– À votre regard. Vous avez celui d’une spécialiste, répond-elle avant d’hésiter un instant. D’une spécialiste un tantinet envieuse.
Bien que Mme Mouratoglou ait répondu de manière amicale, sans aucune intention de blesser, je m’attends à ce qu’Adriani prenne la mouche et m’apprête d’ores et déjà à la contenir pour ne pas nous retrouver en froid avec la seule personne qui fait montre d’un peu d’affection pour nous ces derniers temps. Mais Adriani me surprend lorsqu’elle s’adresse en souriant à Mme Mouratoglou :
– Toutes les bonnes cuisinières sont un peu jalouses un jour ou l’autre, madame Mouratoglou. Ce qui me plaît tant, ici, c’est l’abondance. L’œil est autant rassasié que l’estomac.
Nous remontons Péra en direction de la place Taksim non sans difficulté à cause de la foule en sens inverse.
– Vos confrères, monsieur le commissaire, me murmure Mme Mouratoglou en me montrant discrètement une ruelle sur notre gauche.
En guise de confrères, je vois surtout une brigade de policiers en grande tenue de combat : casque, bouclier et matraque. Ils ont barré la ruelle sur toute sa largeur et sont prêts à intervenir au moindre accroc. J’imagine le sermon que nous aurait seriné le ministre, voire tous les membres du gouvernement réuni, si nous mettions en faction quelques membres des MAT rue Santaroza ou encore rue Charilaou Trikoupi, également fréquentées. Nous aurions eu droit à toute la gamme de noms d’oiseau, allant du gentil « flicaillons » jusqu’au dédaigneux « fascistes », en passant par un hostile « mercenaires ».
– Ils sont là tous les soirs ou il y a quelque chose en particulier aujourd’hui ? dis-je à Mme Mouratoglou dans l’espoir d’en apprendre davantage.
– Je ne viens pas ici tous les soirs, comme vous savez. Mais ils y sont chaque fois que je passe dans ce quartier.
Mme Mouratoglou nous a tous emmenés au restaurant « Imbros » dont le patron est, sans surprise aucune, originaire de cette île turque de la mer Égée. Nous sommes installés en terrasse, sur une longue ruelle qui semble plus étroite qu’elle n’est en réalité, à cause des tables qui débordent sur la chaussée de part et d’autre, comme chez les autres restaurateurs de la rue. Pour y accéder, nous avons dû traverser une rue pleine d’échoppes où l’on proposait les fameuses moules frites, puis continuer tout droit avant de tomber sur d’autres marchands de moules, farcies cette fois. Plus loin, les parfums d’épices, les arômes de pastirma, de la viande de boeuf pressée couverte de cumin, de paprika, de fenugrec, de sel et d’ail, et les odeurs de soudjouk, la saucisse sèche épicée, et celles de likourinos, le poisson fumé dont les plus beaux spécimens de mulet pendaient dans les magasins. Chez nous, ce sont les grappes de raisin que nous exposons ainsi. Ici, c’est la charcuterie et les mézès, les amuse-gueules, qu’on accroche pour attirer le chaland. Je ne sais pas ce qui me restera le plus de mon voyage à Constantinople : Sainte-Sophie, le Bosphore ou les odeurs de la ville.
– Mais enfin, on dirait que ces Turcs sont en permanence affamés ! s’étonne Adriani à l’intention de Mme Mouratoglou.
– Ne vous y trompez pas. Ils mangent peu. Ce sont nous, les Grecs, qui dévorons comme quatre ! s’exclame dans notre dos la voix tonitruante de M. Sotiris, notre restaurateur, que Mme Mouratoglou nous a présenté un peu plus tôt.
– C’est impossible ! proteste Adriani. Il n’y a pas une ruelle où nous soyons passés dont un magasin sur deux ne propose de la nourriture.
– Les Turcs ne sont pas esclaves de la faim mais des saveurs, Mandam, lui précise Sotiris. Le Turc bien né aime à avoir une dizaine d’assiettes autour de lui pour y picorer pendant des heures. Moi je préfère les Grecs.
– Et pourquoi donc ? dis-je.
– Parce qu’ils ont toujours faim. Ils sont donc plus faciles à contenter. Une pièce de viande aussi dure qu’une semelle dans leur assiette, tout au plus une portion de moussakas, et, en moins d’une heure, l’affaire est réglée. Alors qu’avec les Turcs, il faut aller et venir des dizaines de fois pour servir et desservir des assiettes et des ramequins.
Tout en parlant, il se dirige vers une table voisine pour saluer un homme dans la soixantaine, qui dîne seul dans son coin. Il est évident qu’ils se connaissent. Notre restaurateur s’assied en face de lui et commence à lui faire la conversation. Mme Mouratoglou l’observe tout en secouant la tête.
– Si vous saviez combien de restaurants grecs il y avait dans le quartier de Péra, monsieur le commissaire, me dit-elle. Et pas seulement à Péra mais aussi sur les îles des Princes et à Thérapia, que les Turcs appellent Tarabya. Aujourd’hui, il ne reste plus que Sotiris, un autre à Thérapia, et un troisième sur Prinkipos, la plus grande des îles de l’archipel. Büyükada, en turc.
– Ils ont dû vendre leur commerce ? demande Adriani.
– Certains ont vendu. D’autres sont morts et leurs enfants n’ont pas pris la suite, préférant s’installer en Grèce…
À mon grand soulagement, Mme Mouratoglou poursuit ses explications à l’adresse d’Adriani qui, en bonne adepte de la télévision, adore les histoires et en particulier celles qui sont tristes. Moi, c’est tout le contraire : j’éprouve un rejet naturel pour toutes les grandeurs passées sur lesquelles on pleure dès qu’on les évoque. Je jette un regard autour de moi, sur les tables disposées le long de la ruelle. Elles sont toutes occupées. Les convives boivent et bavardent de concert mais, dans l’ensemble, ils font moitié moins de bruit que la moindre petite taverne athénienne dans laquelle on ne peut même pas entendre parler son voisin.
– Mais enfin, on dirait que ces Turcs sont en permanence affamés ! s’étonne Adriani à l’intention de Mme Mouratoglou.
– Ne vous y trompez pas. Ils mangent peu. Ce sont nous, les Grecs, qui dévorons comme quatre ! s’exclame dans notre dos la voix tonitruante de M. Sotiris, notre restaurateur, que Mme Mouratoglou nous a présenté un peu plus tôt.
– C’est impossible ! proteste Adriani. Il n’y a pas une ruelle où nous soyons passés dont un magasin sur deux ne propose de la nourriture.
– Les Turcs ne sont pas esclaves de la faim mais des saveurs, Mandam, lui précise Sotiris. Le Turc bien né aime à avoir une dizaine d’assiettes autour de lui pour y picorer pendant des heures. Moi je préfère les Grecs.
– Et pourquoi donc ? dis-je.
– Parce qu’ils ont toujours faim. Ils sont donc plus faciles à contenter. Une pièce de viande aussi dure qu’une semelle dans leur assiette, tout au plus une portion de moussakas, et, en moins d’une heure, l’affaire est réglée. Alors qu’avec les Turcs, il faut aller et venir des dizaines de fois pour servir et desservir des assiettes et des ramequins.
Tout en parlant, il se dirige vers une table voisine pour saluer un homme dans la soixantaine, qui dîne seul dans son coin. Il est évident qu’ils se connaissent. Notre restaurateur s’assied en face de lui et commence à lui faire la conversation. Mme Mouratoglou l’observe tout en secouant la tête.
– Si vous saviez combien de restaurants grecs il y avait dans le quartier de Péra, monsieur le commissaire, me dit-elle. Et pas seulement à Péra mais aussi sur les îles des Princes et à Thérapia, que les Turcs appellent Tarabya. Aujourd’hui, il ne reste plus que Sotiris, un autre à Thérapia, et un troisième sur Prinkipos, la plus grande des îles de l’archipel. Büyükada, en turc.
– Ils ont dû vendre leur commerce ? demande Adriani.
– Certains ont vendu. D’autres sont morts et leurs enfants n’ont pas pris la suite, préférant s’installer en Grèce…
À mon grand soulagement, Mme Mouratoglou poursuit ses explications à l’adresse d’Adriani qui, en bonne adepte de la télévision, adore les histoires et en particulier celles qui sont tristes. Moi, c’est tout le contraire : j’éprouve un rejet naturel pour toutes les grandeurs passées sur lesquelles on pleure dès qu’on les évoque. Je jette un regard autour de moi, sur les tables disposées le long de la ruelle. Elles sont toutes occupées. Les convives boivent et bavardent de concert mais, dans l’ensemble, ils font moitié moins de bruit que la moindre petite taverne athénienne dans laquelle on ne peut même pas entendre parler son voisin.
La Vierge me regarde de haut d’un air sévère, presque réprobateur. Enfin, c’est ainsi que je ressens les choses. Après tout, je me fais peut-être des idées, à moins que je ne nourrisse un complexe de supériorité tout ce qu’il y a de plus grec orthodoxe. La mère de Dieu a bien d’autres chats à fouetter que de s’occuper de moi. Et pourtant, elle contemple ses ouailles qui se bousculent dans le vaste narthex. J’en fais partie par le plus grand des hasards, accompagné de ma moitié et d’une meute de touristes athéniens.
– La mosaïque représentant la Vierge à l’Enfant date de 867 et est antérieure à toutes les autres mosaïques restaurées, m’informe la voix de la guide en me ramenant au moment présent. Elle a été réalisée à la fin de la seconde période iconoclaste.
– Gloire à Dieu qui m’a donné de voir cela, murmure à mes côtés Adriani en se signant copieusement. Vierge Marie, mère de Dieu, exauce ma prière, ajoute-t-elle.
Je connais parfaitement la raison de ses dévotions mais je préfère ne pas aborder le sujet.
– Le dôme de l’église Sainte-Sophie s’élève à cinquante mètres et soixante centimètres, précise pompeusement la guide. Son diamètre dans l’axe nord-sud est inférieur à celui de l’axe est-ouest. À l’endroit où vous pouvez voir les caractères arabes, autour des petits rayons, se trouvait la mosaïque du Christ Pantocrator. Le texte arabe a été ajouté au dix-huitième siècle. Il s’agit de la première sourate du Coran.
Depuis le centre de la coupole, à l’endroit désigné par la guide, les mosaïques rayonnent, comme de longues frises courant jusqu’aux vitraux pour mieux briller au soleil.
– Si on grattait la peinture des pattes de mouche, tu crois qu’on y verrait dessous le petit Jésus ? Ce serait marrant ! s’esclaffe Stélaras, dont le rire résonne tandis que sa mère le gratifie d’un « Silence ! » sifflé à l’oreille.
– Rien n’est moins sûr, explique la guide. De nombreux archéologues et restaurateurs d’œuvres d’art affirment que la plus grande partie de la mosaïque a été détruite.
– Malgré le temps, malgré les ans, elle est toujours à nous. Mais il n’en reste rien pour le jour où elle nous sera restituée, commente d’un air affligé Despotopoulos.
Fouillant du regard autour de moi, je fais mine de contempler la grandeur du site et m’éloigne du groupe parce que Despotopoulos est un militaire à la retraite, ancien général de la division blindée et fervent défenseur de la sainte guerre opposant les forces armées aux corps de la sécurité. D’où la sempiternelle question qu’il me lance à chacun de ses accès de fièvre patriotique : « Et vous, qu’en pensez-vous, monsieur le commissaire ? » Et moi, je me retiens de ne pas lui balancer que, depuis que les Albanais ont envahi Athènes, il serait bon pour nous d’investir à notre tour Constantinople comme un juste retour des choses. Mais il est fichu de prendre mes propos au premier degré.
– La mosaïque représentant la Vierge à l’Enfant date de 867 et est antérieure à toutes les autres mosaïques restaurées, m’informe la voix de la guide en me ramenant au moment présent. Elle a été réalisée à la fin de la seconde période iconoclaste.
– Gloire à Dieu qui m’a donné de voir cela, murmure à mes côtés Adriani en se signant copieusement. Vierge Marie, mère de Dieu, exauce ma prière, ajoute-t-elle.
Je connais parfaitement la raison de ses dévotions mais je préfère ne pas aborder le sujet.
– Le dôme de l’église Sainte-Sophie s’élève à cinquante mètres et soixante centimètres, précise pompeusement la guide. Son diamètre dans l’axe nord-sud est inférieur à celui de l’axe est-ouest. À l’endroit où vous pouvez voir les caractères arabes, autour des petits rayons, se trouvait la mosaïque du Christ Pantocrator. Le texte arabe a été ajouté au dix-huitième siècle. Il s’agit de la première sourate du Coran.
Depuis le centre de la coupole, à l’endroit désigné par la guide, les mosaïques rayonnent, comme de longues frises courant jusqu’aux vitraux pour mieux briller au soleil.
– Si on grattait la peinture des pattes de mouche, tu crois qu’on y verrait dessous le petit Jésus ? Ce serait marrant ! s’esclaffe Stélaras, dont le rire résonne tandis que sa mère le gratifie d’un « Silence ! » sifflé à l’oreille.
– Rien n’est moins sûr, explique la guide. De nombreux archéologues et restaurateurs d’œuvres d’art affirment que la plus grande partie de la mosaïque a été détruite.
– Malgré le temps, malgré les ans, elle est toujours à nous. Mais il n’en reste rien pour le jour où elle nous sera restituée, commente d’un air affligé Despotopoulos.
Fouillant du regard autour de moi, je fais mine de contempler la grandeur du site et m’éloigne du groupe parce que Despotopoulos est un militaire à la retraite, ancien général de la division blindée et fervent défenseur de la sainte guerre opposant les forces armées aux corps de la sécurité. D’où la sempiternelle question qu’il me lance à chacun de ses accès de fièvre patriotique : « Et vous, qu’en pensez-vous, monsieur le commissaire ? » Et moi, je me retiens de ne pas lui balancer que, depuis que les Albanais ont envahi Athènes, il serait bon pour nous d’investir à notre tour Constantinople comme un juste retour des choses. Mais il est fichu de prendre mes propos au premier degré.
La journée suivante commence par la distribution. Arrivé au bureau avec deux sacs de dragées, je passe à tous les étages en offrir aux collègues.
Les vœux et les remerciements sont cordiaux, mais un peu brefs, genre « respectons la coutume vite fait, on a d’autres chats à fouetter ». Les chats, en l’occurrence, sont les spéculations intensives auxquelles nous nous livrons, serrant les fesses en vue des restrictions qui nous privent du quatorzième mois de salaire et du treizième en partie.
Je bénis le ciel d’avoir pu assurer les études et la thèse de Katérina avec les quatorze. Pour la suite, je fais confiance aux talents d’Adriani, qui sait toujours se débrouiller avec ce qui tombe dans son porte-monnaie. C’est elle qui a insisté pour que je me colle sur le dos les traites de la Seat en pleine crise économique.
L’ambiance au bureau rappelle un peu celle de 2014, sous la dictature, lorsque les Turcs ont envahi Chypre. Les rumeurs se déchaînent et chacun dit n’importe quoi. Quelqu’un affirme qu’on va nous sucrer tout le treizième mois, un autre qu’on nous prendra seulement la moitié de la prime de Noël, un troisième qu’on perdra seulement cinq pour cent des primes de Noël, de Pâques et du congé annuel…
Et moi qui devrais distribuer des condoléances au lieu de dragées, moi qui viens de payer une réception de mariage avec musique live, quand on s’apprête à ratiboiser nos salaires.
– Tout ça, c’est un coup des Allemands soutient Kalliopoulos de la Brigade antiterroriste. C’est eux qui tirent les ficelles dans l’Union européenne et ils font pression pour qu’elle nous mette la corde au cou.
– Arrêtez vos conneries, lance derrière moi la voix de Stathakos, son chef.
Debout devant la porte, il jette un regard furieux sur ses subordonnés.
– Ils ont bon dos, les Allemands. C’est nous qui avons merdé, pour exiger ensuite que les Allemands paient les pots cassés !
Il prend la dragée que je lui tends, marmonne un vague « beaucoup de bonheur », corvée de remerciement contre corvée de dragées. Puis il se réfugie dans son bureau.
– Bon sang ne peut mentir, me chuchote Sgouros, son lieutenant.
– Pourquoi tu dis ça ?
– Parce qu’il est germanophile de naissance. Son grand-père était secrétaire de Tsolakoglou, Premier ministre sous l’Occupation.
– Je ne comprends pas pourquoi les Allemands ne profitent pas nos conquêtes au lieu de les démolir, s’interroge Kalliopoulos. Ça leur ferait mal s’ils exigeaient un treizième mois eux aussi, au lieu de nous enlever notre quatorzième ?
Je perds la suite de l’analyse comparative entre les facultés intellectuelles réduites des Allemands et notre débrouillardise, car mon portable sonne et j’entends la voix de Dermitzakis.
– Monsieur le commissaire, Guikas veut vous voir d’urgence.
Je monte au cinquième avec mes deux sacs plastiques à moitié pleins, comme si je rentrais du marché.
– Entrez, me dit sa secrétaire, il vous attend impatiemment.
– Tu peux me rendre service, Koula, en distribuant le reste ?
– Bien sûr. Laissez-les moi, je m’en occupe.
Guikas fait les cent pas dans son bureau et ce n’est pas bon signe.
– On est dans le pétrin, me dit-il en s’arrêtant net. Heureusement que le mariage a eu lieu, je t’aurais dit de le reporter, je crois.
– Qu’est-ce qui se passe ?
– On a tué Zissimopoulos.
Lisant dans mon regard, apparemment, il poursuit :
– Son nom ne te dit rien ?
– Non.
– Nikitas Zissimopoulos était le gouverneur de la Banque centrale. C’est lui qui l’a introduite en Bourse et l’a ouverte à l’Europe. À son époque, la banque a fait des profits fabuleux. Il s’est retiré il y a cinq ans, mais les fondations qu’il a posées ont résisté à la dernière crise.
– On l’a tué où ?
– Dans le jardin se sa villa, à Koropi.
– Qui l’a trouvé ?
– Le jardinier. Sa femme est morte il y a deux ans. Ses deux fils vivent à Londres. Le jardinier vient arroser tous les jours tôt le matin. Il a fait prévenir la police de Koropi. Heureusement, le commissaire est malin, il m’a appelé directement. Le secret est gardé, pas de journaliste sur le dos.
– On lui a tiré dessus ?
Bref silence.
– Non. On l’a décapité.
– Quoi ?
– Tu as bien entendu. Voilà pourquoi je te dis, heureusement que les médias ne savent rien.
Et le pistolet, la carabine, le couteau, ou du moins le poison, me dis-je, c’est pour les chiens ? La décapitation est devenue rare dans le monde entier, et a disparu chez nous depuis le temps d’Ali Pacha.
Les vœux et les remerciements sont cordiaux, mais un peu brefs, genre « respectons la coutume vite fait, on a d’autres chats à fouetter ». Les chats, en l’occurrence, sont les spéculations intensives auxquelles nous nous livrons, serrant les fesses en vue des restrictions qui nous privent du quatorzième mois de salaire et du treizième en partie.
Je bénis le ciel d’avoir pu assurer les études et la thèse de Katérina avec les quatorze. Pour la suite, je fais confiance aux talents d’Adriani, qui sait toujours se débrouiller avec ce qui tombe dans son porte-monnaie. C’est elle qui a insisté pour que je me colle sur le dos les traites de la Seat en pleine crise économique.
L’ambiance au bureau rappelle un peu celle de 2014, sous la dictature, lorsque les Turcs ont envahi Chypre. Les rumeurs se déchaînent et chacun dit n’importe quoi. Quelqu’un affirme qu’on va nous sucrer tout le treizième mois, un autre qu’on nous prendra seulement la moitié de la prime de Noël, un troisième qu’on perdra seulement cinq pour cent des primes de Noël, de Pâques et du congé annuel…
Et moi qui devrais distribuer des condoléances au lieu de dragées, moi qui viens de payer une réception de mariage avec musique live, quand on s’apprête à ratiboiser nos salaires.
– Tout ça, c’est un coup des Allemands soutient Kalliopoulos de la Brigade antiterroriste. C’est eux qui tirent les ficelles dans l’Union européenne et ils font pression pour qu’elle nous mette la corde au cou.
– Arrêtez vos conneries, lance derrière moi la voix de Stathakos, son chef.
Debout devant la porte, il jette un regard furieux sur ses subordonnés.
– Ils ont bon dos, les Allemands. C’est nous qui avons merdé, pour exiger ensuite que les Allemands paient les pots cassés !
Il prend la dragée que je lui tends, marmonne un vague « beaucoup de bonheur », corvée de remerciement contre corvée de dragées. Puis il se réfugie dans son bureau.
– Bon sang ne peut mentir, me chuchote Sgouros, son lieutenant.
– Pourquoi tu dis ça ?
– Parce qu’il est germanophile de naissance. Son grand-père était secrétaire de Tsolakoglou, Premier ministre sous l’Occupation.
– Je ne comprends pas pourquoi les Allemands ne profitent pas nos conquêtes au lieu de les démolir, s’interroge Kalliopoulos. Ça leur ferait mal s’ils exigeaient un treizième mois eux aussi, au lieu de nous enlever notre quatorzième ?
Je perds la suite de l’analyse comparative entre les facultés intellectuelles réduites des Allemands et notre débrouillardise, car mon portable sonne et j’entends la voix de Dermitzakis.
– Monsieur le commissaire, Guikas veut vous voir d’urgence.
Je monte au cinquième avec mes deux sacs plastiques à moitié pleins, comme si je rentrais du marché.
– Entrez, me dit sa secrétaire, il vous attend impatiemment.
– Tu peux me rendre service, Koula, en distribuant le reste ?
– Bien sûr. Laissez-les moi, je m’en occupe.
Guikas fait les cent pas dans son bureau et ce n’est pas bon signe.
– On est dans le pétrin, me dit-il en s’arrêtant net. Heureusement que le mariage a eu lieu, je t’aurais dit de le reporter, je crois.
– Qu’est-ce qui se passe ?
– On a tué Zissimopoulos.
Lisant dans mon regard, apparemment, il poursuit :
– Son nom ne te dit rien ?
– Non.
– Nikitas Zissimopoulos était le gouverneur de la Banque centrale. C’est lui qui l’a introduite en Bourse et l’a ouverte à l’Europe. À son époque, la banque a fait des profits fabuleux. Il s’est retiré il y a cinq ans, mais les fondations qu’il a posées ont résisté à la dernière crise.
– On l’a tué où ?
– Dans le jardin se sa villa, à Koropi.
– Qui l’a trouvé ?
– Le jardinier. Sa femme est morte il y a deux ans. Ses deux fils vivent à Londres. Le jardinier vient arroser tous les jours tôt le matin. Il a fait prévenir la police de Koropi. Heureusement, le commissaire est malin, il m’a appelé directement. Le secret est gardé, pas de journaliste sur le dos.
– On lui a tiré dessus ?
Bref silence.
– Non. On l’a décapité.
– Quoi ?
– Tu as bien entendu. Voilà pourquoi je te dis, heureusement que les médias ne savent rien.
Et le pistolet, la carabine, le couteau, ou du moins le poison, me dis-je, c’est pour les chiens ? La décapitation est devenue rare dans le monde entier, et a disparu chez nous depuis le temps d’Ali Pacha.
Laissant le cabinet de toilette, je vais voir la cuisine. Sur le marbre, je trouve la bouteille de vodka à moitié vide et dans le placard au-dessus, quatre assiettes, quatre verres, deux tasses, une casserole et des couverts. Tout est nickel, comme si Patsi, la locataire, avait voulu laisser les lieux propres en partant.
À la porte nous trouvons une quadragénaire toute maigre.
– Je suis la propriétaire, déclare-t-elle sans nous saluer. Grigoriadou Eleni.
– Vous pouvez vider l’appartement. Nous n’en avons plus besoin.
C’est ce qu’elle souhaite entendre, je le sais.
– Vassiliki me devait six mois de loyer. À qui je dois les demander, dites-moi, puisqu’elle n’a pas d’héritiers ?
Je juge inutile de lui répondre et commence à descendre l’escalier, suivi de Koula.
– Je vis de mes loyers, je n’ai pas d’autres ressources, crie-t-elle dans mon dos. Qu’est-ce que je dois faire alors ? Me suicider moi aussi ?
– C’est elle que mon père aurait dû épouser, me dit Koula sur le palier du premier étage.
– Pourquoi ?
– Parce que lui aussi ne pense qu’à lui-même. Ma mère, qui s’intéressait aux autres, il l’a tuée.
Dans la rue, sous la pluie fine, des femmes sont rassemblées, silencieuses, qui regardent partir les ambulances. Deux d’entre elles, les bras serrés autour du corps, sanglotent. Nous allons monter dans la Seat lorsque l’une des pleureuses vient vers nous.
– Ketty Sektaridi a été mon institutrice à l’école primaire n°1 d’Egaleo, dit-elle, et les sanglots reprennent. Elle y est restée jusqu’à la retraite. C’était très pauvre ici à l’époque.
– Et maintenant, c’est comment ? lui crie une autre. Mon fils passe la journée devant son écran à chercher comme un fou du boulot sur Internet. Et moi je me dis, qu’est-ce qu’il va faire quand ils nous couperont le téléphone qu’on ne peut plus payer ?
Koula me regarde, puis se tourne vers la pleureuse.
– Je peux vous dire une chose, dit-elle assez fort pour que les autres l’entendent. Aucune d’elles n’a souffert. Elles sont toutes mortes tranquillement dans leur sommeil.
– C’est déjà ça, fait une voix dans le fond.
L’immigré accordéoniste, sous l’auvent d’une quincaillerie, a cessé de jouer et observe la scène.
Je démarre et tourne un peu plus loin à gauche pour prendre la rue Thivon jusqu’à la rue Petrou Ralli. Nous passons devant des poubelles. Deux Noirs, le haut du corps plongé dedans, les fouillent avec frénésie.
À la porte nous trouvons une quadragénaire toute maigre.
– Je suis la propriétaire, déclare-t-elle sans nous saluer. Grigoriadou Eleni.
– Vous pouvez vider l’appartement. Nous n’en avons plus besoin.
C’est ce qu’elle souhaite entendre, je le sais.
– Vassiliki me devait six mois de loyer. À qui je dois les demander, dites-moi, puisqu’elle n’a pas d’héritiers ?
Je juge inutile de lui répondre et commence à descendre l’escalier, suivi de Koula.
– Je vis de mes loyers, je n’ai pas d’autres ressources, crie-t-elle dans mon dos. Qu’est-ce que je dois faire alors ? Me suicider moi aussi ?
– C’est elle que mon père aurait dû épouser, me dit Koula sur le palier du premier étage.
– Pourquoi ?
– Parce que lui aussi ne pense qu’à lui-même. Ma mère, qui s’intéressait aux autres, il l’a tuée.
Dans la rue, sous la pluie fine, des femmes sont rassemblées, silencieuses, qui regardent partir les ambulances. Deux d’entre elles, les bras serrés autour du corps, sanglotent. Nous allons monter dans la Seat lorsque l’une des pleureuses vient vers nous.
– Ketty Sektaridi a été mon institutrice à l’école primaire n°1 d’Egaleo, dit-elle, et les sanglots reprennent. Elle y est restée jusqu’à la retraite. C’était très pauvre ici à l’époque.
– Et maintenant, c’est comment ? lui crie une autre. Mon fils passe la journée devant son écran à chercher comme un fou du boulot sur Internet. Et moi je me dis, qu’est-ce qu’il va faire quand ils nous couperont le téléphone qu’on ne peut plus payer ?
Koula me regarde, puis se tourne vers la pleureuse.
– Je peux vous dire une chose, dit-elle assez fort pour que les autres l’entendent. Aucune d’elles n’a souffert. Elles sont toutes mortes tranquillement dans leur sommeil.
– C’est déjà ça, fait une voix dans le fond.
L’immigré accordéoniste, sous l’auvent d’une quincaillerie, a cessé de jouer et observe la scène.
Je démarre et tourne un peu plus loin à gauche pour prendre la rue Thivon jusqu’à la rue Petrou Ralli. Nous passons devant des poubelles. Deux Noirs, le haut du corps plongé dedans, les fouillent avec frénésie.
En rentrant dans mon bureau, j’ai juste le temps de décrocher.
– Ici le centre d’opérations, monsieur le commissaire. La patrouille nous a prévenus, on a trouvé un mort au Centre olympique.
Le mauvais pressentiment était juste. J’appelle mes collaborateurs. Koula, Vlassopoulos et Dermitzakis arrivent, sans Papadakis, soit qu’il se sente encore étranger, soit qu’il se planque pour éviter les tâches difficiles.
– Koula, appelle Stavropoulos, le médecin légiste, et dis-lui d’aller tout de suite au Centre olympique de Faliro. Préviens aussi Dimitriou de l’Identité judiciaire.
– Un meurtre ?
– Oui.
– Qui est-ce ?
– On ne sait pas officiellement. Selon un appel anonyme, ce serait l’entrepreneur Yerassimos Demertzis. Vlassopoulos et Dermitzakis viennent avec moi. Toi, Koula, tu restes avec Papadakis pour assurer nos arrières.
– Je serai seule. Papadakis ne s’est pas encore pointé.
– Quelle heure est-il ?
– Onze heures.
Les deux autres lui jettent un regard réprobateur.
– Ne me regardez pas comme ça, dit-elle, furieuse. À partir d’aujourd’hui je ne ferme plus les yeux pour personne ! Nous ne sommes pas les bonnes poires qui viennent tous les matins à huit heures, tandis que l’autre nous fait l’honneur de venir quand ça lui chante. Aucun de nous n’est payé. Il n’y a pas que lui.
– Il a fait ça souvent ? dis-je à Dermitzakis.
– Plusieurs fois.
– Et vous ne m’avez rien dit ?
– Voilà, je le dis, répond Koula, tandis que les regards des deux autres expriment leur solidarité professionnelle.
– À notre retour, je veux le voir dans mon bureau. Koula, tu iras sur le Net ramasser tout ce que tu peux trouver sur Yerassimos Demertzis.
L’avenue Vassilissis Sofias est assez encombrée, mais Vlassopoulos met la sirène et nous passons. À Syntagma, nous tombons sur une banderole, à l’endroit où trois ans plus tôt les Indignés avaient déployé la leur déclarant que « La dictature des Colonels continue ». Celle d’aujourd’hui dit : « Aux USA, le Sud a perdu la guerre. Nous la gagnerons. »
– C’est parti pour la guerre ? dit Dermitzakis en riant.
– Ne t’étonne pas si demain tu vois l’armée dans les rues, répond Vlassopoulos.
– Qu’est-ce qu’on aura ? Un nouveau 1940 ?
– Ou une nouvelle dictature, répond sérieusement Vlassopoulos.
– En 40, dis-je à Dermitzakis, nous n’avons pas vaincu les Allemands, mais les Italiens, qui sont du Sud. Quand à un deuxième putsch, oublie. Les chars ne descendront sûrement pas dans la rue.
– Pourquoi ? demande Vlassopoulos.
– La moitié n’a pas de pièces de rechange et l’autre moitié manque de carburant. Donc nous sommes à l’abri, nous surtout, qui aurions été les porteurs d’eau de l’armée.
La circulation dans l’avenue Syngrou est sporadique et nous arrivons en un rien de temps. La voiture de patrouille barre l’entrée du Centre olympique. – Vous le trouverez à côté du gymnase, monsieur le commissaire, me dit le conducteur. Sur un tas d’ordures. Ce n’est pas beau à voir.
Pas besoin de chercher, le tas se voit de loin. Un homme est couché dessus, le visage enfoncé dans les ordures.
J’envoie mes adjoints jeter un coup d’œil aux ruines des installations olympiques et je reste examiner tranquillement le corps.
Je reconnais Yerassimos Demertzis aussitôt, non à son visage, mais aux vêtements. Il les portait lors de la visite à son fils.
Il faut que j’attende Stavropoulos pour me faire une idée, mais même sans lui je vois que la mort a été causée par une blessure : la balle a traversé l’omoplate, puis le cœur avant de ressortir. La mort a dû être immédiate.
Dimitriou de l’Identité judiciaire arrive le premier avec son équipe.
– On cherche quelque chose de précis ?
– La douille. Mais je ne pense pas que vous la trouverez. On a dû le tuer ailleurs et le transporter ici.
Je lui laisse faire son boulot et vais retrouver mes adjoints. Des bâtiments il ne reste que les murs. L’intérieur est vide. Tout ce qui pouvait se revendre a été volé. Il n’y a plus que des sièges cassés, des portes brisées, des filets de but déchirés. Les projecteurs qu’on n’a pas emportés gisent par terre en morceaux. Les débris d’une grandeur passée, qui n’impressionne plus personne : la Grèce entière n’est plus qu’un débris.
– Ici le centre d’opérations, monsieur le commissaire. La patrouille nous a prévenus, on a trouvé un mort au Centre olympique.
Le mauvais pressentiment était juste. J’appelle mes collaborateurs. Koula, Vlassopoulos et Dermitzakis arrivent, sans Papadakis, soit qu’il se sente encore étranger, soit qu’il se planque pour éviter les tâches difficiles.
– Koula, appelle Stavropoulos, le médecin légiste, et dis-lui d’aller tout de suite au Centre olympique de Faliro. Préviens aussi Dimitriou de l’Identité judiciaire.
– Un meurtre ?
– Oui.
– Qui est-ce ?
– On ne sait pas officiellement. Selon un appel anonyme, ce serait l’entrepreneur Yerassimos Demertzis. Vlassopoulos et Dermitzakis viennent avec moi. Toi, Koula, tu restes avec Papadakis pour assurer nos arrières.
– Je serai seule. Papadakis ne s’est pas encore pointé.
– Quelle heure est-il ?
– Onze heures.
Les deux autres lui jettent un regard réprobateur.
– Ne me regardez pas comme ça, dit-elle, furieuse. À partir d’aujourd’hui je ne ferme plus les yeux pour personne ! Nous ne sommes pas les bonnes poires qui viennent tous les matins à huit heures, tandis que l’autre nous fait l’honneur de venir quand ça lui chante. Aucun de nous n’est payé. Il n’y a pas que lui.
– Il a fait ça souvent ? dis-je à Dermitzakis.
– Plusieurs fois.
– Et vous ne m’avez rien dit ?
– Voilà, je le dis, répond Koula, tandis que les regards des deux autres expriment leur solidarité professionnelle.
– À notre retour, je veux le voir dans mon bureau. Koula, tu iras sur le Net ramasser tout ce que tu peux trouver sur Yerassimos Demertzis.
L’avenue Vassilissis Sofias est assez encombrée, mais Vlassopoulos met la sirène et nous passons. À Syntagma, nous tombons sur une banderole, à l’endroit où trois ans plus tôt les Indignés avaient déployé la leur déclarant que « La dictature des Colonels continue ». Celle d’aujourd’hui dit : « Aux USA, le Sud a perdu la guerre. Nous la gagnerons. »
– C’est parti pour la guerre ? dit Dermitzakis en riant.
– Ne t’étonne pas si demain tu vois l’armée dans les rues, répond Vlassopoulos.
– Qu’est-ce qu’on aura ? Un nouveau 1940 ?
– Ou une nouvelle dictature, répond sérieusement Vlassopoulos.
– En 40, dis-je à Dermitzakis, nous n’avons pas vaincu les Allemands, mais les Italiens, qui sont du Sud. Quand à un deuxième putsch, oublie. Les chars ne descendront sûrement pas dans la rue.
– Pourquoi ? demande Vlassopoulos.
– La moitié n’a pas de pièces de rechange et l’autre moitié manque de carburant. Donc nous sommes à l’abri, nous surtout, qui aurions été les porteurs d’eau de l’armée.
La circulation dans l’avenue Syngrou est sporadique et nous arrivons en un rien de temps. La voiture de patrouille barre l’entrée du Centre olympique. – Vous le trouverez à côté du gymnase, monsieur le commissaire, me dit le conducteur. Sur un tas d’ordures. Ce n’est pas beau à voir.
Pas besoin de chercher, le tas se voit de loin. Un homme est couché dessus, le visage enfoncé dans les ordures.
J’envoie mes adjoints jeter un coup d’œil aux ruines des installations olympiques et je reste examiner tranquillement le corps.
Je reconnais Yerassimos Demertzis aussitôt, non à son visage, mais aux vêtements. Il les portait lors de la visite à son fils.
Il faut que j’attende Stavropoulos pour me faire une idée, mais même sans lui je vois que la mort a été causée par une blessure : la balle a traversé l’omoplate, puis le cœur avant de ressortir. La mort a dû être immédiate.
Dimitriou de l’Identité judiciaire arrive le premier avec son équipe.
– On cherche quelque chose de précis ?
– La douille. Mais je ne pense pas que vous la trouverez. On a dû le tuer ailleurs et le transporter ici.
Je lui laisse faire son boulot et vais retrouver mes adjoints. Des bâtiments il ne reste que les murs. L’intérieur est vide. Tout ce qui pouvait se revendre a été volé. Il n’y a plus que des sièges cassés, des portes brisées, des filets de but déchirés. Les projecteurs qu’on n’a pas emportés gisent par terre en morceaux. Les débris d’une grandeur passée, qui n’impressionne plus personne : la Grèce entière n’est plus qu’un débris.
Si tous les Grecs victimes de la bureaucratie devenaient des assassins, le pays perdrait la moitié de sa population. Évidemment, Nassiotis est plutôt allemand, et je crois notre bureaucratie tout à fait capable de faire d’un allemand un assassin.
Ce n'est pas drôle de voir l'opinion publique maintenue dans l'ignorance et l'obscurité, alors qu'un assassin agit impunément. Ce n'est pas drôle non plus de voir les médias informés par l'assassin lui-même et non par les agents de l'Etat concerné.
Généralement, je préfère les promenades nocturnes à Athènes, surtout l'été. Cela peut paraître étrange, mais Athènes est bien plus belle sous les lumières de la nuit. Elle acquiert alors quelque chose de doux, de presque idyllique par moments, qu'elle perd au lever du jour.
- Tes imbéciles de compatriotes ont lancé une bombe dans la maison d’Ataturk à Thessalonique.
Vassilis n’arrivait pas à parler. Il se contentait de hocher la tête, entre indignation et abattement.
- Je ne sais pas ce qui me fait le plus enrager, continua le commissaire. La bombe qu’ils ont lancé dans la maison natale du fondateur de la République turque ou de devoir passer toute la nuit dehors pour tenter de contenir la foule en colère.
Trois jours.
Vassilis n’arrivait pas à parler. Il se contentait de hocher la tête, entre indignation et abattement.
- Je ne sais pas ce qui me fait le plus enrager, continua le commissaire. La bombe qu’ils ont lancé dans la maison natale du fondateur de la République turque ou de devoir passer toute la nuit dehors pour tenter de contenir la foule en colère.
Trois jours.
- Mon oncle avait deux visages, monsieur le commissaire. Un pour sa famille et un pour les étrangers. Avec les étrangers, toujours amical et poli. Avec sa famille, vaniteux et prétentieux. C’était pareil avec ma tante. Devant les étrangers, il était tout miel avec elle. Mais une fois seuls, il n’arrêtait pas de l’humilier du matin au soir.
L’assassinat d’un Immortel.
L’assassinat d’un Immortel.
Ces arguments ont un fond de vérité. C'est vrai, de nombreux chefs d'entreprises transfèrent leur siège social dans des paradis fiscaux pour éviter de payer des impôts. C'est vrai il y a un écart énorme entre le niveau d'instruction des jeunes d'aujourd'hui et les salaires de misère qu'ils touchent. C'est vrai, de nombreux chefs d'entreprise licencient les employés âgés et bien payés pour embaucher des jeunes qui leur coûtent moins chers. C'est vrai aussi que ces jeunes que ces jeunes sont considérés partout comme des travailleurs alors que leurs salaires suffisent à peine pour payer leur loyer et leurs repas. C'est vrai enfin que quand l'économie va mieux, les profits vont dans la poche des riches et les autres n'y gagnent rien.
Qu'est-ce qu'on a eu après la Guerre civile ? demanda t-il au lieu de commenter.
- Tu le sais. La pauvreté, la misère, vous d'un côté, nous de l'autre, et la haine partout.
- On avait aussi autre chose.
- Quoi?
- L’État parallèle. Et voilà qu'il revient, Kostas. Sauf que l'Etat parallèle aujourd'hui n'est pas installé par les politiques, pour terroriser les gens comme nous qui ne sont pas de leur bord. Il sort des entrailles de la crise. Ta fille est l'une de ses victimes et certains de tes confrères le soutiennent, comme autrefois.
- Tu le sais. La pauvreté, la misère, vous d'un côté, nous de l'autre, et la haine partout.
- On avait aussi autre chose.
- Quoi?
- L’État parallèle. Et voilà qu'il revient, Kostas. Sauf que l'Etat parallèle aujourd'hui n'est pas installé par les politiques, pour terroriser les gens comme nous qui ne sont pas de leur bord. Il sort des entrailles de la crise. Ta fille est l'une de ses victimes et certains de tes confrères le soutiennent, comme autrefois.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Pétros Márkaris
Quiz
Voir plus
Mots dont la signification secondaire n'a rien à voir avec la première ...
Carabin : 1) Soldat de la cavalerie légère
2) Étudiant en kinésithérapie
2) Étudiant en architecture
2) Étudiant en médecine
6 questions
41 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur41 lecteurs ont répondu