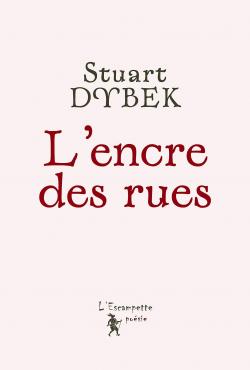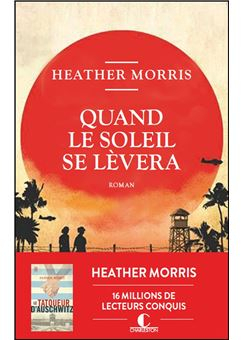Stuart Dybek/5
3 notes
Résumé :
L’Encre des rues est la première traduction intégrale d’un recueil de poèmes paru en 2004 aux États-Unis. Le foisonnement de thèmes (souvenirs d’enfance, misère et violence urbaine, premières amours, philosophie et religion) et de tonalités (lyrisme, humour, cruauté) mène Stuart Dybek à développer une écriture poétique d’une incessante inventivité. Profondeur humaine, nostalgie mais aussi combat pour exister dans le monde contemporain, font toute la richesse de ce r... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'encre des ruesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (3)
Ajouter une critique
DU FOISONNEMENT DES SOUVENIRS...
Il existe des éditeurs, méconnus du grand public, rares, modestes et géniaux, dans leur présentation douce, leurs formats inhabituels, leur catalogue, surtout, leur "fonds" comme on le disait encore en des temps pas si lointain où le monde de l'édition n'était pas seulement obnubilée par le prochain "coup littéraire", par l'énorme succès à venir, par LE texte à lire aujourd'hui (parce que, bien souvent, demain c'est trop tard et que ça n'en vaut plus franchement la peine. Bien évidemment, le monde patient et marginal de la poésie, ses ventes frisant le dérisoire selon la tyrannie des chiffres et des volumes, permet, paradoxalement, de demeurer tels des phares au beau milieu des tempêtes de papier noircis d'encres, et de se ficher comme d'un guigne de cette suractivité de l'instant, cette dictature des modes et de l'Evénement.
Il existe des éditeurs tranquillement agissant, plusieurs décennies durant, qui jamais ne perdent le cap, quelles que soient les difficultés, quels que soient les drames. Assurément, les éditions de l'Escampette sont de ceux-là et c'est vraiment avec un plaisir immense que l'humble lecteur que je suis se retrouve avec l'un de leurs ouvrages - une petite merveille - parmi les plus récents : L'encre des rues de l'américain Stuart Dybek. Cette mise en jambe en forme d'hommage mille fois sincère d'un simple (mais assidu) lecteur en direction d'une bien belle maison d'édition poitevine afin de les remercier chaleureusement de l'envoi du recueil sus-cité à l'occasion de la Masse Critique du mois de Janvier organisée par notre irremplaçable Babelio.com !
C'est ici que furent confectionnés
les vêtements que l'on porte en rêves fugitifs
manteaux planant à la manière de cerfs-volants,
écharpes filant à l'horizon comme des traînes de vapeur,
robes gonflées telles les spinnakers d'un voilier.
C'est par les cinq vers de cette première strophe d'un poème intitulé La Cité des vents, c'est à dire le Chicago de son enfance, le Chicago des premiers émois, le Chicago de la misère, celui de sa grand-mère, celui des communautés, des rues borgnes et des violences quotidiennes, le Chicago des pauvres, le Chicago en friches, parfois, plus subrepticement, le Chicago inaccessible des riches... mais n'allons pas trop vite en besogne ! Cinq vers, libres comme le vent, afin de donner le ton de cette longue et lente remontée dans le temps d'avant, les souvenirs fragiles et profonds malgré tout, ceux par lesquels on avance en lignes plus ou moins droites, à coup de rêves ou de modernité.
Immédiatement après cette mise à l'eau maritime, c'est par une belle tentative d'autobiographie poétique que ce poète américain, né à Chicago dans une famille d'immigrés polonais, se dévoile un peu. «Je n'ai rien voulu oublier» nous affirme-t-il, et c'est d'ailleurs bien souvent à un indispensable exercice de remembrance que Stuart Dybek nous convie, de choses vues plutôt qu'entendues (quoique) :
Ce qui a pu être dit
fut abandonné comme excédent de bagages,
(...)
Il convoque ainsi toutes sortes de moments particulièrement forts en images tour à tour tristes, décalées, tendues, sordides, émouvantes, sombres, tendres, violentes mais sans lyrisme faux, sans euphémisation inutile de l'existence, sans prendre de gant ni de pose ni de faux-semblants. Ce sont des moments de vie crue, féroce, aussi véridiques que possibles, traversés bien souvent d'un amour véritable à l'égard de ce humbles dont il nous dresse le portrait, que ce soit à travers cet acte si simple et si attachant d'une mère épongeant son enfant au sortir du bain ou ce premier baiser que se donnent deux adolescents découvrant les vertiges amoureux, ou encore ce détail aussi anodin que tragique du jeune homme se rendant compte que son oncle va être enterré sans ses «shosea» (lire chaussures : le mot entremêle anglais et polonais), ou, plus loin, décrivant des instants d'amours tarifées... On y trouve aussi beaucoup d'objets ou d'animaux a priori insignifiants mais qui font sens, de manière viscérale, dans l'esprit du poète. Ainsi de ces cabines téléphoniques qui ont, comme partout ailleurs, presque intégralement disparues avec l'arrivée foudroyante des téléphones portables ; plus loin, ce ne sont que quelques abeilles visibles dans l'une de ces innombrables friches que compte Chicago, au point qu'on peut pour ainsi dire parler de campagne à la ville, ou bien une nuée d'oiseaux ; plus tard, c'est un bas nylon, promesse d'un corps par lui habillé ou d'une mort par strangulation ; le temps d'après, il est temps de prier vêpres...
Aussi crue et bouleversante que soit la poésie de Stuart Dybek, jamais elle ne cède à la facilité, jamais, non plus, à la vulgarité ni à un déferlement de violence explosive. Bien plus efficace que quelque cri de haine ou de désespoir, c'est dans les interstices que le poète affirme la brutalité et la douleur de ces vies souvent brisées, désenchantées, languides des quartiers pauvres qui forment l'essentiel de ses souvenirs :
Un homme sort de la lumière au soleil,
une lumière qui ruisselle comme la grâce,
les yeux encore écarquillés vers l'azur
accroché au travers du vide de l'espace,
il entre dans un silence
qui commença par un sanglot
traînant encore un reste de musique
bien que réduit au soupir
d'un accordéon
que l'on replie dans son étui.
On se laisse peu à peu gagner par cette lecture subtile des émotions, par ce train-train quotidien où des drames d'apparence insignifiante se jouent sans cesse, pour peu que l'on soit attentif, le regard en alerte, l'ouïe à la recherche de cette petite musique insidieuse des villes - un angélus, «le pizzicato d'ailes contre les moustiquaires», la «voix de soprano» des fourgons de police qui «atteignait la perfection du cristal» -, alors que c'est en silence que le poète sait qu'il peut balancer entre deux alternatives :
Comme le savent les rêveurs, il est possible
de se précipiter en silence vers le désastre
tout comme vers le désir.
Bien souvent, il vient au lecteur que Stuart Dybek lui propose une sorte d'étrange et passionnant «Je me souviens» mais, a contrario du texte bien connu de Georges Pérec portant ce titre, les récurrences du chicagoan sont tout à la fois très intimes et très engageantes, bien que par une sincère modestie, il s'en défende, estimant son «histoire inachevée racontée en une prose de liste d'épicier»... On en est pourtant très éloignée, d'une telle prétendue liste, même si c'est l'effet que lui inspire ce retour indispensable sur lui-même et les images de son passé à l'orée de l'ultime et bouleversant poème d'une série de neuf textes intitulés - comme s'il devait s'excuser auprès du lecteur de lui avoir infligé une "autobiographie" en introduction - : Anti-mémoire !
Mais nous ne le suivrons pas sur ce terrain, bien qu'il y développe aussi l'impossibilité qu'ont les mots de tout exprimer, «l'oublié, l'irrachetable, l'ordinaire», car une fois posé ce court, affreusement trop court, recueil, on se prend soi-même au jeu tout aussi bien délicieux que tragique de la souvenance et de la nostalgie, même s'il est vain de tâcher d'oublier cette antienne universelle, que cette belle composition autour du temps qui passe et jamais ne revient :
dans la nuit des villes
la règle est toujours : continue d'avancer.
Et le lecteur parcouru de sentiments et d'impressions tendus comme la corde d'un arc de laisser couler dans ses veines le parfum saisissant de L'encre des rues...
Il existe des éditeurs, méconnus du grand public, rares, modestes et géniaux, dans leur présentation douce, leurs formats inhabituels, leur catalogue, surtout, leur "fonds" comme on le disait encore en des temps pas si lointain où le monde de l'édition n'était pas seulement obnubilée par le prochain "coup littéraire", par l'énorme succès à venir, par LE texte à lire aujourd'hui (parce que, bien souvent, demain c'est trop tard et que ça n'en vaut plus franchement la peine. Bien évidemment, le monde patient et marginal de la poésie, ses ventes frisant le dérisoire selon la tyrannie des chiffres et des volumes, permet, paradoxalement, de demeurer tels des phares au beau milieu des tempêtes de papier noircis d'encres, et de se ficher comme d'un guigne de cette suractivité de l'instant, cette dictature des modes et de l'Evénement.
Il existe des éditeurs tranquillement agissant, plusieurs décennies durant, qui jamais ne perdent le cap, quelles que soient les difficultés, quels que soient les drames. Assurément, les éditions de l'Escampette sont de ceux-là et c'est vraiment avec un plaisir immense que l'humble lecteur que je suis se retrouve avec l'un de leurs ouvrages - une petite merveille - parmi les plus récents : L'encre des rues de l'américain Stuart Dybek. Cette mise en jambe en forme d'hommage mille fois sincère d'un simple (mais assidu) lecteur en direction d'une bien belle maison d'édition poitevine afin de les remercier chaleureusement de l'envoi du recueil sus-cité à l'occasion de la Masse Critique du mois de Janvier organisée par notre irremplaçable Babelio.com !
C'est ici que furent confectionnés
les vêtements que l'on porte en rêves fugitifs
manteaux planant à la manière de cerfs-volants,
écharpes filant à l'horizon comme des traînes de vapeur,
robes gonflées telles les spinnakers d'un voilier.
C'est par les cinq vers de cette première strophe d'un poème intitulé La Cité des vents, c'est à dire le Chicago de son enfance, le Chicago des premiers émois, le Chicago de la misère, celui de sa grand-mère, celui des communautés, des rues borgnes et des violences quotidiennes, le Chicago des pauvres, le Chicago en friches, parfois, plus subrepticement, le Chicago inaccessible des riches... mais n'allons pas trop vite en besogne ! Cinq vers, libres comme le vent, afin de donner le ton de cette longue et lente remontée dans le temps d'avant, les souvenirs fragiles et profonds malgré tout, ceux par lesquels on avance en lignes plus ou moins droites, à coup de rêves ou de modernité.
Immédiatement après cette mise à l'eau maritime, c'est par une belle tentative d'autobiographie poétique que ce poète américain, né à Chicago dans une famille d'immigrés polonais, se dévoile un peu. «Je n'ai rien voulu oublier» nous affirme-t-il, et c'est d'ailleurs bien souvent à un indispensable exercice de remembrance que Stuart Dybek nous convie, de choses vues plutôt qu'entendues (quoique) :
Ce qui a pu être dit
fut abandonné comme excédent de bagages,
(...)
Il convoque ainsi toutes sortes de moments particulièrement forts en images tour à tour tristes, décalées, tendues, sordides, émouvantes, sombres, tendres, violentes mais sans lyrisme faux, sans euphémisation inutile de l'existence, sans prendre de gant ni de pose ni de faux-semblants. Ce sont des moments de vie crue, féroce, aussi véridiques que possibles, traversés bien souvent d'un amour véritable à l'égard de ce humbles dont il nous dresse le portrait, que ce soit à travers cet acte si simple et si attachant d'une mère épongeant son enfant au sortir du bain ou ce premier baiser que se donnent deux adolescents découvrant les vertiges amoureux, ou encore ce détail aussi anodin que tragique du jeune homme se rendant compte que son oncle va être enterré sans ses «shosea» (lire chaussures : le mot entremêle anglais et polonais), ou, plus loin, décrivant des instants d'amours tarifées... On y trouve aussi beaucoup d'objets ou d'animaux a priori insignifiants mais qui font sens, de manière viscérale, dans l'esprit du poète. Ainsi de ces cabines téléphoniques qui ont, comme partout ailleurs, presque intégralement disparues avec l'arrivée foudroyante des téléphones portables ; plus loin, ce ne sont que quelques abeilles visibles dans l'une de ces innombrables friches que compte Chicago, au point qu'on peut pour ainsi dire parler de campagne à la ville, ou bien une nuée d'oiseaux ; plus tard, c'est un bas nylon, promesse d'un corps par lui habillé ou d'une mort par strangulation ; le temps d'après, il est temps de prier vêpres...
Aussi crue et bouleversante que soit la poésie de Stuart Dybek, jamais elle ne cède à la facilité, jamais, non plus, à la vulgarité ni à un déferlement de violence explosive. Bien plus efficace que quelque cri de haine ou de désespoir, c'est dans les interstices que le poète affirme la brutalité et la douleur de ces vies souvent brisées, désenchantées, languides des quartiers pauvres qui forment l'essentiel de ses souvenirs :
Un homme sort de la lumière au soleil,
une lumière qui ruisselle comme la grâce,
les yeux encore écarquillés vers l'azur
accroché au travers du vide de l'espace,
il entre dans un silence
qui commença par un sanglot
traînant encore un reste de musique
bien que réduit au soupir
d'un accordéon
que l'on replie dans son étui.
On se laisse peu à peu gagner par cette lecture subtile des émotions, par ce train-train quotidien où des drames d'apparence insignifiante se jouent sans cesse, pour peu que l'on soit attentif, le regard en alerte, l'ouïe à la recherche de cette petite musique insidieuse des villes - un angélus, «le pizzicato d'ailes contre les moustiquaires», la «voix de soprano» des fourgons de police qui «atteignait la perfection du cristal» -, alors que c'est en silence que le poète sait qu'il peut balancer entre deux alternatives :
Comme le savent les rêveurs, il est possible
de se précipiter en silence vers le désastre
tout comme vers le désir.
Bien souvent, il vient au lecteur que Stuart Dybek lui propose une sorte d'étrange et passionnant «Je me souviens» mais, a contrario du texte bien connu de Georges Pérec portant ce titre, les récurrences du chicagoan sont tout à la fois très intimes et très engageantes, bien que par une sincère modestie, il s'en défende, estimant son «histoire inachevée racontée en une prose de liste d'épicier»... On en est pourtant très éloignée, d'une telle prétendue liste, même si c'est l'effet que lui inspire ce retour indispensable sur lui-même et les images de son passé à l'orée de l'ultime et bouleversant poème d'une série de neuf textes intitulés - comme s'il devait s'excuser auprès du lecteur de lui avoir infligé une "autobiographie" en introduction - : Anti-mémoire !
Mais nous ne le suivrons pas sur ce terrain, bien qu'il y développe aussi l'impossibilité qu'ont les mots de tout exprimer, «l'oublié, l'irrachetable, l'ordinaire», car une fois posé ce court, affreusement trop court, recueil, on se prend soi-même au jeu tout aussi bien délicieux que tragique de la souvenance et de la nostalgie, même s'il est vain de tâcher d'oublier cette antienne universelle, que cette belle composition autour du temps qui passe et jamais ne revient :
dans la nuit des villes
la règle est toujours : continue d'avancer.
Et le lecteur parcouru de sentiments et d'impressions tendus comme la corde d'un arc de laisser couler dans ses veines le parfum saisissant de L'encre des rues...
Merci Babelio Masse Critique et les éditions L'Escampette pour l'envoi de ce recueil de poésie d'un auteur que je ne connaissais pas du tout.
J'ai trouvé page 51 la phrase qui selon moi symbolise cette poésie
"dans la nuit des villes
la règle est toujours : continue d'avancer"
Dybek est un auteur de la pop génération et de la pop culture. Né en 1942.
Il nous offre ces poèmes en prose tirés de ses souvenirs de la rue à Chicago, teintés de ses origines polonaises.
On y retrouve en vrac, les bruits de la ville, les parties de pêche dans les étangs des friches alentours, le blues des prostituées " (...) les prostituées avaient le blues à force de fréquenter la police". Tout ce qui a fait son quotidien alors qu'il n'était pas encore un homme fini.
Une poésie réminiscente de certaines chansons de Bob Dylan (Memphis Blues Again par exemple) ou encore des poésies de Leonard Cohen.
Dybek joue avec les mots comme ses ancêtre polonais transformaient les mots pour leur donner une consonnance polonaise, en déclinant les mots anglais le plus souvent en leur rajoutant un a comme dans shoesa pour les chaussures.
Son enfance "polonaise" sous la férule de sa grand-mère, la babushka, adoratrice de la vierge noire de Częstochowa imprègne la symbolique de sa poésie.
Il parcourt la ville à une époque où l'on se souciait peu d'environnement et de pollution, encore moins de sécurité au travail :
"L'air avait une odeur naturelle de cendre",
"je vénérais déjà la nature environnante comme un immigrant"
Dans les friches encerclant la ville "la zone à l'écart où les jeunes se retouvent, où les lièvres ont établi leur sanctuaire.", dans les rues, ça castagne parfois "Oncle Chino (...) disait avoir apperçu un regard (...) provenant du visage difforme que lui renvoyait amoureusement l'enjoliveur éclaboussé de sang"
L'amour n'est pas absent de ces poèmes, un amour encore en recherche, un amour fait de doutes adolescents, brut et brutal, soudain, caché, refoulé, mystérieux, quasi religieux :
"la petite robe d'été déboutonnée glissa au bas de ses reins sur une caisse de bouteilles vides"
"une femme en combinaison de satin et les géraniums qu'elle arrose se transforment en or"
"se précipiter en silence vers le désastre tout comme vers le désir"
"la plus charmante émotion que tu inspires reste évasive : la lumière qui traverse une figurine en verre"
(ils)"se laissent un moment abuser pensant que c'est une fille à l'étage qui leur fait signe"
"c'est la première fois que quelqu'un la paye pour la prendre en photo"
"n'importe qui pourrait juste décider de la payer pour baiser"
"pense à tous ces coeurs brisés, dit-elle, en laissant tomber son soutien-gorge"
Cela ne pourrait être qu'un rêve décide-t-il : "des lèvres planantes descendaient tout le long de son corps" ; "lobe des oreilles familiers avec leur goût de perles" ; "se demandant s'il doit la réveiller gentiment de la langue, ou la laisser dormir"
"je fus certain de reconnaître l'empreinte des lèvres de cette fille sur ses pieds blessés"
De belles images surréalistes traversent ces poèmes : "Les dormeurs tirent le plafond vers le bas pour s'en faire un édredon" ; "il entre dans une histoire où les ombres empruntent un visage humain" ; "j'ai essayé de payer une guirlande de saucisses avec un chapelet"
Une poésie du quotidien, d'un quotidien emporté par le passé et désormais perdu.
Lien : https://camalonga.wordpress...
J'ai trouvé page 51 la phrase qui selon moi symbolise cette poésie
"dans la nuit des villes
la règle est toujours : continue d'avancer"
Dybek est un auteur de la pop génération et de la pop culture. Né en 1942.
Il nous offre ces poèmes en prose tirés de ses souvenirs de la rue à Chicago, teintés de ses origines polonaises.
On y retrouve en vrac, les bruits de la ville, les parties de pêche dans les étangs des friches alentours, le blues des prostituées " (...) les prostituées avaient le blues à force de fréquenter la police". Tout ce qui a fait son quotidien alors qu'il n'était pas encore un homme fini.
Une poésie réminiscente de certaines chansons de Bob Dylan (Memphis Blues Again par exemple) ou encore des poésies de Leonard Cohen.
Dybek joue avec les mots comme ses ancêtre polonais transformaient les mots pour leur donner une consonnance polonaise, en déclinant les mots anglais le plus souvent en leur rajoutant un a comme dans shoesa pour les chaussures.
Son enfance "polonaise" sous la férule de sa grand-mère, la babushka, adoratrice de la vierge noire de Częstochowa imprègne la symbolique de sa poésie.
Il parcourt la ville à une époque où l'on se souciait peu d'environnement et de pollution, encore moins de sécurité au travail :
"L'air avait une odeur naturelle de cendre",
"je vénérais déjà la nature environnante comme un immigrant"
Dans les friches encerclant la ville "la zone à l'écart où les jeunes se retouvent, où les lièvres ont établi leur sanctuaire.", dans les rues, ça castagne parfois "Oncle Chino (...) disait avoir apperçu un regard (...) provenant du visage difforme que lui renvoyait amoureusement l'enjoliveur éclaboussé de sang"
L'amour n'est pas absent de ces poèmes, un amour encore en recherche, un amour fait de doutes adolescents, brut et brutal, soudain, caché, refoulé, mystérieux, quasi religieux :
"la petite robe d'été déboutonnée glissa au bas de ses reins sur une caisse de bouteilles vides"
"une femme en combinaison de satin et les géraniums qu'elle arrose se transforment en or"
"se précipiter en silence vers le désastre tout comme vers le désir"
"la plus charmante émotion que tu inspires reste évasive : la lumière qui traverse une figurine en verre"
(ils)"se laissent un moment abuser pensant que c'est une fille à l'étage qui leur fait signe"
"c'est la première fois que quelqu'un la paye pour la prendre en photo"
"n'importe qui pourrait juste décider de la payer pour baiser"
"pense à tous ces coeurs brisés, dit-elle, en laissant tomber son soutien-gorge"
Cela ne pourrait être qu'un rêve décide-t-il : "des lèvres planantes descendaient tout le long de son corps" ; "lobe des oreilles familiers avec leur goût de perles" ; "se demandant s'il doit la réveiller gentiment de la langue, ou la laisser dormir"
"je fus certain de reconnaître l'empreinte des lèvres de cette fille sur ses pieds blessés"
De belles images surréalistes traversent ces poèmes : "Les dormeurs tirent le plafond vers le bas pour s'en faire un édredon" ; "il entre dans une histoire où les ombres empruntent un visage humain" ; "j'ai essayé de payer une guirlande de saucisses avec un chapelet"
Une poésie du quotidien, d'un quotidien emporté par le passé et désormais perdu.
Lien : https://camalonga.wordpress...
Comme il est d'usage, je voudrais dans un premier temps remercier Babelio et l'Escampette pour cette masse critique. Je ne suis pas un grand lecteur de vers. Bien entendu, j'ai une culture classique et j'aime bien quelques poèmes qui remontent au lycée ou aux efforts de mémoire de mes grands mères. Pourtant, le titre de ce livre m'a attiré inexplicablement.
Je ne connaissais pas Stuart Dybek, mais je vais me renseigner sur ses autres textes. C'est étrange, je ne suis pas un urbain et pourtant cette poésie me parle. Comme le titre l'indique elle parle des rues de la mégapole de l'Illinois. Il y a même parfois un côté Gotham.
Je ne sais pas si la classification existe, mais je rangerais ce livre comme poésie autobiogrphique. Il s'agit d'un florilège d'instants mis en vers. Il y a du rugueux, du douloureux, du malsain, mais aussi du beau. Bref, c'est la vision d'un enfant de l'immigration devenu un grand intellectuel. Pour être un grand poète, il doit falloir être à la marge d'un monde.
Il ne doit pas être évident de traduire de la poésie, pourtant Philippe Niger parvient admirablement à rendre compte des atmosphères de chaque texte. Bien entendu, il faudrait sans doute que je consulte les versions originales.
Cette lecture fût une belle découverte.
Je ne connaissais pas Stuart Dybek, mais je vais me renseigner sur ses autres textes. C'est étrange, je ne suis pas un urbain et pourtant cette poésie me parle. Comme le titre l'indique elle parle des rues de la mégapole de l'Illinois. Il y a même parfois un côté Gotham.
Je ne sais pas si la classification existe, mais je rangerais ce livre comme poésie autobiogrphique. Il s'agit d'un florilège d'instants mis en vers. Il y a du rugueux, du douloureux, du malsain, mais aussi du beau. Bref, c'est la vision d'un enfant de l'immigration devenu un grand intellectuel. Pour être un grand poète, il doit falloir être à la marge d'un monde.
Il ne doit pas être évident de traduire de la poésie, pourtant Philippe Niger parvient admirablement à rendre compte des atmosphères de chaque texte. Bien entendu, il faudrait sans doute que je consulte les versions originales.
Cette lecture fût une belle découverte.
Citations et extraits (4)
Ajouter une citation
Anti-mémoire
9
Un agenda de somnambule, prière
qui précède le temps enregistré, la tradition orale
présumée des quartiers illettrés
où les noms riment
et où le confessionnal t'appelle
sur le dernier téléphone public en service. Réponds,
et une voix étrangère te révélera des secrets
qui ont manqué à ton identité,
ton histoire achevé racontée
en une prose de liste d'épicier -
l'oublié, l'irrachetable,
l'ordinaire, ni vrai, ni faux,
qu'on ne peut pas plus comptabiliser que l'amour.
Par-dessus la lumière vacillante au coin de la rue
flamboie le symbole d'un hibou
dans un silence impossible à écrire.
Seul, le long d'une rue qui ressemble
soudain à toute autre, tu es béni
afin de simplement poursuivre
une autre marche de nuit vers chez toi.
9
Un agenda de somnambule, prière
qui précède le temps enregistré, la tradition orale
présumée des quartiers illettrés
où les noms riment
et où le confessionnal t'appelle
sur le dernier téléphone public en service. Réponds,
et une voix étrangère te révélera des secrets
qui ont manqué à ton identité,
ton histoire achevé racontée
en une prose de liste d'épicier -
l'oublié, l'irrachetable,
l'ordinaire, ni vrai, ni faux,
qu'on ne peut pas plus comptabiliser que l'amour.
Par-dessus la lumière vacillante au coin de la rue
flamboie le symbole d'un hibou
dans un silence impossible à écrire.
Seul, le long d'une rue qui ressemble
soudain à toute autre, tu es béni
afin de simplement poursuivre
une autre marche de nuit vers chez toi.
Autobiographie
7
Quand on grandit dans la rébellion,
les morts s'évanouissent lentement.
Peut-être réapparaissent-ils plus tard.
Il m'arrive encore de percevoir des bribes de souvenirs
de cette paroisse de fantômes
aux frontières de l'enfance - des esprits
enfermés dans une mazurka avec un crucifix,
des rumeurs échappées d'un confessionnal,
des pas dans l'eau d'un caniveau sous l'éclairage des rues
comme si, au lieu des saletés du dégel d'avril, du sang
tourbillonnait autour des galoches noires.
7
Quand on grandit dans la rébellion,
les morts s'évanouissent lentement.
Peut-être réapparaissent-ils plus tard.
Il m'arrive encore de percevoir des bribes de souvenirs
de cette paroisse de fantômes
aux frontières de l'enfance - des esprits
enfermés dans une mazurka avec un crucifix,
des rumeurs échappées d'un confessionnal,
des pas dans l'eau d'un caniveau sous l'éclairage des rues
comme si, au lieu des saletés du dégel d'avril, du sang
tourbillonnait autour des galoches noires.
Sous une lune en plein jour, la clocharde
Que les enfants appelaient Harpie
farfouillait, pliée en deux sous la bosse
qu'elle traînait partout.
Eût-elle été la Déesse de la Chasse,
éternellement jeune, souple comme un arc, à demi-nue,
la cascade dorée de son chignon défait
aurait masqué son humble nudité.
Au lieu de cela, un torrent gris de cheveux emmêlés
(le grotesque peut-être l'œuvre de toute une vie)
balayait le trottoir précédent chacun de ses pas.
Une meute de chiens courait, l'aidant à frayer son passage.
Son porte-monnaie cabossé en paille se balançait fièrement,
pendu à la gueule d'un basset blanc, crasseux et bâtard.
Que les enfants appelaient Harpie
farfouillait, pliée en deux sous la bosse
qu'elle traînait partout.
Eût-elle été la Déesse de la Chasse,
éternellement jeune, souple comme un arc, à demi-nue,
la cascade dorée de son chignon défait
aurait masqué son humble nudité.
Au lieu de cela, un torrent gris de cheveux emmêlés
(le grotesque peut-être l'œuvre de toute une vie)
balayait le trottoir précédent chacun de ses pas.
Une meute de chiens courait, l'aidant à frayer son passage.
Son porte-monnaie cabossé en paille se balançait fièrement,
pendu à la gueule d'un basset blanc, crasseux et bâtard.
Le courant
Le troisième rail du métro
Et la chaise électrique
Sont chargés du même courant
Qui se soir embrase
La lampe de chevet
Qui illumine ton corps.
P.44
Le troisième rail du métro
Et la chaise électrique
Sont chargés du même courant
Qui se soir embrase
La lampe de chevet
Qui illumine ton corps.
P.44
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Livres les plus populaires de la semaine
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Stuart Dybek (3)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Testez vos connaissances en poésie ! (niveau difficile)
Dans quelle ville Verlaine tira-t-il sur Rimbaud, le blessant légèrement au poignet ?
Paris
Marseille
Bruxelles
Londres
10 questions
1226 lecteurs ont répondu
Thèmes :
poésie
, poèmes
, poètesCréer un quiz sur ce livre1226 lecteurs ont répondu