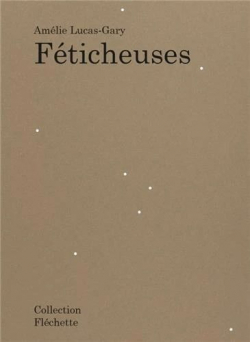>
Critique de Charybde2
Une photographie prise au Dahomey en 1930. Et ce qu'elle peut déclencher de manière volontaire et involontaire. Beaucoup plus qu'un magnifique exercice de style sous contrainte.
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2024/02/26/note-de-lecture-feticheuses-amelie-lucas-gary/
Fléchette est une collection conçue par Céline Pévrier et Adrien Genoudet aux éditions sun/sun, éditions à qui l'on devait déjà bien des textes étonnants (que l'on songe par exemple aux brefs, denses et flamboyants « Il paraît que nous sommes en guerre » de Pierre Terzian, « Et seuls les chiens répondent à ta voix » de Tarik Noui, et « le noir dedans » de Thomas Vinau, ou bien au plus ample mais tout aussi décapant « le dernier cri », de Pierre Terzian à nouveau).
Fléchette, en étroite association avec les Archives de la Planète, entreprise de documentation visuelle conduite par le mécène passionné Albert Kahn entre 1909 et 1931, propose à une sélection d'autrices et d'auteurs de s'emparer d'une seule parmi les quelque 72 000 images autochromes du fonds conservé à Boulogne-Billancourt, dans la maison même du banquier, devenue musée départemental, et d'imaginer à partir de cette image un texte d'une petite cinquantaine de pages, à leur entière discrétion quant au registre à choisir, essai, document, poème ou nouvelle. Après Philippe Artières, Hélène Gaudy, Marie-Hélène Lafon et Fanny Taillandier en 2022, Amélie Lucas-Gary est l'une des quatre autrices et auteurs à qui s'est vu proposer l'exercice en 2023, pour publication en novembre de la même année.
Que ce soit dans ses saisissants romans, « Grotte » (2014), « Vierge » (2017) et « Hic » (2020), ou dans des travaux plus courts à l'étrange et rusé détour poétique, « Trois crimes » (2021) et « qu'avez-vous vu » (2023), Amélie Lucas-Gary nous a amplement démontré par le passé comment elle pouvait extraire du sens à un degré quasiment mythique d'un matériau donné, qu'il soit (pré-)historique, subtilement géographique ou (faussement, bien entendu) infra-ordinaire.
« Féticheuses » ne déparera certainement pas dans ce qui pourrait bien déjà être une forme de palmarès. Avant de se « lancer » dans cette photographie, en succombant finalement au regard si direct et si intrigant d'une féticheuse dahoméenne des années 1930 (Derek Munn, lui aussi, dans son si impressionnant « L'ellipse du bois » de 2019, avait su recréer la magie intime et politique de l'analyse des Ménines de Velazquez par Daniel Arasse, en appliquant ses stratagèmes personnels et machines Enigma sous licence à un cliché de Bill Brandt, faisant émerger un garçon d'un bois en 1936), l'autrice convoque en un sérieux sourire innocent les tours et détours, les affres même, les mystères à élucider en tout cas, du choix : pourquoi cette photographie plutôt que telle autre ? « Leurs visages ne me disent rien » : cette simple remarque résonnera, lourde de sens multiples, tout au long de cette incursion dans l'archive autochrome.
Explicitant ce qui intervient dans le creux de sa prise de décision, fût-ce avec le secours pseudo-aléatoire d'un globe terrestre décidément trop riche en océans, Amélie Lucas-Gary déchiffre pour nous, patiemment, certains des secrets grisants de l'écriture sous contrainte, même lorsque celle-ci semble d'abord se limiter à l'unicité forcée d'un choix et à la chance du regard incisif d'une Africaine depuis longtemps disparue.
Le choix de ce cliché béninois avant la lettre (et donc absolument pas bénin, en effet) conduit presque naturellement Amélie Lucas-Gary, sans qu'elle ait aucunement besoin de forcer le trait, vers le contexte plus ou moins implicite de la présence de ces féticheuses : bien avant l'ouverture ethnologique, les missions aussi froidement militaires et impériales que religieuses et civilisatrices (on pensera aussi bien au Gauz de « Camarade papa » qu'au Frédéric Sounac de « L'histoire navrante de la mission Mouc-Marc ») qui ont envahi le continent africain avant et après le congrès de Berlin de triste mémoire (tel qu'il trône par exemple au coeur de « La bataille d'Occident » d'Éric Vuillard). C'est là, dans l'exploration directe et indirecte des points aveugles de cette photographie, de ses conditions de production, exploration qui peut aussi s'accomplir par un détour onirique et fantastique si nécessaire, que se révèle pleinement la puissance – intersectionnelle sans effort apparent – du travail d'écriture accompli ici, ayant accepté la contrainte pour mieux souligner aussi bien la richesse réelle que l'ambiguïté fondamentale du travail de cartographie et d'archivage – de cette volonté de savoir qui ne peut totalement rester innocente (comme le soulignait d'une tout autre manière le grand Sami Tchak de « le continent du Tout et du presque Rien »). Et c'est ainsi que cette fléchette supplémentaire s'avère particulièrement salutaire.
Lien : https://charybde2.wordpress...
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2024/02/26/note-de-lecture-feticheuses-amelie-lucas-gary/
Fléchette est une collection conçue par Céline Pévrier et Adrien Genoudet aux éditions sun/sun, éditions à qui l'on devait déjà bien des textes étonnants (que l'on songe par exemple aux brefs, denses et flamboyants « Il paraît que nous sommes en guerre » de Pierre Terzian, « Et seuls les chiens répondent à ta voix » de Tarik Noui, et « le noir dedans » de Thomas Vinau, ou bien au plus ample mais tout aussi décapant « le dernier cri », de Pierre Terzian à nouveau).
Fléchette, en étroite association avec les Archives de la Planète, entreprise de documentation visuelle conduite par le mécène passionné Albert Kahn entre 1909 et 1931, propose à une sélection d'autrices et d'auteurs de s'emparer d'une seule parmi les quelque 72 000 images autochromes du fonds conservé à Boulogne-Billancourt, dans la maison même du banquier, devenue musée départemental, et d'imaginer à partir de cette image un texte d'une petite cinquantaine de pages, à leur entière discrétion quant au registre à choisir, essai, document, poème ou nouvelle. Après Philippe Artières, Hélène Gaudy, Marie-Hélène Lafon et Fanny Taillandier en 2022, Amélie Lucas-Gary est l'une des quatre autrices et auteurs à qui s'est vu proposer l'exercice en 2023, pour publication en novembre de la même année.
Que ce soit dans ses saisissants romans, « Grotte » (2014), « Vierge » (2017) et « Hic » (2020), ou dans des travaux plus courts à l'étrange et rusé détour poétique, « Trois crimes » (2021) et « qu'avez-vous vu » (2023), Amélie Lucas-Gary nous a amplement démontré par le passé comment elle pouvait extraire du sens à un degré quasiment mythique d'un matériau donné, qu'il soit (pré-)historique, subtilement géographique ou (faussement, bien entendu) infra-ordinaire.
« Féticheuses » ne déparera certainement pas dans ce qui pourrait bien déjà être une forme de palmarès. Avant de se « lancer » dans cette photographie, en succombant finalement au regard si direct et si intrigant d'une féticheuse dahoméenne des années 1930 (Derek Munn, lui aussi, dans son si impressionnant « L'ellipse du bois » de 2019, avait su recréer la magie intime et politique de l'analyse des Ménines de Velazquez par Daniel Arasse, en appliquant ses stratagèmes personnels et machines Enigma sous licence à un cliché de Bill Brandt, faisant émerger un garçon d'un bois en 1936), l'autrice convoque en un sérieux sourire innocent les tours et détours, les affres même, les mystères à élucider en tout cas, du choix : pourquoi cette photographie plutôt que telle autre ? « Leurs visages ne me disent rien » : cette simple remarque résonnera, lourde de sens multiples, tout au long de cette incursion dans l'archive autochrome.
Explicitant ce qui intervient dans le creux de sa prise de décision, fût-ce avec le secours pseudo-aléatoire d'un globe terrestre décidément trop riche en océans, Amélie Lucas-Gary déchiffre pour nous, patiemment, certains des secrets grisants de l'écriture sous contrainte, même lorsque celle-ci semble d'abord se limiter à l'unicité forcée d'un choix et à la chance du regard incisif d'une Africaine depuis longtemps disparue.
Le choix de ce cliché béninois avant la lettre (et donc absolument pas bénin, en effet) conduit presque naturellement Amélie Lucas-Gary, sans qu'elle ait aucunement besoin de forcer le trait, vers le contexte plus ou moins implicite de la présence de ces féticheuses : bien avant l'ouverture ethnologique, les missions aussi froidement militaires et impériales que religieuses et civilisatrices (on pensera aussi bien au Gauz de « Camarade papa » qu'au Frédéric Sounac de « L'histoire navrante de la mission Mouc-Marc ») qui ont envahi le continent africain avant et après le congrès de Berlin de triste mémoire (tel qu'il trône par exemple au coeur de « La bataille d'Occident » d'Éric Vuillard). C'est là, dans l'exploration directe et indirecte des points aveugles de cette photographie, de ses conditions de production, exploration qui peut aussi s'accomplir par un détour onirique et fantastique si nécessaire, que se révèle pleinement la puissance – intersectionnelle sans effort apparent – du travail d'écriture accompli ici, ayant accepté la contrainte pour mieux souligner aussi bien la richesse réelle que l'ambiguïté fondamentale du travail de cartographie et d'archivage – de cette volonté de savoir qui ne peut totalement rester innocente (comme le soulignait d'une tout autre manière le grand Sami Tchak de « le continent du Tout et du presque Rien »). Et c'est ainsi que cette fléchette supplémentaire s'avère particulièrement salutaire.
Lien : https://charybde2.wordpress...