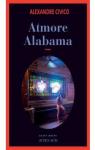Fable sur la violence induite par le capitalisme et son patriarcat, *Dolorès ou le Ventre des chiens* est une ode désespérée à l'incandescence des révoltes, et à toutes celles et ceux qui décident, un jour, de se soulever.
le nouveau roman d'Alexandre Civico paraît en librairie le 3 janvier 2024 !
https://www.actes-sud.fr/dolores-ou-le-ventre-des-chiens
#litterature #rentreedhiver
La vie professionnelle est dure. Même les plus ambitieux ignorent quels chemins la leur empruntera. Même les plus tire-au-flanc ne peuvent savoir ce que l'avenir leur réserve. Tous, sans exception, sont dans l'impossibilité totale de connaître de quelle façon tragique leur vie professionnelle prendra fin - toujours trop tôt, sans avoir le temps de faire ses adieux ni de dire aux collègues de toute une vie combien on les a haïs.
Un corps que la mort est en train d'aspirer à la paille, par petites gorgées ...
... Elle l'a fait tant attendre, cette dame. Elle est venue le chercher une fois laid.
Toi et moi, nous sommes des rois sans paupières, seule la douleur nous préserve de la mélancolie.
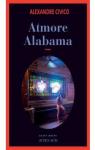
Le lendemain à l’aube, le sommeil s’est arrêté d’un coup. Net. Tant mieux puisqu’il me fallait prendre la route. J’ai quitté Orlando dans la fraîcheur d’un matin pluvieux. La voix de mon téléphone a repris sa litanie, plus ferme que la veille, plus claire. Bientôt, j’ai rejoint l’autoroute, l’Interstate 65, trois voies bordées d’arbres parcourues à vive allure par des camions aux chromes tapageurs, des pickups aux couleurs sombres et des voitures trop pressées. Depuis la veille, une dent travaillait ma gencive, une musaraigne apeurée se mouvait dans ma bouche, paniquée. La douleur était encore supportable, assez en tout cas pour que je puisse me concentrer sur la route, sur les monstres qui la parcouraient à vive allure sans égard pour mon petit véhicule poussif. Je la regardais, cette Amérique, et me suis dit qu’elle dégueulait d’Amérique. De ses propres signes, de ses clins d’œil à elle-même. Cette Amérique avec sa peau grenue, ses vergetures et son fond de teint mal étalé, ses routes larges, ses lumières qui éclairent le jour, ses couleurs stridentes, elle était telle que je l’avais laissée dans ma jeunesse, un peu plus fausse sans doute encore, mais cela venait peut-être de moi.

Défilent les portes, les panneaux, tu ne sais pas exactement quel itinéraire tu vas suivre. La route, tu vas la faire au souvenir. La dose d’adrénaline qui a jailli dans tes veines à les en faire exploser paraît avoir diminué. Ça cogne moins fort dans ta poitrine. Une sortie t’indique Bordeaux. Tu y trouves ton premier jalon. Jusque-là, le chemin n’a rien de très compliqué. Une fois sur l’A 10, une vague de soulagement t’envahit. Devant toi, six cents kilomètres d’abrutissement. Se laisser glisser sur l’asphalte, dégringoler comme on se laisse tomber d’un monticule en joyeuses galipettes. La tension que te procure systématiquement la route s’estompe un peu, elle aussi. Scruter la jauge du carburant. Le réservoir est pratiquement plein. Ne pas s’arrêter avant d’avoir besoin d’essence. Quantité de lumières étoilent le tableau de bord. Elles clignotent, s’allument, s’éteignent sans que tu saches pourquoi. Fais confiance à la mécanique allemande. Tu sourirais presque. Allemand solide, Italien peu fiable. C’est ta conception héritée de la voiture. Un acquis.
Tout ce que l'on fera à partir de maintenant, c'est revivre cette même soirée, revivre cette même soirée, jusqu'à ce qu'elle s'épuise. On va la singer chaque fois un peu plus, l'imiter, et elle finira par avoir l'amertume de l'amande. La joie ne se cultive pas, elle n'existe qu'à l'état sauvage. Il faut la saisir quand elle passe puis la laisser partir.
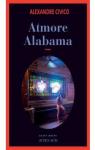
Le premier train du jour surgit du brouillard. Deux gros yeux jaunes, en colère, jaillissent soudain, éclairant le museau renfrogné de la locomotive qui tire derrière elle des dizaines de wagons et de containers. Williams Station Day, dernier samedi d’octobre. L’odeur de carton-pâte des petits matins froids. Une brume épaisse couvre la matinée comme un châle. À l’approche de la gare, le train pousse un mugissement de taureau à l’agonie. La foule assemblée là pour le voir passer lance un grand cri de joie, applaudit, se regarde applaudir, les gens se prennent à témoin, oui, le Williams Station Day a bien officiellement commencé. Je regarde Eve, ses yeux aux teintes orangées brillent d’un éclat enfantin. Certains wagons sont bariolés aux couleurs de l’événement, d’autres aux couleurs de la sainte Amérique. La ville d’Atmore fête sa fondation, cent ans plus tôt, autour de la voie ferrée, seule et unique raison de son existence. On célèbre aujourd’hui l’établissement d’une vague gare devenue une vague ville. Le serpent monstrueux traverse, raide, Atmore pendant un bon quart d’heure, un kilomètre au moins de wagons et de containers avance à une allure modérée, bruyamment, devant une population qui revient tous les ans se célébrer elle-même. L’air est encore frais. Le brouillard ne devrait pas se lever avant une heure. Une bénévole sous un barnum blanc distribue des cafés chauds aux lève-tôt, aux fervents. aux fervents. Je vais en chercher deux, en tends un à Eve qui prend le gobelet entre ses mains pour se réchauffer. Elle boit une gorgée, se brûle la langue, s’en fout, scrute à nouveau l’immense chenille de fer. Je regarde Eve qui regarde le train, indifférente à ce qui l’entoure, aux autres, aux hommes, casquette et chemise à carreaux. Le train s’éloigne, quelques applaudissements épars jaillissent, la journée va pouvoir commencer. Je propose à Eve d’aller prendre un petit-déjeuner au Sprinkle Donuts où Berry est déjà à son poste. Elle acquiesce, a envie d’un honey bun et d’un litre de café.
L’enfance a été banale. Toutes les enfances sont banales. Tes uniques points de comparaison étaient les copains du quartier. Arabes, Yougoslaves, Manouches, et Français. La plupart d’entre vous possédaient deux langues et méprisaient le pays d’origine. La langue des parents était chez tous une langue inculte, une langue au goût de terre, de poussière et de fuite, une langue crasseuse qui fait honte.
Le discours familial, l’héroïsme de classe, n’existaient pas. Pas encore. La notion même de classe était parfaitement étrangère. Les riches étaient loin, et ils n’étaient que les riches.
Ce n’est que plus tard, à l’adolescence, qu’il t’avait inculqué des choses, le père. Des choses confuses et brutes. L’oppression, les patrons, la classe ouvrière, les combats de la guerre d’Espagne. Des enseignements inutiles au milieu des enfants qui, comme vous, vivaient dans cette petite pauvreté que l’on ne dirait pas misère.

Des poings contre la porte. Des poings d’hommes, des poings fermés, des poings si serrés que les jointures devaient craquer comme des noix sous des bottes. Des poings de colère. Ça criait. J’entendais à peine ce que ça disait. Le son était ouaté, presque onctueux, pourtant ça criait, pourtant ça hurlait. Puis ça s’est arrêté. Ça a grogné, discuté, frappé à nouveau du plat de la main. Et des pas lourds ont dévalé l’escalier, le bruit s’atténuant à mesure qu’ils s’éloignaient. Un peu de silence, enfin. J’étais assise dans cette mare humide et rouge, collante. Je continuais à caresser doucement sa tête comme une mère qui ne pourrait se détacher de son enfant mort-né. Rien qui vienne me traverser l’esprit. Pas un mot, pas une sensation. Je n’étais que cette main flattant une chevelure éparse. Du temps a passé mais je ne sais pas combien. Et puis c’est revenu. Les mêmes paroles, les mêmes voix qui se diffusaient doucement dans mes tympans mais qui ne parvenaient pas à construire un sens. Une suite de phonèmes que je ne rattachais pas entre eux. Soudain il y a eu un coup assourdissant, énorme, brutal. Suivi d’un deuxième. La porte a volé en éclats. Je n’ai pas levé la tête, j’ai vu leurs chaussures, des brodequins noirs et luisants. Quatre paires qui se sont précipitées dans la pièce. C’est elle, c’est sûr que c’est elle. J’ai entendu un appareil de transmission, ça crachait, il a dit je crois que c’est elle, je crois qu’on l’a. Il s’est adressé à deux des paires de brodequins luisants, vous restez là, vous appelez une ambulance et vous sécurisez. Il a sorti des menottes, m’a demandé de tendre les mains. Je les ai avancées, jointes, comme en prière. Il m’a relevée, a attrapé le manteau qui se trouvait dans l’entrée, l’a posé sur mes épaules. On l’emmène, les gars. J’ai levé les yeux sur un visage carré au regard bleu. Il m’a prise par le bras et m’a fait descendre l’escalier. Son camarade était avec lui. Il n’avait pas besoin de me tenir, lui. Un seul suffisait. Je ne risquais pas de leur échapper. La voiture était garée juste devant la porte de l’immeuble. Avant de sortir, l’homme au visage carré et aux yeux bleus a relevé le manteau et a couvert ma tête de manière à cacher mon visage. Il m’a poussée à l’arrière de la voiture. Le gyrophare tournait, bleu comme les yeux de l’homme au visage carré. La voiture a démarré en trombe. Ils ont appelé le commissariat, on leur a dit ne venez pas, pas tout de suite. Tournez. Visage carré a demandé confirmation. On vous a dit de tourner. On attend un fourgon. Le collègue de visage carré a ralenti. Son air con de flic avait quelque chose de délicieux. Il roulait sans savoir où aller mais hésitait tout de même par moments entre la droite et la gauche. Alors qu’il n’allait nulle part. Qu’il tournait. Il ne s’arrêtait pas aux feux. Il activait la sirène et passait prudemment les carrefours. Nous avons longé le Rhône ou la Saône, je n’en avais que foutre. Un large fleuve en tout cas. J’ai regardé les hauts immeubles haussmanniens. Ils étaient faits de la pierre qui dure, de la pierre qui protège, de la pierre qui étouffe le bruit des rues. Après un temps ça a éructé dans le poste. Allez à l’hôtel de police du 7e. Le chauffeur a fait un demi-tour acrobatique et a appuyé de nouveau sur l’accélérateur. Il avait l’air content de pouvoir faire son rodéo sur les grandes artères de la ville. Quelques minutes plus tard, il s’est arrêté devant un bâtiment administratif, blanc et vitres, s’est garé juste derrière un fourgon dont les portes se sont ouvertes. Visage carré est sorti de la voiture, en a fait le tour, a remis le manteau sur ma tête et m’a transférée d’un véhicule à l’autre. Les portières ont claqué très fort. On m’a assise sur un banc, entre deux flics armés. Un troisième, visage poupin, était en face de moi. Son fusil aurait dû être à bouchon tant il avait l’air jeune. Le fourgon a démarré. J’entendais à nouveau la radio. Sortez de la ville, on vous dira ensuite. Le flic-enfant avait l’air perplexe. La même expression que l’autre quand on a lui a dit de « tourner ». J’ai aperçu à travers le hublot que nous prenions l’autoroute. J’ai dit on va où ? Le gamin a hésité à me répondre. Le manteau commençait à glisser sur mes épaules, découvrant mon soutien-gorge. Je l’ai remis en place comme je pouvais.
Il a répondu on ne sait pas encore. Visiblement, on cherche un centre pénitentiaire pour vous accueillir.
– C’est légal, ça ? Je n’ai pas droit à ma garde à vue ?
– Vous êtes spéciale, il a répondu, vaguement gêné. On ne peut pas prendre le risque de vous garder dans un commissariat. Et puis, avec les dernières lois antiterroristes…
Au bout d’une demi-heure peut-être, la radio, encore. Un nom que je ne connaissais pas a été prononcé. Le fourgon a accéléré. Bientôt, j’ai entendu des sirènes devant et derrière. On nous escortait.
Le flic-enfant regardait mes cuisses du coin de l’œil, gêné comme un adolescent devant le décolleté un peu trop lâche de la mère de sa copine. J’ai rabattu un pan du manteau dont ils m’avaient recouverte pour le priver de la vue. J’ai imaginé un instant ce qui se tramait sous sa casquette. À portée de main, une chair rose, appétissante, interdite. Il devait bander à regret. J’étais Méduse, ou Circé, ou les sirènes de l’Odyssée. Bref, une salope. J’ai passé doucement ma langue sur mes lèvres et j’ai vu son regret devenir douleur. Les menottes marquaient mes poignets. J’avais froid, n’en disais rien. Le fourgon a cahoté une nouvelle fois. Le bruit du moteur grondant comme ronfle un ogre ne masquait pas les sirènes autour. Je ne voyais l’extérieur que par le hublot de la porte arrière, enfermée dans le ventre de métal d’un fourgon pénitentiaire, trois flics armés à mes côtés. Sous mes ongles, le sang avait séché. Il était brun, couleur de terre. La terre et le sang, la même chose.
Je ne t'ai jamais emmené au cimetière. Il faut que tu vois ça. J'y vais souvent après avoir gobé un cachet, c'est l'endroit le plus agréable de la ville. Là-bas, tous les cons sont morts.