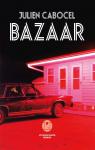Né(e) : 1970
Biographie :
Né en 1970, Julien Cabocel vit et travaille près de Paris.
Auteur et compositeur, il a déjà publié "Remix" un recueil de onze nouvelles pour onze chansons.
Son dernier livre "Bazaar" est sorti le 29/08/2018.
Né en 1970, Julien Cabocel vit et travaille près de Paris.
Auteur et compositeur, il a déjà publié "Remix" un recueil de onze nouvelles pour onze chansons.
Son dernier livre "Bazaar" est sorti le 29/08/2018.
Source : op-editions
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (4)
Voir plusAjouter une vidéo
Julien Cabocel se prête au jeu du portrait littéraire, à l'occasion de la sortie de son premier roman : Bazaar.
Plus d'info : https://www.editions-iconoclaste.fr/livres/bazaar/
Citations et extraits (18)
Voir plus
Ajouter une citation
En me redressant, j’ai jeté un œil vers la chambre de Stella. J’ai fait un pas dans sa direction mais je n’ai pas descendu les lattes de bois de la terrasse. Qu’aurais-je pu ajouter à ce que nos corps s’étaient déjà dit, à cette langue parfaite que nous avions parlée l’autre après-midi et dont les mots nous échappaient dès que nous en saisissions le sens? Que pouvais-je espérer de plus? Sans plus me retourner, j’ai bifurqué en direction du self derrière lequel m’attendait le camion de la Solarem.
Une camionnette blanche. Un coup de freins dans la rue d'Odessa. Pas un cri, il est trop tard pour crier. Un bruit sourd, c’est tout. La tête de Madjik sur le bitume. Une fraction de seconde, il y a ce bruit qui résonne. Puis tout se fige. La ville retient son souffle. Sur le trottoir d’en face, quelqu'un porte la main à ses lèvres.
Ce qu'il reste du choc dans le silence résiste encore un instant puis tout redémarre.
En beaucoup trop bruyant.
En trop fort.
Trop rapide.
Tout le monde s’affole. On court jusqu’à lui. Ça klaxonne. «Écartez-vous! Laissez-le respirer!» La ville reprend son chaos. L'odeur âcre du caoutchouc que le coup de freins a brûlé flotte dans l'air.
Moi, je ne bouge pas. Madjik est allongé là et sans savoir pourquoi je reste immobile, je pense au plat qui a dû se renverser dans son emballage de papier. p. 82-83
Ce qu'il reste du choc dans le silence résiste encore un instant puis tout redémarre.
En beaucoup trop bruyant.
En trop fort.
Trop rapide.
Tout le monde s’affole. On court jusqu’à lui. Ça klaxonne. «Écartez-vous! Laissez-le respirer!» La ville reprend son chaos. L'odeur âcre du caoutchouc que le coup de freins a brûlé flotte dans l'air.
Moi, je ne bouge pas. Madjik est allongé là et sans savoir pourquoi je reste immobile, je pense au plat qui a dû se renverser dans son emballage de papier. p. 82-83
Nous nous connaissons si peu finalement même si les fous rires sans raison au beau milieu d’un repas morose sont un ciment d’une solidité inaltérable. Comme les engueulades affreuses des parents dans lesquelles nous craignions d’être engloutis l’un et l’autre ou ces vacances d’été dans le jardin de nos grands‐parents, à Saint‐Jean‐de‐Mont, dans l’ombre de la grande maison bâtie pour durer toujours et qui avait passé plus vite encore que l’enfance.
- Il peut-être léger comme le vent et parfois lourd comme la pierre. Il est plus fort que le plus fort des hommes mais plus fragile que le verre. Il brûle comme le feu et assouvit mieux que l'eau. Il est le bleu de l'air qu'on ne peut enfermer et le pire des cachots pour ceux qu'il a quittés. Il est une seconde où tient l'éternité.
- Si c'est d'"Amour" dont tu parles je crois l'avoir aperçu.
- Vraiment ? Où ça ?
- Il est sur ce baiser.
- Si c'est d'"Amour" dont tu parles je crois l'avoir aperçu.
- Vraiment ? Où ça ?
- Il est sur ce baiser.
(Les premières pages du livre)
Un surnom. Voilà à peu près tout ce que l’on sait les uns des autres. Et la plupart du temps, c’est largement suffisant pour ce que nous avons à nous dire en attendant devant les restaurants. Dans un surnom, on met ce que l’on veut de soi, tout ce qu’on voudrait être, et tant pis si rouler pour livrer des sandwichs n’a rien à y voir.
Pour tenir sur un vélo, il n’y a rien à faire, personne à être en particulier. Il suffit d’avancer. Si tu arrêtes de pédaler, tu tombes, c’est aussi simple que cela. Tu le sais depuis la première fois où ton guidon s’est mis à trembler et qu’il t’a fallu répondre à la seule vraie question qui te sera jamais posée: continuer à pédaler ou accepter de tomber ?
Et nous en étions là, tous autant que nous étions, avec nos surnoms qui ne voulaient peut-être rien dire, Madjik, Lo et moi, Diesel.
On tombait.
Malgré la fatigue et nos jambes tétanisées à l’idée de tourner encore, nous avons quitté la terrasse rouge et blanc du Falstaff. Comme des insectes éblouis, happés par la valse des phares, nous sommes remontés en selle.
À nous trois, nous n’avions même pas cent ans et nous roulions côte à côte dans une ville deux fois millénaire. Je ne sais plus lequel d’entre nous a lancé ces mots mais ils ont filé dans l’air luisant et nous sommes partis à leur poursuite avec des hurlements de Sioux. L’un après l’autre, nous avons gueulé comme des gamins, comme on crache à la face du temps, comme on lui fait un doigt d’honneur que seule la jeunesse peut faire parce que ce sont ses étincelles qui enflamment l’avenir et que son feu n’a pas encore le goût des cendres. Rien que la vie qui nous appartient. Et le rire de Madjik. Et les façades qui tremblaient au loin.
Mains dans les poches, dans le miroir de cet instant, nous étions les Quatre Fantastiques, les Sept Mercenaires, les Gardiens de la Galaxie, une Chevauchée Fabuleuse, trois livreurs à vélo qui roulions sans commande, sans personne à délivrer qu’eux-mêmes, comme on renverse le monde, pour le plaisir, pour rien.
À Saint-Paul, dans un ballet qui nous échappait, nous avons quitté la voie de bus et nous sommes retrouvés à rouler sur toute la largeur de la rue. Aucune des voitures qui derrière nous commençaient à s’impatienter ne pouvait nous doubler. Ça gueulait, ça klaxonnait. Les insultes fusaient des vitres baissées et des casques aux visières relevées mais pas un de nous ne se décalait. Nous étions intouchables et nos yeux brillaient bien plus fort que la haie d’honneur des réverbères devant nous.
Dans le bouche-à-bouche de nos roues sur l’asphalte, la ville asphyxiée reprenait son souffle. À croire que je n’avais pas avalé tous ces kilomètres depuis que je pédalais dans Paris pour rien. À croire qu’on y pouvait bel et bien quelque chose.
Nous avons tenu jusqu’à la tour Saint-Jacques, avant le boulevard Sébastopol vers lequel les camionnettes, les voitures et les scooters se sont rués comme des affamés dans un bruit d’ogre qui veut dévorer la ville et nous bouffer avec.
Qu’est-ce que c’était bon.
J’en ai lâché mon vélo sur le trottoir d’une rue piétonne qui mène à Beaubourg. Les bras en l’air, en sautillant tel un boxeur qui vient d’arracher le dernier round (poids léger contre métaux lourds), j’ai hurlé à la vie comme si j’avais gagné la partie, prêt à faire face pour les siècles des siècles, et pour des siècles encore, vivant. Et Lo, descendu lui aussi de son cadre pour répondre dans un sourire triomphant aux insultes qui reprenaient de plus belle à notre hauteur quand Madjik, dans un rire éblouissant, leur lançait des baisers !
Et il y en avait eu, des instants comme celui-ci, presque trop beaux pour y croire. Comme la fois où Lo avait tourné sur des Champs-Élysées déserts dans ce qui ressemblait au final d’un Tour de France dont il avait dû rêver tant de fois. Nous avions parlementé un moment pour qu’il puisse rejoindre la ligne de départ d’un « alleycat » inattendu. Dans un sourire railleur, les organisateurs de ces courses improvisées qui incendiaient la ville certains soirs avaient fini par accepter. C’était l’aristocratie de la livraison à vélo, ces types aux t-shirts unis, aux lunettes profilées, aux bermudas de toile. Employés de véritables messageries, ils n’étaient pas tenus de se déguiser pour rouler, n’avaient pas même à payer leur sac à dos d’une caution qu’ils ne récupéreraient jamais. Non, ils utilisaient des vélos à pignon fixe avec lesquels ils se défiaient régulièrement dans ces compétitions nocturnes où tous les coups étaient permis. Tandis que Lo se faisait digérer par la masse des participants, Madjik et moi avions rejoint le rond-point des Champs-Élysées. Les coureurs avaient d’abord remonté l’avenue dans un peloton compact qui comptait bien profiter de l’occasion pour asseoir sa réputation et confirmer une bonne fois pour toutes sa supériorité sur les livreurs low-cost dans notre genre. Mais très vite Lo s’était retrouvé en tête et tous les autres s’étaient lancés à sa poursuite depuis les rues voisines. D’un coup d’œil, il les avait vus s’approcher et avait accéléré encore, donnant tout pour s’échapper de leur horde écumante mais aussi de lui-même, sans doute, de ce qui dans le fond de sa gorge avait quand même le goût d’une défaite. Lui qui n’était pas devenu le champion espéré et qui, pour ne pas abandonner tout à fait, livrait des sushis et des burgers dans des boîtes en polystyrène. Nous nous déchaînions à chacun de ses passages, hurlions à nous casser la voix, à faire vaciller Paris, emportés par notre fierté de voir avec quelle majesté il les distanciait tous. Jusqu’au bout, il avait tenu et avec ce qu’il nous restait de cordes vocales, nous l’avions acclamé puis porté aux nues sur nos épaules tandis que les derniers passaient encore la ligne. Son regard à cet instant, là-haut, au-dessus de nous, au-dessus de tous, valait toutes les médailles, toutes les victoires qu’il n’avait pas remportées. Il ressemblait au champion qu’il aurait dû être, et redevenir pour un instant au moins ce vainqueur magnifique valait toutes les récompenses, vraiment, effaçait tout le reste.
Quand les flics étaient apparus à leur tour pour nous courir après, le peloton s’était dispersé, chacun saluant brièvement Lo d’un geste amer ou beau joueur pour sa victoire. Nous avions détalé derrière eux comme des gamins que nous étions, des enfants qui croyaient encore, ou faisaient semblant de croire, plutôt, à l’imparfait de leurs jeux, de leur job, de leur vie : « Alors moi j’étais l’Indien et toi t’étais le cow-boy. » Imparfait, c’était le mot adéquat, le temps le plus juste. Que les enfants l’aient choisi pour donner vie à leurs rêveries était bien la preuve de leur sagesse. Et toutes les publicités au présent, à l’avenir, tous les storytellers et leur monde idéal pouvaient bien ravaler leurs histoires à tourner en rond. Nous ne serions jamais que des enfants dans le monde imparfait de leurs jeux qui ne croient pas tout ce qu’on leur raconte mais font semblant d’y croire – ce qui n’est pas la même chose. On sait que la roue est voilée, que la chaîne va finir par dérailler, ce n’est pas parce qu’on accepte de pédaler qu’on ne s’en rend pas compte, surtout pas.
Avec Paris, Madjik et Lo tiennent le premier rôle de mes vidéos – des images brutes de nos exploits que je poste de temps en temps sur ma chaîne. Il arrive que j’y apparaisse aussi dans un selfie bancal, un œil sur la route, l’autre sur mon portable. On m’y découvre essoufflé, la masse de mes boucles noires aplatie par le casque d’où jaillit toujours une mèche rebelle, le col de ma chemisette hawaïenne dépassant de mon blouson bicolore. J’en envoie parfois le lien à ma sœur avec l’idée de lui montrer la ville, ce qu’il y a de lumineux malgré tout dans la vie que je me suis choisie. J’espère que l’énergie incroyable de nos errances illumine son quotidien, entre le collège George Sand où j’ai été élève moi aussi et la zone commerciale d’Argenson où se trouve la concession automobile de mon père – elle va bientôt y faire son stage de troisième, m’a-t-elle annoncé dans un SMS ponctué d’un smiley au sourire triste. Pour l’avoir vécue avant elle, je connais sa vie dans le centre-ville de Châtellerault ou devant le journal télévisé, chaque soir à 20 heures, dans le salon du pavillon familial, si propre, si parfaitement rangé, si identique à celui des voisins, des voisins des voisins. À travers ces images de nos prouesses, j’essaie de lui dire que même dans les ruines, même sur les cendres, elle a le droit de danser. Oui, il est encore permis de rire, de faire les cons sans raison et même si cela devient de plus en plus incongru, elle n’y est pour rien. Elle a le droit de s’amuser, de faire des rêves improbables, des rêves d’avenir sans que la planète fasse peser tout le poids de sa survie sur ses épaules de jeune fille. Je me charge de ça. Elle peut danser, faire tourner ses longs cheveux d’or sur la nuit, embrasser le bleu de l’air, et rire, même trop, même fort, et aimer surtout.
À chaque fois que je reçois une de ses lettres, invariablement garnie d’un billet de dix euros soigneusement plié – une page pleine qu’elle entame toujours par mon prénom, « Édouard », enluminé de boucles tracées au feutre mauve –, je m’en veux d’être parti, de ne pas avoir tenu plus longtemps mon rôle de grand frère. J’ai envie de la serrer dans mes bras, de croire qu’il nous reste encore tout un bout d’enfance à partager. Nous nous connaissons si peu finalement même si les fous rires sans raison au beau milieu d’un repas morose sont un ciment d’une solidité inaltérable. Comme les engueulades affreuses des parents dans lesquelles nous craignions d’être engloutis l’un et l’autre ou ces vacances d’été dans le jardin de nos grands-parents, à Saint-Jean-de-Monts, dans l’ombre de la grande maison bâtie pour durer toujours et qui avait passé plus vite encore que l’enfance.
Un surnom. Voilà à peu près tout ce que l’on sait les uns des autres. Et la plupart du temps, c’est largement suffisant pour ce que nous avons à nous dire en attendant devant les restaurants. Dans un surnom, on met ce que l’on veut de soi, tout ce qu’on voudrait être, et tant pis si rouler pour livrer des sandwichs n’a rien à y voir.
Pour tenir sur un vélo, il n’y a rien à faire, personne à être en particulier. Il suffit d’avancer. Si tu arrêtes de pédaler, tu tombes, c’est aussi simple que cela. Tu le sais depuis la première fois où ton guidon s’est mis à trembler et qu’il t’a fallu répondre à la seule vraie question qui te sera jamais posée: continuer à pédaler ou accepter de tomber ?
Et nous en étions là, tous autant que nous étions, avec nos surnoms qui ne voulaient peut-être rien dire, Madjik, Lo et moi, Diesel.
On tombait.
Malgré la fatigue et nos jambes tétanisées à l’idée de tourner encore, nous avons quitté la terrasse rouge et blanc du Falstaff. Comme des insectes éblouis, happés par la valse des phares, nous sommes remontés en selle.
À nous trois, nous n’avions même pas cent ans et nous roulions côte à côte dans une ville deux fois millénaire. Je ne sais plus lequel d’entre nous a lancé ces mots mais ils ont filé dans l’air luisant et nous sommes partis à leur poursuite avec des hurlements de Sioux. L’un après l’autre, nous avons gueulé comme des gamins, comme on crache à la face du temps, comme on lui fait un doigt d’honneur que seule la jeunesse peut faire parce que ce sont ses étincelles qui enflamment l’avenir et que son feu n’a pas encore le goût des cendres. Rien que la vie qui nous appartient. Et le rire de Madjik. Et les façades qui tremblaient au loin.
Mains dans les poches, dans le miroir de cet instant, nous étions les Quatre Fantastiques, les Sept Mercenaires, les Gardiens de la Galaxie, une Chevauchée Fabuleuse, trois livreurs à vélo qui roulions sans commande, sans personne à délivrer qu’eux-mêmes, comme on renverse le monde, pour le plaisir, pour rien.
À Saint-Paul, dans un ballet qui nous échappait, nous avons quitté la voie de bus et nous sommes retrouvés à rouler sur toute la largeur de la rue. Aucune des voitures qui derrière nous commençaient à s’impatienter ne pouvait nous doubler. Ça gueulait, ça klaxonnait. Les insultes fusaient des vitres baissées et des casques aux visières relevées mais pas un de nous ne se décalait. Nous étions intouchables et nos yeux brillaient bien plus fort que la haie d’honneur des réverbères devant nous.
Dans le bouche-à-bouche de nos roues sur l’asphalte, la ville asphyxiée reprenait son souffle. À croire que je n’avais pas avalé tous ces kilomètres depuis que je pédalais dans Paris pour rien. À croire qu’on y pouvait bel et bien quelque chose.
Nous avons tenu jusqu’à la tour Saint-Jacques, avant le boulevard Sébastopol vers lequel les camionnettes, les voitures et les scooters se sont rués comme des affamés dans un bruit d’ogre qui veut dévorer la ville et nous bouffer avec.
Qu’est-ce que c’était bon.
J’en ai lâché mon vélo sur le trottoir d’une rue piétonne qui mène à Beaubourg. Les bras en l’air, en sautillant tel un boxeur qui vient d’arracher le dernier round (poids léger contre métaux lourds), j’ai hurlé à la vie comme si j’avais gagné la partie, prêt à faire face pour les siècles des siècles, et pour des siècles encore, vivant. Et Lo, descendu lui aussi de son cadre pour répondre dans un sourire triomphant aux insultes qui reprenaient de plus belle à notre hauteur quand Madjik, dans un rire éblouissant, leur lançait des baisers !
Et il y en avait eu, des instants comme celui-ci, presque trop beaux pour y croire. Comme la fois où Lo avait tourné sur des Champs-Élysées déserts dans ce qui ressemblait au final d’un Tour de France dont il avait dû rêver tant de fois. Nous avions parlementé un moment pour qu’il puisse rejoindre la ligne de départ d’un « alleycat » inattendu. Dans un sourire railleur, les organisateurs de ces courses improvisées qui incendiaient la ville certains soirs avaient fini par accepter. C’était l’aristocratie de la livraison à vélo, ces types aux t-shirts unis, aux lunettes profilées, aux bermudas de toile. Employés de véritables messageries, ils n’étaient pas tenus de se déguiser pour rouler, n’avaient pas même à payer leur sac à dos d’une caution qu’ils ne récupéreraient jamais. Non, ils utilisaient des vélos à pignon fixe avec lesquels ils se défiaient régulièrement dans ces compétitions nocturnes où tous les coups étaient permis. Tandis que Lo se faisait digérer par la masse des participants, Madjik et moi avions rejoint le rond-point des Champs-Élysées. Les coureurs avaient d’abord remonté l’avenue dans un peloton compact qui comptait bien profiter de l’occasion pour asseoir sa réputation et confirmer une bonne fois pour toutes sa supériorité sur les livreurs low-cost dans notre genre. Mais très vite Lo s’était retrouvé en tête et tous les autres s’étaient lancés à sa poursuite depuis les rues voisines. D’un coup d’œil, il les avait vus s’approcher et avait accéléré encore, donnant tout pour s’échapper de leur horde écumante mais aussi de lui-même, sans doute, de ce qui dans le fond de sa gorge avait quand même le goût d’une défaite. Lui qui n’était pas devenu le champion espéré et qui, pour ne pas abandonner tout à fait, livrait des sushis et des burgers dans des boîtes en polystyrène. Nous nous déchaînions à chacun de ses passages, hurlions à nous casser la voix, à faire vaciller Paris, emportés par notre fierté de voir avec quelle majesté il les distanciait tous. Jusqu’au bout, il avait tenu et avec ce qu’il nous restait de cordes vocales, nous l’avions acclamé puis porté aux nues sur nos épaules tandis que les derniers passaient encore la ligne. Son regard à cet instant, là-haut, au-dessus de nous, au-dessus de tous, valait toutes les médailles, toutes les victoires qu’il n’avait pas remportées. Il ressemblait au champion qu’il aurait dû être, et redevenir pour un instant au moins ce vainqueur magnifique valait toutes les récompenses, vraiment, effaçait tout le reste.
Quand les flics étaient apparus à leur tour pour nous courir après, le peloton s’était dispersé, chacun saluant brièvement Lo d’un geste amer ou beau joueur pour sa victoire. Nous avions détalé derrière eux comme des gamins que nous étions, des enfants qui croyaient encore, ou faisaient semblant de croire, plutôt, à l’imparfait de leurs jeux, de leur job, de leur vie : « Alors moi j’étais l’Indien et toi t’étais le cow-boy. » Imparfait, c’était le mot adéquat, le temps le plus juste. Que les enfants l’aient choisi pour donner vie à leurs rêveries était bien la preuve de leur sagesse. Et toutes les publicités au présent, à l’avenir, tous les storytellers et leur monde idéal pouvaient bien ravaler leurs histoires à tourner en rond. Nous ne serions jamais que des enfants dans le monde imparfait de leurs jeux qui ne croient pas tout ce qu’on leur raconte mais font semblant d’y croire – ce qui n’est pas la même chose. On sait que la roue est voilée, que la chaîne va finir par dérailler, ce n’est pas parce qu’on accepte de pédaler qu’on ne s’en rend pas compte, surtout pas.
Avec Paris, Madjik et Lo tiennent le premier rôle de mes vidéos – des images brutes de nos exploits que je poste de temps en temps sur ma chaîne. Il arrive que j’y apparaisse aussi dans un selfie bancal, un œil sur la route, l’autre sur mon portable. On m’y découvre essoufflé, la masse de mes boucles noires aplatie par le casque d’où jaillit toujours une mèche rebelle, le col de ma chemisette hawaïenne dépassant de mon blouson bicolore. J’en envoie parfois le lien à ma sœur avec l’idée de lui montrer la ville, ce qu’il y a de lumineux malgré tout dans la vie que je me suis choisie. J’espère que l’énergie incroyable de nos errances illumine son quotidien, entre le collège George Sand où j’ai été élève moi aussi et la zone commerciale d’Argenson où se trouve la concession automobile de mon père – elle va bientôt y faire son stage de troisième, m’a-t-elle annoncé dans un SMS ponctué d’un smiley au sourire triste. Pour l’avoir vécue avant elle, je connais sa vie dans le centre-ville de Châtellerault ou devant le journal télévisé, chaque soir à 20 heures, dans le salon du pavillon familial, si propre, si parfaitement rangé, si identique à celui des voisins, des voisins des voisins. À travers ces images de nos prouesses, j’essaie de lui dire que même dans les ruines, même sur les cendres, elle a le droit de danser. Oui, il est encore permis de rire, de faire les cons sans raison et même si cela devient de plus en plus incongru, elle n’y est pour rien. Elle a le droit de s’amuser, de faire des rêves improbables, des rêves d’avenir sans que la planète fasse peser tout le poids de sa survie sur ses épaules de jeune fille. Je me charge de ça. Elle peut danser, faire tourner ses longs cheveux d’or sur la nuit, embrasser le bleu de l’air, et rire, même trop, même fort, et aimer surtout.
À chaque fois que je reçois une de ses lettres, invariablement garnie d’un billet de dix euros soigneusement plié – une page pleine qu’elle entame toujours par mon prénom, « Édouard », enluminé de boucles tracées au feutre mauve –, je m’en veux d’être parti, de ne pas avoir tenu plus longtemps mon rôle de grand frère. J’ai envie de la serrer dans mes bras, de croire qu’il nous reste encore tout un bout d’enfance à partager. Nous nous connaissons si peu finalement même si les fous rires sans raison au beau milieu d’un repas morose sont un ciment d’une solidité inaltérable. Comme les engueulades affreuses des parents dans lesquelles nous craignions d’être engloutis l’un et l’autre ou ces vacances d’été dans le jardin de nos grands-parents, à Saint-Jean-de-Monts, dans l’ombre de la grande maison bâtie pour durer toujours et qui avait passé plus vite encore que l’enfance.
- Vous êtes photographe ?
- Disons que je l'ai été. Ç'aura été ma passion. J'ai toujours pris tout ce qu'il y avait à prendre, tu peux me croire.
-Et pourquoi avec ce genre d'appareil ?
- Parce qu'il est instantané, justement ! Comme la vie. Pas d'avant, pas d'après, juste l'instant. Clic. Les imbéciles croient qu'en prenant une photo ils immortalisent quelque chose alors que c'est tout le contraire, précisément tout le contraire. Prendre une photo tue le présent, tu m'entends ? A l'instant où tu appuies sur le déclencheur, tout est foutu. Irrémédiablement. Crois moi. Sauf avec ce genre de petits bijoux qui, d'une certaine façon, étire le présent, l'allonge, infiniment. Pourquoi crois-tu que les Papous refusent de se laisser photographier ? Parce qu'ils savent par instinct que la photo leur vole quelque chose. Mais ce n'est pas leur âme qu'ils ont peur de perdre, ou je ne sais quelle autre idiotie qu'on entend souvent. Non. C'est le présent. C'est l'instant. Si tu étais toi-même photographe, tu saurais de quoi je parle. Un bon photographe ne travaille pas avec la lumière, ça n'a jamais été ça l'enjeu. Non, le truc, c'est de ne pas tuer le présent. Et crois-moi, ce n'est pas si facile.
- Disons que je l'ai été. Ç'aura été ma passion. J'ai toujours pris tout ce qu'il y avait à prendre, tu peux me croire.
-Et pourquoi avec ce genre d'appareil ?
- Parce qu'il est instantané, justement ! Comme la vie. Pas d'avant, pas d'après, juste l'instant. Clic. Les imbéciles croient qu'en prenant une photo ils immortalisent quelque chose alors que c'est tout le contraire, précisément tout le contraire. Prendre une photo tue le présent, tu m'entends ? A l'instant où tu appuies sur le déclencheur, tout est foutu. Irrémédiablement. Crois moi. Sauf avec ce genre de petits bijoux qui, d'une certaine façon, étire le présent, l'allonge, infiniment. Pourquoi crois-tu que les Papous refusent de se laisser photographier ? Parce qu'ils savent par instinct que la photo leur vole quelque chose. Mais ce n'est pas leur âme qu'ils ont peur de perdre, ou je ne sais quelle autre idiotie qu'on entend souvent. Non. C'est le présent. C'est l'instant. Si tu étais toi-même photographe, tu saurais de quoi je parle. Un bon photographe ne travaille pas avec la lumière, ça n'a jamais été ça l'enjeu. Non, le truc, c'est de ne pas tuer le présent. Et crois-moi, ce n'est pas si facile.
Stella était assise dans un canapé de velours déglingué dans un angle du grand espace qui servait de cour intérieure au Bazaar. Elle regardait le ciel étoilé, lovée dans un long gilet marron, trop grand de trois ou quatre tailles, les jambes repliées sous elle, la tête sur un gros coussin de la même couleur ambre que le canapé. Si elle n’a pas semblé faire trop attention à moi, j’ai eu de mon côté le plus grand mal à regarder ailleurs. Certaines femmes sont comme des aimants, on ne peut rien y faire, il faut qu’on les regarde, parce que l’on sent comme intuitivement que si on ne le fait pas, notre vie n’aura pas été tout à fait la même, on aura manqué quelque chose en somme du mystère du monde, on aura insulté Dieu sait qui, quelque divinité peut-être, qui dans des temps reculés, anciens, révolus, avait offert aux hommes la beauté, toute la beauté : les femmes. p.45-46
Le soleil se levait lentement. Un dégradé halluciné de rose et de mauve se déchirait sur le noir pour se déverser sur mon pare-brise comme un cocktail que la nuit buvait du bout des lèvres. Et c’était beau. C’était même mieux que ça. Puis peu à peu, la terre est devenue plus claire et les rétroviseurs se sont mis à dessiner d’étranges volutes de poussière, une fumée qui se dissipait lentement dans les couleurs du matin.
Je n’avais pas prévu de m’arrêter mais je n’en étais quand même pas à pisser dans des bouteilles en plastique comme les camionneurs qui balancent ça par la fenêtre – d’une part parce que je n’étais pas vraiment habitué à la chose et que j’avais peur de m’en foutre partout, ...
Je n’avais pas prévu de m’arrêter mais je n’en étais quand même pas à pisser dans des bouteilles en plastique comme les camionneurs qui balancent ça par la fenêtre – d’une part parce que je n’étais pas vraiment habitué à la chose et que j’avais peur de m’en foutre partout, ...
Ainsi les mots étaient-ils partis à nouveau.
Pas après pas.
Pierre après pierre.
Avant d'arriver en haut, certains avaient glissé sur les neiges éternelles qui coiffaient les pentes du sommet.
D'autres avaient manqué dévisser dans le vide ou dans l'une des crevasses qu'il leur avait fallu franchir. Mais, au bout du compte, pas un n'était tombé.
Comme s'ils s'étaient tenus les uns les autres. Comme s'ils formaient une espèce de phrase, simple et complexe à la fois. Une phrase qui aurait raconté, si quelqu'un avait pu la lire entièrement, toute cette histoire, toutes les histoires, peut-être même toute l'histoire.
Pas après pas.
Pierre après pierre.
Avant d'arriver en haut, certains avaient glissé sur les neiges éternelles qui coiffaient les pentes du sommet.
D'autres avaient manqué dévisser dans le vide ou dans l'une des crevasses qu'il leur avait fallu franchir. Mais, au bout du compte, pas un n'était tombé.
Comme s'ils s'étaient tenus les uns les autres. Comme s'ils formaient une espèce de phrase, simple et complexe à la fois. Une phrase qui aurait raconté, si quelqu'un avait pu la lire entièrement, toute cette histoire, toutes les histoires, peut-être même toute l'histoire.
Combien d’années avais-je passées à l’agence avant de me décider ? Dix ? Quinze ? Je ne sais même plus. J’avais pu en tous les cas suivre en direct la « mutation », comme on avait décidé un beau matin d’appeler le bordel généralisé dans lequel nous avions commencé à nous prendre les pieds. « Mutation ». C’était un tel euphémisme que je me suis demandé un moment si ce n’était pas quelqu’un de l’agence qui avait bossé là-dessus. Dominique Chevalier. C’était du Dominique tout craché. Il faut lui reconnaître un certain talent pour ce genre de trouvailles, pour des images et des mots qui n’auraient jamais dû se croiser. Un certain génie même, on peut le reconnaître. Si vous saviez le nombre de slogans improbables qu’on lui doit, vous en seriez malades. Des exemples ? Honnêtement, je n’en ai pas le courage. Plus l’envie. Si ça vous empêche de dormir, allumez vos téléviseurs, longez les murs de vos villes ou les panneaux publicitaires des zones commerciales de leurs périphéries, vous finirez bien par trouver une idée ou une ligne dont il est l’auteur, si on peut appeler cela comme ça. Je crois que si je n’étais pas parti, si j’avais continué à jouer notre petit jeu quotidien, ç’aurait mal fini. Je ne pouvais plus le voir.
Je vous dois une petite précision : je suis Dominique Chevalier.
Je vous dois une petite précision : je suis Dominique Chevalier.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Julien Cabocel
Lecteurs de Julien Cabocel (82)Voir plus
Quiz
Voir plus
Adjectifs qui n'en font qu'à leur tête😋
Un bâtiment qui n'est plus une école
Une ancienne école
Une école ancienne
12 questions
129 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, adjectif
, sensCréer un quiz sur cet auteur129 lecteurs ont répondu