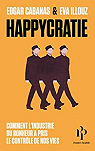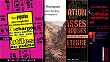Critiques de Eva Illouz (92)
Les auteurs ignorent que les hommes se sont toujours préoccupés de vivre moins malheureux et plus heureux. Pour eux, « la recherche du bonheur est l’un des traits les plus distinctifs de la culture nord-américaine » (p. 13). Faire des recherches sur le bonheur et enseigner les résultats c’est faire le jeu de « la société capitaliste néo-libérale ». Faire croire que le bonheur des peuples est une chose essentielle « c’est la stratégie de Pinochet au Chili, suivi de Cameron au Royaume-Uni et de Sarkosy en France » (sic, p. 53).
N’étant pas à une contradiction près, les auteurs affirment que les recherches sur le bonheur — notamment l’analyse des « Big Data » —n’ont « quasi rien appris » (p. 59), mais affirment un peu plus loin que ces analyses permettent aux grandes entreprises « d’exercer une influence non seulement sur les aspects les plus courants des existences individuelles, mais aussi sur les modèles comportementaux les plus généralisés ».
La « psychologie positive » est la cible privilégiée. Les auteurs affirment que ce courant « a insufflé de l’oxygène à une discipline, la psychologie, chroniquement incapable de trouver son objet d’étude » (sic, p. 41). Pour eux ce courant est « une industrie mondiale pesant des milliards ». Sans fournir leurs sources, ils affirment que le Centre de psychologie positive de l’université de Pennsylvanie a reçu « des sommes énormes » de « personnages ultra-conservateurs », de multinationales (notamment Coca-Cola) et des Émirats arabes. La psychologie positive serait « une sorte de pornographie émotionnelle » (p. 12s).
Pour eux, les procédures qui aident les personnes — en particulier les travailleurs — à mieux gérer leurs émotions ne font rien d’autre que le jeu des patrons : elles façonnent « le citoyen néolibéral idéal » et produisent des « happycondriaques ».
Un défaut majeur de l’ouvrage est que la psychologie positive est présentée comme une doctrine unifiée. En réalité c’est l’étude, en principe scientifique, de ce qui permet de vivre plus heureux, et le résultat actuel est loin d’être une conception totalement unifiée. L’autre grand reproche aux auteurs est qu’ils publient un ouvrage de 270 pages pour exposer quelques idées qui peuvent tenir dans un article. Sur ces idées, il existait d’ailleurs déjà un bon nombre d’articles parfaitement redondants.
Lien : https://moodleucl.uclouvain...
N’étant pas à une contradiction près, les auteurs affirment que les recherches sur le bonheur — notamment l’analyse des « Big Data » —n’ont « quasi rien appris » (p. 59), mais affirment un peu plus loin que ces analyses permettent aux grandes entreprises « d’exercer une influence non seulement sur les aspects les plus courants des existences individuelles, mais aussi sur les modèles comportementaux les plus généralisés ».
La « psychologie positive » est la cible privilégiée. Les auteurs affirment que ce courant « a insufflé de l’oxygène à une discipline, la psychologie, chroniquement incapable de trouver son objet d’étude » (sic, p. 41). Pour eux ce courant est « une industrie mondiale pesant des milliards ». Sans fournir leurs sources, ils affirment que le Centre de psychologie positive de l’université de Pennsylvanie a reçu « des sommes énormes » de « personnages ultra-conservateurs », de multinationales (notamment Coca-Cola) et des Émirats arabes. La psychologie positive serait « une sorte de pornographie émotionnelle » (p. 12s).
Pour eux, les procédures qui aident les personnes — en particulier les travailleurs — à mieux gérer leurs émotions ne font rien d’autre que le jeu des patrons : elles façonnent « le citoyen néolibéral idéal » et produisent des « happycondriaques ».
Un défaut majeur de l’ouvrage est que la psychologie positive est présentée comme une doctrine unifiée. En réalité c’est l’étude, en principe scientifique, de ce qui permet de vivre plus heureux, et le résultat actuel est loin d’être une conception totalement unifiée. L’autre grand reproche aux auteurs est qu’ils publient un ouvrage de 270 pages pour exposer quelques idées qui peuvent tenir dans un article. Sur ces idées, il existait d’ailleurs déjà un bon nombre d’articles parfaitement redondants.
Lien : https://moodleucl.uclouvain...
Eva Illouz et Edgar Cabanas critiquent l’injonction au bonheur déployée par la psychologie positive et récupérée par les méthodes de management et de coaching. Une lecture qui déconstruit l’esprit du temps.
Lien : https://www.la-croix.com/Cul..
Lien : https://www.la-croix.com/Cul..
Une analyse du recul de la démocratie libérale et de ses valeurs par quinze intellectuels, qui n’esquisse guère de voies de sortie.
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Le présent ouvrage a pour objet l'analyse comparative de l'idéal-type de la relation afférant à la conjugalité (hétérosexuelle, monogame, occidentale surtout anglo-saxonne et basée principalement sur une perspective féminine) dans la modernité tardive par rapport à l'époque pré-moderne (XIXe siècle avec quelques aperçus précédents) ; cet idéal-type se développe (ou est imposé) culturellement, par la littérature et l'épistolaire jadis, associé à l'image et aux technologies informatiques à présent, au sein de la classe dominante, la moyenne et haute bourgeoisie (masculine).
Sa thèse fondamentale consiste à établir, dans le passage entre les deux modèles, la primauté des déterminants sociologiques – les conditions économiques et sociales de la société – vis-à-vis de la lecture psychologique ou psychanalytique qui focalisent l'interprétation de l'amour sur l'individu ou sur son inconscient (respectivement), puis vis-à-vis de l'épigone de cette lecture, représenté par « l'industrie du self-help » ou développement personnel, vis-à-vis d'un certain féminisme qui aurait fait du recul du patriarcat et de la révolution sexuelle des gages de bonheur et d'épanouissement, enfin vis-à-vis des réductionnismes biologique et neuroscientifique. « Le fait que nous soyons des entités psychologiques […] est un lui-même un fait sociologique. » (p. 31)
Dans cette perspective, la modernité a apporté des changements dans « l'écologie » du milieu des possibilités conjugales, ainsi que dans « l'architecture du choix » du partenaire jusque là inouïs, fondés sur une incomparable liberté personnelle, sur une relative égalité entre les genres (mais au prix d'une inégalité individuelle accrue), sur la quête de la satisfaction sexuelle, sur une rationalisation des critères du choix (malgré la marchandisation de ceux-ci), sur une considération toute nouvelle de l'introspection propre et réciproque (en dépit d'une ontologisation de la personnalité et des sentiments), sur des variables inédites comme l'autonomie et l'engagement asymétrique, enfin sur le phénomène original de la demande de reconnaissance du moi par l'amour. Ces « avancés », dont la valeur n'est point remise en question, n'ont toutefois pas provoqué le bonheur amoureux ; à maints égards, et pour des raisons qui leur sont propres et consubstantielles, elles justifient même un nouveau malheur amoureux, de nouvelles formes de domination, l'approfondissement d'anciennes et de récentes inégalités et injustices. À ce propos, les résultats présentent d'étonnantes analogies avec les phénomènes liés à la libéralisation du marché capitaliste (référence est faite à Zygmund Bauman et à Bourdieu) et le consumérisme sévit d'une façon bien décrite dans le « champ sexuel », là où le choix amoureux – « comme notion conscientisée, réflexive » – prend les formes de la consommation économique.
Thèmes principaux :
La transformation de l'écologie et de l'architecture du choix
due à « des raisons normatives (la révolution sexuelle), sociales (l'affaiblissement de l'endogamie de classe […]), et technologiques (l'apparition de l'Internet et des sites de rencontre) » ;
l'élargissement considérable du choix des partenaires sur un champ indéfiniment ouvert rend le processus plus long et plus complexe, susceptible de réévaluation constante et sujet au calcul des chances d'opérer un meilleur choix ;
il transforme aussi la nature du désir et de la volonté.
L'apparition de champs sexuels
mise en compétition permanente des acteurs et travail incessant d'évaluation de soi et des autres en fonction de leur capital sexuel ;
asymétrie de genre entre la durée de la permanence dans le champ sexuel vs marché matrimonial, laquelle est liée à l'impératif de la reproduction [idée que je conteste] ;
influence du marketing et de l'industrie culturelle dans les critères d'évaluation ;
sexualité cumulative [je dirais plutôt « sérielle »] et détachement de l'affectif et/ou stratégies contradictoires d'attachement et de détachement et leur influence sur la dynamique des rapports ;
phobie de l'engagement (spécifiquement masculine) [idée que je conteste] ;
De nouveaux modes de reconnaissance du moi
dus à l'évolution et la précarisation du statut social provoquant des vulnérabilités accrues dans l'estime de soi, donc « sexualité hypertrophiée » car « transformée en statut » (p. 127) ;
la réussite dans le champ sexuel, et plus particulièrement la contradiction entre autonomie et engagement, ainsi qu'entre attachement et détachement influent sur l'amour de soi, et sa carence entraîne un processus d'auto-accusation ;
« la littérature prolifique consacrée à Mars et à Vénus [... dissimule] une réorganisation des différences de genre autour de l'amour comme source de sentiment de sa valeur (sociale et personnelle) pour les femmes ou du capital sexuel pour les hommes » (p. 376)
L'affaiblissement du désir et le manque de volonté
« L'ironie, la phobie de l'engagement, l'ambivalence, la désillusion […] constituent les composantes principales de ce que j'ai appelé la déstructuration de la volonté et du désir, conduisant de la formation de liens intenses à une froide individualité. Ces quatre composantes expriment la difficulté de s'engager totalement dans le désir de l'autre […] et, plus généralement, un refroidissement de la passion. » (p. 376) ;
très intéressante analyse conclusive (ch. V : « Du fantasme romantique à la désillusion ») de l'évolution de la conceptualisation de l'imagination par rapport au réel (presque un essai autonome), dans le passage entre la littérature et l'Internet : on parvient à la notion très intéressante de « désir autotélique » (i.e. le désir POUR le désir, et le désir DU désir – presque un bouclage de la boucle par rapport à la conception platonicienne de l'amour) [considération mienne propre].
Cette lecture est ardue, truffée de références très hétéroclites, non seulement sociologiques et philosophiques mais allant de la littérature aux entretiens, des blogs aux petites annonces et aux réponses aux lecteurs du New York Times. J'approuve entièrement l'usage du corpus littéraire dans un travail de sociologie culturelle, émettant toutefois la réserve qu'il aurait été plus opportun d'éviter les classiques du XIXe siècle, Jane Austen, Balzac, etc., en leur préférant des auteurs de moindre valeur artistique, donc plus fidèles à l'air du temps et au discours moyen, ne serait-ce que par symétrie avec les sources contemporaines utilisées. Je salue le souci constant de déculpabiliser les amoureux malheureux, contrairement à la démarche psychologique et mercantile américaine (merci à la psychanalyse européenne de nous en épargner aussi).
À certains moments, j'ai eu l'impression que l'effort démonstratif déployé était disproportionné par rapport au consensus autour de la thèse à défendre, provoquant une lourdeur aussi pénible qu'inutile. Je regrette aussi l'absence d'une bibliographie finale, du moment que retrouver une référence dans la pléthore des notes de bas de page s'avère extrêmement difficile.
Par contre j'émets trois critiques très fondamentales sur des questions de fond :
1/sur un aspect de l'asymétrie de genre :
« L'une des principales thèses de ce livre est d'une grande simplicité : les hommes disposent aujourd'hui d'un choix sexuel et émotionnel bien plus grand que les femmes, et c'est ce déséquilibre qui crée une domination affective » (p. 372).
Or, sans essayer de retracer toute une argumentation qui occupe plus de 80 p. soit la totalité du ch. II, il me semble que l'idée peut se résumer à une présence plus longue des hommes que des femmes sur le marché sexuel, et à une moindre perte de valeur sexuelle liée à l'âge chez les premiers : dans ces conditions, l'abondance masculine en nombre et en valeur serait supérieure à tout instant donné, et selon la loi de la demande et de l'offre...
2/ l'aspect culturel est insuffisamment traité : par ex. je sais que, dans le droit américain, la notion de divorce pour faute est encore très prégnante, de sorte que les conséquences financières d'un divorce sont désastreuses pour la partie jugée « fautive » (souvent l'homme), et cela a sans doute des conséquences énormes sur l'engagement matrimonial ; cette situation juridique est absente en Europe.
3/ la primauté (éventuelle) de l'approche sociologique ne peut être que complémentaire par rapport aux autres, dénigrées, et à celles, philosophique et politique, évoquées en filigrane :
« Si le choix est le propre de l'individu moderne, savoir comment et pourquoi les gens choisissent – ou non – de vivre une relation est essentiel pour comprendre l'amour comme expérience de la modernité. » (p. 38). Certes. Encore faut-il aussi savoir, au moins sur un plan personnel, QUI l'on choisit, ne serait-ce que pour tenir compte de tous ceux qui, en dépit de tous les déterminants sociologiques, s'avèrent NE PAS être malheureux en amour.
Sa thèse fondamentale consiste à établir, dans le passage entre les deux modèles, la primauté des déterminants sociologiques – les conditions économiques et sociales de la société – vis-à-vis de la lecture psychologique ou psychanalytique qui focalisent l'interprétation de l'amour sur l'individu ou sur son inconscient (respectivement), puis vis-à-vis de l'épigone de cette lecture, représenté par « l'industrie du self-help » ou développement personnel, vis-à-vis d'un certain féminisme qui aurait fait du recul du patriarcat et de la révolution sexuelle des gages de bonheur et d'épanouissement, enfin vis-à-vis des réductionnismes biologique et neuroscientifique. « Le fait que nous soyons des entités psychologiques […] est un lui-même un fait sociologique. » (p. 31)
Dans cette perspective, la modernité a apporté des changements dans « l'écologie » du milieu des possibilités conjugales, ainsi que dans « l'architecture du choix » du partenaire jusque là inouïs, fondés sur une incomparable liberté personnelle, sur une relative égalité entre les genres (mais au prix d'une inégalité individuelle accrue), sur la quête de la satisfaction sexuelle, sur une rationalisation des critères du choix (malgré la marchandisation de ceux-ci), sur une considération toute nouvelle de l'introspection propre et réciproque (en dépit d'une ontologisation de la personnalité et des sentiments), sur des variables inédites comme l'autonomie et l'engagement asymétrique, enfin sur le phénomène original de la demande de reconnaissance du moi par l'amour. Ces « avancés », dont la valeur n'est point remise en question, n'ont toutefois pas provoqué le bonheur amoureux ; à maints égards, et pour des raisons qui leur sont propres et consubstantielles, elles justifient même un nouveau malheur amoureux, de nouvelles formes de domination, l'approfondissement d'anciennes et de récentes inégalités et injustices. À ce propos, les résultats présentent d'étonnantes analogies avec les phénomènes liés à la libéralisation du marché capitaliste (référence est faite à Zygmund Bauman et à Bourdieu) et le consumérisme sévit d'une façon bien décrite dans le « champ sexuel », là où le choix amoureux – « comme notion conscientisée, réflexive » – prend les formes de la consommation économique.
Thèmes principaux :
La transformation de l'écologie et de l'architecture du choix
due à « des raisons normatives (la révolution sexuelle), sociales (l'affaiblissement de l'endogamie de classe […]), et technologiques (l'apparition de l'Internet et des sites de rencontre) » ;
l'élargissement considérable du choix des partenaires sur un champ indéfiniment ouvert rend le processus plus long et plus complexe, susceptible de réévaluation constante et sujet au calcul des chances d'opérer un meilleur choix ;
il transforme aussi la nature du désir et de la volonté.
L'apparition de champs sexuels
mise en compétition permanente des acteurs et travail incessant d'évaluation de soi et des autres en fonction de leur capital sexuel ;
asymétrie de genre entre la durée de la permanence dans le champ sexuel vs marché matrimonial, laquelle est liée à l'impératif de la reproduction [idée que je conteste] ;
influence du marketing et de l'industrie culturelle dans les critères d'évaluation ;
sexualité cumulative [je dirais plutôt « sérielle »] et détachement de l'affectif et/ou stratégies contradictoires d'attachement et de détachement et leur influence sur la dynamique des rapports ;
phobie de l'engagement (spécifiquement masculine) [idée que je conteste] ;
De nouveaux modes de reconnaissance du moi
dus à l'évolution et la précarisation du statut social provoquant des vulnérabilités accrues dans l'estime de soi, donc « sexualité hypertrophiée » car « transformée en statut » (p. 127) ;
la réussite dans le champ sexuel, et plus particulièrement la contradiction entre autonomie et engagement, ainsi qu'entre attachement et détachement influent sur l'amour de soi, et sa carence entraîne un processus d'auto-accusation ;
« la littérature prolifique consacrée à Mars et à Vénus [... dissimule] une réorganisation des différences de genre autour de l'amour comme source de sentiment de sa valeur (sociale et personnelle) pour les femmes ou du capital sexuel pour les hommes » (p. 376)
L'affaiblissement du désir et le manque de volonté
« L'ironie, la phobie de l'engagement, l'ambivalence, la désillusion […] constituent les composantes principales de ce que j'ai appelé la déstructuration de la volonté et du désir, conduisant de la formation de liens intenses à une froide individualité. Ces quatre composantes expriment la difficulté de s'engager totalement dans le désir de l'autre […] et, plus généralement, un refroidissement de la passion. » (p. 376) ;
très intéressante analyse conclusive (ch. V : « Du fantasme romantique à la désillusion ») de l'évolution de la conceptualisation de l'imagination par rapport au réel (presque un essai autonome), dans le passage entre la littérature et l'Internet : on parvient à la notion très intéressante de « désir autotélique » (i.e. le désir POUR le désir, et le désir DU désir – presque un bouclage de la boucle par rapport à la conception platonicienne de l'amour) [considération mienne propre].
Cette lecture est ardue, truffée de références très hétéroclites, non seulement sociologiques et philosophiques mais allant de la littérature aux entretiens, des blogs aux petites annonces et aux réponses aux lecteurs du New York Times. J'approuve entièrement l'usage du corpus littéraire dans un travail de sociologie culturelle, émettant toutefois la réserve qu'il aurait été plus opportun d'éviter les classiques du XIXe siècle, Jane Austen, Balzac, etc., en leur préférant des auteurs de moindre valeur artistique, donc plus fidèles à l'air du temps et au discours moyen, ne serait-ce que par symétrie avec les sources contemporaines utilisées. Je salue le souci constant de déculpabiliser les amoureux malheureux, contrairement à la démarche psychologique et mercantile américaine (merci à la psychanalyse européenne de nous en épargner aussi).
À certains moments, j'ai eu l'impression que l'effort démonstratif déployé était disproportionné par rapport au consensus autour de la thèse à défendre, provoquant une lourdeur aussi pénible qu'inutile. Je regrette aussi l'absence d'une bibliographie finale, du moment que retrouver une référence dans la pléthore des notes de bas de page s'avère extrêmement difficile.
Par contre j'émets trois critiques très fondamentales sur des questions de fond :
1/sur un aspect de l'asymétrie de genre :
« L'une des principales thèses de ce livre est d'une grande simplicité : les hommes disposent aujourd'hui d'un choix sexuel et émotionnel bien plus grand que les femmes, et c'est ce déséquilibre qui crée une domination affective » (p. 372).
Or, sans essayer de retracer toute une argumentation qui occupe plus de 80 p. soit la totalité du ch. II, il me semble que l'idée peut se résumer à une présence plus longue des hommes que des femmes sur le marché sexuel, et à une moindre perte de valeur sexuelle liée à l'âge chez les premiers : dans ces conditions, l'abondance masculine en nombre et en valeur serait supérieure à tout instant donné, et selon la loi de la demande et de l'offre...
2/ l'aspect culturel est insuffisamment traité : par ex. je sais que, dans le droit américain, la notion de divorce pour faute est encore très prégnante, de sorte que les conséquences financières d'un divorce sont désastreuses pour la partie jugée « fautive » (souvent l'homme), et cela a sans doute des conséquences énormes sur l'engagement matrimonial ; cette situation juridique est absente en Europe.
3/ la primauté (éventuelle) de l'approche sociologique ne peut être que complémentaire par rapport aux autres, dénigrées, et à celles, philosophique et politique, évoquées en filigrane :
« Si le choix est le propre de l'individu moderne, savoir comment et pourquoi les gens choisissent – ou non – de vivre une relation est essentiel pour comprendre l'amour comme expérience de la modernité. » (p. 38). Certes. Encore faut-il aussi savoir, au moins sur un plan personnel, QUI l'on choisit, ne serait-ce que pour tenir compte de tous ceux qui, en dépit de tous les déterminants sociologiques, s'avèrent NE PAS être malheureux en amour.
(Seuil, 2014 - Traduit de l'anglais et de l'allemand par Frédéric Joly)
Considérant la teneur morale des changements de l'époque moderne, la thèse d'Eva Illouz est que le succès de "Cinquante nuances de Grey" n'est pas à chercher dans son contenu érotique/pornographique, mais dans le fait que la relation sadomasochiste mise en scène entre en résonance avec l'état actuel des rapports hommes-femmes. La romance développe un fantasme qui solutionne des contradictions liées à l'état funeste de l'amour et de la sexualité. La sociologue insiste sur la nouvelle dimension culturelle du "self-help" qui prolonge le livre dans la réalité intime des femmes et elle se positionne sur la quête dans laquelle s'inscrit la signification du sadomasochisme (BDSM).
[...].
Quels sont les antagonismes vécus par les femmes que la relation sado-masochisme du roman de E. L. James permettrait de solutionner ? Le féminisme trouve-t-il un terrain propice dans la sexualité ?
[...].
Compte-rendu complet sur le site (cf adresse ci-dessous).
Lien : http://christianwery.blogspo..
Considérant la teneur morale des changements de l'époque moderne, la thèse d'Eva Illouz est que le succès de "Cinquante nuances de Grey" n'est pas à chercher dans son contenu érotique/pornographique, mais dans le fait que la relation sadomasochiste mise en scène entre en résonance avec l'état actuel des rapports hommes-femmes. La romance développe un fantasme qui solutionne des contradictions liées à l'état funeste de l'amour et de la sexualité. La sociologue insiste sur la nouvelle dimension culturelle du "self-help" qui prolonge le livre dans la réalité intime des femmes et elle se positionne sur la quête dans laquelle s'inscrit la signification du sadomasochisme (BDSM).
[...].
Quels sont les antagonismes vécus par les femmes que la relation sado-masochisme du roman de E. L. James permettrait de solutionner ? Le féminisme trouve-t-il un terrain propice dans la sexualité ?
[...].
Compte-rendu complet sur le site (cf adresse ci-dessous).
Lien : http://christianwery.blogspo..
Eva Illouz : Pourquoi l’amour fait mal (2012)
Le titre accrocheur est inspiré de Naomie Wolf (Quand la beauté fait mal, 1990, cité page 108) et sous-titré « L’expérience amoureuse dans la modernité ». Il est enrichi de notes, de résumés, de listes numérotées comme un travail critique mais la rigueur manque. Il ne définit pas l’expérience ni la souffrance amoureuses. L’amour est traité comme un sentiment individuel et non interpersonnel, le confinant au désir et à l’amour-propre, et la seule mention d’un amour réciproque apparait p. 222. La modernité est temporellement définie comme étant la période qui succéda à la première guerre mondiale. En occident, domaine exploré par EI, ce siècle hautement hétérogène a vu un doublement de la population et de l’espérance de vie, les bouleversements de l’urbanisation, la régression des convictions religieuses, l’accès des deux sexes à l’éducation, à la responsabilité économique et au vote, et l’émergence de la contraception et de l’avortement volontaire. L’influence de ces mutations n’est guère abordée et la littérature scientifique sur la morbimortalité associée à la rupture des relations de couple n’est pas mentionnée. Les sources déclarées sont les romans sentimentaux pour l’amour romantique, et, pour l’amour moderne (lire du XXIème siècle), un large éventail de manuels dédiés à la relation amoureuse, à la rencontre, au mariage et au divorce ; des sites internet de rencontre ; et pour finir une analyse de la chronique « Modern love » du New York Times. Il est enfin question de 70 entretiens où la personne interrogée la plus jeune a 25 ans, et la plus âgée 67, et toutes ont suivi des études supérieures. Ces interviews excluent les plus jeunes, donc les premières amours, et représentent un point de vue occidental, urbain, féminin, hétérosexuel dans une catégorie socio-culturelle favorisée. L’amour est la recherche du mariage dans l’amour romantique et de la quête impossible d’une relation stable dans l’amour moderne.
La thèse d’EI est que le malheur de l’amour contemporain vient d’une structure concurrentielle et capitaliste du marché amoureux, de l’abondance sexuelle et de la phobie masculine de l’engagement. De ce point de vue et dans ce milieu, le rôle parmi d’autres de ces facteurs est probable mais l’argumentation est purement rhétorique en terrain biaisé. Il manque des faits : ils pourraient venir de la comparaison du milieu urbain et du milieu rural pour le rôle du marché amoureux, de la comparaison du mainstream et des minorités (Pakistanais d’Angleterre, orthodoxes d’Israël, mormons des USA) pour le rôle de l’engagement, avec les ajustement nécessaires sur le revenu et le niveau d’éducation. Le style est redondant avec une inflation de mots-valise (phobie masculine de l’engagement, psyché déficiente, sexualisation des femmes), de caricatures (l’hétérosexualité compulsive qui définit les différentes formes d’humiliation, de dénigrement et de mépris dont les femmes font systématiquement l’objet de la part des hommes), et d’affirmations hasardeuses (Dans le texte de Descartes, l’expérience du doute revêt un caractère jubilatoire, dans l’acception lacanienne du terme, semblable au plaisir que prend un bébé à anticiper le contrôle sur son corps , Sex and the City, que beaucoup considèrent comme une bible des relations amoureuses modernes, Marx, héritier et militant des lumières), etc.
Le titre accrocheur est inspiré de Naomie Wolf (Quand la beauté fait mal, 1990, cité page 108) et sous-titré « L’expérience amoureuse dans la modernité ». Il est enrichi de notes, de résumés, de listes numérotées comme un travail critique mais la rigueur manque. Il ne définit pas l’expérience ni la souffrance amoureuses. L’amour est traité comme un sentiment individuel et non interpersonnel, le confinant au désir et à l’amour-propre, et la seule mention d’un amour réciproque apparait p. 222. La modernité est temporellement définie comme étant la période qui succéda à la première guerre mondiale. En occident, domaine exploré par EI, ce siècle hautement hétérogène a vu un doublement de la population et de l’espérance de vie, les bouleversements de l’urbanisation, la régression des convictions religieuses, l’accès des deux sexes à l’éducation, à la responsabilité économique et au vote, et l’émergence de la contraception et de l’avortement volontaire. L’influence de ces mutations n’est guère abordée et la littérature scientifique sur la morbimortalité associée à la rupture des relations de couple n’est pas mentionnée. Les sources déclarées sont les romans sentimentaux pour l’amour romantique, et, pour l’amour moderne (lire du XXIème siècle), un large éventail de manuels dédiés à la relation amoureuse, à la rencontre, au mariage et au divorce ; des sites internet de rencontre ; et pour finir une analyse de la chronique « Modern love » du New York Times. Il est enfin question de 70 entretiens où la personne interrogée la plus jeune a 25 ans, et la plus âgée 67, et toutes ont suivi des études supérieures. Ces interviews excluent les plus jeunes, donc les premières amours, et représentent un point de vue occidental, urbain, féminin, hétérosexuel dans une catégorie socio-culturelle favorisée. L’amour est la recherche du mariage dans l’amour romantique et de la quête impossible d’une relation stable dans l’amour moderne.
La thèse d’EI est que le malheur de l’amour contemporain vient d’une structure concurrentielle et capitaliste du marché amoureux, de l’abondance sexuelle et de la phobie masculine de l’engagement. De ce point de vue et dans ce milieu, le rôle parmi d’autres de ces facteurs est probable mais l’argumentation est purement rhétorique en terrain biaisé. Il manque des faits : ils pourraient venir de la comparaison du milieu urbain et du milieu rural pour le rôle du marché amoureux, de la comparaison du mainstream et des minorités (Pakistanais d’Angleterre, orthodoxes d’Israël, mormons des USA) pour le rôle de l’engagement, avec les ajustement nécessaires sur le revenu et le niveau d’éducation. Le style est redondant avec une inflation de mots-valise (phobie masculine de l’engagement, psyché déficiente, sexualisation des femmes), de caricatures (l’hétérosexualité compulsive qui définit les différentes formes d’humiliation, de dénigrement et de mépris dont les femmes font systématiquement l’objet de la part des hommes), et d’affirmations hasardeuses (Dans le texte de Descartes, l’expérience du doute revêt un caractère jubilatoire, dans l’acception lacanienne du terme, semblable au plaisir que prend un bébé à anticiper le contrôle sur son corps , Sex and the City, que beaucoup considèrent comme une bible des relations amoureuses modernes, Marx, héritier et militant des lumières), etc.
Une sociologue qui prend, pour démontrer ses propos, les héroïnes de Jane Austen en exemple indiscutable, déjà, ça m'a paru louche, mais vu que Madame Austen est reconnue pour être un chef d'orchestre absolument époustouflant, je ne me suis pas méfiée...
Que plus du quart du livre s'évertue à gesticuler autour des rites amoureux du XVIIIème ou XIXème siècle, passe encore.
Mais qu'Eva Illouz n'ait pas pensé un instant que derrière les faux-semblant de la haute société européenne pouvait se cacher un monde parallèle dans lequel l'amour pouvait être totalement détaché de l'attachement matrimonial... pas facile d'adhérer...
Et puis que, pompeuse, madame se répète, revienne en arrière dans des affirmations douteuses sur la place de l'homme ou de la femme dans la société moderne, ça m'a fichu le bourdon.
J'ai démissionné en cours de route, honte à moi !
Que plus du quart du livre s'évertue à gesticuler autour des rites amoureux du XVIIIème ou XIXème siècle, passe encore.
Mais qu'Eva Illouz n'ait pas pensé un instant que derrière les faux-semblant de la haute société européenne pouvait se cacher un monde parallèle dans lequel l'amour pouvait être totalement détaché de l'attachement matrimonial... pas facile d'adhérer...
Et puis que, pompeuse, madame se répète, revienne en arrière dans des affirmations douteuses sur la place de l'homme ou de la femme dans la société moderne, ça m'a fichu le bourdon.
J'ai démissionné en cours de route, honte à moi !
Eva Illouz livre une étude fine et inédite de nos rapports amoureux à l'aune des mutations de la modernité, et, au premier chef, de la montée en puissance de l'individu.
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
Lien : http://www.nonfiction.fr/art..
ATTENTION CHEF D'OEUVRE ! Quel bijou que ce livre que j'ai acheté par hasard ! Une rigueur dans l'analyse, une véritable reconstruction historique et sociologique des formes amoureuses de notre époque. L'auteur soutient en effet que si l'amour a certainement toujours existé, il existe des amours, des souffrances et des désillusions qui sont typiquement modernes. Le plan est solide, les phrases confinent au sublime tant elles sont par moment bien écrites et emplies à la fois de lucidité et de sagesse. Vraiment impressionnant. Les références sont diverses et variées, interdisciplinaires. Jamais un auteur n'a autant montré que la sociologie pouvait être rigoureuse ; et jamais un auteur n'a autant rappelé que la sociologie a pris pour thème de sa recherche les souffrances de la condition humaine : pauvreté, misère, oppression politique, le suicide chez Durkheim, certes ; et maintenant, pourrait-on ajouter, les souffrances de l'amour et des désillusions avec cette sociologue. Ce qui est terrible me semble-t-t-il, c'est aussi ce qui est implicitement suggéré même si l'auteur ne le dit pas : nous sommes faits pour nous faire souffrir au sujet de l'amour. Nous sommes responsables de nos désillusions, de nos déceptions. La rationalisation extrême de nos demandes (sur nous-mêmes : est-ce que j'aime vraiment ? ; sur les causes de notre amour : est-ce une passion passagère ? ; sur les nombreux paramètres espérés : gentil, beau, courtois, intelligent, charmant, etc etc ; sur les modèles idéaux et imaginaires : mais n'y a t-il pas mieux, est-ce qu'il n'y a pas une autre histoire possible qui serait plus épanouissante ?) entraîne une véritable souffrance dont nous sommes la cause. Incontournable.
Comment expliquer le succès phénoménal qu’a connu le livre « Cinquante nuances de Grey » sorti il y a quelque temps ? Rappelons le sujet de ce livre pour les rares qui seraient restés à l’écart du battage médiatique orchestré autour de ce roman :
L’héroïne de cette trilogie est une jeune fille, Anastasia (Ana pour les intimes) qui, lorsqu’elle achève ses études, est initiée à la sexualité, à l’amour et à la vie professionnelle (dans l’édition) à travers sa liaison avec un homme adepte de formes sophistiquées de SM .
Une des raisons de ce succès, selon l’auteure Eva Illouz, professeur de sociologie à l’Université Hébraïque de Jérusalem, est qu’il s’agit d’un roman pour femmes, promu comme un roman pour femmes. Ce roman a occupé la première place du palmarès des best-sellers du New York Times pendant dix semaines, en Europe il a eu beaucoup de succès également . Il a fait l’objet de plus de 500 commentaires sur Babelio, score qui sera longtemps inégalé je pense..
Plus qu’un roman pour femmes, ce roman illustre parfaitement les nouvelles relations qui se dessinent actuellement entre hommes et femmes dans notre société post-féministe.
Il montre bien en effet que la sexualité peut être vue par de nombreuses femmes comme un lieu de connaissance de soi et d’une découverte de leur identité mais aussi comme un problème.
Problème venant essentiellement de ce que la sexualité féminine peut apparaître comme prise en étau entre la liberté sexuelle et une structure sociale traditionnelle de la famille.
Là où les codes et comportements attendus étaient très clairs, et ce jusqu’à la fin du 20ème siècle, une nouvelle réalité se dessine : les codes ont changé et chacun des partenaires doit défendre son autonomie tout en « négociant » les conditions d’ attachement ou de vie commune avec son partenaire.
Et c’est là que le personnage d’Ana prend toute sa force : même si elle accepte la participation à certaines pratiques de son richissime amant, elle négocie sans arrêt quitte à partir provisoirement.. pour revenir ensuite dans de meilleures conditions.
Je ne suis pas toujours entièrement convaincue par la démonstration de Eva Illouz mais en tout cas son livre m’a passionnée, bien plus que le livre dont elle fait l’analyse !
Elle traite le sujet en sociologue et son approche est passionnante.
Force est de constater que la sexualité constitue un « marqueur » des rapports de force et que l’évolution qu’on voit depuis plusieurs années est complexe et a des répercussions importantes.
Le héros du livre , comme l’explique Mme Illouz, illustre la nouvelle tendance de développement de la sexualité « sérielle » (visant à multiplier les expériences) et récréative.
Le livre montre que la situation de la femme est encore loin d’égaler celle de l’homme ; celle-ci devant interpréter les signes qui lui sont donnés. Attachement réel ou pas ? That’s the question…
Christian Grey, le héros, incarnerait l’homme moderne tel que le perçoivent les femmes d’aujourd’hui : ambigu, inconstant, prévenant et inquiétant, vulnérable et puissant.
L’angoisse dans tout cela, c’est que le désir, l’autonomie, la négociation, la réciprocité et l’égalité sont des forces qui tirent et poussent dans des directions difficilement prévisibles.
D’autant plus que, comme le souligne si justement Eva Illouz, le caractère sélectif et inachevé de la révolution féministe a rendu terriblement complexes les relations affectives et sexuelles.
Un petit résumé pour éclairer encore ce sujet difficile :
Le livre « Cinquante nuances de Grey » est devenu un best-seller mondial car internet l’a rendu accessible, parce qu’il est en résonance avec la tradition du roman d’amour (même si cela n’apparaît pas au premier abord).. ; et parce qu’il est «performatif » (même si on peut le regretter) il transforme les pratiques des gens en les décrivant.
Un excellent travail de sociologue qui nous fait mieux comprendre les enjeux d’aujourd’hui.
En tout cas cela ne m’a pas donné envie de relire « Cinquante nuances de Grey » livre qui m’avait profondément ennuyée…
L’héroïne de cette trilogie est une jeune fille, Anastasia (Ana pour les intimes) qui, lorsqu’elle achève ses études, est initiée à la sexualité, à l’amour et à la vie professionnelle (dans l’édition) à travers sa liaison avec un homme adepte de formes sophistiquées de SM .
Une des raisons de ce succès, selon l’auteure Eva Illouz, professeur de sociologie à l’Université Hébraïque de Jérusalem, est qu’il s’agit d’un roman pour femmes, promu comme un roman pour femmes. Ce roman a occupé la première place du palmarès des best-sellers du New York Times pendant dix semaines, en Europe il a eu beaucoup de succès également . Il a fait l’objet de plus de 500 commentaires sur Babelio, score qui sera longtemps inégalé je pense..
Plus qu’un roman pour femmes, ce roman illustre parfaitement les nouvelles relations qui se dessinent actuellement entre hommes et femmes dans notre société post-féministe.
Il montre bien en effet que la sexualité peut être vue par de nombreuses femmes comme un lieu de connaissance de soi et d’une découverte de leur identité mais aussi comme un problème.
Problème venant essentiellement de ce que la sexualité féminine peut apparaître comme prise en étau entre la liberté sexuelle et une structure sociale traditionnelle de la famille.
Là où les codes et comportements attendus étaient très clairs, et ce jusqu’à la fin du 20ème siècle, une nouvelle réalité se dessine : les codes ont changé et chacun des partenaires doit défendre son autonomie tout en « négociant » les conditions d’ attachement ou de vie commune avec son partenaire.
Et c’est là que le personnage d’Ana prend toute sa force : même si elle accepte la participation à certaines pratiques de son richissime amant, elle négocie sans arrêt quitte à partir provisoirement.. pour revenir ensuite dans de meilleures conditions.
Je ne suis pas toujours entièrement convaincue par la démonstration de Eva Illouz mais en tout cas son livre m’a passionnée, bien plus que le livre dont elle fait l’analyse !
Elle traite le sujet en sociologue et son approche est passionnante.
Force est de constater que la sexualité constitue un « marqueur » des rapports de force et que l’évolution qu’on voit depuis plusieurs années est complexe et a des répercussions importantes.
Le héros du livre , comme l’explique Mme Illouz, illustre la nouvelle tendance de développement de la sexualité « sérielle » (visant à multiplier les expériences) et récréative.
Le livre montre que la situation de la femme est encore loin d’égaler celle de l’homme ; celle-ci devant interpréter les signes qui lui sont donnés. Attachement réel ou pas ? That’s the question…
Christian Grey, le héros, incarnerait l’homme moderne tel que le perçoivent les femmes d’aujourd’hui : ambigu, inconstant, prévenant et inquiétant, vulnérable et puissant.
L’angoisse dans tout cela, c’est que le désir, l’autonomie, la négociation, la réciprocité et l’égalité sont des forces qui tirent et poussent dans des directions difficilement prévisibles.
D’autant plus que, comme le souligne si justement Eva Illouz, le caractère sélectif et inachevé de la révolution féministe a rendu terriblement complexes les relations affectives et sexuelles.
Un petit résumé pour éclairer encore ce sujet difficile :
Le livre « Cinquante nuances de Grey » est devenu un best-seller mondial car internet l’a rendu accessible, parce qu’il est en résonance avec la tradition du roman d’amour (même si cela n’apparaît pas au premier abord).. ; et parce qu’il est «performatif » (même si on peut le regretter) il transforme les pratiques des gens en les décrivant.
Un excellent travail de sociologue qui nous fait mieux comprendre les enjeux d’aujourd’hui.
En tout cas cela ne m’a pas donné envie de relire « Cinquante nuances de Grey » livre qui m’avait profondément ennuyée…
Ce livre raconte l’histoire de l’amour hétérosexuel et de la souffrance moderne, une conjugalité non moins violente ni moins asymétrique que l’amour romantique, en particulier pour les femmes.
Lien : http://www.laviedesidees.fr/..
Lien : http://www.laviedesidees.fr/..
La sociologue Eva Illouz brode 400 pages qui mêlent haute littérature et courrier du coeur. Dense, profond, et symptomatique.
Lien : http://rss.nouvelobs.com/c/3..
Lien : http://rss.nouvelobs.com/c/3..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Eva Illouz
Quiz
Voir plus
Comment te dire Adieu ?
Tous les garçons et les filles de mon âge Se promènent dans la rue deux par deux Tous les garçons et les filles de mon âge Savent bien ce que c'est d'être ...?...
deux
affreux
heureux
vieux
10 questions
151 lecteurs ont répondu
Thème :
Françoise HardyCréer un quiz sur cet auteur151 lecteurs ont répondu