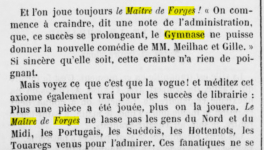Critiques de Georges Ohnet (13)
Le docteur Davidoff, raconte une histoire au cours d'une soirée donnée par le prince où un certain Patrizzi Wladimir Alexievich, voyant sa bien-aimée Maria Fodorowna en train de mourir va voir une sorcière. La sorcière lui administra un breuvage auquel il va succomber octroyant son âme à sa bien-aimée. Celle-ci survit et l'âme de son amoureux vivra en elle. Autrement, ils restent unis pour toujours.. Alors Pierre Laurrier, prenant exemple à cette histoire, tentera l'expérience....
Un livre qui se lit plutôt bien, malgré l'aspect un peu hermétique, ça se lit d'une traite, on retrouve des passions d'amour perturbées qui veulent vaincre la mort...
Un livre qui se lit plutôt bien, malgré l'aspect un peu hermétique, ça se lit d'une traite, on retrouve des passions d'amour perturbées qui veulent vaincre la mort...
Égaré, cherchant ses repères, Pascal rencontre une jolie jeune fille à qui il demande secours. La jeune l'accompagne et lui indique le chemin. A la fin, ils ont demandé à se présenter chacun à son tour : Mlle Clairefont et lui Pascal Carvajan... Surpris, leur doux sourire se transforme en dédain....
Une guerre est déclarée entre ces deux familles. Celle habitant la grande Marnière, la famille Clairefont et celle de Neuville, la famille Carvajan. Les Clairefont sont une grande fortune de l’Angleterre installée en France. Les Calvajan, dont le père est le maire de la ville bénéficie du soutien des habitants de la ville dans ce conflit. Mais Pascal Cavaljan, amoureux de Mlle Clairefont va remuer les anciens souvenirs du passé de ces deux familles…
Une histoire vraiment classique, et contée classiquement avec des respirations purement classique. L’histoire est passionnante, on le lit comme on lirait facilement le comte de Monte-christo. Mais j’ai été gênée par trop de détails de l’auteur…
Une guerre est déclarée entre ces deux familles. Celle habitant la grande Marnière, la famille Clairefont et celle de Neuville, la famille Carvajan. Les Clairefont sont une grande fortune de l’Angleterre installée en France. Les Calvajan, dont le père est le maire de la ville bénéficie du soutien des habitants de la ville dans ce conflit. Mais Pascal Cavaljan, amoureux de Mlle Clairefont va remuer les anciens souvenirs du passé de ces deux familles…
Une histoire vraiment classique, et contée classiquement avec des respirations purement classique. L’histoire est passionnante, on le lit comme on lirait facilement le comte de Monte-christo. Mais j’ai été gênée par trop de détails de l’auteur…
(Critique du roman le plus lu du XIXè siècle, adapté au théâtre et commenté par Francisque Sarcey dont je reprends intégralement les propos)
Il y a dans ce succès un enseignement. Tandis qu'une école de révolutionnaires bruyants prétend bouleverser de fond en comble les vieilles règles et nous apporter un art nouveau, voici un homme qui réussit, disons mieux, qui va aux nues, tout simplement parce qu'il sait son métier, parce qu'il nous donne ce qu'on appelait autrefois une pièce bien faite.
Le drame de M. Ohnet est fondé sur des sentiments que tout le monde comprend et qui intéresse tout le monde parce qu'ils sont les sentiments communs de la nature humaine ; il est clairement exposé, déduit avec logique ; un dénouement heureux le conclut. Il n'en faut pas davantage, je ne dis pas pour écrire un chef-d'oeuvre, mais pour plaire deux ou trois cents fois de suite au public.
Et moi aussi, certes, j'aurais bien des regrets à exprimer en parlant de l'oeuvre de M. Ohnet : l'étude des passions est superficielle ; les caractères tiennent plus de la convention que de la réalité ; le style, encore qu'il ait le mouvement dramatique, est de conversation courante, entre gens qui parlent une langue ordinaire. Non, à coup sûr, je ne regarde pas le *Maître de forges* comme un chef-d'oeuvre.
Voyez pourtant, ô jeunes gens, ce que peuvent au théâtre des qualités dont vous faites orgueilleusement fi : la science des combinaisons, la dextérité et la sûreté de main, l'art de conduire logiquement une seule et même idée, sous forme dramatique, de l'exposition au dénouement, puisque, avec ces seuls mérites, sans philosophie, sans poésie, et presque sans style, M. Ohnet a conquis le public tout entier. Regardez ce que deviennent à côté des ouvrages à prétentions plus hautes.
M. Ohnet a, dans son *Maître de forges*, mis en oeuvre une idée qui n'est pas fort nouvelle. Mais qu'importe au théâtre ! Il ne s'agit pas là de faire ce que n'a fait personne encore, mais de bien faire ce qu'on fait.
Une femme d'un caractère altier a été poussée par les circonstances à épouser, avec un autre amour dans le coeur, un homme qu'il lui était permis de croire au-dessous d'elle et qui l'aimait passionnément.
Le mari, comme il arrive souvent, s'est trouvé être supérieur de tous points à l'amant. Il se produit dans son âme, et à la suite d'un son coeur, un lent revirement ; mais elle met une certaine pudeur à exprimer les nouveaux sentiments qui l'agitent à l'homme qu'elle a affecté de mépriser ; ce serait lui donner le spectacle de sa défaite, et l'orgueil la retient sur le bord d'une déclaration qu'elle attend, car il a lui aussi sa fierté, et ne peut ni ne veut faire les premiers pas.
Un événement, qui mettra en jeu la vie de son mari, précipitera le coeur de l'épouse, et la jettera, éperdue et repentante, aux bras de celui qu'elle aime à présent, qui seul méritait d'être aimé d'elle et qui lui pardonne en l'embrassant. Ce baiser, le baiser de la réconciliation, est aussi le baiser de dénouement.
L'intérêt du *Maître de forges* est dans la peinture de cette âme qui part de la haine et du mépris pour arriver, en passant par toutes sortes de sentiments intermédiaires, à l'amour le plus exalté. Il y a drame, puisqu'il y a mouvement. L'art de l'écrivain consistera à marquer d'un trait vif et pittoresque les divers moments que traverse cette passion, avant d'arriver au but qu'il avait désigné d'avance.
Je sais guère d'exposition plus claire, plus nette, plus vivante que celle du *Maître de forges*. Ce premier acte est celle d'un homme qui a la pleine possession de son outil ; qui le manie avec une parfaite sûreté de main.
Nous voyons tout d'abord Mlle Claire de Beaulieu triste, préoccupée. Elle aime le jeune duc de Bligny, son cousin. Elle s'est, dès son enfance, habituée à le regarder comme son fiancé ; le duc a laissé croire que son intention formelle était d'épouser Claire ; les deux familles, qui voyaient ce mariage avec plaisir, ont permis aux deux jeunes gens de vivre ensemble, de se dire qu'ils s'aimaient.
Or, le duc est parti pour un voyage, et l'on n'a plus eu de ses nouvelles. Pourquoi n'écrit-il pas ? Claire a l'âme noble, elle ne saurait le soupçonner d'une trahison. Mais, pourtant, elle ne saurait se longtemps sans donner de nouvelles !
Le silence du jeune duc ne s'explique que trop.
Un vieil ami de la famille des Beaulieu tire la mère à part, et lui apprend deux choses également cruelles : la première, c'est qu'elle vient de perdre en Angleterre un procès, où feu son mari s'était engagé et d'où dépendait sa fortune ; la seconde, c'est que le duc de Bligny, que l'on croît encore en voyage, est revenu depuis quinze jours à Paris ; il s'est laissé emporter aux amours faciles ; il a eu des besoins d'argent, il a joué, il a perdu ; la dernière culotte est de cent mille francs : une culotte définitive, car il n'a pas le premier sou.
Ce n'est pas en se mariant avec Claire, ruinée à présent, qu'il raccommodera ses affaires. Il tourne donc autour de Mlle Moulinet, la fille d'un homme qui s'est enrichi à vendre du chocolat exempt de cacao, une fille de dix millions, s'il vous plaît. On croit qu'il a demandé officiellement sa main.
Mme de Beaulieu est atterrée de ces deux nouvelles. Mais elle estime qu'il vaut mieux les cacher l'une et l'autre à sa fille. La pauvre enfant les apprendra toujours assez tôt.
Le vieil ami, qui est un homme sage et très au courant du pays où Mme de Beaulieu vient passer la belle saison, lui parle discrètement d'un certain M. Philippe Derblay, maître de forges, qui est en train de faire une immense fortune ; c'est un jeune homme grand d'avenir ; il commande à deux mille ouvriers ; il sera, le jour où il le voudra, député et peut-être ministre. Il aime silencieusement et passionnément Mlle Claire. Si on lui donnait un signe d'encouragement...
Ce Philippe Derblay, nous l'avons vu en effet dans une visite qu'il a faite avec sa soeur au château. Il est distingué et aimable ; on sent chez lui un homme supérieur. Mais quoi ! c'est un roturier et un forgeron.
Mme de Beaulieu ne repousse que faiblement l'idée d'une mésalliance. Mais comment persuader à Claire, qui est d'un caractère si hautain, de renoncer à un duc qu'elle aime, pour donner sa main à un homme qui n'est que riche et qu'elle n'aime pas ?
Ce mariage semble impossible, et il faut qu'il se fasse, car c'est de ce mariage que partira le drame.
M. Georges Ohnet a trouvé un moyen très simple, très ingénieux et j'ajouterai très dramatique, car il est pris dans le caractère même de Mlle Claire de Beaulieu. C'est précisément parce qu'elle est de coeur altier qu'elle va, sans réfléchir, par coup de tête, se jeter dans une mésalliance.
Je vous ai parlé de Mlle Moulinet, cette fille de dix millions, à qui le duc de Bligny fait la cour. Eh bien, cette jeune personne a été élevée autrefois au même couvent où se trouvaient Mlle Claire de Beaulieu et l'une de ses cousines. C'était un couvent où l'on n'admettait guère que des filles de noblesse. Aussi M. Moulinet l'avait-il choisi pour sa fille. Elle y avait été horriblement malheureuse ; elle avait eu à subir les plaisanteries de ses compagnes ; elle avait été tourmentée de tous les serpents de l'envie.
Vous jugez de son plaisir quand elle voit le duc de Bligny, qui passait partout pour le fiancé de Mlle de Beaulieu, lui faire la cour et demander sa main. Quelle revanche pour elle ! Elle allait donc traiter sur un pied d'égalité avec ces filles de l'aristocratie, et les écraser de ses millions. Mais il y a une vengeance plus délicate, plus féminine, qu'elle a méditée de se payer, sans qu'il lui en coûte rien.
Elle vient avec son père au château De Beaulieu s'autorisant des vieilles relations qu'a créées entre les deux jeunes filles une camaraderie de couvent. Elle a, dit-elle, un conseil à demander à sa bonne amie Claire.
Ce conseil, vous le devinez bien : peut-elle et doit-elle épouser le duc de Bligny ? Elle a su, par hasard, que le duc s'était engagé avec Claire. Si Claire y tient, elle est trop honnête personne pour aller sur les brisées d'une amie, elle le lui cède.
Elle parle longtemps sur ce ton, enfonçant le poignard et le retournant dans le coeur de la malheureuse Claire, qui cache de son mieux sa douleur et son désespoir.
Comment faire pour répondre tout de suite à cette insolente provocation, pour montrer à ce duc infidèle et déloyal, à cette péronnelle impertinente, qu'on ne se soucie pas d'eux, qu'on a de quoi les dédaigner ?
Il faut trouver un mari.
- M. Philippe Derblay est-il toujours dans les mêmes dispositions ? Demande-t-elle.
Et comme il répond qu'obtenir sa main serait le comble de ses voeux :
- La voici ! Dit-elle.
Et, se tournant vers toute la compagnie qui entre :
- Ma chère amie, dit-elle à Mlle Moulinet, vous venez de m'annoncer votre mariage avec M. le duc, permettez-moi de vous faire part du mien : j'épouse M. Philippe Derblay.
Voilà un mariage fait par dépit ; nous sentons bien qu'il en sortira des tempêtes. Nous le sentons d'autant mieux que la fière jeune fille, en épousant Philippe Derblay, croît ne faire qu'une mésalliance. Elle se se doute pas qu'on peut l'accuser de s'être vendue, car elle est pauvre à cette heure et il est riche. Qu'adviendra-t-il quand elle apprendra ce secret ? (elle ignorait encore la ruine récente de sa famille) Et il faudra qu'elle l'apprenne un jour ou l'autre.
L'avenir est donc gros de complications et de mystères.
Et si vous saviez comme tout cela nous est présenté avec grâce et animation ! En quelques mots justes et expressifs, l'auteur nous met au courant de tous ces personnages. Nous faisons connaissance, non seulement avec les deux héros du drame, Philippe Derblay et Claire de Beaulieu, mais avec nombre de personnages épisodiques.
C'est M. Moulinet père, le parvenu du chocolat, qui fait d'un air bon enfant la roue avec ses millions, débite avec l'aplomb du millionnaire d'énormes sottises dont souffre tout bas sa fille, et répète à tout propos : M. le duc, mon gendre. C'est sa fille, la belle Athénaïs, avec ses allures vipérines, son parler doucereux, son art tout féminin de distiller le poison de la médisance : c'est le duc de Bligny, un viveur sans coeur ni esprit, qui n'a pour lui que les manières du grand courage et le courage du gentilhomme ; c'est Mme de Préfont, une cousine de Claire, entichée comme elle de préjugés nobiliaires, mais quia eu la chance de rencontrer un bon mari qui l'adore et qu'elle fait marcher à la baguette, rieuse, spirituelle et de bon conseil ; c'est la mère, Mme de Beaulieu, une digue et aimable douairière, dont la sagesse plait par un tour d'attendrissement maternel ; c'est le frère de Claire, un garçon de coeur généreux et de parole vive, qui couperait volontiers les deux oreilles au duc pour lui apprendre à ne plus aimer sa soeur : c'est Bachelin, le vieil ami de la famille De Beaulieu, le raisonneur de la comédie ; tout ce monde va, bien, s'agite, se croise, sans confusion, révélant son caractère par un mot, le mot juste et qui frappe, jusqu'à la scène à effet qui clôt par un coup de théâtre ce merveilleux premier acte.
Le mariage vient d'être célébré, à minuit, sans apparat, dans la chapelle du château. Les invités, qui étaient peu nombreux, se sont retirés ; on a laissé la jeune femme seule au salon en costume de mariée. Elle est agitée, nerveuse. Voilà le terrible moment venu ; elle est engagée ; il faut payer. Les suites de son coup de tête lui inspirent une sorte d'horreur. Elle ne s'est pas encore expliquée de son coeur avec celui qui est aujourd'hui son mari. le mariage a été si vite décidé ! Elle l'a si peu vu durant les délais règlementaires ! Et puis, elle reculait devant cette déclaration ! Bref ! La voilà acculée.
Le mari entre : Il remarque chez sa femme certaines hésitations, qui lui paraissent toutes naturelles. C'est un honnête homme, un homme délicat : il comprend ses scrupules de pudeur chez une jeune épouse. Il les excuse, bien qu'il en soit un peu chagrin. Il lui offre de se retirer, de la laisser seule à ses réflexions ou à son sommeil. Il s'approche pour lui dire adieu ; il semble que la scène soit terminée là.
Il faut cependant qu'elle revive, si l'on veut que le sujet soit pleinement exposé. Comment et sur quoi se fera le revirement du mari ?
Le mari, au moment de déposer sur les cheveux de sa femme un baiser d'adieu, se laisse aller à un mouvement de passion, et, la serrant de bras pressé sur sa poitrine :
— Si vous saviez pourtant, lui murmure-t-il tout bas, comme je vous aime !
À cet enlacement subit, l'orgueil de la jeune femme s'est révolté. Elle a eu un mouvement de répulsion ; elle s'est, d'un geste inconscient et subit, débarrassée du bras qui l'étreignait.
Ce geste est pour Philippe comme un trait de lumière.
Ce n'est plus là le mouvement de pudeur d'une jeune fille qui hésite au seuil de l'inconnu, c'est de la répugnance, c'est de l'aversion, une aversion qu'explique seul un autre amour.
— Vous aimez encore le duc, s'écrie-t-il désespéré et furieux.
Elle, dans un transport de révolte :
— Et quand cela serait ?
Voyez avec quelle facilité la scène tourne sur un simple geste. Dans la première partie, les deux époux ont épuisé toutes les raisons, tirées de l'ordre commun, qui poussent l'un à désirer et à prier, l'autre à se dérober. Dans la seconde, après une volte-face subite, tous deux vont aller jusqu'au bout de la situation nouvelle que ce geste leur a créée.
Le mari, ce mari si humble et si suppliant tout à l'heure, s'est redressé sous l'outrage.
Sa femme lui dit : Gardez ma dot ; c'est la rançon de ma liberté.
Ce mot de rançon lui brûle les lèvres ; cette dot, il ne la touchée, puisqu'elle n'existe pas.
Mais il se tait par pudeur. Au surplus, ce n'est plus la vision de la dot qui le touche. Ce qui lui fait monter le rouge au front et les larmes aux yeux, c'est l'horreur qu'elle lui témoigne, et cela quand c'est elle-même qui l'a choisi, qui lui a en quelque sorte demandé sa main ! Il ne peut se tenir d'indignation et lui crie que désormais leur vie sera irrémédiablement séparée.
— Voici votre appartement ; voici le mien.
Et il ajoute que, dût-elle un jour se jeter à ses pieds pour lui demander l'oubli de cette nuit cruelle, jamais il ne l'admettra à rentrer en grâce.
C'est un autre homme que celui qu'elle avait connu : un homme énergique qui lui impose ; elle sentirait presque une envie de s'humilier, de revenir sur ce qu'elle a dit, mais son orgueil l'arrête ; elle traverse la scène d'un pas lent, s'arrête un instant devant la porte de la chambre à coucher, et la pousse d'un geste où il y a comme du regret mêlé à son dépit.
Son mari la suit des yeux et voyant retomber la porte sur elle :
— Je t'adore, s'écrie-t-il, mais je te briserai.
Ainsi s'annonce la lutte qui va remplir le drame (…)
C'est la fête de Mme Derblay. Il y a réception à l'usine, et nous y revoyons tous les personnages qui ont défilé sous nos yeux au premier acte, même le duc de Bligny et la duchesse, la belle Athénaïs, que l'on a dû inviter, parce qu'ils sont de la famille et qu'on n'a pas voulu faire d'esclandre. Les ouvriers ont délégué un des leurs pour offrir un bouquet à Mme Derblay, qui fait le bonheur de leur patron ; la fête est gaie, on lui fait compliment de la joie qu'elle répand autour d'elle. Au milieu de toutes ces félicitations, Claire est horriblement triste. Ce mari qu'elle croyait détester a su l'aimer, elle se met à l'aimer. Il est si bon, si grand, si généreux ! Tout le monde l'estime et l'honore, tout le monde a l'air de croire qu'il est en passe d'arriver à tout. Et ce mari, elle l'a dédaigné ! Elle n'est plus rien pour lui ! Il l'accable en public de prévenances et de cadeaux, mais il est glacé avec elle, et si par hasard une phrase de regret est près d'éclore sur ses lèvres, il l'arrête d'un mot froid ou d'un geste sceptique.
Mais voici ce qui est bien pire.
Elle commence à connaître les tourments de la jalousie. Tandis que le duc tourne autour d'elle et lui débite des fadeurs, — ah ! il prend bien son temps, le duc ! — Athénaïs fait mine d'accaparer Philippe, elle lui demande son bras, elle s'extasie sur ses moindres mots ; elle joue la femme amoureuse, enchantée que ces coquetteries fassent enrager sa bonne amie.
Le sang monte aux joues de Claire. Elle n'est pas de celles qui peuvent s'attarder aux situations équivoques. Il lui faut une explication avec Athénaïs, une explication complète.
Athénaïs n'a pas besoin de se cacher : elle tient le bon bout, elle est duchesse de Bligny. Elle joue donc franc jeu avec son ancienne camarade de couvent.
— Eh bien, oui, lui dit-elle, c'est une revanche. Tu m'as humiliée à la pension avec ton titre et ta fortune, c'est mon tour aujourd'hui...
Ah ! C'est ainsi ! Vous avez déjà vu de quels coups de tête Claire est capable dans un mouvement de passion.
Elle se laisse cette fois emporter à une incartade tout aussi funeste en conséquences que l'a été la première.
— Monsieur le duc, dit-elle, s'adressant à son cousin, donnez votre bras à Mme de Bligny et ramenez-la ; je la chasse.
Athénaïs reste suffoquée.
— Ne me défendez-vous pas, monsieur le duc ? s'écrie-t-elle ; me laisserez-vous insulter ainsi ?
Le duc est mis au pied du mur. Il se tourne vers Philippe.
— Prenez-vous la responsabilité de ce qu'a dit Mme Derblay ?
— Je tiens pour bien dit et pour bien fait tout ce que dit et fait Mme Derblay, répond Philippe.
Un duel est inévitable, et, quand la toile se relève, nous sommes chez Philippe, qui prend ses dernières dispositions.
Mme Derblay est folle de douleur : c'est elle qui est cause de tout le mal, c'est elle qui a jeté son mari dans ce danger terrible. Elle ne peut rien pour le sauver et elle l'adore. Elle se traîne à ses pieds et il reste impassible. Il ne la trouve pas encore assez punie.
On le trouverait peut-être un peu cruel de ne pas céder ; mais quoi ! lui aussi, il est jaloux.
— Eh ! bien, oui, je le hais, ce duc qui m'a pris votre amour. Si je l'ai reçu chez moi, c'est que je guettais l'occasion d'une querelle ; vous me l'avez fournie, je la saisis aux cheveux et je vais le tuer, si je puis.
Rien de plus vrai et de plus émouvant.
Le dénouement est court.
La scène représente le coin du parc où les deux adversaires doivent se battre. Nous assistons aux préparatifs du duel entre Philippe et le duc. Ils sont placés à vingt pas, le dos tourné l'un à l'autre. Au commandement, ils doivent se retourner et tirer à volonté.
La formule sacramentelle est dite ; tous deux font volte-face. Mais avant de tirer, maîtresse Mme Derblay épie le moment ; elle s'est jetée au-devant du pistolet, reçoit la balle dans la poitrine et tombe.
Cet incident met naturellement fin au combat.
Philippe se jette sur le corps de sa femme. Elle se relève péniblement.
— Un seul mot : m'aimes-tu ?
— Je t'adore.
— Ah ! comme nous allons être heureux !
Vous pensez bien qu'elle guérira, qu'ils vivront en effet très heureux, comme dans les contes de fées et qu'ils auront, toujours comme dans les contes de fées, beaucoup d'enfants.
Cette pièce charmante est jouée à ravir.
Il y a dans ce succès un enseignement. Tandis qu'une école de révolutionnaires bruyants prétend bouleverser de fond en comble les vieilles règles et nous apporter un art nouveau, voici un homme qui réussit, disons mieux, qui va aux nues, tout simplement parce qu'il sait son métier, parce qu'il nous donne ce qu'on appelait autrefois une pièce bien faite.
Le drame de M. Ohnet est fondé sur des sentiments que tout le monde comprend et qui intéresse tout le monde parce qu'ils sont les sentiments communs de la nature humaine ; il est clairement exposé, déduit avec logique ; un dénouement heureux le conclut. Il n'en faut pas davantage, je ne dis pas pour écrire un chef-d'oeuvre, mais pour plaire deux ou trois cents fois de suite au public.
Et moi aussi, certes, j'aurais bien des regrets à exprimer en parlant de l'oeuvre de M. Ohnet : l'étude des passions est superficielle ; les caractères tiennent plus de la convention que de la réalité ; le style, encore qu'il ait le mouvement dramatique, est de conversation courante, entre gens qui parlent une langue ordinaire. Non, à coup sûr, je ne regarde pas le *Maître de forges* comme un chef-d'oeuvre.
Voyez pourtant, ô jeunes gens, ce que peuvent au théâtre des qualités dont vous faites orgueilleusement fi : la science des combinaisons, la dextérité et la sûreté de main, l'art de conduire logiquement une seule et même idée, sous forme dramatique, de l'exposition au dénouement, puisque, avec ces seuls mérites, sans philosophie, sans poésie, et presque sans style, M. Ohnet a conquis le public tout entier. Regardez ce que deviennent à côté des ouvrages à prétentions plus hautes.
M. Ohnet a, dans son *Maître de forges*, mis en oeuvre une idée qui n'est pas fort nouvelle. Mais qu'importe au théâtre ! Il ne s'agit pas là de faire ce que n'a fait personne encore, mais de bien faire ce qu'on fait.
Une femme d'un caractère altier a été poussée par les circonstances à épouser, avec un autre amour dans le coeur, un homme qu'il lui était permis de croire au-dessous d'elle et qui l'aimait passionnément.
Le mari, comme il arrive souvent, s'est trouvé être supérieur de tous points à l'amant. Il se produit dans son âme, et à la suite d'un son coeur, un lent revirement ; mais elle met une certaine pudeur à exprimer les nouveaux sentiments qui l'agitent à l'homme qu'elle a affecté de mépriser ; ce serait lui donner le spectacle de sa défaite, et l'orgueil la retient sur le bord d'une déclaration qu'elle attend, car il a lui aussi sa fierté, et ne peut ni ne veut faire les premiers pas.
Un événement, qui mettra en jeu la vie de son mari, précipitera le coeur de l'épouse, et la jettera, éperdue et repentante, aux bras de celui qu'elle aime à présent, qui seul méritait d'être aimé d'elle et qui lui pardonne en l'embrassant. Ce baiser, le baiser de la réconciliation, est aussi le baiser de dénouement.
L'intérêt du *Maître de forges* est dans la peinture de cette âme qui part de la haine et du mépris pour arriver, en passant par toutes sortes de sentiments intermédiaires, à l'amour le plus exalté. Il y a drame, puisqu'il y a mouvement. L'art de l'écrivain consistera à marquer d'un trait vif et pittoresque les divers moments que traverse cette passion, avant d'arriver au but qu'il avait désigné d'avance.
Je sais guère d'exposition plus claire, plus nette, plus vivante que celle du *Maître de forges*. Ce premier acte est celle d'un homme qui a la pleine possession de son outil ; qui le manie avec une parfaite sûreté de main.
Nous voyons tout d'abord Mlle Claire de Beaulieu triste, préoccupée. Elle aime le jeune duc de Bligny, son cousin. Elle s'est, dès son enfance, habituée à le regarder comme son fiancé ; le duc a laissé croire que son intention formelle était d'épouser Claire ; les deux familles, qui voyaient ce mariage avec plaisir, ont permis aux deux jeunes gens de vivre ensemble, de se dire qu'ils s'aimaient.
Or, le duc est parti pour un voyage, et l'on n'a plus eu de ses nouvelles. Pourquoi n'écrit-il pas ? Claire a l'âme noble, elle ne saurait le soupçonner d'une trahison. Mais, pourtant, elle ne saurait se longtemps sans donner de nouvelles !
Le silence du jeune duc ne s'explique que trop.
Un vieil ami de la famille des Beaulieu tire la mère à part, et lui apprend deux choses également cruelles : la première, c'est qu'elle vient de perdre en Angleterre un procès, où feu son mari s'était engagé et d'où dépendait sa fortune ; la seconde, c'est que le duc de Bligny, que l'on croît encore en voyage, est revenu depuis quinze jours à Paris ; il s'est laissé emporter aux amours faciles ; il a eu des besoins d'argent, il a joué, il a perdu ; la dernière culotte est de cent mille francs : une culotte définitive, car il n'a pas le premier sou.
Ce n'est pas en se mariant avec Claire, ruinée à présent, qu'il raccommodera ses affaires. Il tourne donc autour de Mlle Moulinet, la fille d'un homme qui s'est enrichi à vendre du chocolat exempt de cacao, une fille de dix millions, s'il vous plaît. On croit qu'il a demandé officiellement sa main.
Mme de Beaulieu est atterrée de ces deux nouvelles. Mais elle estime qu'il vaut mieux les cacher l'une et l'autre à sa fille. La pauvre enfant les apprendra toujours assez tôt.
Le vieil ami, qui est un homme sage et très au courant du pays où Mme de Beaulieu vient passer la belle saison, lui parle discrètement d'un certain M. Philippe Derblay, maître de forges, qui est en train de faire une immense fortune ; c'est un jeune homme grand d'avenir ; il commande à deux mille ouvriers ; il sera, le jour où il le voudra, député et peut-être ministre. Il aime silencieusement et passionnément Mlle Claire. Si on lui donnait un signe d'encouragement...
Ce Philippe Derblay, nous l'avons vu en effet dans une visite qu'il a faite avec sa soeur au château. Il est distingué et aimable ; on sent chez lui un homme supérieur. Mais quoi ! c'est un roturier et un forgeron.
Mme de Beaulieu ne repousse que faiblement l'idée d'une mésalliance. Mais comment persuader à Claire, qui est d'un caractère si hautain, de renoncer à un duc qu'elle aime, pour donner sa main à un homme qui n'est que riche et qu'elle n'aime pas ?
Ce mariage semble impossible, et il faut qu'il se fasse, car c'est de ce mariage que partira le drame.
M. Georges Ohnet a trouvé un moyen très simple, très ingénieux et j'ajouterai très dramatique, car il est pris dans le caractère même de Mlle Claire de Beaulieu. C'est précisément parce qu'elle est de coeur altier qu'elle va, sans réfléchir, par coup de tête, se jeter dans une mésalliance.
Je vous ai parlé de Mlle Moulinet, cette fille de dix millions, à qui le duc de Bligny fait la cour. Eh bien, cette jeune personne a été élevée autrefois au même couvent où se trouvaient Mlle Claire de Beaulieu et l'une de ses cousines. C'était un couvent où l'on n'admettait guère que des filles de noblesse. Aussi M. Moulinet l'avait-il choisi pour sa fille. Elle y avait été horriblement malheureuse ; elle avait eu à subir les plaisanteries de ses compagnes ; elle avait été tourmentée de tous les serpents de l'envie.
Vous jugez de son plaisir quand elle voit le duc de Bligny, qui passait partout pour le fiancé de Mlle de Beaulieu, lui faire la cour et demander sa main. Quelle revanche pour elle ! Elle allait donc traiter sur un pied d'égalité avec ces filles de l'aristocratie, et les écraser de ses millions. Mais il y a une vengeance plus délicate, plus féminine, qu'elle a méditée de se payer, sans qu'il lui en coûte rien.
Elle vient avec son père au château De Beaulieu s'autorisant des vieilles relations qu'a créées entre les deux jeunes filles une camaraderie de couvent. Elle a, dit-elle, un conseil à demander à sa bonne amie Claire.
Ce conseil, vous le devinez bien : peut-elle et doit-elle épouser le duc de Bligny ? Elle a su, par hasard, que le duc s'était engagé avec Claire. Si Claire y tient, elle est trop honnête personne pour aller sur les brisées d'une amie, elle le lui cède.
Elle parle longtemps sur ce ton, enfonçant le poignard et le retournant dans le coeur de la malheureuse Claire, qui cache de son mieux sa douleur et son désespoir.
Comment faire pour répondre tout de suite à cette insolente provocation, pour montrer à ce duc infidèle et déloyal, à cette péronnelle impertinente, qu'on ne se soucie pas d'eux, qu'on a de quoi les dédaigner ?
Il faut trouver un mari.
- M. Philippe Derblay est-il toujours dans les mêmes dispositions ? Demande-t-elle.
Et comme il répond qu'obtenir sa main serait le comble de ses voeux :
- La voici ! Dit-elle.
Et, se tournant vers toute la compagnie qui entre :
- Ma chère amie, dit-elle à Mlle Moulinet, vous venez de m'annoncer votre mariage avec M. le duc, permettez-moi de vous faire part du mien : j'épouse M. Philippe Derblay.
Voilà un mariage fait par dépit ; nous sentons bien qu'il en sortira des tempêtes. Nous le sentons d'autant mieux que la fière jeune fille, en épousant Philippe Derblay, croît ne faire qu'une mésalliance. Elle se se doute pas qu'on peut l'accuser de s'être vendue, car elle est pauvre à cette heure et il est riche. Qu'adviendra-t-il quand elle apprendra ce secret ? (elle ignorait encore la ruine récente de sa famille) Et il faudra qu'elle l'apprenne un jour ou l'autre.
L'avenir est donc gros de complications et de mystères.
Et si vous saviez comme tout cela nous est présenté avec grâce et animation ! En quelques mots justes et expressifs, l'auteur nous met au courant de tous ces personnages. Nous faisons connaissance, non seulement avec les deux héros du drame, Philippe Derblay et Claire de Beaulieu, mais avec nombre de personnages épisodiques.
C'est M. Moulinet père, le parvenu du chocolat, qui fait d'un air bon enfant la roue avec ses millions, débite avec l'aplomb du millionnaire d'énormes sottises dont souffre tout bas sa fille, et répète à tout propos : M. le duc, mon gendre. C'est sa fille, la belle Athénaïs, avec ses allures vipérines, son parler doucereux, son art tout féminin de distiller le poison de la médisance : c'est le duc de Bligny, un viveur sans coeur ni esprit, qui n'a pour lui que les manières du grand courage et le courage du gentilhomme ; c'est Mme de Préfont, une cousine de Claire, entichée comme elle de préjugés nobiliaires, mais quia eu la chance de rencontrer un bon mari qui l'adore et qu'elle fait marcher à la baguette, rieuse, spirituelle et de bon conseil ; c'est la mère, Mme de Beaulieu, une digue et aimable douairière, dont la sagesse plait par un tour d'attendrissement maternel ; c'est le frère de Claire, un garçon de coeur généreux et de parole vive, qui couperait volontiers les deux oreilles au duc pour lui apprendre à ne plus aimer sa soeur : c'est Bachelin, le vieil ami de la famille De Beaulieu, le raisonneur de la comédie ; tout ce monde va, bien, s'agite, se croise, sans confusion, révélant son caractère par un mot, le mot juste et qui frappe, jusqu'à la scène à effet qui clôt par un coup de théâtre ce merveilleux premier acte.
Le mariage vient d'être célébré, à minuit, sans apparat, dans la chapelle du château. Les invités, qui étaient peu nombreux, se sont retirés ; on a laissé la jeune femme seule au salon en costume de mariée. Elle est agitée, nerveuse. Voilà le terrible moment venu ; elle est engagée ; il faut payer. Les suites de son coup de tête lui inspirent une sorte d'horreur. Elle ne s'est pas encore expliquée de son coeur avec celui qui est aujourd'hui son mari. le mariage a été si vite décidé ! Elle l'a si peu vu durant les délais règlementaires ! Et puis, elle reculait devant cette déclaration ! Bref ! La voilà acculée.
Le mari entre : Il remarque chez sa femme certaines hésitations, qui lui paraissent toutes naturelles. C'est un honnête homme, un homme délicat : il comprend ses scrupules de pudeur chez une jeune épouse. Il les excuse, bien qu'il en soit un peu chagrin. Il lui offre de se retirer, de la laisser seule à ses réflexions ou à son sommeil. Il s'approche pour lui dire adieu ; il semble que la scène soit terminée là.
Il faut cependant qu'elle revive, si l'on veut que le sujet soit pleinement exposé. Comment et sur quoi se fera le revirement du mari ?
Le mari, au moment de déposer sur les cheveux de sa femme un baiser d'adieu, se laisse aller à un mouvement de passion, et, la serrant de bras pressé sur sa poitrine :
— Si vous saviez pourtant, lui murmure-t-il tout bas, comme je vous aime !
À cet enlacement subit, l'orgueil de la jeune femme s'est révolté. Elle a eu un mouvement de répulsion ; elle s'est, d'un geste inconscient et subit, débarrassée du bras qui l'étreignait.
Ce geste est pour Philippe comme un trait de lumière.
Ce n'est plus là le mouvement de pudeur d'une jeune fille qui hésite au seuil de l'inconnu, c'est de la répugnance, c'est de l'aversion, une aversion qu'explique seul un autre amour.
— Vous aimez encore le duc, s'écrie-t-il désespéré et furieux.
Elle, dans un transport de révolte :
— Et quand cela serait ?
Voyez avec quelle facilité la scène tourne sur un simple geste. Dans la première partie, les deux époux ont épuisé toutes les raisons, tirées de l'ordre commun, qui poussent l'un à désirer et à prier, l'autre à se dérober. Dans la seconde, après une volte-face subite, tous deux vont aller jusqu'au bout de la situation nouvelle que ce geste leur a créée.
Le mari, ce mari si humble et si suppliant tout à l'heure, s'est redressé sous l'outrage.
Sa femme lui dit : Gardez ma dot ; c'est la rançon de ma liberté.
Ce mot de rançon lui brûle les lèvres ; cette dot, il ne la touchée, puisqu'elle n'existe pas.
Mais il se tait par pudeur. Au surplus, ce n'est plus la vision de la dot qui le touche. Ce qui lui fait monter le rouge au front et les larmes aux yeux, c'est l'horreur qu'elle lui témoigne, et cela quand c'est elle-même qui l'a choisi, qui lui a en quelque sorte demandé sa main ! Il ne peut se tenir d'indignation et lui crie que désormais leur vie sera irrémédiablement séparée.
— Voici votre appartement ; voici le mien.
Et il ajoute que, dût-elle un jour se jeter à ses pieds pour lui demander l'oubli de cette nuit cruelle, jamais il ne l'admettra à rentrer en grâce.
C'est un autre homme que celui qu'elle avait connu : un homme énergique qui lui impose ; elle sentirait presque une envie de s'humilier, de revenir sur ce qu'elle a dit, mais son orgueil l'arrête ; elle traverse la scène d'un pas lent, s'arrête un instant devant la porte de la chambre à coucher, et la pousse d'un geste où il y a comme du regret mêlé à son dépit.
Son mari la suit des yeux et voyant retomber la porte sur elle :
— Je t'adore, s'écrie-t-il, mais je te briserai.
Ainsi s'annonce la lutte qui va remplir le drame (…)
C'est la fête de Mme Derblay. Il y a réception à l'usine, et nous y revoyons tous les personnages qui ont défilé sous nos yeux au premier acte, même le duc de Bligny et la duchesse, la belle Athénaïs, que l'on a dû inviter, parce qu'ils sont de la famille et qu'on n'a pas voulu faire d'esclandre. Les ouvriers ont délégué un des leurs pour offrir un bouquet à Mme Derblay, qui fait le bonheur de leur patron ; la fête est gaie, on lui fait compliment de la joie qu'elle répand autour d'elle. Au milieu de toutes ces félicitations, Claire est horriblement triste. Ce mari qu'elle croyait détester a su l'aimer, elle se met à l'aimer. Il est si bon, si grand, si généreux ! Tout le monde l'estime et l'honore, tout le monde a l'air de croire qu'il est en passe d'arriver à tout. Et ce mari, elle l'a dédaigné ! Elle n'est plus rien pour lui ! Il l'accable en public de prévenances et de cadeaux, mais il est glacé avec elle, et si par hasard une phrase de regret est près d'éclore sur ses lèvres, il l'arrête d'un mot froid ou d'un geste sceptique.
Mais voici ce qui est bien pire.
Elle commence à connaître les tourments de la jalousie. Tandis que le duc tourne autour d'elle et lui débite des fadeurs, — ah ! il prend bien son temps, le duc ! — Athénaïs fait mine d'accaparer Philippe, elle lui demande son bras, elle s'extasie sur ses moindres mots ; elle joue la femme amoureuse, enchantée que ces coquetteries fassent enrager sa bonne amie.
Le sang monte aux joues de Claire. Elle n'est pas de celles qui peuvent s'attarder aux situations équivoques. Il lui faut une explication avec Athénaïs, une explication complète.
Athénaïs n'a pas besoin de se cacher : elle tient le bon bout, elle est duchesse de Bligny. Elle joue donc franc jeu avec son ancienne camarade de couvent.
— Eh bien, oui, lui dit-elle, c'est une revanche. Tu m'as humiliée à la pension avec ton titre et ta fortune, c'est mon tour aujourd'hui...
Ah ! C'est ainsi ! Vous avez déjà vu de quels coups de tête Claire est capable dans un mouvement de passion.
Elle se laisse cette fois emporter à une incartade tout aussi funeste en conséquences que l'a été la première.
— Monsieur le duc, dit-elle, s'adressant à son cousin, donnez votre bras à Mme de Bligny et ramenez-la ; je la chasse.
Athénaïs reste suffoquée.
— Ne me défendez-vous pas, monsieur le duc ? s'écrie-t-elle ; me laisserez-vous insulter ainsi ?
Le duc est mis au pied du mur. Il se tourne vers Philippe.
— Prenez-vous la responsabilité de ce qu'a dit Mme Derblay ?
— Je tiens pour bien dit et pour bien fait tout ce que dit et fait Mme Derblay, répond Philippe.
Un duel est inévitable, et, quand la toile se relève, nous sommes chez Philippe, qui prend ses dernières dispositions.
Mme Derblay est folle de douleur : c'est elle qui est cause de tout le mal, c'est elle qui a jeté son mari dans ce danger terrible. Elle ne peut rien pour le sauver et elle l'adore. Elle se traîne à ses pieds et il reste impassible. Il ne la trouve pas encore assez punie.
On le trouverait peut-être un peu cruel de ne pas céder ; mais quoi ! lui aussi, il est jaloux.
— Eh ! bien, oui, je le hais, ce duc qui m'a pris votre amour. Si je l'ai reçu chez moi, c'est que je guettais l'occasion d'une querelle ; vous me l'avez fournie, je la saisis aux cheveux et je vais le tuer, si je puis.
Rien de plus vrai et de plus émouvant.
Le dénouement est court.
La scène représente le coin du parc où les deux adversaires doivent se battre. Nous assistons aux préparatifs du duel entre Philippe et le duc. Ils sont placés à vingt pas, le dos tourné l'un à l'autre. Au commandement, ils doivent se retourner et tirer à volonté.
La formule sacramentelle est dite ; tous deux font volte-face. Mais avant de tirer, maîtresse Mme Derblay épie le moment ; elle s'est jetée au-devant du pistolet, reçoit la balle dans la poitrine et tombe.
Cet incident met naturellement fin au combat.
Philippe se jette sur le corps de sa femme. Elle se relève péniblement.
— Un seul mot : m'aimes-tu ?
— Je t'adore.
— Ah ! comme nous allons être heureux !
Vous pensez bien qu'elle guérira, qu'ils vivront en effet très heureux, comme dans les contes de fées et qu'ils auront, toujours comme dans les contes de fées, beaucoup d'enfants.
Cette pièce charmante est jouée à ravir.
J'ai acheté ce livre à une brocante, pourquoi je ne sais pas trop... Parce qu'il n'y avait aucun résumé et que l'auteur est un oublié de l'histoire de la littérature ? Ou peut être que c'est cette irrésistible odeur de vieux papier qui m'a conquise...
On comprends pourquoi ce n'est pas un grand nom de la littérature du XIXème siècle : le style est assez simple et épuré, sans réels style ou identité. Néanmoins très agréable à lire. Ce qui plonge véritablement le lecteur dans l'histoire ce sont ces deux personnages principaux à forts caractères qu'on ne peut s'empêcher d'aimer et de détester et dont les rapports conflictuels ne sont pas sans rappeler une certaine Elizabeth et un certain Mr Darcy. L'histoire est bien menée avec une fin romanesque, haute en couleurs qui clôt une belle histoire d'amour.
Si vous chercher une belle plume et un grand roman passez votre chemin mais pour se délasser et passer un bon moment c'est le bon livre !
On comprends pourquoi ce n'est pas un grand nom de la littérature du XIXème siècle : le style est assez simple et épuré, sans réels style ou identité. Néanmoins très agréable à lire. Ce qui plonge véritablement le lecteur dans l'histoire ce sont ces deux personnages principaux à forts caractères qu'on ne peut s'empêcher d'aimer et de détester et dont les rapports conflictuels ne sont pas sans rappeler une certaine Elizabeth et un certain Mr Darcy. L'histoire est bien menée avec une fin romanesque, haute en couleurs qui clôt une belle histoire d'amour.
Si vous chercher une belle plume et un grand roman passez votre chemin mais pour se délasser et passer un bon moment c'est le bon livre !
J'étais JEUNE, JEUne, jeune... lorsque j'ai lu ce livre. Je m'en souviens encore, j'ai tant pleuré à la fin ! Faire une critique ? Non, j'en suis incapable !!!!! Mais c'était si beau ! ! !
Vingt-et-unième volume du cycle des "Batailles de la Vie", "Gens De La Noce" est à compter comme l'un des meilleurs romans de Georges Ohnet, si ce n'est le meilleur. Après le très feuilletonnesque et hasardeux "Au Fond du Gouffre", Georges Ohnet revenait avec brio à ce qu'il savait faire de mieux : le portrait à charge des mœurs bourgeoises de son temps
"Gens De La Noce" est avant tout la dissection à vif d'une jeunesse nantie, désabusée et désordonnée, au sein d'un groupe d'amis trentenaires, installés chichement dans l'existence sans avoir jamais fait d'efforts pour cela : dilettantes, fils de riches industriels, épouses délaissées, aventurières entretenues, tous habitués à faire "la noce" ensemble, entendez par là les sorties en ville, mondaines et éthyliques, au sein desquelles cette élite croulant sous l'argent tente de noyer son ennui profond d'une existence linéaire et déterminée.
Au cœur de ce groupe, un couple peu assorti : Monsieur et Mme Laiglise, puis leurs amants respectifs et officiels, Valentine de Rétif pour l'un, Jean de Thomiès pour l'autre, tous deux étant aussi entre eux d'anciens amants. Et enfin, un groupe d'amis plus ou moins parasitaire autour de ce quatuor de base.
On va ensemble au théâtre, dans les cabarets, dans les bars interlopes. On y fait aussi des affaires : Etienne Laiglise est à la tête d'une société industrielle florissante, bien que ses bénéfices s'évaporent en cadeaux pour Mme de Rétif. On a toujours quelqu'un à lui recommander, un projet à lui vendre, une faveur à lui demander. Il s'y prête de bonne grâce, se sentant le généreux pacha de tous ses compagnons d'ennuis.
Tout pourrait continuer ainsi pendant bien des années, mais un duo inattendu rejoint, un peu malgré lui et au hasard des investissements, ce groupe de parisiens décadents : il s'agit de M. Prévinquières, ancien banquier, ruiné il y a quelques années et honni de tous à ce titre, mais qui revient millionnaire, après une longue expatriation en Afrique, où il a monté de très profitables affaires. Il présente à nos gens de la noce sa ravissante et virginale fille, Mlle de Prévinquières, créature charmante, douce et d'une exemplaire moralité.
Ces nouveaux arrivants, tous deux d'une bonhomie et d'une candeur provinciales, font une forte impression sur les deux amants officiels, Valentine de Rétif et Jean de Thomiès, qui partagent une même inquiétude pour l'avenir. Ils ont tous deux dépassé la trentaine. Aimant vivre sur un grand pied, ils sont de grands dépensiers aux patrimoines agonisants, et rêvent secrètement de finir en beauté sur un mariage bourgeois aux allures de retour à zéro, qui leur assurerait à la foi le confort d'une fortune solide et l'assurance repentante de vieillir au sein d'une union heureuse. Ensemble, ils décident d'intriguer, Valentine pour épouser M. de Prévinquières, Jean pour épouser sa fille, tout en s'épaulant mutuellement pour rompre en douceur et sans scandale avec les Laiglise.
Dans ce monde d'apparat, où l'on craint surtout le scandale, leur démarche a de bonnes chances de réussite, car ces deux esprits aiguisés sont des intelligences perverses, capables de développer des trésors d'hypocrisie et de manipulations adroites. Malheureusement, Jacqueline Laiglise s'est laissée prendre au piège des sentiments. Terriblement déçue par son mariage avec Etienne, elle s'est raccrochée avec tout le désespoir d'une femme trahie à ce cher Jean de Thomiès.
Son instinct de femme lui révèle très vite que Thomiès a la tête ailleurs, et elle ne comprend que trop bien quelle femme nouvellement arrivée absorbe ses pensées. De son côté, ayant réussi à convaincre Prévinquières de l'épouser, Valentine de Rétif impose un douloureux silence aux allures de fin de non-recevoir à Etienne Laiglise, qui dans un premiers temps, croit voir tout son univers s'écrouler. Lui et sa femme comprennent cependant que leurs amants respectifs se sont entendus pour les abandonner. Persuadé que Jean de Thomiès est seul à l'origine de cette intrigue, Etienne Laiglise le provoque en duel au révolver. Folle de douleur à l'idée de voir les deux hommes de sa vie s'entretuer, impuissante à apaiser les orgueils démesurés de l'un et de l'autre, Jacqueline les empêche de s'affronter de la seule manière qui soit possible pour elle : en se suicidant au domicile de Thomiès.
Cet acte d'amour sacrificiel et ultime renvoie chacun des gens de la noce face à sa mesquinerie et à sa médiocrité égoïste. Les mariages annoncés ne se feront pas, le groupe des gens de la noce se dissout, ses membres n'auront plus jamais le cœur à la fête. Brisé par la culpabilité, Jean de Thomiès s'expatrie en Orient, tandis qu'Etienne Laiglise, lentement, se laisse couler en délaissant ses affaires...
"Gens De La Noce" peut sembler assez dépassé quant aux problématiques qu'il développe, la décadence de ce groupe d'amis ne nous semblant guère aussi scandaleuse qu'en son temps, et le mariage ayant bien moins aujourd'hui ce symbole à la fois carcéral et sécuritaire. Néanmoins, Georges Ohnet sait avec une impressionnante maîtrise nous faire pénétrer dans ce groupe de fêtards hautains et prétentieux comme dans un labyrinthe qui ne nous révèle les arcanes de cette communauté que pour mieux nous en démontrer les verrous terribles et inéluctables qui enchaînent ces gens les uns aux autres.
Ohnet nous démontre merveilleusement de quelle manière un groupe de gens au final assez mal dans leur peau parviennent à se faire illusion mutuellement par le biais d'une décadence forcée et orchestrée qui permet à ces esprits, au fond puissamment conservateurs, de sauver les apparences et de s'abandonner, d'une manière extrêmement codifiée, à des actes et des adultères pervers qui leur semblent une revanche sur leurs frustrations mutuelles.
À ce jeu de miroirs, où chacun contemple le reflet qu'il aimerait avoir, seule Jacqueline se laisse prendre jusqu'à la passion amoureuse, et elle le paye de sa vie, éclaboussant de son sang les strass et les paillettes d'individus fats et imbus d'eux-mêmes. De par leur fraîcheur et leur innocence, les Prévinquières père et fille sont les déclencheurs involontaires de cette brutale désagrégation d'un groupe d'amis dont tous les liens sont fondés sur des mensonges.
On trouvera néanmoins ces figures idéales, incarnant des vertus hautement chrétiennes, quelque peu desséchées comparées à nos valeurs morales contemporaines, mais là aussi, le lustre du temps n'empêche pas de saisir toute la richesse et la cruauté d'un drame inéluctable. Dialoguiste de génie, Georges Ohnet s'en donne à cœur joie dans ce roman très bavard, très théâtral, où chaque pique fait mouche, et où l'orgueil et le dédain trahissent les âmes même les plus candides. Il y a quelque chose de définitivement proustien, dans "Gens De La Noce", mais avec quelque chose de terriblement noir et de définitivement misanthrope.
Esprit conservateur mais incroyablement tourmenté, Georges Ohnet signe ici l'une de ses démonstrations les plus abouties au sein d'un roman fascinant, envoûtant, mais terriblement malaisé, qui témoigne en plus de la mentalité implacable et irresponsable de la très haute-bourgeoisie au tournant du siècle.
Joyau noir jeté en travers de l'image souvent idyllique que l'on se fait de la Belle Époque, "Gens De La Noce" est un piège machiavélique d'une grande qualité littéraire, quintessence absolue d'un écrivain qui fut en son temps amèrement critiqué, non sans raison, mais dont l'oeuvre, de par sa monomanie sadique, orgueilleuse et dérangeante, demeure quelque chose d'absolument unique dans la littérature française.
"Gens De La Noce" est avant tout la dissection à vif d'une jeunesse nantie, désabusée et désordonnée, au sein d'un groupe d'amis trentenaires, installés chichement dans l'existence sans avoir jamais fait d'efforts pour cela : dilettantes, fils de riches industriels, épouses délaissées, aventurières entretenues, tous habitués à faire "la noce" ensemble, entendez par là les sorties en ville, mondaines et éthyliques, au sein desquelles cette élite croulant sous l'argent tente de noyer son ennui profond d'une existence linéaire et déterminée.
Au cœur de ce groupe, un couple peu assorti : Monsieur et Mme Laiglise, puis leurs amants respectifs et officiels, Valentine de Rétif pour l'un, Jean de Thomiès pour l'autre, tous deux étant aussi entre eux d'anciens amants. Et enfin, un groupe d'amis plus ou moins parasitaire autour de ce quatuor de base.
On va ensemble au théâtre, dans les cabarets, dans les bars interlopes. On y fait aussi des affaires : Etienne Laiglise est à la tête d'une société industrielle florissante, bien que ses bénéfices s'évaporent en cadeaux pour Mme de Rétif. On a toujours quelqu'un à lui recommander, un projet à lui vendre, une faveur à lui demander. Il s'y prête de bonne grâce, se sentant le généreux pacha de tous ses compagnons d'ennuis.
Tout pourrait continuer ainsi pendant bien des années, mais un duo inattendu rejoint, un peu malgré lui et au hasard des investissements, ce groupe de parisiens décadents : il s'agit de M. Prévinquières, ancien banquier, ruiné il y a quelques années et honni de tous à ce titre, mais qui revient millionnaire, après une longue expatriation en Afrique, où il a monté de très profitables affaires. Il présente à nos gens de la noce sa ravissante et virginale fille, Mlle de Prévinquières, créature charmante, douce et d'une exemplaire moralité.
Ces nouveaux arrivants, tous deux d'une bonhomie et d'une candeur provinciales, font une forte impression sur les deux amants officiels, Valentine de Rétif et Jean de Thomiès, qui partagent une même inquiétude pour l'avenir. Ils ont tous deux dépassé la trentaine. Aimant vivre sur un grand pied, ils sont de grands dépensiers aux patrimoines agonisants, et rêvent secrètement de finir en beauté sur un mariage bourgeois aux allures de retour à zéro, qui leur assurerait à la foi le confort d'une fortune solide et l'assurance repentante de vieillir au sein d'une union heureuse. Ensemble, ils décident d'intriguer, Valentine pour épouser M. de Prévinquières, Jean pour épouser sa fille, tout en s'épaulant mutuellement pour rompre en douceur et sans scandale avec les Laiglise.
Dans ce monde d'apparat, où l'on craint surtout le scandale, leur démarche a de bonnes chances de réussite, car ces deux esprits aiguisés sont des intelligences perverses, capables de développer des trésors d'hypocrisie et de manipulations adroites. Malheureusement, Jacqueline Laiglise s'est laissée prendre au piège des sentiments. Terriblement déçue par son mariage avec Etienne, elle s'est raccrochée avec tout le désespoir d'une femme trahie à ce cher Jean de Thomiès.
Son instinct de femme lui révèle très vite que Thomiès a la tête ailleurs, et elle ne comprend que trop bien quelle femme nouvellement arrivée absorbe ses pensées. De son côté, ayant réussi à convaincre Prévinquières de l'épouser, Valentine de Rétif impose un douloureux silence aux allures de fin de non-recevoir à Etienne Laiglise, qui dans un premiers temps, croit voir tout son univers s'écrouler. Lui et sa femme comprennent cependant que leurs amants respectifs se sont entendus pour les abandonner. Persuadé que Jean de Thomiès est seul à l'origine de cette intrigue, Etienne Laiglise le provoque en duel au révolver. Folle de douleur à l'idée de voir les deux hommes de sa vie s'entretuer, impuissante à apaiser les orgueils démesurés de l'un et de l'autre, Jacqueline les empêche de s'affronter de la seule manière qui soit possible pour elle : en se suicidant au domicile de Thomiès.
Cet acte d'amour sacrificiel et ultime renvoie chacun des gens de la noce face à sa mesquinerie et à sa médiocrité égoïste. Les mariages annoncés ne se feront pas, le groupe des gens de la noce se dissout, ses membres n'auront plus jamais le cœur à la fête. Brisé par la culpabilité, Jean de Thomiès s'expatrie en Orient, tandis qu'Etienne Laiglise, lentement, se laisse couler en délaissant ses affaires...
"Gens De La Noce" peut sembler assez dépassé quant aux problématiques qu'il développe, la décadence de ce groupe d'amis ne nous semblant guère aussi scandaleuse qu'en son temps, et le mariage ayant bien moins aujourd'hui ce symbole à la fois carcéral et sécuritaire. Néanmoins, Georges Ohnet sait avec une impressionnante maîtrise nous faire pénétrer dans ce groupe de fêtards hautains et prétentieux comme dans un labyrinthe qui ne nous révèle les arcanes de cette communauté que pour mieux nous en démontrer les verrous terribles et inéluctables qui enchaînent ces gens les uns aux autres.
Ohnet nous démontre merveilleusement de quelle manière un groupe de gens au final assez mal dans leur peau parviennent à se faire illusion mutuellement par le biais d'une décadence forcée et orchestrée qui permet à ces esprits, au fond puissamment conservateurs, de sauver les apparences et de s'abandonner, d'une manière extrêmement codifiée, à des actes et des adultères pervers qui leur semblent une revanche sur leurs frustrations mutuelles.
À ce jeu de miroirs, où chacun contemple le reflet qu'il aimerait avoir, seule Jacqueline se laisse prendre jusqu'à la passion amoureuse, et elle le paye de sa vie, éclaboussant de son sang les strass et les paillettes d'individus fats et imbus d'eux-mêmes. De par leur fraîcheur et leur innocence, les Prévinquières père et fille sont les déclencheurs involontaires de cette brutale désagrégation d'un groupe d'amis dont tous les liens sont fondés sur des mensonges.
On trouvera néanmoins ces figures idéales, incarnant des vertus hautement chrétiennes, quelque peu desséchées comparées à nos valeurs morales contemporaines, mais là aussi, le lustre du temps n'empêche pas de saisir toute la richesse et la cruauté d'un drame inéluctable. Dialoguiste de génie, Georges Ohnet s'en donne à cœur joie dans ce roman très bavard, très théâtral, où chaque pique fait mouche, et où l'orgueil et le dédain trahissent les âmes même les plus candides. Il y a quelque chose de définitivement proustien, dans "Gens De La Noce", mais avec quelque chose de terriblement noir et de définitivement misanthrope.
Esprit conservateur mais incroyablement tourmenté, Georges Ohnet signe ici l'une de ses démonstrations les plus abouties au sein d'un roman fascinant, envoûtant, mais terriblement malaisé, qui témoigne en plus de la mentalité implacable et irresponsable de la très haute-bourgeoisie au tournant du siècle.
Joyau noir jeté en travers de l'image souvent idyllique que l'on se fait de la Belle Époque, "Gens De La Noce" est un piège machiavélique d'une grande qualité littéraire, quintessence absolue d'un écrivain qui fut en son temps amèrement critiqué, non sans raison, mais dont l'oeuvre, de par sa monomanie sadique, orgueilleuse et dérangeante, demeure quelque chose d'absolument unique dans la littérature française.
histoire passionnante et surprenante que j'ai lue dans ma jeunesse. Cela m'avait influencé au point que je m'en rappelle comme si c'était hier. Au point de la recommander à un client et d'en produire un texte dans ma chronique personnelle là-dessus (littérature interdite)
Lien : http://danalbertini.net
Lien : http://danalbertini.net
Monument de la littérature bourgeoise de son temps, plus gros vendeur de livres de la Belle-Époque, honni par le monde des lettres pour la mesquinerie hautaine et égoïste de son univers, Georges Ohnet préfigurait pourtant toute l'évolution littéraire de la première moitié du XXème siècle vers une analyse plus ou moins profonde des moeurs de la bourgeoisie de province. Georges Ohnet laisse une œuvre imposante et protéiforme, qui passe progressivement du roman de mœurs au roman policier, posant les bases de ce qu'allait être bien des années plus tard les univers du romancier Georges Simenon et du cinéaste Claude Chabrol.
Néanmoins, homme de son temps, lui-même bourgeois nostalgique des temps monarchiques (son immense succès littéraire lui permettra d'acquérir le château du Bois-La-Croix, en région parisienne), Georges Ohnet est loin, même aujourd'hui, de nous apparaître comme un écrivain sympathique et recommandable. Le mépris de ses pairs fit d'ailleurs très vite de lui un homme isolé, amer, obnubilé par l'élévation sociale et le rapprochement entre bourgeoisie affairiste et aristocratie désargentée.
L'essentiel de l'oeuvre de Georges Ohnet consiste en un cycle de 34 romans qui, bien qu'indépendants les uns des autres, sont rassemblés sous le titre « Les Batailles de la Vie », ne partagant entre eux que la nature de leurs intrigues, fondées sur des luttes individuelles, en couples, au sein d'une famille ou d'une communauté. Tout chez Ohnet se résume à cette âpreté des êtres qui imposent leurs volontés aux uns et aux autres, fut-ce au prix d'un meurtre ou d'un suicide plus ou moins assisté, car le suicide et le crime passionnel - entendez autant le crime par amour que le crime par haine - rodent en permanence dans les romans de Georges Ohnet, et assez souvent y font basculer l'intrigue ou en donnent le point final.
« La Grande Marnière » (1885) est le cinquième volume de ces « Batailles de la Vie », et c'est un des romans les plus douteux de toute la carrière de son auteur. D'abord parce qu'il est quasiment plagié sur « L'Idée de Jean Têterol », un roman de Victor Cherbuliez paru en 1878. Mais là où l'astucieux et l'ironique Cherbuliez avait su brosser une farce féroce mais aimable et pleine de tendresse, Georges Ohnet s'y montre mortellement sérieux en choisissant d'en faire une tragédie shakespearienne quelque peu balourde...
L'histoire se déroule dans un petit village de Normandie, nommée La Neuville, où rien ne semblerait jamais troubler la routine de chacun si une haine farouche n'opposait le maire, un impitoyable homme d'affaires nommé Carvajan, au châtelain local, M. de Clairefont. Les origines de cette haine remonte à quatre décennies plus tôt, alors que le jeune marquis exerçait volontiers son droit de cuissage sous la Restauration, et avait jeté son dévolu sur la fiancée de Carvajan, d'ailleurs parfaitement consentante. Surprenant les deux amants dans le fiacre du marquis, Carvajan s'était pris, de la part de ce dernier, un magistral coup de fouet qui avait imprimé sur son visage une cicatrice indélébile. Depuis ce jour, Carvajan, qui n'était alors qu'un modeste paysan, s'était jeté à corps perdu dans les affaires jusqu'à devenir un industriel millionnaire. Se faisant assez facilement élire comme maire, il se mit alors à racheter progressivement toutes les dettes qui touchaient le châtelain, jusqu'à être son unique et omnipotent débiteur.
Car depuis l'âge où le marquis courait la gueuse, le Second Empire puis la République sont passés par là, et les spoliations ont rapidement réduit les biens du marquis à son seul château, qu'il habite avec sa sœur, la truculente Mme de Saint-Maurice, ainsi qu'avec ses deux enfants, le belliqueux Robert et la charmante Antoinette. Pris depuis longtemps d'une toquade obsessionnelle pour la chimie, persuadé qu'il va découvrir au fond de ses alambics un engrais miraculeux dont le commerce va renflouer ses caisses, le marquis de Clairefont a peu à peu délégué les affaires courantes à sa famille et s'est claquemuré dans ses recherches scientifiques infructueuses. Petit à petit, les terres et le château ont été hypothéqués, et Carvajan pense enfin tenir sa vengeance. La dette de M. de Clairefont se monte à 160 000 francs. Carvajan en exige le paiement avant la fin du mois courant, sinon il exproprie les Clairefont et saisit tous leurs biens, y compris la grande marnière qui se trouve sur leurs terres.
Bien que Georges Ohnet, sans doute mal renseigné, la décrive comme un tumulus, il s'agit en réalité d'une cavité naturelle dans un sol, agrandie ou non par la main de l'homme, au sein de laquelle on trouve le plus souvent de la craie, mais aussi des substances organiques vendues, au XIXème siècle, comme des engrais biologiques. Une marnière était donc encore, en 1885, une sorte de mine dont on pouvait très profitablement exploiter les matières souterraines. Aujourd'hui, elle n'a plus guère qu'un caractère folklorique ou touristique, puisque c'est un phénomène géologique presque exclusif à la région de Haute-Normandie.
Pour que sa victoire soit complète, Cavajan fait revenir au village son fils Pascal, monté à Paris bien des années plus tôt et installé là-bas comme avocat. Pascal, à vrai dire, ne revient à La Neuville qu'en traînant les pieds, car il n'aime guère son père, et la fréquentation des élites parisiennes lui a rendu encore plus odieuse la mesquinerie cupide et brutale de son géniteur. Égaré aux abords du village, il tombe sur la jeune Antoinette de Clairefont, qui le guide vers le chemin du village. Ce n'est qu'au moment des adieux, et donc des présentations, que chacun d'entre eux reconnaît, atterré, la progéniture de son ennemi.
Charmé néanmoins par la jeune femme, Pascal va résolument prendre le parti des Clairefont face à son père, au point même, pour gagner leur confiance forcément réticente, de payer leurs dettes sur ses propres économies, ce qui rend Carvajan père furieux et l‘amène à chasser son fils de sa maison. Pascal se résigne alors à rentrer à Paris, mais il n'en a pas le temps : un drame vient endeuiller le village.
Au lendemain d'un bal public, Rose, l'une des jeunes femmes y ayant participé, est retrouvé morte étranglée dans l'un des buissons environnants. Or, cette jeune femme était connue pour être un flirt occasionnel de Robert de Clairefont, des témoins les ont d'ailleurs vus ensemble sortir du bal. Tout semble donc accuser Robert, qui se retrouve arrêté par la police. Pascal décide de se faire son avocat, et parviendra à le faire acquitter près une brillante plaidoirie, non sans que l'on ait découvert que le meurtre de Rose avait été en fait commis par l'idiot du village, lequel, se sachant découvert, se jette très mélodramatiquement dans le vide depuis le haut du château des Clairefont.
La défaite de Carvajan père étant consommée, il ne reste plus qu'à Antoinette qu'à demander fort inhabituellement la main de Pascal, qui n'ose bien entendu se déclarer auprès d'une personne située au-dessus de lui dans l'échelle sociale. Les deux beaux pères ennemis mortels sont bien obligés de se soumettre au plus indiscutable des traités de paix, et voilà comment on met fin à la lutte des classes !
Cette histoire serait tout à fait romantique et charmante, si Georges Ohnet n'appuyait d'une main de plomb sur le manichéisme très orienté qu'il lui confère : dans ce microcosme social que représente le petit village de la Neuville, Ohnet célèbre l'alliance – pour ne pas dire l'allégeance – de la "bonne" bourgeoisie, représentée par Pascal Carvajan, avec l'aristocratie – la famille de Clairefont – laquelle, en dépit de ses erreurs de jugement ou ses maladresses, demeure quand même l'élite indiscutable de la société, représentante de valeurs morales et d'éducation tout à fait partagée par cette "bonne" bourgeoisie. Face à eux, Carvajan représente le paysan, l'ouvrier, le prolétaire, le parvenu rendu monstrueux par un orgueil boursouflé – beaucoup trop pour un pauvre – et par une fortune que l'on ne devrait jamais confier à quelqu'un qui n'a pas été éduqué. Quant au reste du village, les habitants, tous d'extraction modeste, y sont à peine mieux présentés que l'idiot du village. Leurs physiques sont épouvantables, grimaciers, vulgaires, et lorsque, ulcérés d'avoir perdu l'une de leurs plus jolies filles, ces villageois injurient Robert de Clairefont au moment où la police vient l'arrêter, Georges Ohnet lui-même dans sa narration parle de "rage populacière".
Toute cette débauche de mépris plombe inutilement un récit dont l'intérêt repose principalement sur le dilemme de Pascal Carvajan, contraint moralement de trahir son propre père pour des raisons d'honnêteté et d'intégrité morale qui vont bien au-delà des limites de classes sociales, auxquelles néanmoins Georges Ohnet s'efforce, à la moindre occasion, de ramener le lecteur.
Il en résulte que ce roman, dont l'intrigue, pour être classique et assez grandement plagiée, n'en est pas moins brillamment menée et magistralement servie par des dialogues qui font mouche (grande spécialité de Georges Ohnet), se révèle d'une lecture malaisée tant Georges Ohnet veut concilier l'inconciliable, c'est-à-dire la vertu morale et profondément généreuse de son héros avec une mentalité légitimiste partisane, fondée sur le mépris ouvert des trois quarts de l'humanité, et reflétant d'ailleurs bien moins la pensée aristocrate, protégée du dédain par son patrimoine et sa longue lignée d'ancêtres par rapport à laquelle il lui faut rester digne, que la pensée bourgeoise la plus arriviste, celle que seule la fortune, souvent changeante, sépare réellement du prolétariat, et qui tient souvent, par inquiétude, à marquer fort insolemment la barrière sociale.
Ajoutons à cela que les sentiments humains ici, en dépit d'un romantisme de façade, ne sont bien souvent que des postures identitaires, des partisanneries fumeuses ou des reconnaissances de dettes. Quelque chose de froid et de desséché unit même Pascal Carvajan et Antoinette de Clairefont, le premier n'aimant réellement en elle qu'une jolie figure, de beaux cheveux blonds, et le port droit et fier de sa caste, tandis que la jeune femme n'est réellement émue que par l'esprit de dévouement, de sacrifice et d'allégeance de Pascal. Malgré quelques jolis moments, dont la très touchante et très pudique déclaration d'Antoinette à Pascal, leur mariage ne semble aux yeux de l'auteur qu'une fructueuse association permettant de mettre fin à tous les litiges, et c'est tout de même une conclusion un peu gênante…
À noter enfin que « La Grande Marnière » est l'un des rares romans de Georges Ohnet à avoir été adapté au cinéma, en 1943, par Jean de Marguénat, avec Jean Chevrier et Micheline Francey dans les rôles-titres. Le film suit assez fidèlement l'intrigue du roman, même si les dialogues, modernisés, n'ont pas la brillance de ceux de Georges Ohnet. Souffrant d'un budget limité qui rend très imparfaite la reconstitution d'un village du XIXème siècle, le film néanmoins confère aux personnages du récit un peu plus de chaleur et d'humanité que ce que Georges Ohnet avait cru bon de leur donner, et corrige ainsi partiellement les défauts et le parti pris de ce roman.
Néanmoins, homme de son temps, lui-même bourgeois nostalgique des temps monarchiques (son immense succès littéraire lui permettra d'acquérir le château du Bois-La-Croix, en région parisienne), Georges Ohnet est loin, même aujourd'hui, de nous apparaître comme un écrivain sympathique et recommandable. Le mépris de ses pairs fit d'ailleurs très vite de lui un homme isolé, amer, obnubilé par l'élévation sociale et le rapprochement entre bourgeoisie affairiste et aristocratie désargentée.
L'essentiel de l'oeuvre de Georges Ohnet consiste en un cycle de 34 romans qui, bien qu'indépendants les uns des autres, sont rassemblés sous le titre « Les Batailles de la Vie », ne partagant entre eux que la nature de leurs intrigues, fondées sur des luttes individuelles, en couples, au sein d'une famille ou d'une communauté. Tout chez Ohnet se résume à cette âpreté des êtres qui imposent leurs volontés aux uns et aux autres, fut-ce au prix d'un meurtre ou d'un suicide plus ou moins assisté, car le suicide et le crime passionnel - entendez autant le crime par amour que le crime par haine - rodent en permanence dans les romans de Georges Ohnet, et assez souvent y font basculer l'intrigue ou en donnent le point final.
« La Grande Marnière » (1885) est le cinquième volume de ces « Batailles de la Vie », et c'est un des romans les plus douteux de toute la carrière de son auteur. D'abord parce qu'il est quasiment plagié sur « L'Idée de Jean Têterol », un roman de Victor Cherbuliez paru en 1878. Mais là où l'astucieux et l'ironique Cherbuliez avait su brosser une farce féroce mais aimable et pleine de tendresse, Georges Ohnet s'y montre mortellement sérieux en choisissant d'en faire une tragédie shakespearienne quelque peu balourde...
L'histoire se déroule dans un petit village de Normandie, nommée La Neuville, où rien ne semblerait jamais troubler la routine de chacun si une haine farouche n'opposait le maire, un impitoyable homme d'affaires nommé Carvajan, au châtelain local, M. de Clairefont. Les origines de cette haine remonte à quatre décennies plus tôt, alors que le jeune marquis exerçait volontiers son droit de cuissage sous la Restauration, et avait jeté son dévolu sur la fiancée de Carvajan, d'ailleurs parfaitement consentante. Surprenant les deux amants dans le fiacre du marquis, Carvajan s'était pris, de la part de ce dernier, un magistral coup de fouet qui avait imprimé sur son visage une cicatrice indélébile. Depuis ce jour, Carvajan, qui n'était alors qu'un modeste paysan, s'était jeté à corps perdu dans les affaires jusqu'à devenir un industriel millionnaire. Se faisant assez facilement élire comme maire, il se mit alors à racheter progressivement toutes les dettes qui touchaient le châtelain, jusqu'à être son unique et omnipotent débiteur.
Car depuis l'âge où le marquis courait la gueuse, le Second Empire puis la République sont passés par là, et les spoliations ont rapidement réduit les biens du marquis à son seul château, qu'il habite avec sa sœur, la truculente Mme de Saint-Maurice, ainsi qu'avec ses deux enfants, le belliqueux Robert et la charmante Antoinette. Pris depuis longtemps d'une toquade obsessionnelle pour la chimie, persuadé qu'il va découvrir au fond de ses alambics un engrais miraculeux dont le commerce va renflouer ses caisses, le marquis de Clairefont a peu à peu délégué les affaires courantes à sa famille et s'est claquemuré dans ses recherches scientifiques infructueuses. Petit à petit, les terres et le château ont été hypothéqués, et Carvajan pense enfin tenir sa vengeance. La dette de M. de Clairefont se monte à 160 000 francs. Carvajan en exige le paiement avant la fin du mois courant, sinon il exproprie les Clairefont et saisit tous leurs biens, y compris la grande marnière qui se trouve sur leurs terres.
Bien que Georges Ohnet, sans doute mal renseigné, la décrive comme un tumulus, il s'agit en réalité d'une cavité naturelle dans un sol, agrandie ou non par la main de l'homme, au sein de laquelle on trouve le plus souvent de la craie, mais aussi des substances organiques vendues, au XIXème siècle, comme des engrais biologiques. Une marnière était donc encore, en 1885, une sorte de mine dont on pouvait très profitablement exploiter les matières souterraines. Aujourd'hui, elle n'a plus guère qu'un caractère folklorique ou touristique, puisque c'est un phénomène géologique presque exclusif à la région de Haute-Normandie.
Pour que sa victoire soit complète, Cavajan fait revenir au village son fils Pascal, monté à Paris bien des années plus tôt et installé là-bas comme avocat. Pascal, à vrai dire, ne revient à La Neuville qu'en traînant les pieds, car il n'aime guère son père, et la fréquentation des élites parisiennes lui a rendu encore plus odieuse la mesquinerie cupide et brutale de son géniteur. Égaré aux abords du village, il tombe sur la jeune Antoinette de Clairefont, qui le guide vers le chemin du village. Ce n'est qu'au moment des adieux, et donc des présentations, que chacun d'entre eux reconnaît, atterré, la progéniture de son ennemi.
Charmé néanmoins par la jeune femme, Pascal va résolument prendre le parti des Clairefont face à son père, au point même, pour gagner leur confiance forcément réticente, de payer leurs dettes sur ses propres économies, ce qui rend Carvajan père furieux et l‘amène à chasser son fils de sa maison. Pascal se résigne alors à rentrer à Paris, mais il n'en a pas le temps : un drame vient endeuiller le village.
Au lendemain d'un bal public, Rose, l'une des jeunes femmes y ayant participé, est retrouvé morte étranglée dans l'un des buissons environnants. Or, cette jeune femme était connue pour être un flirt occasionnel de Robert de Clairefont, des témoins les ont d'ailleurs vus ensemble sortir du bal. Tout semble donc accuser Robert, qui se retrouve arrêté par la police. Pascal décide de se faire son avocat, et parviendra à le faire acquitter près une brillante plaidoirie, non sans que l'on ait découvert que le meurtre de Rose avait été en fait commis par l'idiot du village, lequel, se sachant découvert, se jette très mélodramatiquement dans le vide depuis le haut du château des Clairefont.
La défaite de Carvajan père étant consommée, il ne reste plus qu'à Antoinette qu'à demander fort inhabituellement la main de Pascal, qui n'ose bien entendu se déclarer auprès d'une personne située au-dessus de lui dans l'échelle sociale. Les deux beaux pères ennemis mortels sont bien obligés de se soumettre au plus indiscutable des traités de paix, et voilà comment on met fin à la lutte des classes !
Cette histoire serait tout à fait romantique et charmante, si Georges Ohnet n'appuyait d'une main de plomb sur le manichéisme très orienté qu'il lui confère : dans ce microcosme social que représente le petit village de la Neuville, Ohnet célèbre l'alliance – pour ne pas dire l'allégeance – de la "bonne" bourgeoisie, représentée par Pascal Carvajan, avec l'aristocratie – la famille de Clairefont – laquelle, en dépit de ses erreurs de jugement ou ses maladresses, demeure quand même l'élite indiscutable de la société, représentante de valeurs morales et d'éducation tout à fait partagée par cette "bonne" bourgeoisie. Face à eux, Carvajan représente le paysan, l'ouvrier, le prolétaire, le parvenu rendu monstrueux par un orgueil boursouflé – beaucoup trop pour un pauvre – et par une fortune que l'on ne devrait jamais confier à quelqu'un qui n'a pas été éduqué. Quant au reste du village, les habitants, tous d'extraction modeste, y sont à peine mieux présentés que l'idiot du village. Leurs physiques sont épouvantables, grimaciers, vulgaires, et lorsque, ulcérés d'avoir perdu l'une de leurs plus jolies filles, ces villageois injurient Robert de Clairefont au moment où la police vient l'arrêter, Georges Ohnet lui-même dans sa narration parle de "rage populacière".
Toute cette débauche de mépris plombe inutilement un récit dont l'intérêt repose principalement sur le dilemme de Pascal Carvajan, contraint moralement de trahir son propre père pour des raisons d'honnêteté et d'intégrité morale qui vont bien au-delà des limites de classes sociales, auxquelles néanmoins Georges Ohnet s'efforce, à la moindre occasion, de ramener le lecteur.
Il en résulte que ce roman, dont l'intrigue, pour être classique et assez grandement plagiée, n'en est pas moins brillamment menée et magistralement servie par des dialogues qui font mouche (grande spécialité de Georges Ohnet), se révèle d'une lecture malaisée tant Georges Ohnet veut concilier l'inconciliable, c'est-à-dire la vertu morale et profondément généreuse de son héros avec une mentalité légitimiste partisane, fondée sur le mépris ouvert des trois quarts de l'humanité, et reflétant d'ailleurs bien moins la pensée aristocrate, protégée du dédain par son patrimoine et sa longue lignée d'ancêtres par rapport à laquelle il lui faut rester digne, que la pensée bourgeoise la plus arriviste, celle que seule la fortune, souvent changeante, sépare réellement du prolétariat, et qui tient souvent, par inquiétude, à marquer fort insolemment la barrière sociale.
Ajoutons à cela que les sentiments humains ici, en dépit d'un romantisme de façade, ne sont bien souvent que des postures identitaires, des partisanneries fumeuses ou des reconnaissances de dettes. Quelque chose de froid et de desséché unit même Pascal Carvajan et Antoinette de Clairefont, le premier n'aimant réellement en elle qu'une jolie figure, de beaux cheveux blonds, et le port droit et fier de sa caste, tandis que la jeune femme n'est réellement émue que par l'esprit de dévouement, de sacrifice et d'allégeance de Pascal. Malgré quelques jolis moments, dont la très touchante et très pudique déclaration d'Antoinette à Pascal, leur mariage ne semble aux yeux de l'auteur qu'une fructueuse association permettant de mettre fin à tous les litiges, et c'est tout de même une conclusion un peu gênante…
À noter enfin que « La Grande Marnière » est l'un des rares romans de Georges Ohnet à avoir été adapté au cinéma, en 1943, par Jean de Marguénat, avec Jean Chevrier et Micheline Francey dans les rôles-titres. Le film suit assez fidèlement l'intrigue du roman, même si les dialogues, modernisés, n'ont pas la brillance de ceux de Georges Ohnet. Souffrant d'un budget limité qui rend très imparfaite la reconstitution d'un village du XIXème siècle, le film néanmoins confère aux personnages du récit un peu plus de chaleur et d'humanité que ce que Georges Ohnet avait cru bon de leur donner, et corrige ainsi partiellement les défauts et le parti pris de ce roman.
C'est un duel d'orgueil entre l'aristocratie de naissance (la noblesse qui ne survit que par le nom et l'héritage) et l'aristocratie du mérite ou du travail.
Ne pourrait-il pas y avoir un pont-commun, une synergie entre ces deux aristocraties ? Comme dirait Octave qui est le candide rêveur du livre, l'une étant « la gloire du passé » et la seconde « le progrès dans le présent » ?
Ou comme Balzac le rêvait « l'aristocratie et la bourgeoisie vont mettre en commun, l'une ses traditions d'élégance, de bon goût et de haute politique, l'autre ses conquêtes prodigieuses dans les arts et les sciences ; puis toute deux, à la tête du peuple, elles l'entraîneront dans une voie de civilisation et de lumière »
Non - ces deux aristocraties coopèrent peu, rarement et souvent mal quand c'est le cas.
Tous les maux de ce roman viennent de l'égo meurtri d'Athénaïs. Son père n'a eu que la mauvaise idée de la placer dans un couvent réputé à Paris pour être un repaire privilégié de filles nobles. Or, quand on est qu'une simple fille d'un chocolatier industriel, cela finit tôt ou tard par se savoir … Elle est inévitablement traumatisée par les cruelles railleries de ses camarades d'écoles nobles, dont Claire de Beaulieu.
Ainsi, tout au long de sa vie, Athénaïs sera tourmentée à la fois d'un désir de revanche sociale à l'encontre de la noblesse et d'une irrésistible envie d'imiter tous les codes de la noblesse.
Elle avait tout : beauté, argent (fille unique et riche héritière) et intelligence ; il ne lui manquait plus qu'un nom, et un nom cela s'achète.
Hasard favorable, le père d'Athénaïs, grotesque parvenu prêt à tout pour briller davantage, saisi au vol un jeune noble débauché et ravagé par les jeux d'argent : le Duc de Bligny.
Au plus bas, de lourdes dettes de jeu pesant sur lui, il lui propose d'effacer ses dettes en contrepartie d'un mariage avec sa fille. Cette corruption est immédiatement acceptée par le Duc de Bligny, au mépris des fiançailles avec Claire de Beaulieu.
Après le nom, il convient d'y ajouter des terres et un château qui complète parfaitement la panoplie du parvenu qui joue aux nobles. Mieux encore, puisqu'il s'agit d'un bien près du domaine des Beaulieu, afin qu'Athénaïs s'empresse d'aller narguer de la façon la plus sournoise possible Claire de Beaulieu.
C'est ici une scène formidable : Athénaïs feint les retrouvailles heureuses devant la famille de Claire, s'isole avec elle et lui demande conseil quant à sa future alliance, lui apprenant ainsi qu'elle se marie avec le fiancé de Claire, le Duc de Bligny, tout en sachant pertinemment que des fiançailles étaient en cours entre ces derniers.
D'une fierté froide mais bouillonnante d'intérieur, Claire nie les fiançailles et court-circuite brutalement la conversation en déclarant qu'elle va elle aussi se marier avec son voisin, un certain Monsieur Philippe d'Herblay, maître d'une forge prospère. Elle prétend l'aimer alors qu'elle l'a toujours souverainement méprisé, qu'elle rejetait d'un oeil sec toutes ses avances.
Le pacte est vite conclu avec Philippe, ravi d'intégrer une famille noble.
Ces deux mariages mixtes seront de vrais désastres.
Philippe a beau être le mari idéal, attentionné, humble, riche, grand et beau, rien ne trouvera grâce aux yeux méprisants de Claire qui regrettera amèrement ce mariage impulsif.
L'orgueil ayant cela de mauvais qu'il est souvent contagieux, cet orgueil se transmettra de Claire à Philippe qui développera un complexe d'infériorité et passera ainsi d'un mari modèle à un époux sévère, grave, dur et indifférent.
Ainsi, plus Philippe montrera à Claire une autorité personnelle qui s'affirme, et plus elle en sera étonnée, intriguée, au point de le désirer, réalisant bien plus tard (et trop tard) la chance qu'elle avait.
L'autre mariage aura bien moins de complexité émotionnelle : Athénaïs et le Duc de Bligny vont saisir instantanément la superficialité de leur arrangement et mèneront une vie de débauché de salon chacun de leur côté.
La conduite d'Athénaïs n'est motivée que par le désir de briller davantage que Claire dans tous les domaines et ne se refuse rien. Elle ira jusqu'à tenter de saboter le mariage de Claire en voulant être la maitresse de Philippe par des moyens outrageusement séducteurs.
Seule une grave crise mettra fin à ce jeu interminable.
Dans ce roman, chaque personnage mérite pleinement ses difficultés et au lieu d'empatir douloureusement, on bat joyeusement des mains à chaque scène où les personnages se détériorent entre eux à coup d'aiguilles, de petites phrases mais d'une grande violence derrière la diplomatie de salon. On aime ce mauvais orgueil extrême qui s'accroît au fil des vengeances et on en demande davantage.
L'auteur peint le mal et il châtie volontiers ; mais il n'est ni systématique ni absolu, et même au fond de chaque personnage odieux il laisse entrevoir quelque chose d'humain. L'auteur contextualise finement chaque personnage et c'est un plaisir à lire.
(Ce roman a été adapté au théâtre : ci-dessous un lien contenant une critique de Francisque Sarcey)
https://www.babelio.com/livres/Ohnet-Le-maitre-des-forges-theatre/1575306/critiques/3650406
Ne pourrait-il pas y avoir un pont-commun, une synergie entre ces deux aristocraties ? Comme dirait Octave qui est le candide rêveur du livre, l'une étant « la gloire du passé » et la seconde « le progrès dans le présent » ?
Ou comme Balzac le rêvait « l'aristocratie et la bourgeoisie vont mettre en commun, l'une ses traditions d'élégance, de bon goût et de haute politique, l'autre ses conquêtes prodigieuses dans les arts et les sciences ; puis toute deux, à la tête du peuple, elles l'entraîneront dans une voie de civilisation et de lumière »
Non - ces deux aristocraties coopèrent peu, rarement et souvent mal quand c'est le cas.
Tous les maux de ce roman viennent de l'égo meurtri d'Athénaïs. Son père n'a eu que la mauvaise idée de la placer dans un couvent réputé à Paris pour être un repaire privilégié de filles nobles. Or, quand on est qu'une simple fille d'un chocolatier industriel, cela finit tôt ou tard par se savoir … Elle est inévitablement traumatisée par les cruelles railleries de ses camarades d'écoles nobles, dont Claire de Beaulieu.
Ainsi, tout au long de sa vie, Athénaïs sera tourmentée à la fois d'un désir de revanche sociale à l'encontre de la noblesse et d'une irrésistible envie d'imiter tous les codes de la noblesse.
Elle avait tout : beauté, argent (fille unique et riche héritière) et intelligence ; il ne lui manquait plus qu'un nom, et un nom cela s'achète.
Hasard favorable, le père d'Athénaïs, grotesque parvenu prêt à tout pour briller davantage, saisi au vol un jeune noble débauché et ravagé par les jeux d'argent : le Duc de Bligny.
Au plus bas, de lourdes dettes de jeu pesant sur lui, il lui propose d'effacer ses dettes en contrepartie d'un mariage avec sa fille. Cette corruption est immédiatement acceptée par le Duc de Bligny, au mépris des fiançailles avec Claire de Beaulieu.
Après le nom, il convient d'y ajouter des terres et un château qui complète parfaitement la panoplie du parvenu qui joue aux nobles. Mieux encore, puisqu'il s'agit d'un bien près du domaine des Beaulieu, afin qu'Athénaïs s'empresse d'aller narguer de la façon la plus sournoise possible Claire de Beaulieu.
C'est ici une scène formidable : Athénaïs feint les retrouvailles heureuses devant la famille de Claire, s'isole avec elle et lui demande conseil quant à sa future alliance, lui apprenant ainsi qu'elle se marie avec le fiancé de Claire, le Duc de Bligny, tout en sachant pertinemment que des fiançailles étaient en cours entre ces derniers.
D'une fierté froide mais bouillonnante d'intérieur, Claire nie les fiançailles et court-circuite brutalement la conversation en déclarant qu'elle va elle aussi se marier avec son voisin, un certain Monsieur Philippe d'Herblay, maître d'une forge prospère. Elle prétend l'aimer alors qu'elle l'a toujours souverainement méprisé, qu'elle rejetait d'un oeil sec toutes ses avances.
Le pacte est vite conclu avec Philippe, ravi d'intégrer une famille noble.
Ces deux mariages mixtes seront de vrais désastres.
Philippe a beau être le mari idéal, attentionné, humble, riche, grand et beau, rien ne trouvera grâce aux yeux méprisants de Claire qui regrettera amèrement ce mariage impulsif.
L'orgueil ayant cela de mauvais qu'il est souvent contagieux, cet orgueil se transmettra de Claire à Philippe qui développera un complexe d'infériorité et passera ainsi d'un mari modèle à un époux sévère, grave, dur et indifférent.
Ainsi, plus Philippe montrera à Claire une autorité personnelle qui s'affirme, et plus elle en sera étonnée, intriguée, au point de le désirer, réalisant bien plus tard (et trop tard) la chance qu'elle avait.
L'autre mariage aura bien moins de complexité émotionnelle : Athénaïs et le Duc de Bligny vont saisir instantanément la superficialité de leur arrangement et mèneront une vie de débauché de salon chacun de leur côté.
La conduite d'Athénaïs n'est motivée que par le désir de briller davantage que Claire dans tous les domaines et ne se refuse rien. Elle ira jusqu'à tenter de saboter le mariage de Claire en voulant être la maitresse de Philippe par des moyens outrageusement séducteurs.
Seule une grave crise mettra fin à ce jeu interminable.
Dans ce roman, chaque personnage mérite pleinement ses difficultés et au lieu d'empatir douloureusement, on bat joyeusement des mains à chaque scène où les personnages se détériorent entre eux à coup d'aiguilles, de petites phrases mais d'une grande violence derrière la diplomatie de salon. On aime ce mauvais orgueil extrême qui s'accroît au fil des vengeances et on en demande davantage.
L'auteur peint le mal et il châtie volontiers ; mais il n'est ni systématique ni absolu, et même au fond de chaque personnage odieux il laisse entrevoir quelque chose d'humain. L'auteur contextualise finement chaque personnage et c'est un plaisir à lire.
(Ce roman a été adapté au théâtre : ci-dessous un lien contenant une critique de Francisque Sarcey)
https://www.babelio.com/livres/Ohnet-Le-maitre-des-forges-theatre/1575306/critiques/3650406
Ohnet Georges
Le maître de forge
L’histoire se passe en1880 dans le Jura très bien écrit et décrit aussi mais c’est un véritable roman que l’on pourrait appeler « vintage ».
Cependant, après cette lecture on se sent détendu, relax et pas de question à se poser, un bon moment de détente
Le marquis de Beaulieu, deux enfants, Claire et Octave et un neveu le duc Billing
Claire aime le neveu et se destine à l’épouser. Pour raison d’affaires, il doit partir à Saint Petersbourg, mais pas seulement affaires, jeux, fêtes, femmes, etc.
Il apprend que la marquise t ses enfants sont ruinés, lui qui a tant de dettes, du coup il trouve une jeune femme bourgeoise et riche de surcroît.
De son côté Claire souffre énormément car elle ne connait pas la raison de ce revirement et voue une haine féroce à sa rivale
Le maître de forges quant à lui a plusieurs entreprises et est fort riche et n’a cure d’épouser Claire bien qu’elle soit pauvre
Elle ne le support pas et ne comprend pas malgré son attitude qu’il soit si gentil envers elle.
Plus tard, elle comprendra que son cousin a épousé cette personne justement parce qu’il avait besoin d’argent seulement
Le véritable roman d’amour de l’époque
Le maître de forge
L’histoire se passe en1880 dans le Jura très bien écrit et décrit aussi mais c’est un véritable roman que l’on pourrait appeler « vintage ».
Cependant, après cette lecture on se sent détendu, relax et pas de question à se poser, un bon moment de détente
Le marquis de Beaulieu, deux enfants, Claire et Octave et un neveu le duc Billing
Claire aime le neveu et se destine à l’épouser. Pour raison d’affaires, il doit partir à Saint Petersbourg, mais pas seulement affaires, jeux, fêtes, femmes, etc.
Il apprend que la marquise t ses enfants sont ruinés, lui qui a tant de dettes, du coup il trouve une jeune femme bourgeoise et riche de surcroît.
De son côté Claire souffre énormément car elle ne connait pas la raison de ce revirement et voue une haine féroce à sa rivale
Le maître de forges quant à lui a plusieurs entreprises et est fort riche et n’a cure d’épouser Claire bien qu’elle soit pauvre
Elle ne le support pas et ne comprend pas malgré son attitude qu’il soit si gentil envers elle.
Plus tard, elle comprendra que son cousin a épousé cette personne justement parce qu’il avait besoin d’argent seulement
Le véritable roman d’amour de l’époque
Fort du succès colossal rencontré par ses deux précédents romans, « Le Maître de Forges » (1882) et « La Comtesse Sarah » (1883), Georges Ohnet va commettre avec « Lise Fleuron » son premier faux pas littéraire, en s’abandonnant à cette rancœur amère qui le poussera régulièrement par la suite à écrire des œuvres rancunières et mortifères mais, paradoxalement, d’un grand infantilisme.
Avec « Lise Fleuron », Georges Ohnet sort pour la première fois du milieu bourgeois pour se risquer dans un milieu artistique, et pas n’importe lequel : le théâtre. C’est en effet d’abord comme auteur de pièces de théâtre que Georges Ohnet se lança dans les années 1870, avec deux pièces qui ne rencontrèrent pas le moindre succès. Ce fut donc par dépit, dans un premier temps, que Georges Ohnet se tourna vers le roman.
C’est donc juste après avoir rencontré et affermi son succès en tant que romancier que Georges Ohnet décide de régler ses comptes avec le théâtre dans ce roman, - car il s’agit bien d’un règlement de comptes fielleux et revanchard envers tous les professionnels du métier.
Lise Fleuron est un personnage idéal, une jeune comédienne passionnée par son art, belle, sage, pure, encore vierge, ayant à charge une vieille mère aigrie et aveugle, qui ne cesse de répéter que la voie théâtrale est une perversion, que toutes les actrices finissent comme filles de joie. Avec une infinie patience, Lise encaisse le harcèlement quotidien de sa mère, que sa désapprobation n’empêche point de manger à elle toute seule une bonne partie des gains de sa fille.
Lise Fleuron est en effet parvenue à un tournant de sa carrière, en dénichant un engagement au Théâtre des Fantaisies-Dramatiques de la rue du faubourg Saint-Martin (allusion à peine voilée à l’authentique Théâtre des Délassements-Comiques installé entre 1873 et 1878 dans cette même rue).
En ces années 1870-1880, le théâtre est le premier divertissement des Parisiens, il se joue près d’une centaine de pièces par jour, dans une vingtaine de théâtres, de 15h à 23h sans discontinuité. Cette frénésie théâtrale permet aux acteurs d’être salariés à plein temps par le théâtre qui les emploie. Ils sont tenus de connaître en même temps les textes de cinq ou six pièces, car toutes sont jouées à la suite par les mêmes acteurs sous différents costumes. C’est un travail exténuant, chronophage, et sans aucune sécurité de l’emploi, car lorsque un théâtre passe de mode ou enchaîne les fours, on dégraisse le personnel, que l’on rend souvent responsable d’un insuccès prolongé. On ne peut s’attaquer à l’auteur de la pièce : en ce temps-là, il paye le théâtre pour que sa pièce soit jouée, et il paye même très cher. On ne peut s’en prendre à celui qui paye, on passe donc ses nerfs sur ceux qui sont payés, à savoir les acteurs, dont on attend que leur talent sauve un texte médiocre ou une mauvaise pièce.
C’est donc un métier très dur, peu rémunérateur au vu des efforts à fournir, et qui ne laisse guère le temps d’investir et de fructifier sa fortune, même quand il y a des succès. Les acteurs vivaient alors comme la cigale de la fable, la quasi-totalité d’entre eux moururent dans une misère noire quand le public les lâcha, quand la mémoire ou leur voix s’éteignit ou quand simplement leur limite d’âge futt atteinte. Qui plus est, il n’existait pas encore de moyens techniques d’enregistrer, de photographier ou de filmer leurs performances, aussi furent-ils voués à l’oubli le plus total quand ils descendaient de scène après une vie entière passée sur les planches.
De ce métier superbe et ingrat, où tant de grands comédiens se sont tués au travail, Georges Ohnet ne veut rien savoir. Tout le milieu théâtral n’est pour lui qu’un ramassis de vermines cabotines et d’affairistes vicieux et corrompus. C’est à cette pègre-là que la jeune et candide Lise Fleuron va se heurter, attisant la concupiscence lubrique des hommes et la jalousie haineuse des autres comédiennes. Car, portée par une vocation pure dont elle est la seule détentrice émérite, Lise Fleuron devient vite la coqueluche du public et la bête noire de sa rivale, Clémence Villa, brune méditerranéenne capiteuse et lubrique, qui ne doit sa carrière qu’à des complaisances sexuelles envers le directeur du théâtre, François Rombaud, homme d’affaires habile, et surtout envers son compagnon officiel, cofondateur du théâtre, le banquier et producteur Sélim Nuïo, sorte de gros vieillard lubrique et pervers. Clémence Villa souffre très vite de voir ces deux chevaliers-servants, habituellement à ses pieds, se passionner soudain pour Lise Fleuron et tenter se la mettre dans leur lit. Mais candide et déterminée, Lise Fleuron refuse implacablement toutes les avances, ne vit que pour son métier de comédienne, et finit par tomber amoureuse au fil des mois d’un jeune aristocrate financier, habitué du théâtre, et qui vient souvent admirer Lise : Jean de Brives. Le double privilège de cet amant noble et fortuné, que Clémence Villa tentait déjà de séduire depuis quelques mois, attire sur Lise Fleuron les railleries des autres comédiens, qui croient la jeune fille intéressée. En réalité, Lise Fleuron n’écoute que son cœur qui bat le plus sincèrement du monde pour le jeune nobliau.
Devant cette romance pure, qui n’empêche nullement Lise de jouer sur scène et d’enthousiasmer le public, François Rombaud jette l’éponge, tout comme Claude La Barre, auteur de la pièce qui révèle Lise, et qui est en fait un ami d’enfance à elle, le seul être assez pur de son entourage, puisque littéraire et écrivain (Ben tiens !). On croit un temps que l’amour va finalement naître entre Lise et lui, mais en fait, non, et il ne semble pas plus que ça s’en formaliser. L’inutilité de ce personnage, tout au long du roman, est assez confondante.
Sélim Nuïo, en revanche, est un esprit suffisamment retors pour élaborer une stratégie qui va lui permettre d’utiliser l’histoire d’amour de Lise pour l’amener dans son lit à lui. Il sympathise avec Jean de Brives, et l’intéresse progressivement à la spéculation financière, lui proposant même de lui confier ses économies pour les faire fructifier. En réalité, Nuïo veut la perte du jeune homme, il va acheter en son nom des valeurs qu’il sait pouvoir lui-même faire s’effondrer à la bourse en quelques semaines. Pris au jeu, heureux en argent comme en amour, Jean de Brives ne voit pas le piège se refermer sur lui. Lorsque le krach boursier survient, il se retrouve criblé de dettes, avec comme unique débiteur Sélim Nuïo, qui lui réclame plusieurs millions de francs. Celui-ci n’attend qu’une chose, que Lise Fleuron vienne le supplier de renoncer à ruiner Jean en échange de quelques nuits avec lui.
Mais la candide Lise, elle non plus, ne réalise pas la menace qui pèse sur elle. Décidée à discuter argent et échelonnement des dettes, comptant sur ses succès au théâtre pour rembourser, elle accepte de la part de Nuïo une invitation au restaurant, dont elle ne devine pas l’intention cachée. Par hasard, Clémence Villa, la compagne officielle de Nuïo, apprend la date et le lieu de ce dîner et, furieuse de voir Lise tourner autour de tous les hommes de sa vie, elle se venge en communicant ce rendez-vous à Jean de Brives. Celui-ci, accablé par ses pertes financières, a perdu beaucoup de son discernement. Comme Lise lui a caché ce rendez-vous, il se persuade qu’elle veut le quitter pour le très riche Nuïo. Fou de douleur et de colère, il fait irruption dans le restaurant où dînent Lise et Nuïo, et y fait un scandale, accusant Lise de vouloir se faire entretenir par le banquier, ce que celui-ci, avec un sourire, ne dément pas. Lise ne parvient pas à se disculper auprès de Jean, qui sort furieux du restaurant après l’avoir traitée de catin. Échappant alors aux mains gluantes et consolatrices de Sélim Nuïo, qui croit son heure arrivée, Lise Fleuron fuit elle aussi du restaurant, rentre chez elle en pleurant, et se met au lit. En quelques jours, la jeune éplorée meurt de chagrin, comme seules savaient le faire les pures jeunes filles du temps jadis... Et c'est tout ? Et bien, oui, c'est tout.
Il y avait pourtant un beau roman initiatique à faire autour de la désillusion de cette jeune comédienne naïve qui se heurte à l’âpreté d’un milieu artistique corrompu et amer, mais Georges Ohnet passe définitivement à côté par un excès de balourdise mélodramatique et de rancœur fielleuse. Car si ce drame ne fonctionne pas comme il devrait, c’est que tout y est en excès. Vivier de cabotins narcissiques et de noceurs lubriques, le Théâtre des Fantaisies-Dramatiques ne semble abriter personne qui soit réellement intéressé par le théâtre. Même les comédiens semblent peu passionnés par la comédie. Lise Fleuron débarque dans une troupe qui a tout d’une meute royale de courtisans, qui n’ont rien d’autres à faire de leurs journées que de fomenter des intrigues et de compter l’argent qu’ils gagnent. Toutes les relations sexuelles sont soumises au renvoi d’ascenseur (expression anachronique dans ce contexte, mais néanmoins exacte). Clémence Villa est un bloc de haine, prête à aller jusqu’au meurtre pour faire disparaître Lise Fleuron, comme si une comédienne expérimentée ne s’était jamais préparée à l’idée d’être éclipsée un jour par un jeune talent. Jean de Brives, poupée de chiffons ballottée par les évènements, est aussi inconsistant qu'un fantôme. Sélim Nuïo se révèle un monument de pourriture, à la nationalité ambiguë, et sans que cela soit expressément dit, correspond un peu trop à des classiques clichés antisémites. Quant à Lise Fleuron, son innocence et sa pureté confinent à l’aveuglement pur et simple, tant elle ne voit jamais rien venir, ne doute jamais des faux amis qui l’entourent, n’imagine pas un seul instant qu’on puisse être jaloux d’elle ou qu’on cherche à la posséder par des moyens détournés. Poupée de porcelaine trop belle pour être vraie, trop pure pour imaginer qu'il y a des gens méchants, ravissante idiote qu’un chagrin d’amour suffit à condamner à mort, elle semble jaillir de la pauvre imagination d’un écrivain qui veut s’obstiner à croire qu’il n’existe que deux sortes de femmes, les anges et les putains. L’immaturité de cette vision binaire, pour ne pas dire bipolaire, contribue grandement au caractère ridicule de ce récit qui, plus sobre et plus réaliste, aurait pu se révéler passionnant. Mais en idolâtrant cette héroïne virginale et niaise, désormais bien désuète, tout en se répandant en crachats féroces et mortifères sur tout le milieu théâtral sans aucune exception, Georges Ohnet n’arrive qu’à se caricaturer lui-même au sein d’un défoulement narratif boursouflé et grotesque, parfois même risible dans sa mauvaise foi.
Malgré d’indéniables qualités narratives qui permettent, tant bien que mal, d’arriver tout de même au bout de ce récit, bien succinct malgré les 460 pages qu’Ohnet lui consacre, « Lise Fleuron » est assurément un des plus mauvais romans de son auteur, et annonce en tout cas ce qui se vérifiera plus tard, à savoir que Georges Ohnet, chroniqueur inspiré et talentueux de la bourgeoisie de la Belle-Époque, perd totalement les pédales et fonce dans le décor dès qu’il sort de ce milieu étriqué qui fut le sien...
À noter, pour finir, que ce roman eut une bien inattendue postérité, puisque l’histoire de Lise Fleuron fit une forte impression, une décennie plus tard, sur une jeune artiste de music-hall parisienne nommée Marguerite Rauscher, laquelle adopta pour sa carrière le pseudonyme de Lise Fleuron. Georges Ohnet dût s’en arracher les cheveux, car cette Lise Fleuron fut l’exact opposé de son héroïne : une cocotte à la fesse légère, collectionneuse d’amants, gouailleuse et vulgaire, spécialisée dans les rôles de prostituées dans les opérettes. Elle popularisa le décolleté plongeant, et reste même célèbre pour une série de cartes postales érotiques étonnamment audacieuses pour l’époque. Aujourd’hui encore, le nom de Lise Fleuron reste étroitement lié à l’histoire de l’érotisme en France. Une claque supplémentaire pour le pauvre Georges, qui semble avoir définitivement perdu avec ce roman cette « Bataille de la Vie »-ci.
Avec « Lise Fleuron », Georges Ohnet sort pour la première fois du milieu bourgeois pour se risquer dans un milieu artistique, et pas n’importe lequel : le théâtre. C’est en effet d’abord comme auteur de pièces de théâtre que Georges Ohnet se lança dans les années 1870, avec deux pièces qui ne rencontrèrent pas le moindre succès. Ce fut donc par dépit, dans un premier temps, que Georges Ohnet se tourna vers le roman.
C’est donc juste après avoir rencontré et affermi son succès en tant que romancier que Georges Ohnet décide de régler ses comptes avec le théâtre dans ce roman, - car il s’agit bien d’un règlement de comptes fielleux et revanchard envers tous les professionnels du métier.
Lise Fleuron est un personnage idéal, une jeune comédienne passionnée par son art, belle, sage, pure, encore vierge, ayant à charge une vieille mère aigrie et aveugle, qui ne cesse de répéter que la voie théâtrale est une perversion, que toutes les actrices finissent comme filles de joie. Avec une infinie patience, Lise encaisse le harcèlement quotidien de sa mère, que sa désapprobation n’empêche point de manger à elle toute seule une bonne partie des gains de sa fille.
Lise Fleuron est en effet parvenue à un tournant de sa carrière, en dénichant un engagement au Théâtre des Fantaisies-Dramatiques de la rue du faubourg Saint-Martin (allusion à peine voilée à l’authentique Théâtre des Délassements-Comiques installé entre 1873 et 1878 dans cette même rue).
En ces années 1870-1880, le théâtre est le premier divertissement des Parisiens, il se joue près d’une centaine de pièces par jour, dans une vingtaine de théâtres, de 15h à 23h sans discontinuité. Cette frénésie théâtrale permet aux acteurs d’être salariés à plein temps par le théâtre qui les emploie. Ils sont tenus de connaître en même temps les textes de cinq ou six pièces, car toutes sont jouées à la suite par les mêmes acteurs sous différents costumes. C’est un travail exténuant, chronophage, et sans aucune sécurité de l’emploi, car lorsque un théâtre passe de mode ou enchaîne les fours, on dégraisse le personnel, que l’on rend souvent responsable d’un insuccès prolongé. On ne peut s’attaquer à l’auteur de la pièce : en ce temps-là, il paye le théâtre pour que sa pièce soit jouée, et il paye même très cher. On ne peut s’en prendre à celui qui paye, on passe donc ses nerfs sur ceux qui sont payés, à savoir les acteurs, dont on attend que leur talent sauve un texte médiocre ou une mauvaise pièce.
C’est donc un métier très dur, peu rémunérateur au vu des efforts à fournir, et qui ne laisse guère le temps d’investir et de fructifier sa fortune, même quand il y a des succès. Les acteurs vivaient alors comme la cigale de la fable, la quasi-totalité d’entre eux moururent dans une misère noire quand le public les lâcha, quand la mémoire ou leur voix s’éteignit ou quand simplement leur limite d’âge futt atteinte. Qui plus est, il n’existait pas encore de moyens techniques d’enregistrer, de photographier ou de filmer leurs performances, aussi furent-ils voués à l’oubli le plus total quand ils descendaient de scène après une vie entière passée sur les planches.
De ce métier superbe et ingrat, où tant de grands comédiens se sont tués au travail, Georges Ohnet ne veut rien savoir. Tout le milieu théâtral n’est pour lui qu’un ramassis de vermines cabotines et d’affairistes vicieux et corrompus. C’est à cette pègre-là que la jeune et candide Lise Fleuron va se heurter, attisant la concupiscence lubrique des hommes et la jalousie haineuse des autres comédiennes. Car, portée par une vocation pure dont elle est la seule détentrice émérite, Lise Fleuron devient vite la coqueluche du public et la bête noire de sa rivale, Clémence Villa, brune méditerranéenne capiteuse et lubrique, qui ne doit sa carrière qu’à des complaisances sexuelles envers le directeur du théâtre, François Rombaud, homme d’affaires habile, et surtout envers son compagnon officiel, cofondateur du théâtre, le banquier et producteur Sélim Nuïo, sorte de gros vieillard lubrique et pervers. Clémence Villa souffre très vite de voir ces deux chevaliers-servants, habituellement à ses pieds, se passionner soudain pour Lise Fleuron et tenter se la mettre dans leur lit. Mais candide et déterminée, Lise Fleuron refuse implacablement toutes les avances, ne vit que pour son métier de comédienne, et finit par tomber amoureuse au fil des mois d’un jeune aristocrate financier, habitué du théâtre, et qui vient souvent admirer Lise : Jean de Brives. Le double privilège de cet amant noble et fortuné, que Clémence Villa tentait déjà de séduire depuis quelques mois, attire sur Lise Fleuron les railleries des autres comédiens, qui croient la jeune fille intéressée. En réalité, Lise Fleuron n’écoute que son cœur qui bat le plus sincèrement du monde pour le jeune nobliau.
Devant cette romance pure, qui n’empêche nullement Lise de jouer sur scène et d’enthousiasmer le public, François Rombaud jette l’éponge, tout comme Claude La Barre, auteur de la pièce qui révèle Lise, et qui est en fait un ami d’enfance à elle, le seul être assez pur de son entourage, puisque littéraire et écrivain (Ben tiens !). On croit un temps que l’amour va finalement naître entre Lise et lui, mais en fait, non, et il ne semble pas plus que ça s’en formaliser. L’inutilité de ce personnage, tout au long du roman, est assez confondante.
Sélim Nuïo, en revanche, est un esprit suffisamment retors pour élaborer une stratégie qui va lui permettre d’utiliser l’histoire d’amour de Lise pour l’amener dans son lit à lui. Il sympathise avec Jean de Brives, et l’intéresse progressivement à la spéculation financière, lui proposant même de lui confier ses économies pour les faire fructifier. En réalité, Nuïo veut la perte du jeune homme, il va acheter en son nom des valeurs qu’il sait pouvoir lui-même faire s’effondrer à la bourse en quelques semaines. Pris au jeu, heureux en argent comme en amour, Jean de Brives ne voit pas le piège se refermer sur lui. Lorsque le krach boursier survient, il se retrouve criblé de dettes, avec comme unique débiteur Sélim Nuïo, qui lui réclame plusieurs millions de francs. Celui-ci n’attend qu’une chose, que Lise Fleuron vienne le supplier de renoncer à ruiner Jean en échange de quelques nuits avec lui.
Mais la candide Lise, elle non plus, ne réalise pas la menace qui pèse sur elle. Décidée à discuter argent et échelonnement des dettes, comptant sur ses succès au théâtre pour rembourser, elle accepte de la part de Nuïo une invitation au restaurant, dont elle ne devine pas l’intention cachée. Par hasard, Clémence Villa, la compagne officielle de Nuïo, apprend la date et le lieu de ce dîner et, furieuse de voir Lise tourner autour de tous les hommes de sa vie, elle se venge en communicant ce rendez-vous à Jean de Brives. Celui-ci, accablé par ses pertes financières, a perdu beaucoup de son discernement. Comme Lise lui a caché ce rendez-vous, il se persuade qu’elle veut le quitter pour le très riche Nuïo. Fou de douleur et de colère, il fait irruption dans le restaurant où dînent Lise et Nuïo, et y fait un scandale, accusant Lise de vouloir se faire entretenir par le banquier, ce que celui-ci, avec un sourire, ne dément pas. Lise ne parvient pas à se disculper auprès de Jean, qui sort furieux du restaurant après l’avoir traitée de catin. Échappant alors aux mains gluantes et consolatrices de Sélim Nuïo, qui croit son heure arrivée, Lise Fleuron fuit elle aussi du restaurant, rentre chez elle en pleurant, et se met au lit. En quelques jours, la jeune éplorée meurt de chagrin, comme seules savaient le faire les pures jeunes filles du temps jadis... Et c'est tout ? Et bien, oui, c'est tout.
Il y avait pourtant un beau roman initiatique à faire autour de la désillusion de cette jeune comédienne naïve qui se heurte à l’âpreté d’un milieu artistique corrompu et amer, mais Georges Ohnet passe définitivement à côté par un excès de balourdise mélodramatique et de rancœur fielleuse. Car si ce drame ne fonctionne pas comme il devrait, c’est que tout y est en excès. Vivier de cabotins narcissiques et de noceurs lubriques, le Théâtre des Fantaisies-Dramatiques ne semble abriter personne qui soit réellement intéressé par le théâtre. Même les comédiens semblent peu passionnés par la comédie. Lise Fleuron débarque dans une troupe qui a tout d’une meute royale de courtisans, qui n’ont rien d’autres à faire de leurs journées que de fomenter des intrigues et de compter l’argent qu’ils gagnent. Toutes les relations sexuelles sont soumises au renvoi d’ascenseur (expression anachronique dans ce contexte, mais néanmoins exacte). Clémence Villa est un bloc de haine, prête à aller jusqu’au meurtre pour faire disparaître Lise Fleuron, comme si une comédienne expérimentée ne s’était jamais préparée à l’idée d’être éclipsée un jour par un jeune talent. Jean de Brives, poupée de chiffons ballottée par les évènements, est aussi inconsistant qu'un fantôme. Sélim Nuïo se révèle un monument de pourriture, à la nationalité ambiguë, et sans que cela soit expressément dit, correspond un peu trop à des classiques clichés antisémites. Quant à Lise Fleuron, son innocence et sa pureté confinent à l’aveuglement pur et simple, tant elle ne voit jamais rien venir, ne doute jamais des faux amis qui l’entourent, n’imagine pas un seul instant qu’on puisse être jaloux d’elle ou qu’on cherche à la posséder par des moyens détournés. Poupée de porcelaine trop belle pour être vraie, trop pure pour imaginer qu'il y a des gens méchants, ravissante idiote qu’un chagrin d’amour suffit à condamner à mort, elle semble jaillir de la pauvre imagination d’un écrivain qui veut s’obstiner à croire qu’il n’existe que deux sortes de femmes, les anges et les putains. L’immaturité de cette vision binaire, pour ne pas dire bipolaire, contribue grandement au caractère ridicule de ce récit qui, plus sobre et plus réaliste, aurait pu se révéler passionnant. Mais en idolâtrant cette héroïne virginale et niaise, désormais bien désuète, tout en se répandant en crachats féroces et mortifères sur tout le milieu théâtral sans aucune exception, Georges Ohnet n’arrive qu’à se caricaturer lui-même au sein d’un défoulement narratif boursouflé et grotesque, parfois même risible dans sa mauvaise foi.
Malgré d’indéniables qualités narratives qui permettent, tant bien que mal, d’arriver tout de même au bout de ce récit, bien succinct malgré les 460 pages qu’Ohnet lui consacre, « Lise Fleuron » est assurément un des plus mauvais romans de son auteur, et annonce en tout cas ce qui se vérifiera plus tard, à savoir que Georges Ohnet, chroniqueur inspiré et talentueux de la bourgeoisie de la Belle-Époque, perd totalement les pédales et fonce dans le décor dès qu’il sort de ce milieu étriqué qui fut le sien...
À noter, pour finir, que ce roman eut une bien inattendue postérité, puisque l’histoire de Lise Fleuron fit une forte impression, une décennie plus tard, sur une jeune artiste de music-hall parisienne nommée Marguerite Rauscher, laquelle adopta pour sa carrière le pseudonyme de Lise Fleuron. Georges Ohnet dût s’en arracher les cheveux, car cette Lise Fleuron fut l’exact opposé de son héroïne : une cocotte à la fesse légère, collectionneuse d’amants, gouailleuse et vulgaire, spécialisée dans les rôles de prostituées dans les opérettes. Elle popularisa le décolleté plongeant, et reste même célèbre pour une série de cartes postales érotiques étonnamment audacieuses pour l’époque. Aujourd’hui encore, le nom de Lise Fleuron reste étroitement lié à l’histoire de l’érotisme en France. Une claque supplémentaire pour le pauvre Georges, qui semble avoir définitivement perdu avec ce roman cette « Bataille de la Vie »-ci.
19ème volume de la série des "Batailles de la Vie", "Au Fond du Gouffre" est un roman assez inattendu de la part de Georges Ohnet, d'ordinaire plus centré sur des intrigues familiales bourgeoises. L'auteur prend ici un tournant assez nouveau en adoptant les codes et le style des romans-feuilletons policiers, visant un public ouvertement plus populaire, même si les personnages principaux du récit sont tous issus de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie.
L'histoire débute par un dîner chez un des bourgeois les plus cossus de Paris, Cyprien Marenval. À table, la conversation débouche sur le thème de l'erreur judiciaire. Faut-il y croire ou non ? Après quelques hésitations, un jeune invité, Christian de Tragomer, affirme que non seulement il est persuadé qu'il y a des erreurs judiciaires, mais que personnellement, il est certain d'en connaître au moins une.
En effet, ce groupe d'amis a vécu deux ans auparavant une tragédie qui a touché l'un de ses membres, Jacques de Fréneuse. Ce jeune noceur a subitement - et apparemment sans motif - assassiné sa fiancée, Lea Perelli, dont on a trouvé chez lui le cadavre défiguré par plusieurs balles de révolver tirées à bout portant. Bien qu'il ait toujours clamé son innocence, Jacques de Fréneuse a été condamné à perpétuité, et déporté dans un bagne en Nouvelle-Calédonie. Sous le choc, ses amis eux-mêmes n'ont pas douté de ce crime atroce, et par gêne, ont progressivement cessé de rendre visite à la mère et à la soeur de Jacques de Freneuse, toutes deux éplorées et inconsolables. Tragomer lui-même assume douloureusement d'avoir pris cette distance, car il était fiancé à la soeur de son ami Jacques, et n'a pu l'épouser pour une question de respectabilité.
Cependant, lors d'un voyage d'agrément aux Etats-Unis, Tragomer assiste un soir à la performance d'une chanteuse américaine nommée Jenny Hawkins, en laquelle il reconnaît formellement Lea Perelli, censée pourtant être morte. D'abord persuadé d'être le jouet d'une hallucination, Tragomer n'a plus le moindre doute quand il réalise que Jenny Hawkins est managée par un jeune nobliau français, Sorège, un ami d'enfance de Jacques de Fréneuse. Tragomer soupçonne une machination. Mais comment le prouver ? Passionné par cette énigme, Marenval décide de s'associer au jeune Tragomer pour enquêter sur cette mystérieuse Jenny Hawkins. Très vite, ils apprennent que cette chanteuse américaine s'appelle en fait Jeanne Beaud, qu'elle est de nationalité française, et que sous son véritable nom, elle aurait vivoté dans quelques cabarets parisiens avant d'émigrer aux Etats-Unis nantie d'une nouvelle identité. Mais lorsque Tragomer parvient à obtenir une photographie de cette chanteuse, prise alors qu'elle vivait encore en France, il constate que ce n'est pas la femme qui se fait appeler Jenny Hawkins. Il y a donc eu usurpation d'identité, et il s'agit donc bien de Lea Perelli qui a refait sa vie après avoir été soi-disant assassinée. Afin de la démasquer, Marenval et Tragomer iront même jusqu'au bagne de Nouvelle-Calédonie pour en faire évader Jacques de Fréneuse au péril de leurs vies, afin de le ramener à Londres, où Jenny Hawkins fait un gala prochainement. Ils espèrent qu'en le confrontant à Lea Perelli et à Sorège, marionnettiste cynique de cette mystification, les deux criminels se révèleront dans toute leur félonie...
L'intrigue, on le voit, est purement policière. Il n'est pas question ici de se plonger dans une atmosphère de moeurs provinciales. Délibérément, Georges Ohnet s'essaye à quelque chose de nouveau, et hélas, il s'y montre plus que médiocre.
D'abord, comme on s'en doute, tout est ici assez prévisible. L'auteur se donne inutilement beaucoup de mal pour entretenir un suspense dont l'enjeu est aisément devinable dès les premières pages. Même en tenant compte du fait que le genre policier était encore un peu balbutiant en 1899, les intrigues policières n'en étaient pas moins très souvent alambiquées, et ce, depuis les tous premiers romans d'Emile Gaboriau, véritable créateur du genre.
Soit qu'il ait une piètre estime de ses lecteurs, soit qu'il n'ait pas eu envie de se fatiguer, Georges Ohnet a préféré se contenter de cette mince trame, et s'est surtout concentré sur les détails de l'enquête, tout en exprimant les réflexions, les doutes, les hésitations de Tragomer et Marenval, en insistant de manière très discutable sur la nécessité de transgresser la loi pour faire triompher la Justice.
C'est d'ailleurs là ce que l'on peut considérer comme le fond véritablement littéraire de ce feuilleton à demi-raté : Georges Ohnet est soucieux, par-delà son récit, de s'interroger sur la rigueur morale prévalant l'institution judiciaire, laquelle, selon lui, a trop vite tendance à conclure hâtivement que le suspect le plus probable est forcément le seul coupable possible. Il est à noter que ce roman fut écrit en pleine affaire Dreyfus, et que sans aucun doute, Georges Ohnet était fortement influencé par l'actualité, et a voulu en extrapoler certaines conclusions dans un contexte plus civil.
Néanmoins, ce souci de faire passer un message est précisément ce qui plombe "Au Fond du Gouffre". N'est pas Eugène Sue qui veut : le roman-feuilleton a ses règles ! Celles-ci imposent un certain rythme, une dynamique, des intrigues multiples et croisées, une foule de personnages et une attention constamment renouvelée par des rebondissements et des coups de théâtre. Or, par cette démarche moraliste sentencieuse, assez exprimée du reste par de trop nombreux - et interminables - dialogues philosophiques, "Au Fond du Gouffre" est un roman terriblement lent, qui parle plus qu'il n'avance, et qui étale ses rebondissements parfois sur une trentaine de pages. On retrouve finalement assez vite l'aspect quelque peu monolithique, statique, du style habituel de Georges Ohnet, mais sans ce qui en fait toute la qualité : c'est-à-dire l'ambiance, l'atmosphère, la tension entre les êtres, bref, tout ce qui se dégage précisément de ses plus célèbres chroniques provinciales. Le titre même du roman est un avant-goût de cet immobilisme désespérant, qui plonge dans la torpeur une enquête se voulant pourtant palpitante.
Georges Ohnet a parfaitement compris la mécanique du roman-feuilleton, mais il l'applique sans passion, sans enthousiasme, sans aucune folie. Seule son expérience de narrateur fait qu'on se laisse tout de même embarquer dans son histoire bien improbable, non sans noter d'innombrables longueurs. Trop préoccupé de prouver par un pathos permanent toutes les conséquences dramatiques d'une erreur judiciaire, Georges Ohnet saborde à la fois son récit et sa démonstration, cette dernière apparaissant vite comme un très ennuyeux sermon.
Un tel manque de discernement a de quoi surprendre chez un auteur, qui arrivait alors à sa quinzième année de carrière et n'était plus un débutant. Sans doute Georges Ohnet a-t-il eu trop confiance en lui. Toujours est-il que ce roman ne s'est guère bonifié avec le temps, et s'il se laisse encore lire d'un oeil paresseux, "Au Fond du Gouffre" apparait aujourd'hui terriblement vieillot, n'ayant même pas pour lui la fantaisie d'un vrai roman-feuilleton, ni le charme kitsch d'une fable de la Belle-Époque. Dramatiquement morne et sérieux, même si paradoxalement "Au Fond du Gouffre" est l'un de ses romans les moins tourmentés, Georges Ohnet rate assez ostensiblement son examen d'entrée dans le genre policier, et ne parvient qu'à "ohnetiser" une littérature de genre au travers d'un roman bancal, mal conçu, mal conté, besogneux et presque parodique à force de maladresses...
L'histoire débute par un dîner chez un des bourgeois les plus cossus de Paris, Cyprien Marenval. À table, la conversation débouche sur le thème de l'erreur judiciaire. Faut-il y croire ou non ? Après quelques hésitations, un jeune invité, Christian de Tragomer, affirme que non seulement il est persuadé qu'il y a des erreurs judiciaires, mais que personnellement, il est certain d'en connaître au moins une.
En effet, ce groupe d'amis a vécu deux ans auparavant une tragédie qui a touché l'un de ses membres, Jacques de Fréneuse. Ce jeune noceur a subitement - et apparemment sans motif - assassiné sa fiancée, Lea Perelli, dont on a trouvé chez lui le cadavre défiguré par plusieurs balles de révolver tirées à bout portant. Bien qu'il ait toujours clamé son innocence, Jacques de Fréneuse a été condamné à perpétuité, et déporté dans un bagne en Nouvelle-Calédonie. Sous le choc, ses amis eux-mêmes n'ont pas douté de ce crime atroce, et par gêne, ont progressivement cessé de rendre visite à la mère et à la soeur de Jacques de Freneuse, toutes deux éplorées et inconsolables. Tragomer lui-même assume douloureusement d'avoir pris cette distance, car il était fiancé à la soeur de son ami Jacques, et n'a pu l'épouser pour une question de respectabilité.
Cependant, lors d'un voyage d'agrément aux Etats-Unis, Tragomer assiste un soir à la performance d'une chanteuse américaine nommée Jenny Hawkins, en laquelle il reconnaît formellement Lea Perelli, censée pourtant être morte. D'abord persuadé d'être le jouet d'une hallucination, Tragomer n'a plus le moindre doute quand il réalise que Jenny Hawkins est managée par un jeune nobliau français, Sorège, un ami d'enfance de Jacques de Fréneuse. Tragomer soupçonne une machination. Mais comment le prouver ? Passionné par cette énigme, Marenval décide de s'associer au jeune Tragomer pour enquêter sur cette mystérieuse Jenny Hawkins. Très vite, ils apprennent que cette chanteuse américaine s'appelle en fait Jeanne Beaud, qu'elle est de nationalité française, et que sous son véritable nom, elle aurait vivoté dans quelques cabarets parisiens avant d'émigrer aux Etats-Unis nantie d'une nouvelle identité. Mais lorsque Tragomer parvient à obtenir une photographie de cette chanteuse, prise alors qu'elle vivait encore en France, il constate que ce n'est pas la femme qui se fait appeler Jenny Hawkins. Il y a donc eu usurpation d'identité, et il s'agit donc bien de Lea Perelli qui a refait sa vie après avoir été soi-disant assassinée. Afin de la démasquer, Marenval et Tragomer iront même jusqu'au bagne de Nouvelle-Calédonie pour en faire évader Jacques de Fréneuse au péril de leurs vies, afin de le ramener à Londres, où Jenny Hawkins fait un gala prochainement. Ils espèrent qu'en le confrontant à Lea Perelli et à Sorège, marionnettiste cynique de cette mystification, les deux criminels se révèleront dans toute leur félonie...
L'intrigue, on le voit, est purement policière. Il n'est pas question ici de se plonger dans une atmosphère de moeurs provinciales. Délibérément, Georges Ohnet s'essaye à quelque chose de nouveau, et hélas, il s'y montre plus que médiocre.
D'abord, comme on s'en doute, tout est ici assez prévisible. L'auteur se donne inutilement beaucoup de mal pour entretenir un suspense dont l'enjeu est aisément devinable dès les premières pages. Même en tenant compte du fait que le genre policier était encore un peu balbutiant en 1899, les intrigues policières n'en étaient pas moins très souvent alambiquées, et ce, depuis les tous premiers romans d'Emile Gaboriau, véritable créateur du genre.
Soit qu'il ait une piètre estime de ses lecteurs, soit qu'il n'ait pas eu envie de se fatiguer, Georges Ohnet a préféré se contenter de cette mince trame, et s'est surtout concentré sur les détails de l'enquête, tout en exprimant les réflexions, les doutes, les hésitations de Tragomer et Marenval, en insistant de manière très discutable sur la nécessité de transgresser la loi pour faire triompher la Justice.
C'est d'ailleurs là ce que l'on peut considérer comme le fond véritablement littéraire de ce feuilleton à demi-raté : Georges Ohnet est soucieux, par-delà son récit, de s'interroger sur la rigueur morale prévalant l'institution judiciaire, laquelle, selon lui, a trop vite tendance à conclure hâtivement que le suspect le plus probable est forcément le seul coupable possible. Il est à noter que ce roman fut écrit en pleine affaire Dreyfus, et que sans aucun doute, Georges Ohnet était fortement influencé par l'actualité, et a voulu en extrapoler certaines conclusions dans un contexte plus civil.
Néanmoins, ce souci de faire passer un message est précisément ce qui plombe "Au Fond du Gouffre". N'est pas Eugène Sue qui veut : le roman-feuilleton a ses règles ! Celles-ci imposent un certain rythme, une dynamique, des intrigues multiples et croisées, une foule de personnages et une attention constamment renouvelée par des rebondissements et des coups de théâtre. Or, par cette démarche moraliste sentencieuse, assez exprimée du reste par de trop nombreux - et interminables - dialogues philosophiques, "Au Fond du Gouffre" est un roman terriblement lent, qui parle plus qu'il n'avance, et qui étale ses rebondissements parfois sur une trentaine de pages. On retrouve finalement assez vite l'aspect quelque peu monolithique, statique, du style habituel de Georges Ohnet, mais sans ce qui en fait toute la qualité : c'est-à-dire l'ambiance, l'atmosphère, la tension entre les êtres, bref, tout ce qui se dégage précisément de ses plus célèbres chroniques provinciales. Le titre même du roman est un avant-goût de cet immobilisme désespérant, qui plonge dans la torpeur une enquête se voulant pourtant palpitante.
Georges Ohnet a parfaitement compris la mécanique du roman-feuilleton, mais il l'applique sans passion, sans enthousiasme, sans aucune folie. Seule son expérience de narrateur fait qu'on se laisse tout de même embarquer dans son histoire bien improbable, non sans noter d'innombrables longueurs. Trop préoccupé de prouver par un pathos permanent toutes les conséquences dramatiques d'une erreur judiciaire, Georges Ohnet saborde à la fois son récit et sa démonstration, cette dernière apparaissant vite comme un très ennuyeux sermon.
Un tel manque de discernement a de quoi surprendre chez un auteur, qui arrivait alors à sa quinzième année de carrière et n'était plus un débutant. Sans doute Georges Ohnet a-t-il eu trop confiance en lui. Toujours est-il que ce roman ne s'est guère bonifié avec le temps, et s'il se laisse encore lire d'un oeil paresseux, "Au Fond du Gouffre" apparait aujourd'hui terriblement vieillot, n'ayant même pas pour lui la fantaisie d'un vrai roman-feuilleton, ni le charme kitsch d'une fable de la Belle-Époque. Dramatiquement morne et sérieux, même si paradoxalement "Au Fond du Gouffre" est l'un de ses romans les moins tourmentés, Georges Ohnet rate assez ostensiblement son examen d'entrée dans le genre policier, et ne parvient qu'à "ohnetiser" une littérature de genre au travers d'un roman bancal, mal conçu, mal conté, besogneux et presque parodique à force de maladresses...
Georges Ohnet signe ici l'un de ses livres les plus marquants, célèbre aussi par la critique assassine qu'en a fait le pourtant très débonnaire Anatole France, et qui est reprise sur la page Wikipedia consacrée à Georges Ohnet. Cette critique n'est pas fondamentalement injuste, mais elle est très excessive, car effectivement, on trouverait difficilement deux écrivains aux conceptions plus opposées qu'Anatole France, chrétien humaniste, et Georges Ohnet, matérialiste bourgeois qui n'avait foi que dans les conventions sociales.
Sans surprise, la volonté est la thématique de base de ce roman, qui tranche par rapport à son prédécesseur, "Les Dames de Sainte-Croix", par une sophistication extrême dans la description d'un milieu communautaire de la bourgeoisie de province.
Le roman tourne autour de Louis Hérault, dernier rejeton d'une famille d'affairistes autodidactes, dont la mère fait entrer comme gouvernante dans la maison familiale une jeune femme du nom d'Hélène Graville, qui se trouve être une cousine éloignée issue d'une branche adultérine de la famille. Cette jeune fille charmante et vertueuse conquiert le cœur du pourtant très noceur Louis Hérault, mais aussi de son ami Clément Tauziat, lui aussi très viveur mais plus sentimentalement investi que son ami Louis. C'est pourtant finalement à Louis qu'Hélène accorde sa main.
Or, Louis est un être faible, influençable, lâche, qui menait déjà une relation adultère avec Diana Olifaunt, une intrigante anglaise, mariée à un notable britannique, et qui la poursuit après le mariage de Louis. Diana, avec l'accord de son mari, négocie ses faveurs auprès des puissants alliés de ce dernier, dont Lereboulley, un financier renommé, et Louis Herault, auquel elle cède au début par simple caprice.
Evidemment, toute cette situation repose sur un équilibre fragile, celui visant à maintenir dans l'ignorance les personnes trompées, et l'essentiel du roman de Georges Ohnet consiste à faire balancer d'un côté puis de l'autre la destinée de ce Louis Hérault sans volonté, sous l'emprise de deux femmes aux volontés puissantes et contradictoires. Toujours amoureux d'Hélène, Clément Tauziat attend l'heure de la chute de Louis. Plus tard, Lereboulley instruit de la relation de Diana avec Louis, tentera lui aussi de le faire chuter, pour récupérer sa maîtresse. Balloté par tous ces vents contraires, Louis est finalement le seul à ne pas perdre de plumes dans cette histoire, s'adaptant lors de chaque revers à ce que la situation exige.
Il s'en dégage fatalement une morale qui avait bien de quoi faire dresser les cheveux sur la tête à ce pauvre Anatole France, mais qui a aussi de quoi choquer nos contemporains : au final, pour Georges Ohnet, peu importent la morale et la vertu, seul compte la respectabilité, et celle-ci repose principalement sur un nom de famille et une fortune, tous deux hérités, et qu'il faut s'efforcer de préserver, quel qu'en soit le prix. L'amitié ne compte pas, l'amour encore moins. Pire : il est un dérèglement des sens, qui ne peut provoquer que de grands malheurs. Tous deux sincèrement amoureux, Tauziat et Lereboulley sont les grands perdants de cette histoire, tandis que l'attachement conventionnel et mortifiant d'Hélène envers son fourbe mari est considéré comme un sens du devoir qui ne peut être que remarquable. Quant à Louis Hérault lui-même, il est un parfait mauvais exemple dont les vices et les lâchetés n'ont que fort peu de conséquences sur sa vie - même si, par son attitude, il gâche bien d'autres existences -, car la solidité de sa position sociale et la priorité qu'il lui donne, lui vaut une totale rédemption.
Nous avons là effectivement les raisons pour lesquelles on peut percevoir les livres de Georges Ohnet comme "déplaisants" et ses conceptions "désobligeantes", pour reprendre les qualificatifs assez justes d'Anatole France.
Reste qu'en dehors de ces travers parfaitement assumés par l'auteur, et qui font partie de son style, Georges Ohnet n'est pas un mauvais romancier, même si ses ficelles sont parfois un peu grossières. Les personnages sont cohérents, complémentaires, bien dessinés, très personnages de théâtre (c'était d'ailleurs le premier amour - malheureux - de Georges Ohnet), et le caractère relativement conventionnel de ses intrigues est habilement compensé par cette morale élastique et biscornue, qui rend au final ses romans terriblement imprévisibles, le happy-end n'étant pas de rigueur.
Qui plus est, Georges Ohnet est un écrivain qui a un étonnant sens du suspense pour un homme de sa génération. Il annonce en fait toute la littérature policière du siècle suivant, particulièrement les ambiances à la Georges Simenon, qui chez Ohnet, restent cantonnées à la bonne société, mais le principe reste le même : un dysfonctionnement, en lieu et place de ce qui sera plus tard un crime, permet au lecteur de pénétrer l'intimité d'une ou de plusieurs familles, en s'étalant volontiers sur les coucheries, les compromissions, les rivalités de pouvoir, les inévitables histoires d'argent...
Les romans de Georges Ohnet peuvent, en ce sens, apparaître comme une sorte de polar avant l'heure, où le meurtre n'est jamais au début, mais à la toute fin, où les questions de bien et de mal se posent moins que celles de ce qui est légal ou criminel - ou plus exactement en ce qui le concerne, de ce qui est bienséant ou de ce qui ne l'est pas, concernant des personnes qui savent rester à leur place ou qui ne le savent pas - ce qui est aussi une forme de loi qui dépasse de beaucoup les valeurs morales.
"Volonté" est sur beaucoup de plans une oeuvre très emblématique du style Ohnet, et sa lecture est frappante par sa modernité, malgré le caractère désuet de l'intrigue. Le style d'Ohnet est par ailleurs très vivant, très sobre, on ne croirait pas lire un livre du XIXème siècle, mais plutôt des années 1930 ou 1940, l'ambiance rappelle aussi parfois les polars américains de l'après-guerre, avec une certaine tension narrative. Au final, même si l'ensemble peut déplaire et la fin du roman encore plus, "Volonté" est plutôt un ouvrage envoûtant et palpitant qui préfigure l'évolution littéraire du XXème siècle, avec tout ce que ça implique, y compris évidemment une grande perte de noblesse intellectuelle et d'humanisme.
Sans surprise, la volonté est la thématique de base de ce roman, qui tranche par rapport à son prédécesseur, "Les Dames de Sainte-Croix", par une sophistication extrême dans la description d'un milieu communautaire de la bourgeoisie de province.
Le roman tourne autour de Louis Hérault, dernier rejeton d'une famille d'affairistes autodidactes, dont la mère fait entrer comme gouvernante dans la maison familiale une jeune femme du nom d'Hélène Graville, qui se trouve être une cousine éloignée issue d'une branche adultérine de la famille. Cette jeune fille charmante et vertueuse conquiert le cœur du pourtant très noceur Louis Hérault, mais aussi de son ami Clément Tauziat, lui aussi très viveur mais plus sentimentalement investi que son ami Louis. C'est pourtant finalement à Louis qu'Hélène accorde sa main.
Or, Louis est un être faible, influençable, lâche, qui menait déjà une relation adultère avec Diana Olifaunt, une intrigante anglaise, mariée à un notable britannique, et qui la poursuit après le mariage de Louis. Diana, avec l'accord de son mari, négocie ses faveurs auprès des puissants alliés de ce dernier, dont Lereboulley, un financier renommé, et Louis Herault, auquel elle cède au début par simple caprice.
Evidemment, toute cette situation repose sur un équilibre fragile, celui visant à maintenir dans l'ignorance les personnes trompées, et l'essentiel du roman de Georges Ohnet consiste à faire balancer d'un côté puis de l'autre la destinée de ce Louis Hérault sans volonté, sous l'emprise de deux femmes aux volontés puissantes et contradictoires. Toujours amoureux d'Hélène, Clément Tauziat attend l'heure de la chute de Louis. Plus tard, Lereboulley instruit de la relation de Diana avec Louis, tentera lui aussi de le faire chuter, pour récupérer sa maîtresse. Balloté par tous ces vents contraires, Louis est finalement le seul à ne pas perdre de plumes dans cette histoire, s'adaptant lors de chaque revers à ce que la situation exige.
Il s'en dégage fatalement une morale qui avait bien de quoi faire dresser les cheveux sur la tête à ce pauvre Anatole France, mais qui a aussi de quoi choquer nos contemporains : au final, pour Georges Ohnet, peu importent la morale et la vertu, seul compte la respectabilité, et celle-ci repose principalement sur un nom de famille et une fortune, tous deux hérités, et qu'il faut s'efforcer de préserver, quel qu'en soit le prix. L'amitié ne compte pas, l'amour encore moins. Pire : il est un dérèglement des sens, qui ne peut provoquer que de grands malheurs. Tous deux sincèrement amoureux, Tauziat et Lereboulley sont les grands perdants de cette histoire, tandis que l'attachement conventionnel et mortifiant d'Hélène envers son fourbe mari est considéré comme un sens du devoir qui ne peut être que remarquable. Quant à Louis Hérault lui-même, il est un parfait mauvais exemple dont les vices et les lâchetés n'ont que fort peu de conséquences sur sa vie - même si, par son attitude, il gâche bien d'autres existences -, car la solidité de sa position sociale et la priorité qu'il lui donne, lui vaut une totale rédemption.
Nous avons là effectivement les raisons pour lesquelles on peut percevoir les livres de Georges Ohnet comme "déplaisants" et ses conceptions "désobligeantes", pour reprendre les qualificatifs assez justes d'Anatole France.
Reste qu'en dehors de ces travers parfaitement assumés par l'auteur, et qui font partie de son style, Georges Ohnet n'est pas un mauvais romancier, même si ses ficelles sont parfois un peu grossières. Les personnages sont cohérents, complémentaires, bien dessinés, très personnages de théâtre (c'était d'ailleurs le premier amour - malheureux - de Georges Ohnet), et le caractère relativement conventionnel de ses intrigues est habilement compensé par cette morale élastique et biscornue, qui rend au final ses romans terriblement imprévisibles, le happy-end n'étant pas de rigueur.
Qui plus est, Georges Ohnet est un écrivain qui a un étonnant sens du suspense pour un homme de sa génération. Il annonce en fait toute la littérature policière du siècle suivant, particulièrement les ambiances à la Georges Simenon, qui chez Ohnet, restent cantonnées à la bonne société, mais le principe reste le même : un dysfonctionnement, en lieu et place de ce qui sera plus tard un crime, permet au lecteur de pénétrer l'intimité d'une ou de plusieurs familles, en s'étalant volontiers sur les coucheries, les compromissions, les rivalités de pouvoir, les inévitables histoires d'argent...
Les romans de Georges Ohnet peuvent, en ce sens, apparaître comme une sorte de polar avant l'heure, où le meurtre n'est jamais au début, mais à la toute fin, où les questions de bien et de mal se posent moins que celles de ce qui est légal ou criminel - ou plus exactement en ce qui le concerne, de ce qui est bienséant ou de ce qui ne l'est pas, concernant des personnes qui savent rester à leur place ou qui ne le savent pas - ce qui est aussi une forme de loi qui dépasse de beaucoup les valeurs morales.
"Volonté" est sur beaucoup de plans une oeuvre très emblématique du style Ohnet, et sa lecture est frappante par sa modernité, malgré le caractère désuet de l'intrigue. Le style d'Ohnet est par ailleurs très vivant, très sobre, on ne croirait pas lire un livre du XIXème siècle, mais plutôt des années 1930 ou 1940, l'ambiance rappelle aussi parfois les polars américains de l'après-guerre, avec une certaine tension narrative. Au final, même si l'ensemble peut déplaire et la fin du roman encore plus, "Volonté" est plutôt un ouvrage envoûtant et palpitant qui préfigure l'évolution littéraire du XXème siècle, avec tout ce que ça implique, y compris évidemment une grande perte de noblesse intellectuelle et d'humanisme.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Le Fer, dans tous ses états
Adenolia
119 livres
Auteurs proches de Georges Ohnet
Lecteurs de Georges Ohnet (52)Voir plus
Quiz
Voir plus
Connaissez-vous La Peau de Chagrin de Balzac ?
Comment se comme le personnage principal du roman ?
Valentin de Lavallière
Raphaël de Valentin
Raphaël de Vautrin
Ferdinand de Lesseps
10 questions
1310 lecteurs ont répondu
Thème : La Peau de chagrin de
Honoré de BalzacCréer un quiz sur cet auteur1310 lecteurs ont répondu