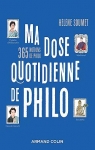Citations de Hélène Soumet (127)
« L’amour des mythes est, en quelque manière, amour de la sagesse » selon Aristote. Le mythe, quoiqu’imaginaire et merveilleux, nous conte les origines du monde, la naissance de l’humanité, la raison de l’existence du mal. Ce sont les mythes qui expliquent la naissance de l’ordre qui surgit du chaos primordial.
On confond souvent le chaos et le désordre, en croyant que le chaos n’est qu’un plus grand désordre. Or, le chaos est ce mystérieux état primordial avant la création du monde, avant même l’ordre et le désordre.
Les cosmogonies partent toujours de cet état premier : le chaos en Grèce, le tohu-bohu dans la Bible, le noun en Égypte, Nammu à Sumer. Il y a dans ce concept de chaos une universalité étonnante. Le chaos, c’est l’indistinction, la matière informe qui interdit le surgissement de toute forme, une idée difficile à se représenter.
Cet état d’indescriptible confusion est antérieur au désordre qui, lui, présuppose déjà l’existence d’un ordre. La mise en ordre s’opère par une puissance supérieure qui vient des dieux, ou d’un dieu souvent au terme d’une lutte acharnée entre lui et le chaos. Lorsque l’ordre du monde est instauré, hélas, on n’en termine pas avec le chaos : monstres, dragons, sorciers, titans sont autant de forces obscures qui menacent le fragile ordre du monde instauré par les dieux. Surgit alors le désordre, qui est l’ordre dérangé, bouleversé.
Les cosmogonies partent toujours de cet état premier : le chaos en Grèce, le tohu-bohu dans la Bible, le noun en Égypte, Nammu à Sumer. Il y a dans ce concept de chaos une universalité étonnante. Le chaos, c’est l’indistinction, la matière informe qui interdit le surgissement de toute forme, une idée difficile à se représenter.
Cet état d’indescriptible confusion est antérieur au désordre qui, lui, présuppose déjà l’existence d’un ordre. La mise en ordre s’opère par une puissance supérieure qui vient des dieux, ou d’un dieu souvent au terme d’une lutte acharnée entre lui et le chaos. Lorsque l’ordre du monde est instauré, hélas, on n’en termine pas avec le chaos : monstres, dragons, sorciers, titans sont autant de forces obscures qui menacent le fragile ordre du monde instauré par les dieux. Surgit alors le désordre, qui est l’ordre dérangé, bouleversé.
Les mythes sont des récits imaginaires qui relatent les origines du monde et répondent par des métaphores, par l’évocation de forces surnaturelles aux éternelles questions des hommes sur leur origine et leur destinée. Ils pallient ainsi l’ignorance des premières causes.
L’épopée recèle déjà des réflexions sur le sens de la vie, la mort, l’amitié. Émotions et sentiments si proches des nôtres ! Dans le passage suivant du récit, des accents épicuriens évoquent la brièveté de la vie et conseillent à Gilgamesh, le héros en quête de l’impossible immortalité, de jouir du moment présent. Émouvant récit qui vient de si loin…
Dès l’aube de l’humanité, les hommes ont réfléchi au mystère de leur origine, au sens de leur vie, au monde étrange qui les entoure et à la merveilleuse capacité de parler, de penser qui les distingue de tous les êtres vivants. Les récits très anciens qui ont échappé à la destruction témoignent du désir impérieux de comprendre et d’éclaircir le mystère de la vie humaine.
Comment pouvons-nous déclarer qu’une chose est belle sans savoir au moins confusément ce qu’est la beauté ? Car notre monde ignore la beauté absolue. C’est, dirait Platon, que surgit alors par le phénomène de la réminiscence, une lueur qui nous éclaire dans la nuit, qui est le souvenir d’une beauté absolue que l’âme a contemplée ailleurs.
La poésie seule peut évoquer cette âme voyageuse, immatérielle et par là, immortelle. Mais Platon reste évasif sur la réincarnation ; ce qui lui importe, c’est qu’au cours de ces vagabondages l’âme revient dans son lieu d’origine où elle a contemplé les Idées : le Beau, le Vrai le Bien.
Ce désir de savoir chez Platon est inséparable de l’Éros, de l’amour. L’amoureux est tendu vers l’objet de ses feux, il cherche à exprimer son amour, raconte, écrit avec passion, compose des poèmes, car tout sentiment amoureux est loquace. De même, chez Platon tout discours qui recherche la vérité, n’est pas pur goût de l’abstraction mais relève de l’inspiration, du désir amoureux.
La dialectique n’est pas une controverse, une joute intellectuelle entre deux esprits rivaux, la dialectique n’est jamais une lutte entre deux personnes mais au contraire une alliance entre deux personnes qui cherchent le vrai.
Le projet politique de Platon se fortifie au cours de ces événements dramatiques. Il lui faut savoir comment une cité pourrait être bien gouvernée. Ainsi, malgré ces troubles, malgré la crainte d’appartenir à une famille suspecte, malgré le chagrin d’avoir perdu autant de membres de sa famille, Platon continue à suivre les leçons de Socrate, apprenant peu à peu la méthode dialectique, merveilleux moyen d’attendre le vrai.
Si l’éducateur mène l’enfant vers l’humanité, si l’homme politique vise le Bien de la cité, il importe alors que l’éducateur comme l’homme politique prennent conscience qu’il existe en l’homme une dimension surhumaine, une part divine. Éduquer, c’est conduire hors de, selon l’étymologie ; mais où sera conduit l’enfant d’un éducateur ignorant ?
Source, origine, cause de tout l’intelligible, le Bien est ce par quoi la pensée peut aller au vrai et se séparer des opinions, comme du monde flou et changeant de la sensation. Permettant toute connaissance fondée, le Bien est un principe (ce qui est premier) et par là, ce que toute âme recherche.
Sortons de nos doux rêves où tous les problèmes ont des solutions ! La lumière du soleil éclaire l’intelligence mais il faut monter vers la source de lumière : le Soleil.
Le point par exemple n’a ni surface ni mesure. On saisit par là que c’est une Idée et non pas une réalité sensible car notre expérience ne nous informe guère sur une chose qui n’a ni surface ni mesure. En revanche, la droite qui est un ensemble de points est mesurable, tout en n’ayant pas de surface ! Puisque les bases sont infondées alors les résultats, s’ils sont cohérents et justes ne sont pas vrais absolument.
Pour Platon, l’éducateur n’est pas un tendre, ce n’est pas le pédagogue, il commence par la contrainte car le prisonnier n’a guère envie de sortir et cherche plutôt, aussitôt libéré, à revenir à ses anciennes illusions, à l’instar des protagonistes des dialogues qui préfèrent la fuite aux questions de Socrate. Les ombres mouvantes de la caverne constituent un monde illusoire attrayant pour celui qui craint d’affronter le réel, qui redoute l’éblouissement douloureux de la lumière. C’est pourquoi l’éducateur libère le prisonnier de force, le choque, le déstabilise, pour lui faire prendre conscience de son ignorance et le diriger, en le tractant péniblement, malgré lui, pour qu’il se tourne vers un discours fondé, approchant pas à pas de la vérité.
Les prisonniers ne cherchent pas à s’évader. La caverne, doux cocon à l’abri du réel est un refuge où ils se bercent d’illusions. Pourquoi sortir ? C’est l’éducateur qui détache le prisonnier, le libère de ses chaînes malgré lui et le contraint à tourner la tête, à sortir de son « confort » douillet pour voir les objets réels dont il ne percevait que les ombres. La caverne comme lieu de l’obscur a été interprétée de mille manières.
Le prisonnier vit une étrange vie : les ombres suscitent des désirs, des craintes, des plaisirs irraisonnés. Les prisonniers de la caverne ne sont pas des troglodytes, ni même des peuples sauvages étrangers à toute civilisation. Socrate suggère que ces prisonniers ne sont que des hommes ordinaires sans éducation, pas si éloignés de nous au demeurant. Ces prisonniers représentent la nature humaine dénuée d’éducation. L’homme sans la culture, ni la philosophie.
Platon est impatient de savoir ce qui pourrait permettre à une cité d’être bien gouvernée, et de connaître le principe de justice qui éclairerait les choix politiques. Mais comment trouver un homme qui ne soit pas corruptible, qui ne soit pas mû par la soif du pouvoir, par l’appétit insatiable des richesses ? Comment trouver un homme qui sache diriger la cité et prendre les bonnes décisions ? Quelle est donc cette science qu’il devrait posséder ? Il faudra à Platon toute une vie pour établir la possibilité d’un gouvernement juste.
Cet amour de Socrate envers Alcibiade fut partagé comme le montre Platon dans le Banquet. Et l’on disait que Socrate, l’homme le plus laid d’Athènes avait une relation d’amour avec le plus bel homme du monde. Si ses élèves sont capables de telles trahisons, comment faire confiance à un tel maître ? Socrate, par cette « amitié » sulfureuse risquait fort d’être considéré comme un ennemi de la cité.
Adulé par ses disciples, aimé par le brillant Alcibiade, détesté par les prêtres et les sophistes, Socrate ne fait pas l’unanimité à Athènes, d’autant qu’il éveille la méfiance des pères, car il décourage parfois les jeunes gens qui veulent se lancer dans la politique, comme il l’a fait pour Platon et ses frères ainsi que pour le fils du tanneur Anytos.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Hélène Soumet
Lecteurs de Hélène Soumet (63)Voir plus
Quiz
Voir plus
Que racontent les auteurs de polars ?
Généralement, nous suivons un détective privé très intelligent (en tout cas persuadé de l’être) qui va résoudre une énigme en collectant des indices.
Jean-Patrick Manchette
Agatha Christie
David Goodis
Harlan Coben
6 questions
145 lecteurs ont répondu
Thèmes :
romans policiers et polarsCréer un quiz sur cet auteur145 lecteurs ont répondu