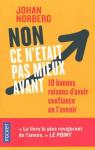Citations de Johan Norberg (64)
Pour reprendre les mots du grand expert dans les questions de développement récemment décédé [ouvrage publié en 2003], Peter T. Bauer, l’aide étrangère est souvent une façon de « DISTRIBUER L’ARGENT DES PAUVRES VIVANT DANS DES PAYS RICHES AUX RICHES VIVANT DANS DES PAYS PAUVRES».
[…] Comme les fonds sont directement envoyés aux gouvernements de ces pays, il est souvent plus profitable de prendre le contrôle de l’Etat que de tenter de s’enrichir en produisant et en commerçant.
[…] L’aide au développement a souvent aidé des dictateurs corrompus à s’accrocher au pouvoir (Fidel Castro a amassé une fortune évaluée à un milliard de dollars pendant que le PIB de Cuba se contractait du tiers.)
(Ch. 4 Les problèmes des pays en développement, p. 158-159)
[…] Comme les fonds sont directement envoyés aux gouvernements de ces pays, il est souvent plus profitable de prendre le contrôle de l’Etat que de tenter de s’enrichir en produisant et en commerçant.
[…] L’aide au développement a souvent aidé des dictateurs corrompus à s’accrocher au pouvoir (Fidel Castro a amassé une fortune évaluée à un milliard de dollars pendant que le PIB de Cuba se contractait du tiers.)
(Ch. 4 Les problèmes des pays en développement, p. 158-159)
La principale leçon que l’on peut tirer après plusieurs décennies de recommandations de la part du FMI et de la Banque mondiale est qu’elles ont un effet négligeable sur les pays qui reçoivent les fonds. Pour de nombreux gouvernements aux prises avec une crise financière majeure, ces prêts offrent une dernière chance d’éviter des réformes substantielles et difficiles. En général, il leur suffit simplement de promettre des réformes pour recevoir des sommes gigantesques. Il s’agit d’une pratique dangereuse, qui permet à des potentats locaux de se maintenir au pouvoir et de préserver leur régime corrompu avec quelques réformes mineures pour satisfaire les représentants du FMI. Avec le recul des années, l’ex ministre russe des Finances Boris Fiodorov affirme que les octrois du FMI n’ont fait que reporter à plus tard des réformes libérales que la Russie aurait du adopter de toutes façons.
(Ch. 4 Les problèmes des pays en développement, p. 153)
(Ch. 4 Les problèmes des pays en développement, p. 153)
Les politiques qu’ils [les pays latino-américains] ont plutôt mises en œuvre sont un modèle de protectionnisme et de suicide économique. Les gouvernements ont distribué des subventions massives à l’industrie locale, tout en la protégeant derrière des tarifs exorbitants. Pendant les années 1950, on a introduit des quotas et des barrières très strictes pour empêcher l’importation de produits étrangers, avec des tarifs de 100 à 200%. Parce que les consommateurs n’avaient plus la possibilité d’acheter des produits importés, les industries locales ont pu augmenter leur production et générer une forte croissance. Mais comme elles ne subissaient aucune pression concurrentielle, elles n’ont pas senti l’obligation de s’améliorer sur le plan technique et opérationnel. Ce sont des industries inefficaces et désuètes qui ont pris de l’expansion. Les prix du marché local étant plus élevés que ceux du marché international, il y avait peu d’avantages à exporter. L’économie devint plus politisée à mesure que les gouvernements entreprirent de contrôler la main-d’œuvre, les prix et la production dans le sens d’une industrialisation forcée. Le pouvoir interventionniste de l’Etat prit une ampleur de plus en plus imposante ; en Argentine, même les cirques furent nationalisés. Les firmes mirent donc plus d’efforts à tenter de s’arroger les faveurs des personnages influents qu’à rationaliser leur production. […] La distribution des ressources est devenue de plus en plus déterminée par les pressions politiques et de moins en moins par les transactions du marché.
Ceux qui n’occupaient pas une position d’influence et qui ne faisaient pas partie d’une coalition d’intérêts puissants – les autochtones, les travailleurs ruraux, les petits entrepreneurs et les habitants des bidonvilles – étaient laissés pour compte. Les tarifs leur enlevaient le pain de la bouche, et quand le gouvernement eut recours à l’inflation pour financer ses dépenses, leurs maigres épargnes furent oblitérées.
(Ch. 4 Les problèmes des pays en développement, p. 140-141)
Ceux qui n’occupaient pas une position d’influence et qui ne faisaient pas partie d’une coalition d’intérêts puissants – les autochtones, les travailleurs ruraux, les petits entrepreneurs et les habitants des bidonvilles – étaient laissés pour compte. Les tarifs leur enlevaient le pain de la bouche, et quand le gouvernement eut recours à l’inflation pour financer ses dépenses, leurs maigres épargnes furent oblitérées.
(Ch. 4 Les problèmes des pays en développement, p. 140-141)
Grâce à la liberté d’échanger, nous pouvons consommer des biens et des services que nous n’aurions jamais pu produire nous-mêmes. Cela signifie que nous pouvons choisir les biens qui nous apportent le plus de satisfaction au meilleur prix. Dans un magasin suédois, nous pouvons acheter des bananes et des ananas, même s’ils ne poussent pas en Suède. On trouve des légumes frais tout l’hiver dans les latitudes les plus au nord, et même les habitants de pays sans accès à la mer peuvent acheter du saumon de Norvège.
(Ch. 3 Le libre-échange, c’est équitable, p. 96)
(Ch. 3 Le libre-échange, c’est équitable, p. 96)
Loin d’être la preuve que la réglementation et les contrôles bureaucratiques constituent la recette du succès, les tigres est-asiatiques montrent qu’une économie de marché qui s’appuie sur l’esprit d’entreprise et l’ouverture vers l’extérieur est la voie vers le développement.
(Ch. 2 …et ce n’est pas une coïncidence, p. 86)
(Ch. 2 …et ce n’est pas une coïncidence, p. 86)
L’économie d’un pays s’améliore d’abord parce que ses habitants travaillent, épargnent et investissent. Des impôts élevés sur le travail, l’épargne et le capital ont donc pour effet, dans les mots de John Stuart Mill, de « pénaliser les gens pour avoir travaillé plus fort et mis plus d’argent de côté que leurs voisins ». Cela décourage les gens de faire les activités qui sont les plus bénéfiques pour la société. Ou encore, comme quelqu’un l’a déjà dit : « Les amendes sont une sorte de taxe pour avoir fait quelque chose de mal, alors que les taxes sont une sorte d’amende pour avoir fait quelque chose de bien. »
(Ch. 2 …et ce n’est pas une coïncidence, p. 65)
(Ch. 2 …et ce n’est pas une coïncidence, p. 65)
[…] les gens réfléchissent et travaillent partout […]. C’est principalement l’environnement qui fait la différence. Permet-il et encourage-t-il le travail des individus, ou bien pose-t-il des obstacles à leur réalisation et les exploite-t-il pour ses propres fins ? Cela dépend de nombreux facteurs : les individus ont-ils la liberté et la possibilité d’aller de l’avant avec leurs projets ? Les laisse-t-on posséder des biens, investir à long terme, conclure des ententes et commercer avec d’autres ? Bref, bénéficient-ils des avantages du capitalisme ?
(Ch. 2 …et ce n’est pas une coïncidence, p. 49)
(Ch. 2 …et ce n’est pas une coïncidence, p. 49)
Le nombre de conflits militaires a diminué de moitié au cours de la dernière décennie et aujourd’hui [livre publié en déc. 2003], moins de 1% de la population mondiale est directement affectée par la guerre. Cela est dû […] à l’expansion des échanges internationaux , qui RENDENT LES CONFLITS MOINS INTERESSANTS. Un citoyen s’intéresse moins à la taille de son pays lorsqu’il jouit de la liberté de mouvement et de commerce. On peut créer la prospérité non pas en annexant une partie du territoire d’un autre pays, mais en ayant la possibilité de commercer avec ce pays et de profiter de ses ressources. DANS UN MONDE CONSTITUE D’ETATS NATIONAUX VIVANT EN AUTARCIE, LES TERRITOIRES ETRANGERS N’ONT DE VALEUR QUE LORSQUE L’ON PEUT S’EN EMPARER.
(Ch. 1 Chaque jour les choses s’améliorent, p. 32)
(Ch. 1 Chaque jour les choses s’améliorent, p. 32)
Sous un régime dictatorial, même les dirigeants peuvent être trompés par la censure. Tout porte à croire que les dirigeants chinois ont été rassurés par leur propre propagande et par les statistiques trafiquées de leurs subalternes alors que 30 millions de personnes mourraient de fin pendant le « Grand Bond en avant » de 1958 à 1961.
(Ch. 1 Chaque jour les choses s’améliorent, p. 27)
(Ch. 1 Chaque jour les choses s’améliorent, p. 27)
A cause du manque de calories, les gens ne pouvaient pas travailler assez dur pour produire la quantité de nourriture qui leur aurait permis de travailler dur.
Après le krach de 1929, les Etats-Unis ont adopté une politique protectionniste draconienne, et tout ce qu’ils exportèrent par la suite fut la dépression économique. D’autres gouvernements répliquèrent de la même façon et le commerce s’effondra à l’échelle mondiale, diminuant des deux tiers en seulement trois ans. Une crise nationale provoqua une dépression d’une ampleur planétaire. Le retour du protectionnisme aujourd’hui entraînerait la stagnation dans les pays riches et une pauvreté encore plus grande dans les pays en développement.
(Ch. 7 Il faut libéraliser, pas standardiser, p. 259)
(Ch. 7 Il faut libéraliser, pas standardiser, p. 259)
Parce que tout le monde est en concurrence avec tout le monde, on peut penser que la conséquence inévitable sera que les compagnies les plus riches, qui peuvent se permettre de payer plus, mettront la main sur tout le capital. Mais le capital provient maintenant de divers pays et la quantité offerte augmente. Ce ne sont pas nécessairement les plus riches qui font les meilleurs propositions, mais ceux qui peuvent créer plus de nouvelles richesses avec l’argent. Les plus gros potentiels de profits, en général, ne se retrouvent pas dans les industries où il y a déjà eu de nombreux investissements, mais dans les nouvelles entreprises qui n’ont pas encore réussi à obtenir le financement nécessaire pour des projets prometteurs. Les marchés de capitaux ont surtout de l’importance pour ceux qui ont de bonnes idées mais pas de capital pour les concrétiser.
(Ch. 6 Un capital international débridé, p. 217-218)
(Ch. 6 Un capital international débridé, p. 217-218)
[…] la mondialisation a permis à différents pays d’adopter de nouvelles technologies plus rapidement et […] celles-ci sont généralement moins dommageables pour l’environnement. Un groupe de chercheurs a enquêté sur les pratiques de l’industrie sidérurgique dans 50 pays. Ils ont conclu que les pays avec les économies les plus ouvertes ont été à l’avant-garde dans l’adoption de technologies moins polluantes, et que la production d’acier dans ces pays générait presque 20% moins d’émissions polluantes qu’une production semblable dans les pays à l’économie fermée. Ce sont les compagnies multinationales qui poussent dans cette direction parce qu’elles ont intérêt à systématiser leur production en adoptant des techniques similaires.
(Ch. 5 La course vers le sommet, p. 201)
(Ch. 5 La course vers le sommet, p. 201)
[…] le capitalisme ne force pas les gens à maximiser le profit dans tout ce qu’ils font, il les laisse simplement libres d’utiliser leur propriété comme bon leur semble.
(Ch. 4 Les problèmes des pays en développement, p. 163)
(Ch. 4 Les problèmes des pays en développement, p. 163)
Le ministère japonais de l’Industrie et du Commerce, MITI, est souvent présenté comme un exemple réussi de planification économique, mais s’il est vrai qu’il a relativement bien fait, c’est surtout en répondant aux signaux du marché. Par contre, ses tentatives pour créer de nouvelles industries indépendamment de la situation du marché furent moins heureuses. MITI a, par exemple, investi des milliards de dollars dans les surgénérateurs nucléaires, un ordinateur de cinquième génération et une plate-forme pétrolière contrôlée à distance, des projets qui se sont tous avérés de coûteux échecs. Heureusement pour les Japonais, MITI a aussi échoué dans ses tentatives de tuer dans l’œuf le développement de certains secteurs, lorsqu’il a par exemple voulu dans les années 1950 supprimer les petits producteurs de voitures ou empêcher Sony d’importer la technologie des transistors.
(Ch. 4 Les problèmes des pays en développement, p. 148-149)
(Ch. 4 Les problèmes des pays en développement, p. 148-149)
La gauche dépeint habituellement le libéralisme comme […] représentant les intérêts des riches parce qu[e] défend[ant] les droits de propriété.[…] L’expérience nous montre que ce ne sont pas les riches qui bénéficient d’abord de la protection des droits de propriété. Au contraire ce sont les citoyens les plus vulnérables qui peuvent avoir le plus à perdre dans une société sans droits de propriétés clairement établis, parce que ce sont alors ceux qui ont le plus de pouvoir politique et de contacts qui réussissent à s’emparer des ressources. Là où la propriété privée existe, les ressources et les revenus sont affectés en priorité à ceux qui sont productifs, qui offrent des biens et services ou leur main-d’œuvre. […]
L’économiste péruvien Hernando de Soto a fait plus que quiconque pour expliquer comment les pauvres sont les grands perdants lorsque les droits de propriétés ne sont pas protégés.
Dans son révolutionnaire essai « The Mystery of Capital », il bouleverse complètement la vision habituelle que l’on a des pauvres. Selon lui, le problème n’est pas qu’ils sont démunis et sans avoirs, mais plutôt qu’ils n’ont pas de droits de propriété clairement définis sur ce qu’ils possèdent.
(Ch. 2 …et ce n’est pas une coïncidence, p. 73-74)
L’économiste péruvien Hernando de Soto a fait plus que quiconque pour expliquer comment les pauvres sont les grands perdants lorsque les droits de propriétés ne sont pas protégés.
Dans son révolutionnaire essai « The Mystery of Capital », il bouleverse complètement la vision habituelle que l’on a des pauvres. Selon lui, le problème n’est pas qu’ils sont démunis et sans avoirs, mais plutôt qu’ils n’ont pas de droits de propriété clairement définis sur ce qu’ils possèdent.
(Ch. 2 …et ce n’est pas une coïncidence, p. 73-74)
Beaucoup de gens croient que la libéralisation et la croissance de l’économie ont pour effet d’élargir les inégalités au sein d’une société. Encore une fois, la question n’est pas là. Ce qui importe d’abord est de savoir dans quelles conditions vous vivez, et non dans quelles conditions par rapport aux autres.
(Ch. 2 …et ce n’est pas une coïncidence, p. 67)
(Ch. 2 …et ce n’est pas une coïncidence, p. 67)
Les Etats du Sud [de l’Inde] – Andhra Pradesh, Karnataka et Tamil Nadu – ont fait des progrès très rapides grâce à la libéralisation. Leur croissance a dépassé la moyenne nationale, atteignant parfois le rythme spectaculaire de 15% par année. Ce sont aussi ces Etats qui ont attiré le plus d’investissements, aussi bien de l’étranger que du reste de l’Inde. L’industrie des nouvelles technologies de l’information s’y est installée et l’on a pu observer, par exemple, une croissance annuelle de 50% du secteur des logiciels.
[…] alors que les conditions de vie ont à peine changé dans les Etats tels Bihar et Uttar Pradesh qui n’ont amorcé aucune réforme de libéralisation de l’économie.
(Ch. 1 Chaque jour les choses s’améliorent, p. 41)
[…] alors que les conditions de vie ont à peine changé dans les Etats tels Bihar et Uttar Pradesh qui n’ont amorcé aucune réforme de libéralisation de l’économie.
(Ch. 1 Chaque jour les choses s’améliorent, p. 41)
LE TRAVAIL FORCE typique des économies précapitalistes est en voie d’être remplacé par la liberté de contrat et la liberté de mouvement là où LE MARCHE A PU S’ETABLIR.
(Ch. 1 Chaque jour les choses s’améliorent, p. 19)
(Ch. 1 Chaque jour les choses s’améliorent, p. 19)
Les firmes étrangères dans les pays les moins développés offrent des salaires en moyenne deux fois plus élevés que ceux des compagnies locales similaires. Les marxistes prétendent que les multinationales exploitent les pauvres travailleurs, mais si cela se traduit par des revenus plusieurs fois supérieurs, l’exploitation est sûrement la meilleure alternative !
(p. 191)
(p. 191)
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Johan Norberg
Lecteurs de Johan Norberg (45)Voir plus
Quiz
Voir plus
SECONDE GUERRE MONDIALE
Quelles sont les dates de début et de fin de la Seconde Guerre mondiale ?
De 1940 à 1945
De 1914 à 1918
De 1939 à 1945
8 questions
616 lecteurs ont répondu
Thèmes :
seconde guerre mondialeCréer un quiz sur cet auteur616 lecteurs ont répondu