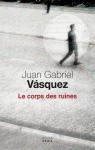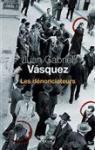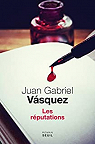Critiques de Juan Gabriel Vásquez (141)
C'est très bien écrit mais très basé sur l'histoire de la Colombie. Je n'ai pas pu rentrer dans le livre. Dommage, peut-être le reprendrai-je plus tard?
Un pavé de 500 pages sur deux meurtres politiques de l'histoire colombienne, c'est Le corps des ruines de Juan Gabriel Vásquez. C'est un livre très personnel de cet auteur colombien dans lequel il agit en tant que personne forcée par les circonstances de rechercher la vérité derrière deux assassinats politiques, notamment celui de Rafael Uribe Uribe en 1914 et celui de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Vásquez nous emmène aux endroits où les meurtres ont été commis et nous présente la version officielle et les théories de la conspiration qui se sont rapidement produites autour de ces meurtres. C'est aussi l'histoire de la solitude et de la vie perdue de personnes qui ont essayé de regarder au-delà de la version officielle. C'est aussi l'histoire d'un peuple qui a toujours été exposé au gré du pouvoir, de deux camps qui ont déterminé l'histoire récente colombienne (et par extension de tout le continent): la lutte entre les libéraux / socialistes et les conservateurs. Les magouilles ont toujours été magnifiquement tues, mais grâce à cette lecture immersive, vous avez un aperçu de ce qui se passait dans les coulisses. Et pourtant le doute reste: est-il paranoïaque de croire qu'il y a plus qu'une version officielle? Ou est-ce précisément l'intention? Faire croire les personnes qui sont critiques qu'ils sont en fait paranoïaques. Une lecture envoûtante associée à un style de grande beauté!
Autant l’avouer, je ne suis pas férue de littérature étrangère. Je n’en ai par ailleurs que très peu de connaissance. Peut-être par crainte d’un décalage lié à la traduction je privilégie, en effet, la lecture d’ouvrages d’auteurs français. Mais il se trouve que j’ai eu à lire, dans le cadre de la rentrée littéraire, le dernier roman d’un auteur colombien, Juan Gabriel Vasquez, "Le corps des ruines".
Je remercie très sincèrement les Editions du Seuil.
Juan Gabriel Vasquez, l’auteur, est aussi le narrateur. Il raconte sa rencontre, un soir, chez son ami le Docteur Benavides, d’un certain Carlos Carballo. Cet homme particulier a tendance à voir dans l’assassinat de chaque homme politique célèbre la "patte" de puissances obscures. Et, quand il parle notamment des meurtres du sénateur colombien Rafael Uribe Uribe tué en 1914 à coups de hachette par deux menuisiers, du leader libéral Jorge Eliecer Gaitàn en 1948 ou encore de celui de John Fitzgerald Kennedy, il n’y voit qu’une série de complots. Si Vasquez considère d’abord les propos de ce Carlos comme pures divagations, il va petit à petit se poser des questions et tomber dans le piège de son interlocuteur… et y entraîner la lectrice que je suis.
Je dois reconnaître que la lecture de cet ouvrage m’a demandé du temps, beaucoup de temps. On ne se plonge pas dans le texte comme un nageur en eau tranquille. Il m’a fallu souvent m’interrompre pour faire des recherches. Je ne connaissais rien de l’histoire politique de la Colombie et si l’assassinat de Kennedy reste parfaitement ancré dans ma mémoire, j’ai dû relire certains articles pour m’assurer de n’avoir rien oublié des circonstances et de ce qui en fut relaté par la suite. Aux confins de l’autobiographie – je l’ai dit, l’auteur est en même temps le narrateur – de l’enquête à la fois politique et policière, il s’agit pourtant bien d’un roman : "Mais moi, c’était la seule chose que je trouvais captivante dans les romans : l’exploration de cette autre réalité ; non la réalité des faits ni la reproduction romancée des événements véritables … qui poussent le romancier vers des endroits interdits au journaliste ou à l’historien."
J’ai trouvé ce roman exigeant, fouillé, érudit où les références littéraires sont pléthores qui citent Gabriel Garcia Marquez, mais aussi Thémistocle et Cicéron. Et je ne parle de Carlos Gardel le célèbre chanteur et compositeur de Tango, dont la mort est également présente. Les personnages fourmillent et les détails sont légions. Comme l’auteur, je me suis sentie emportée par les propos de ce Carballo qui mène la danse et fait vaciller la raison. Et si ce qu’il avance était vrai ? Et si derrière chacun de ces crimes existait une autre vérité ? Ces questions présentes au fur et à mesure de l’avancée du récit le rendent envoûtant et m’ont fait oublier les quelques longueurs que je pourrais lui reprocher. Il est vraisemblable que quelques pages en moins – il y en a tout de même 500 – n’auraient en rien nui à son intérêt.
Pour autant, j’ai été emballée, admirative de tant de connaissances et de talent d’écriture. J’ai ouï dire par une Colombienne qu’il n’était pas particulièrement connu dans son pays natal mais il faut dire qu’il a plus vécu ailleurs. En tous les cas il est évident que l’histoire de son pays d’origine lui tient à cœur.
Je remercie très sincèrement les Editions du Seuil.
Juan Gabriel Vasquez, l’auteur, est aussi le narrateur. Il raconte sa rencontre, un soir, chez son ami le Docteur Benavides, d’un certain Carlos Carballo. Cet homme particulier a tendance à voir dans l’assassinat de chaque homme politique célèbre la "patte" de puissances obscures. Et, quand il parle notamment des meurtres du sénateur colombien Rafael Uribe Uribe tué en 1914 à coups de hachette par deux menuisiers, du leader libéral Jorge Eliecer Gaitàn en 1948 ou encore de celui de John Fitzgerald Kennedy, il n’y voit qu’une série de complots. Si Vasquez considère d’abord les propos de ce Carlos comme pures divagations, il va petit à petit se poser des questions et tomber dans le piège de son interlocuteur… et y entraîner la lectrice que je suis.
Je dois reconnaître que la lecture de cet ouvrage m’a demandé du temps, beaucoup de temps. On ne se plonge pas dans le texte comme un nageur en eau tranquille. Il m’a fallu souvent m’interrompre pour faire des recherches. Je ne connaissais rien de l’histoire politique de la Colombie et si l’assassinat de Kennedy reste parfaitement ancré dans ma mémoire, j’ai dû relire certains articles pour m’assurer de n’avoir rien oublié des circonstances et de ce qui en fut relaté par la suite. Aux confins de l’autobiographie – je l’ai dit, l’auteur est en même temps le narrateur – de l’enquête à la fois politique et policière, il s’agit pourtant bien d’un roman : "Mais moi, c’était la seule chose que je trouvais captivante dans les romans : l’exploration de cette autre réalité ; non la réalité des faits ni la reproduction romancée des événements véritables … qui poussent le romancier vers des endroits interdits au journaliste ou à l’historien."
J’ai trouvé ce roman exigeant, fouillé, érudit où les références littéraires sont pléthores qui citent Gabriel Garcia Marquez, mais aussi Thémistocle et Cicéron. Et je ne parle de Carlos Gardel le célèbre chanteur et compositeur de Tango, dont la mort est également présente. Les personnages fourmillent et les détails sont légions. Comme l’auteur, je me suis sentie emportée par les propos de ce Carballo qui mène la danse et fait vaciller la raison. Et si ce qu’il avance était vrai ? Et si derrière chacun de ces crimes existait une autre vérité ? Ces questions présentes au fur et à mesure de l’avancée du récit le rendent envoûtant et m’ont fait oublier les quelques longueurs que je pourrais lui reprocher. Il est vraisemblable que quelques pages en moins – il y en a tout de même 500 – n’auraient en rien nui à son intérêt.
Pour autant, j’ai été emballée, admirative de tant de connaissances et de talent d’écriture. J’ai ouï dire par une Colombienne qu’il n’était pas particulièrement connu dans son pays natal mais il faut dire qu’il a plus vécu ailleurs. En tous les cas il est évident que l’histoire de son pays d’origine lui tient à cœur.
A la suite d'une rencontre au cours d'une soirée avec un personnage intrigant passionné par l'assassinat de Gaitán en 1948, l'auteur a été amené à replonger dans l'histoire de son pays et ses violents soubresauts. Vazquez nous entraine alors dans la quête d'un individu qui remet en question la version officielle des faits et cherche à remonter la piste du véritable assassin de ce meurtre qui changea définitivement la Colombie. Il en résulte ce roman à la fois historique mais également personnel où l'auteur s'interroge sur son rapport au passé de son pays mais également à la violence qui le compose. Intelligent, profond, captivant
Qui est le mystérieux Carlos Carballo, un homme peu fréquentable, avec qui le narrateur Juan Gabriel Vasquez a une vive altercation, le soir de leur rencontre, chez le Docteur Benavides, et que Vasquez juge vite comme adepte de la théorie des complots ?
Et si le brillant Jorge Eliecer Gaitan, un homme politique de tout premier plan n’avait pas été assassiné le 09 Avril 1948 comme le veut la légende par un seul homme, lynché peu après ? Et qu'en est-il du Sénateur Uribe Uribe, mort en 1914, dans des circonstances que Carbalho juge bien trompeuses ?
Toutes ces questions, et bien d'autres encore, l'auteur narrateur va se les poser et nous entraîner, mi fascinés, mi dégoûtés, dans 500 pages d'enquêtes sur l'histoire de la Colombie et de deux assassinats célèbres pour tenter de lever le voile sur les mystères non résolus.
On en ressort un peu groggy, notamment de la retranscription intégrale de ce "Qui sont-ils" écrits par un jeune avocat pour faire la lumière sur le meurtre de Uribe Uribe, un peu ébahi devant un tel style littéraire au profit d'un récit qui n'est pas sans résonance avec notre période contemporaine et son lot de "fake news" ou récits nationaux.
Et si le brillant Jorge Eliecer Gaitan, un homme politique de tout premier plan n’avait pas été assassiné le 09 Avril 1948 comme le veut la légende par un seul homme, lynché peu après ? Et qu'en est-il du Sénateur Uribe Uribe, mort en 1914, dans des circonstances que Carbalho juge bien trompeuses ?
Toutes ces questions, et bien d'autres encore, l'auteur narrateur va se les poser et nous entraîner, mi fascinés, mi dégoûtés, dans 500 pages d'enquêtes sur l'histoire de la Colombie et de deux assassinats célèbres pour tenter de lever le voile sur les mystères non résolus.
On en ressort un peu groggy, notamment de la retranscription intégrale de ce "Qui sont-ils" écrits par un jeune avocat pour faire la lumière sur le meurtre de Uribe Uribe, un peu ébahi devant un tel style littéraire au profit d'un récit qui n'est pas sans résonance avec notre période contemporaine et son lot de "fake news" ou récits nationaux.
Dans « Le Corps des ruines », l’écrivain poursuit son exploration introspective de la violence colombienne et de ses conséquences.
Lien : http://www.lemonde.fr/livres..
Lien : http://www.lemonde.fr/livres..
A travers les assassinats de deux hommes politiques colombiens (Rafael Uribe Uribe tué en 1914 et Jorge Eliecer Gaïtan en 1949), Juan Gabriel Vasquez a écrit un roman très fourni sur le complotisme.
L'étrange Carlos Carballo, obsédé par les meurtres d'hommes politiques, pense que ces évènements résultent d'un complot.
Tout le mystère de ce livre s'appuie sur des "vestiges" des deux corps de ces victimes d'assassinat, à savoir une vertèbre et un morceau de crane.
Ce personnage de Carlos Carbello, totalement obsédé, nous émeut parfois et nous agace souvent.
Mais au-delà de celui-ci, c'est l'évocation de ces meurtres politiques qui, sans avoir une vision complotiste de l'Histoire, méritent d'être mis en lumière pour les respect du peuple colombien et la mémoire de ces deux hommes politiques.
Juan Gabriel Vasquez a un grand talent et son livre laisse, à ses lecteurs, un souvenir lumineux.
L'étrange Carlos Carballo, obsédé par les meurtres d'hommes politiques, pense que ces évènements résultent d'un complot.
Tout le mystère de ce livre s'appuie sur des "vestiges" des deux corps de ces victimes d'assassinat, à savoir une vertèbre et un morceau de crane.
Ce personnage de Carlos Carbello, totalement obsédé, nous émeut parfois et nous agace souvent.
Mais au-delà de celui-ci, c'est l'évocation de ces meurtres politiques qui, sans avoir une vision complotiste de l'Histoire, méritent d'être mis en lumière pour les respect du peuple colombien et la mémoire de ces deux hommes politiques.
Juan Gabriel Vasquez a un grand talent et son livre laisse, à ses lecteurs, un souvenir lumineux.
Brouiller les frontières entre fiction et réalité, s’affranchir d’un passé souvent insondable pour comprendre - et surtout faire comprendre - l’histoire de son pays natal : avec Le corps des ruines, Juan Gabriel Vásquez reprend et approfondit avec brio ses thèmes de prédilection.
A la croisée des genres, entre chronique politique, enquête policière et roman autobiographique, l’auteur nous livre probablement son roman le plus abouti et le plus captivant. A l’image de la littérature espagnole post franquiste, dont le désir d’oublier se heurte constamment à un nécessaire devoir de mémoire, l’écriture est ici symbolique d’une littérature colombienne profondément marquée par l’histoire de son pays, empreinte de violences qui se répètent et se répondent indéfiniment. A partir des ossements de deux figures libérales légendaires de Bogota, assassinées à deux époques différentes (le général Rafael Uribe Uribe en 1914, puis le leader Jorge Eliécer Gaitán en 1948), plus que jamais, l’écriture se donne ici pour objectif d’exorciser la violence symptomatique de tout un pays.
A travers la réécriture de l’histoire étrangement liée de ces deux crimes politiques, c’est aussi la genèse de l’écriture, l’envie de devenir écrivain, qui est sublimée au fil du roman. L’auteur et le narrateur se fondent dans une même identité pour donner corps à un roman dense et magnifiquement construit, que l’on ne parvient plus à lâcher au bout de quelques pages seulement.
A la croisée des genres, entre chronique politique, enquête policière et roman autobiographique, l’auteur nous livre probablement son roman le plus abouti et le plus captivant. A l’image de la littérature espagnole post franquiste, dont le désir d’oublier se heurte constamment à un nécessaire devoir de mémoire, l’écriture est ici symbolique d’une littérature colombienne profondément marquée par l’histoire de son pays, empreinte de violences qui se répètent et se répondent indéfiniment. A partir des ossements de deux figures libérales légendaires de Bogota, assassinées à deux époques différentes (le général Rafael Uribe Uribe en 1914, puis le leader Jorge Eliécer Gaitán en 1948), plus que jamais, l’écriture se donne ici pour objectif d’exorciser la violence symptomatique de tout un pays.
A travers la réécriture de l’histoire étrangement liée de ces deux crimes politiques, c’est aussi la genèse de l’écriture, l’envie de devenir écrivain, qui est sublimée au fil du roman. L’auteur et le narrateur se fondent dans une même identité pour donner corps à un roman dense et magnifiquement construit, que l’on ne parvient plus à lâcher au bout de quelques pages seulement.
Il va être difficile de rendre compte de ce roman tant il est tentaculaire, intelligent, maîtrisé, tant le roman et le non-roman y sont étroitement intriqués au bénéfice de l'esprit et d'une certaine générosité.
Juan Gabriel Vasquez s'y montre écrivain à l’œuvre, s’appropriant peu à peu un sujet qui l'a initialement rebuté, à l'écoute des signes qu'au fil des années celui-ci peut lui envoyer, l'amenant à accepter de douter, de se remettre en question pour finalement se l'approprier au prix d'un itinéraire affectivo-intellectuel traversant le temps et les continents.
Ce sujet lui est apporté/imposé par une espèce de complotiste exalté, monomaniaque et agaçant, Carlos Carballo, fasciné par deux assassinats politiques qui ont été des tournants majeurs dans l'histoire de la Colombie: celui de Rafael Uribe Uribe en 1914, et celui de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, deux figures de l'opposition libérale. Pour ces deux assassinats, les exécutants ont été châtiés, et Carballo soutient que la justice s'est refusée à remonter le fil des vrais commanditaires. La juxtaposition de ces deux affaires est l'occasion d'interroger la société colombienne, pervertie d'avoir toujours frayé avec la violence, de réfléchir au lien que celle-ci entretient avec le mensonge et la dissimulation, et de montrer comment la quête de la vérité, si elle est vouée à l'échec, permet cependant d'interroger sa propre intimité, mais aussi tout le corps social notamment dans sa dimension politico-judiciaire.
On est dans une démarche assez curieuse (et plusieurs fois revendiquée) qui mêle sciemment l'autofiction et l'histoire d'un pays, mais aussi l'Histoire et la fiction pour produire une œuvre protéiforme, mi-polar politique, mi-réflexion et quête de sens. Dans cette démarche qui n'est pas sans rappeler Cercas, mais portée ici par une écriture fluide et pleine de vivacité, parfois à la limite de la faconde, Juan Gabriel Vasquez communique, par un montage époustouflant, sa passion, ses émotions et son érudition. il tire un fil qui en révèle un autre, suggère sans imposer, les longueurs sont très rares (et sans doute indispensables), c'est de la belle ouvrage.
Juan Gabriel Vasquez s'y montre écrivain à l’œuvre, s’appropriant peu à peu un sujet qui l'a initialement rebuté, à l'écoute des signes qu'au fil des années celui-ci peut lui envoyer, l'amenant à accepter de douter, de se remettre en question pour finalement se l'approprier au prix d'un itinéraire affectivo-intellectuel traversant le temps et les continents.
Ce sujet lui est apporté/imposé par une espèce de complotiste exalté, monomaniaque et agaçant, Carlos Carballo, fasciné par deux assassinats politiques qui ont été des tournants majeurs dans l'histoire de la Colombie: celui de Rafael Uribe Uribe en 1914, et celui de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, deux figures de l'opposition libérale. Pour ces deux assassinats, les exécutants ont été châtiés, et Carballo soutient que la justice s'est refusée à remonter le fil des vrais commanditaires. La juxtaposition de ces deux affaires est l'occasion d'interroger la société colombienne, pervertie d'avoir toujours frayé avec la violence, de réfléchir au lien que celle-ci entretient avec le mensonge et la dissimulation, et de montrer comment la quête de la vérité, si elle est vouée à l'échec, permet cependant d'interroger sa propre intimité, mais aussi tout le corps social notamment dans sa dimension politico-judiciaire.
On est dans une démarche assez curieuse (et plusieurs fois revendiquée) qui mêle sciemment l'autofiction et l'histoire d'un pays, mais aussi l'Histoire et la fiction pour produire une œuvre protéiforme, mi-polar politique, mi-réflexion et quête de sens. Dans cette démarche qui n'est pas sans rappeler Cercas, mais portée ici par une écriture fluide et pleine de vivacité, parfois à la limite de la faconde, Juan Gabriel Vasquez communique, par un montage époustouflant, sa passion, ses émotions et son érudition. il tire un fil qui en révèle un autre, suggère sans imposer, les longueurs sont très rares (et sans doute indispensables), c'est de la belle ouvrage.
Tout l'art d'une dissertation universitaire tient dans la 3° partie : thèse, antithèse, d'accord, mais synthèse (priez pour nous) ? J'ai mis des années à peaufiner cette 3° partie que je reprenais à tous les coups pour pérorer sur l'art comme unificateur des contraires. Je pardonne à ma suffisance d'alors (pour celle d'aujourd'hui, j'attends encore un peu) car c'est finalement ce dont parle ce roman brillantissime, aussi émouvant qu'intelligent et à la construction parfaite. « Les livres, écrit Juan Vasquez, ne sont et ne seront jamais que des preuves élaborées de désorientation […]en écrivant un livre, [le romancier] tente ainsi de pallier sa confusion, de réduire l'espace entre ce qu'il ignore et ce qu'il pourrait savoir […]. « de nos querelles avec les autres, nous faisons de la rhétorique. de nos querelles avec nous-mêmes, de la poésie », disait Yeats. Mais que se passe-t-il quand les deux querelles ont lieu simultanément, quand se disputer avec les autres est un reflet ou une transfiguration de ce face-à-face avec nous-mêmes, enfoui mais constant ? Alors on écrit un livre comme celui auquel je travaille à présent, on s'en remet aveuglément au fait que cet ouvrage signifiera quelque chose pour autrui. »
Vasquez est colombien : devenu père, il choisit de quitter un pays dont la violence endémique lui paraît susceptible de souiller ses jumelles nées avant terme, que le moindre microbe met en danger. Quelques années plus tard, revenu d'Espagne avec femme et enfants, il apprend qu'une parole malheureuse prononcée avant son départ, avait douloureusement affecté la vie d'un de ses amis.
La réflexion sur le pouvoir des mots va irriguer tout le livre, qui plonge vers le passé pour comprendre comment il continue à nous hanter grâce aux discours construits pour l'expliquer (le coeur du livre est un autre livre, pamphlet dérisoire, voulu comme un second « J'accuse » mais qui ne connaîtra jamais la postérité de l'article de Zola) et aussi grâce à tous les témoins du passé qui sont la preuve que ce qui a été fut réellement : le roman comporte de nombreuses photos, comme celle du cadavre du candidat à la présidentielle de 1948 Jorge Eliécer Gaitán, celle de la radiographie de son thorax (avec en son centre l'ombre d'un haricot – une balle), celle d'un bocal qui contient une vertèbre encore recouverte de filaments de chair…
Deux autres assassinats politiques sont aussi longuement évoqués : celui du général Uribe et, mieux connu de nous, celui de John F. Kennedy dont nul n'a oublié la photo, celle où Jackie rampe sur l'arrière de la limousine pour recueillir les morceaux du crâne de son mari qui vient d'exploser sous l'impact des balles.
Jackie tente de reconstituer la tête de son mari en maintenant ce qu'elle a recueilli à l'arrière de son crane : geste inouï qui renvoie pourtant à celui de la déesse Isis cherchant dans le monde les morceaux du corps d'Osiris ; et ce remembrement que Jackie Kennedy crut pouvoir opérer nous rappelle que le verbe « remember » a à voir avec la reconstitution et que se souvenir demande de rassembler et d'unifier.
C'est donc un livre sur la mémoire et sur la transmission que ce « Corps des ruines » : que transmet un père à ses enfants ? Que transmet un pays à ceux qui y sont nés ? Que transmet un auteur à ses lecteurs ? C'est aussi un livre sur les croyances : que tenons-nous pour vrai ? Pourquoi ? Les histoires disent-elles moins la vérité que l'histoire ?
Autour de la mort de Kennedy, de Gaitán, du général Uribe, sont nées de multiples versions alternatives. À ceux qui les regarderaient avec scepticisme, les complotistes ont une réponse toute prête : « le but essentiel de toute conspiration est de cacher son existence et ne pas la voir est l'évidence même de sa réalité. » Or, si je ne me trompe pas, il ne s'agit de rien de moins ici que de la preuve ontologique : Dieu existe puisque la perfection ne peut se passer de l'existence. Et les récits conspirationnistes disent le vrai justement parce qu'on ne les croit pas.
Nous vivons de croyances, qu'on les appelle religions, histoire officielle, légendes ou récits conspirationnistes, et les plus chères d'entre elles en disent moins sur notre vision du monde que sur les efforts que nous déployons pour dresser des tombeaux à ceux que nous aimions et que nous avons perdus. Les reliques, le mouchoir que l'on trempe dans le sang de celui qui vient d'être tué dressent un pont avec le passé, « l'étrange privilège de tenir entre ses mains les ruines d'un être humain » est un moyen d'empêcher le temps de s'écouler, sinon à l'envers.
(D'accord, Proust et sa madeleine, c'est une autre façon de voir les choses. Mais Proust manquait peut-être d'estomac)
Quant à la littérature, elle a peut-être moins à voir avec le souvenir qu'avec le remembrement. Tous les discours s'y trouvent et y acquièrent de ce fait une égale dignité : la vérité de chacun y est collectée, ses désirs et ses souffrances reconnus, et c'est là la seule vérité qui vaut. « le lecteur qui souhaiterait voir [dans ce livre] des ressemblances avec la vie réelle le fera sous sa propre responsabilité. »
Vasquez est colombien : devenu père, il choisit de quitter un pays dont la violence endémique lui paraît susceptible de souiller ses jumelles nées avant terme, que le moindre microbe met en danger. Quelques années plus tard, revenu d'Espagne avec femme et enfants, il apprend qu'une parole malheureuse prononcée avant son départ, avait douloureusement affecté la vie d'un de ses amis.
La réflexion sur le pouvoir des mots va irriguer tout le livre, qui plonge vers le passé pour comprendre comment il continue à nous hanter grâce aux discours construits pour l'expliquer (le coeur du livre est un autre livre, pamphlet dérisoire, voulu comme un second « J'accuse » mais qui ne connaîtra jamais la postérité de l'article de Zola) et aussi grâce à tous les témoins du passé qui sont la preuve que ce qui a été fut réellement : le roman comporte de nombreuses photos, comme celle du cadavre du candidat à la présidentielle de 1948 Jorge Eliécer Gaitán, celle de la radiographie de son thorax (avec en son centre l'ombre d'un haricot – une balle), celle d'un bocal qui contient une vertèbre encore recouverte de filaments de chair…
Deux autres assassinats politiques sont aussi longuement évoqués : celui du général Uribe et, mieux connu de nous, celui de John F. Kennedy dont nul n'a oublié la photo, celle où Jackie rampe sur l'arrière de la limousine pour recueillir les morceaux du crâne de son mari qui vient d'exploser sous l'impact des balles.
Jackie tente de reconstituer la tête de son mari en maintenant ce qu'elle a recueilli à l'arrière de son crane : geste inouï qui renvoie pourtant à celui de la déesse Isis cherchant dans le monde les morceaux du corps d'Osiris ; et ce remembrement que Jackie Kennedy crut pouvoir opérer nous rappelle que le verbe « remember » a à voir avec la reconstitution et que se souvenir demande de rassembler et d'unifier.
C'est donc un livre sur la mémoire et sur la transmission que ce « Corps des ruines » : que transmet un père à ses enfants ? Que transmet un pays à ceux qui y sont nés ? Que transmet un auteur à ses lecteurs ? C'est aussi un livre sur les croyances : que tenons-nous pour vrai ? Pourquoi ? Les histoires disent-elles moins la vérité que l'histoire ?
Autour de la mort de Kennedy, de Gaitán, du général Uribe, sont nées de multiples versions alternatives. À ceux qui les regarderaient avec scepticisme, les complotistes ont une réponse toute prête : « le but essentiel de toute conspiration est de cacher son existence et ne pas la voir est l'évidence même de sa réalité. » Or, si je ne me trompe pas, il ne s'agit de rien de moins ici que de la preuve ontologique : Dieu existe puisque la perfection ne peut se passer de l'existence. Et les récits conspirationnistes disent le vrai justement parce qu'on ne les croit pas.
Nous vivons de croyances, qu'on les appelle religions, histoire officielle, légendes ou récits conspirationnistes, et les plus chères d'entre elles en disent moins sur notre vision du monde que sur les efforts que nous déployons pour dresser des tombeaux à ceux que nous aimions et que nous avons perdus. Les reliques, le mouchoir que l'on trempe dans le sang de celui qui vient d'être tué dressent un pont avec le passé, « l'étrange privilège de tenir entre ses mains les ruines d'un être humain » est un moyen d'empêcher le temps de s'écouler, sinon à l'envers.
(D'accord, Proust et sa madeleine, c'est une autre façon de voir les choses. Mais Proust manquait peut-être d'estomac)
Quant à la littérature, elle a peut-être moins à voir avec le souvenir qu'avec le remembrement. Tous les discours s'y trouvent et y acquièrent de ce fait une égale dignité : la vérité de chacun y est collectée, ses désirs et ses souffrances reconnus, et c'est là la seule vérité qui vaut. « le lecteur qui souhaiterait voir [dans ce livre] des ressemblances avec la vie réelle le fera sous sa propre responsabilité. »
Ce sont 7 récits de style très réaliste et qui ont comme cadre les Ardennes belges et la France. L’auteur vécut 1 an à Xhoris, une zone rurale de la Belgique wallone, après un séjour de plusieurs années à Paris.
C’est curieux comme un jeune romancier d’origine colombienne a pu capter avec autant de justesse la quintessence de ces lieux l’hiver et de ces gens : les couleurs grises du paysage et des âmes, les solitudes, les conflits sentimentaux et/ou familiaux, le mode de vie rural rythmé par la chasse, les coutumes locales, les sentiments et le mode de vie des gens. Ce sont des détails qu’un écrivain chevronné remarque, mais que ce soit un jeune écrivain étranger, cela dénote un pouvoir d’observation supérieur à la moyenne.
C’est le second récit qui donne le titre au livre. Les thèmes abordés sont épineux et il est beaucoup question de tristesse, d’une certaine impuissance devant la vie, de la mort qui rôde, de l’incommunication dans les couples, d’une certaine solitude existentielle, etc.
L’écriture de Vasquez est de grande qualité, la minutie avec laquelle il traite les détails est aussi remarquable. Tout ceci m’a laissé très admirative, mais les histoires n’ont pas réussi à m’intéresser et, in fine, cette lecture m’a laissé une chape de plomb sur l’âme.
C’est la profonde solitude de l’être humain qui m’a paru ressurgir en force de cette prose.
Lien : https://pasiondelalectura.wo..
C’est curieux comme un jeune romancier d’origine colombienne a pu capter avec autant de justesse la quintessence de ces lieux l’hiver et de ces gens : les couleurs grises du paysage et des âmes, les solitudes, les conflits sentimentaux et/ou familiaux, le mode de vie rural rythmé par la chasse, les coutumes locales, les sentiments et le mode de vie des gens. Ce sont des détails qu’un écrivain chevronné remarque, mais que ce soit un jeune écrivain étranger, cela dénote un pouvoir d’observation supérieur à la moyenne.
C’est le second récit qui donne le titre au livre. Les thèmes abordés sont épineux et il est beaucoup question de tristesse, d’une certaine impuissance devant la vie, de la mort qui rôde, de l’incommunication dans les couples, d’une certaine solitude existentielle, etc.
L’écriture de Vasquez est de grande qualité, la minutie avec laquelle il traite les détails est aussi remarquable. Tout ceci m’a laissé très admirative, mais les histoires n’ont pas réussi à m’intéresser et, in fine, cette lecture m’a laissé une chape de plomb sur l’âme.
C’est la profonde solitude de l’être humain qui m’a paru ressurgir en force de cette prose.
Lien : https://pasiondelalectura.wo..
Quand j’ai emprunté à la bibliothèque le livre Les amants de la Toussaint, de l’écrivian colombien Juan Gabriel Vasquez, j’ai eu droit à trois surprises. La première, il s’agit d’un recueil de nouvelles. La deuxième, toutes les histoires se déroulent non pas en Colombie mais dans une région comprise entre la Belgique et le nord-est de la France. La troisième, j’ai adoré le style de l’auteur. Pourtant, j’avais déjà lu un ou deux autres trucs de Vasquez et, sans avoir détesté, ça ne m’avait pas particulièrement interpelé. D’où l’importance de donner une autre chance.
Pourtant, dans les sept nouvelles qui composent Les amants de la Toussaint, rien de si extraordinaire. On y présente des personnages à la croisé des chemins, que ce soit une rupture, un voyage, une rencontre, bref, rien de très dramatique. D’ailleurs, en écrivant ces lignes, j’éprouve de la difficulté à me remémorer les histoires. C’est que, ces histoires, elles sont simples et anodines, elles pourraient arriver à n’importe qui, à tout un chacun. Il y a bien une vague tristesse (ou mélancolie ou nostalgie) qui émane de l’ensemble et j’y étais sensible.
Aussi, c’est que, dans ce recueil, c’est l’atmosphère qui a réussi à me tenir accroché. Ces paysages des Ardennes, nuageux, grisâtres, pluvieux ou brumeux. J’aime bien quand les éléments se mettent de la partie. Pareillement pour les animaux, ils apportent une touche de réalisme. Je ne peux l’expliquer mieux. Ajoutez à cela des activités peu usuelles, par exemple, un couple sur le bord de la rupture qui va à la chasse. Mais il ne s’agit pas roman policier, n’allez pas vous imaginer un crime crapuleux. Plutôt quelque chose qui semble décalé, créant un malaise.
Pour continuer sur la même lancée, ce qui m’a également marqué, ce sont les gestes des personnages, un tic, le non dit, un regard, une parole à moitié prononcée ou bien qui en cache une autre. Ou bien des dialogues de sourds.
« - En fait, on aurait très bien pu le trouver, a déclaré Michelle, qui m’avait rejoint. » (p. 38) Elle parle du faisan atteint à la chasse, qui est tombé dans les fleurs et que les chiens n’ont pas retrouvé. Elle se l’imagine blessé, mourant dans d’atroces souffrances. Quand son conjoint se justifie, elle s’emporte. « - Tu es cruel. Ça ne tourne pas très rond dans ta tête. » Las, le conjoint retourne sur le sentier de chasse mais Michelle s’inquiète. « Tu vas revenir ? » Ces phrases, et d’autres encore, laissent deviner une dynamique de couple étrange.
Ces éléments et d’autres me donnent l’impression que le style de l’auteur a des qualités cinématographiques. Ses mots sont comme une caméra qui saisit des éléments du décor, la physionomie des personnages, ils s’y arrêtent un instant afin de donner le ton, de permettre au lecteur de s’imprégner de l’atmosphère puis ils continuent leur chemin. Ainsi donc, pas de longues descriptions, seulement quelques indications qui sont autant le fruit de la narration que du point de vue des différents personnages impliqués dans la scène.
« Les tons violet et fuschia dominaient dans la chambre. La courtepointe était d’un prune impudique, l’encadrement du lit ausis rose que la crème d’un gâteau. Tout près, un miroir trois-quarts renvoya à Oliveira l’image d’un homme moins jeune qu’il ne l’était. » (p. 160) Avec si peu, on en sait déjà beaucoup, et l’histoire se poursuit.
Bref, Les amants de la Toussaint est un recueil de nouvelles toutes en impressions, en regrets, en secrets, en espoirs. Toutefois, à lire tranquillement. Moi, j’en ai étalé la lecture sur une semaine, une histoire par jour.
Pourtant, dans les sept nouvelles qui composent Les amants de la Toussaint, rien de si extraordinaire. On y présente des personnages à la croisé des chemins, que ce soit une rupture, un voyage, une rencontre, bref, rien de très dramatique. D’ailleurs, en écrivant ces lignes, j’éprouve de la difficulté à me remémorer les histoires. C’est que, ces histoires, elles sont simples et anodines, elles pourraient arriver à n’importe qui, à tout un chacun. Il y a bien une vague tristesse (ou mélancolie ou nostalgie) qui émane de l’ensemble et j’y étais sensible.
Aussi, c’est que, dans ce recueil, c’est l’atmosphère qui a réussi à me tenir accroché. Ces paysages des Ardennes, nuageux, grisâtres, pluvieux ou brumeux. J’aime bien quand les éléments se mettent de la partie. Pareillement pour les animaux, ils apportent une touche de réalisme. Je ne peux l’expliquer mieux. Ajoutez à cela des activités peu usuelles, par exemple, un couple sur le bord de la rupture qui va à la chasse. Mais il ne s’agit pas roman policier, n’allez pas vous imaginer un crime crapuleux. Plutôt quelque chose qui semble décalé, créant un malaise.
Pour continuer sur la même lancée, ce qui m’a également marqué, ce sont les gestes des personnages, un tic, le non dit, un regard, une parole à moitié prononcée ou bien qui en cache une autre. Ou bien des dialogues de sourds.
« - En fait, on aurait très bien pu le trouver, a déclaré Michelle, qui m’avait rejoint. » (p. 38) Elle parle du faisan atteint à la chasse, qui est tombé dans les fleurs et que les chiens n’ont pas retrouvé. Elle se l’imagine blessé, mourant dans d’atroces souffrances. Quand son conjoint se justifie, elle s’emporte. « - Tu es cruel. Ça ne tourne pas très rond dans ta tête. » Las, le conjoint retourne sur le sentier de chasse mais Michelle s’inquiète. « Tu vas revenir ? » Ces phrases, et d’autres encore, laissent deviner une dynamique de couple étrange.
Ces éléments et d’autres me donnent l’impression que le style de l’auteur a des qualités cinématographiques. Ses mots sont comme une caméra qui saisit des éléments du décor, la physionomie des personnages, ils s’y arrêtent un instant afin de donner le ton, de permettre au lecteur de s’imprégner de l’atmosphère puis ils continuent leur chemin. Ainsi donc, pas de longues descriptions, seulement quelques indications qui sont autant le fruit de la narration que du point de vue des différents personnages impliqués dans la scène.
« Les tons violet et fuschia dominaient dans la chambre. La courtepointe était d’un prune impudique, l’encadrement du lit ausis rose que la crème d’un gâteau. Tout près, un miroir trois-quarts renvoya à Oliveira l’image d’un homme moins jeune qu’il ne l’était. » (p. 160) Avec si peu, on en sait déjà beaucoup, et l’histoire se poursuit.
Bref, Les amants de la Toussaint est un recueil de nouvelles toutes en impressions, en regrets, en secrets, en espoirs. Toutefois, à lire tranquillement. Moi, j’en ai étalé la lecture sur une semaine, une histoire par jour.
Critique de Jean-Baptiste Harang pour le Magazine Littéraire
La clé du livre se trouve dans sa phrase ultime, sur cette page surnuméraire dont le lecteur, souvent, croit pouvoir se dispenser, la page des «remerciements» : «[...] un recueil de nouvelles doit être comme un roman dont les personnages ne se connaissent pas.» Vásquez dit tenir cette définition d'un maître du genre, Tobias Wolff, et elle lui va bien. Les personnages des sept nouvelles des Amants de la Toussaint ne se connaissent peut-être pas, mais ils pourraient bien. La plupart de ces histoires, écrites en castillan de Colombie, se passent dans les Ardennes belges, où l'auteur vécut, autour des mêmes villages, et il paraît peu vraisemblable que l'un ou l'autre ne se soient pas rencontrés au cours d'une partie de chasse, à fêter un mariage, à suivre un enterrement, à la friterie de Zoé. Le livre refermé, les survivants finiront bien par se croiser, dans l'étrangeté d'un monde de brume, de nuit, d'improbable, et de réel pourtant, qui nimbe l'entièreté du texte et lie les nouvelles éparses comme le joint, la mosaïque. L'autre clé du recueil est plus facile à retrouver, elle crève les yeux dès les premières phrases : «À l'époque, je ne sortais guère de Belgique. Je passais mon temps à observer les Ardennais et à partager leurs activités, puis j'essayais d'écrire ce que j'avais vu en perdant le moins de détails possible.» Cette attitude du premier narrateur sera la règle des suivants : dire ce que l'on voit dans les moindres détails, et ne pas juger, décrire sans état d'âme l'état des âmes de ses contemporains, et la vanité de la compassion.
Les histoires, qu'on ne racontera pas ici, commencent comme si elles allaient bien finir, avec justesse et sérénité, jusqu'à l'incident, l'accident qui les transforme en pauvres destins révélateurs de ce que nous sommes. Les amours se grisent et ne grisent plus, les enfants meurent avant leurs parents, les couples se trompent, les amants ne se retrouvent pas, les désirs ne s'exaucent plus, la chair est triste et l'énergie s'enfuit, à ne plus avoir la force de répondre au téléphone, de sauver celle qui se noie. On pêche, on chasse, on a des fusils, des coups partent, le maître de chasse n'est pas maître de lui, le magicien n'a plus d'atout dans sa poche, une jeune veuve sait ce qu'elle veut, voir un homme dans le pyjama du défunt. On rêve de franchir le cercle polaire pour échapper à la nuit noire, on prendrait un nom islandais, et le jour disparaît tout l'hiver comme un blanc immense dans la mémoire, comme la mort promise et parfois espérée.
Juan Gabriel Vásquez est né en 1973 à Bogotá, il vit aujourd'hui à Barcelone, ses deux premiers romans traduits en français malmenaient l'histoire de la Colombie, de Panamá et de Conrad. Les Amants de la Toussaint démontrent qu'il sait que la nature humaine n'a pas l'humanité très naturelle, que le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres, et qu'il connaît sur le bout des doigts l'art de la nouvelle.
La clé du livre se trouve dans sa phrase ultime, sur cette page surnuméraire dont le lecteur, souvent, croit pouvoir se dispenser, la page des «remerciements» : «[...] un recueil de nouvelles doit être comme un roman dont les personnages ne se connaissent pas.» Vásquez dit tenir cette définition d'un maître du genre, Tobias Wolff, et elle lui va bien. Les personnages des sept nouvelles des Amants de la Toussaint ne se connaissent peut-être pas, mais ils pourraient bien. La plupart de ces histoires, écrites en castillan de Colombie, se passent dans les Ardennes belges, où l'auteur vécut, autour des mêmes villages, et il paraît peu vraisemblable que l'un ou l'autre ne se soient pas rencontrés au cours d'une partie de chasse, à fêter un mariage, à suivre un enterrement, à la friterie de Zoé. Le livre refermé, les survivants finiront bien par se croiser, dans l'étrangeté d'un monde de brume, de nuit, d'improbable, et de réel pourtant, qui nimbe l'entièreté du texte et lie les nouvelles éparses comme le joint, la mosaïque. L'autre clé du recueil est plus facile à retrouver, elle crève les yeux dès les premières phrases : «À l'époque, je ne sortais guère de Belgique. Je passais mon temps à observer les Ardennais et à partager leurs activités, puis j'essayais d'écrire ce que j'avais vu en perdant le moins de détails possible.» Cette attitude du premier narrateur sera la règle des suivants : dire ce que l'on voit dans les moindres détails, et ne pas juger, décrire sans état d'âme l'état des âmes de ses contemporains, et la vanité de la compassion.
Les histoires, qu'on ne racontera pas ici, commencent comme si elles allaient bien finir, avec justesse et sérénité, jusqu'à l'incident, l'accident qui les transforme en pauvres destins révélateurs de ce que nous sommes. Les amours se grisent et ne grisent plus, les enfants meurent avant leurs parents, les couples se trompent, les amants ne se retrouvent pas, les désirs ne s'exaucent plus, la chair est triste et l'énergie s'enfuit, à ne plus avoir la force de répondre au téléphone, de sauver celle qui se noie. On pêche, on chasse, on a des fusils, des coups partent, le maître de chasse n'est pas maître de lui, le magicien n'a plus d'atout dans sa poche, une jeune veuve sait ce qu'elle veut, voir un homme dans le pyjama du défunt. On rêve de franchir le cercle polaire pour échapper à la nuit noire, on prendrait un nom islandais, et le jour disparaît tout l'hiver comme un blanc immense dans la mémoire, comme la mort promise et parfois espérée.
Juan Gabriel Vásquez est né en 1973 à Bogotá, il vit aujourd'hui à Barcelone, ses deux premiers romans traduits en français malmenaient l'histoire de la Colombie, de Panamá et de Conrad. Les Amants de la Toussaint démontrent qu'il sait que la nature humaine n'a pas l'humanité très naturelle, que le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres, et qu'il connaît sur le bout des doigts l'art de la nouvelle.
Les écrivains « locaux » sont-ils les mieux placés pour parler de leur pays, de leur région ou de leur ville ? Bonne question que Juan Gabriel Vásquez m’offre l’occasion d’approfondir. Né à Bogota, il a passé en 1999, à l’âge de 26 ans, une année en Belgique et a publié un recueil de nouvelles intitulé « Les amants de la Toussaint (Los Amantes de Todos los Santos) » dont la majorité se passe dans les Ardennes belges. C’est une région que je connais relativement bien et j’étais donc curieux de voir comment elle apparaissait sous l’œil d’un jeune auteur colombien.
Plusieurs nouvelles du recueil ont comme décor la vallée de l’Ourthe, au sud de Liège. Elles se déroulent dans un milieu rural aisé, amateur de chasse. Les hommes se retrouvent dans les brumes de l’automne pour le rond matinal au départ de la battue. Les rituels semblent immuables, les familles sont liées depuis des générations.
Dans ce monde plein de traditions, mais parfois rude, Vásquez décrit avec un œil très précis les gestes, les objets et les ambiances : un verre de porto servi, un lièvre que l’on dépiaute, un Browning que l’on charge. L’autorité dans la voix d’un chef de famille qui ne souffre pas d’être contesté. Son regard aigu lui permet aussi de percer, au-delà des non-dits et des bienséances échangées entre voisins, les rancœurs, les secrets et les trahisons. Accidents déguisés, maris trompés, suicides ou meurtres : les vertes vallées ardennaises cachent de nombreux drames sous le couvert feutré de leurs forêts et derrière leurs imposantes demeures de pierre grise.
Lien : http://www.lecturesdevoyage...
Plusieurs nouvelles du recueil ont comme décor la vallée de l’Ourthe, au sud de Liège. Elles se déroulent dans un milieu rural aisé, amateur de chasse. Les hommes se retrouvent dans les brumes de l’automne pour le rond matinal au départ de la battue. Les rituels semblent immuables, les familles sont liées depuis des générations.
Dans ce monde plein de traditions, mais parfois rude, Vásquez décrit avec un œil très précis les gestes, les objets et les ambiances : un verre de porto servi, un lièvre que l’on dépiaute, un Browning que l’on charge. L’autorité dans la voix d’un chef de famille qui ne souffre pas d’être contesté. Son regard aigu lui permet aussi de percer, au-delà des non-dits et des bienséances échangées entre voisins, les rancœurs, les secrets et les trahisons. Accidents déguisés, maris trompés, suicides ou meurtres : les vertes vallées ardennaises cachent de nombreux drames sous le couvert feutré de leurs forêts et derrière leurs imposantes demeures de pierre grise.
Lien : http://www.lecturesdevoyage...
Les amants de la Toussaint
Bon titre qui tombe à pic pour ce mois de novembre
La Toussaint c'est le jours des morts.
La Toussaint c'est l'automne et c'est la période de la chasse en Belgique comme en France. C'est la période de la nature morte
La Toussaint ce n'est pas la Saint-Amour mais plutôt la période des amours mortes
Sept récits intrigants de Belgique et de France qui parlent de la difficulté d'être des couples, de séparations et surtout de mort violente.
Drame familial
Un mariage a sauver
Un couple hanté par un mort
L’élargissement d’une criminelle
Un couple séparé visite un beau parent
Un adultère avec un magicien
Suicide d’une femme forte et désespérée
En arrière fond la chasse, Les Ardennes
Vasquez a une écriture très fluide, légère mais précise qui permet de rentrer dans le sujet de la nouvelle très rapidement et ça tombe quand on est pas trop adepte de ce genre littéraire. D'autant plus que les sujets sont austères, tristes voir franchement morbides et les personnages pris au piège d'une atmosphère épaisse, lourde et pesant sont d'une désespérance pathologique. Des personnages dépareillés qui ne sont pas "ensembles"
Ils semblent se parler à eux-mêmes plutôt qu'à leur interlocuteurs. Les dialogues montrent un désintérêts des antagonistes qui au mieux sont seuls et fuyants au pire hostiles entre eux dans les gestes les plus quotidiens de la vie. Des comportements, le ton des voix très humain qui donnent un air de déjà vu et qui paraît lugubre. Un désespoir flagrant de la vie domestique et de la relation.
L'atmosphère est terne et sans ampleur Elle engourdie les personnages et les fige dans leurs actions dont ils ne savent pas se dépêtrer.
Vasquez donne un tour très soutenu a sa narration. Sa prose est contenue et composée et la précision de la langue est agréable mais parfois ses personnages font des remarques, comparaisons bizarres , presque ( mais pas vraiment)des soliloques qui ont quelque chose de précieux voir déplacés et laborieux. Dans le récit cela jure un peu
On comprend que Vasquez cherche à faire mieux, peaufiner sa phrase, la ciseler comme un artisan avant de rendre l'ouvrage mais pour lui le mieux est l'ennemi du bien.
Pour exemple en parlant de son ventre, après une étreinte sans joie, éclairé par une lumière blafarde"...stries blanches et luisantes, semblables aux trainées baveuses d'un escargot le long des mur d'un cimetière". L'image de la trace baveuse d'escargot a déjà été utilisée dans une nouvelle précédente Si c'est la trace d'un petit gris ça va! si celle d'un Geronimo je comprend mieux la fixation de Vasquez car elle est conséquente mais bon il est écrivain pas héliciculteur.
Et puis un colombien devrait comprendre qu'en France les escargots c'est sacré ça ne laisse pas de trace sur les ravioles de pommes de terres qui sont farcies et donc, l'escargot est dedans (CQFD)
Cette image est un peu nauséabonde et pas nécessaire (en plus sur un mur de cimetière: Alors que là par contre....Tilt!... On vient de faire le lien avec la Toussaint ah d'accord!) Il y a là une surenchère de vocables préjudiciable à la clarté et esthétique du texte
Il faudra que Vasquez se réfrène et évite d'en rajouter avec ça ce sera presque parfait(Concis, Juan, concis!)
Voilà une lecture bien tristounette vivement le mois de mai
Il est vrai qu'avec un titre pareil il ne fallait pas s'attendre à voir des amants heureux!
Bon titre qui tombe à pic pour ce mois de novembre
La Toussaint c'est le jours des morts.
La Toussaint c'est l'automne et c'est la période de la chasse en Belgique comme en France. C'est la période de la nature morte
La Toussaint ce n'est pas la Saint-Amour mais plutôt la période des amours mortes
Sept récits intrigants de Belgique et de France qui parlent de la difficulté d'être des couples, de séparations et surtout de mort violente.
Drame familial
Un mariage a sauver
Un couple hanté par un mort
L’élargissement d’une criminelle
Un couple séparé visite un beau parent
Un adultère avec un magicien
Suicide d’une femme forte et désespérée
En arrière fond la chasse, Les Ardennes
Vasquez a une écriture très fluide, légère mais précise qui permet de rentrer dans le sujet de la nouvelle très rapidement et ça tombe quand on est pas trop adepte de ce genre littéraire. D'autant plus que les sujets sont austères, tristes voir franchement morbides et les personnages pris au piège d'une atmosphère épaisse, lourde et pesant sont d'une désespérance pathologique. Des personnages dépareillés qui ne sont pas "ensembles"
Ils semblent se parler à eux-mêmes plutôt qu'à leur interlocuteurs. Les dialogues montrent un désintérêts des antagonistes qui au mieux sont seuls et fuyants au pire hostiles entre eux dans les gestes les plus quotidiens de la vie. Des comportements, le ton des voix très humain qui donnent un air de déjà vu et qui paraît lugubre. Un désespoir flagrant de la vie domestique et de la relation.
L'atmosphère est terne et sans ampleur Elle engourdie les personnages et les fige dans leurs actions dont ils ne savent pas se dépêtrer.
Vasquez donne un tour très soutenu a sa narration. Sa prose est contenue et composée et la précision de la langue est agréable mais parfois ses personnages font des remarques, comparaisons bizarres , presque ( mais pas vraiment)des soliloques qui ont quelque chose de précieux voir déplacés et laborieux. Dans le récit cela jure un peu
On comprend que Vasquez cherche à faire mieux, peaufiner sa phrase, la ciseler comme un artisan avant de rendre l'ouvrage mais pour lui le mieux est l'ennemi du bien.
Pour exemple en parlant de son ventre, après une étreinte sans joie, éclairé par une lumière blafarde"...stries blanches et luisantes, semblables aux trainées baveuses d'un escargot le long des mur d'un cimetière". L'image de la trace baveuse d'escargot a déjà été utilisée dans une nouvelle précédente Si c'est la trace d'un petit gris ça va! si celle d'un Geronimo je comprend mieux la fixation de Vasquez car elle est conséquente mais bon il est écrivain pas héliciculteur.
Et puis un colombien devrait comprendre qu'en France les escargots c'est sacré ça ne laisse pas de trace sur les ravioles de pommes de terres qui sont farcies et donc, l'escargot est dedans (CQFD)
Cette image est un peu nauséabonde et pas nécessaire (en plus sur un mur de cimetière: Alors que là par contre....Tilt!... On vient de faire le lien avec la Toussaint ah d'accord!) Il y a là une surenchère de vocables préjudiciable à la clarté et esthétique du texte
Il faudra que Vasquez se réfrène et évite d'en rajouter avec ça ce sera presque parfait(Concis, Juan, concis!)
Voilà une lecture bien tristounette vivement le mois de mai
Il est vrai qu'avec un titre pareil il ne fallait pas s'attendre à voir des amants heureux!
Accessible, plutôt facile à lire, un sujet intéressant que je trouve pour ma part mal exploité, ou survolé. J'entends par là un aspect humain approfondi mais au dépend de l'aspect historique, qui me reste toujours aussi cher quant à mes lectures.
Je ne suis pas arrivé malheureusement à rentrer dans l'histoire de ce roman.
En exergue:
"Jamais tu ne laveras de ce que tu as fait là-bas; tu ne pourras assez parler pour cela.
Qui veut prendre la parole?
Qui veut incriminer le passé?
Qui veut garantir l'avenir?"
(Démosthène- Sur la couronne)
Roman à nombreux tiroirs, Les dénonciateurs se base sur un fait historique : en 1943, au moment de la rupture de la Colombie avec les puissances de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon), des listes noires furent dressées et les Allemands résidant sur place furent sans distinction enfermés dans un camp, alors que beaucoup s’étaient justement réfugiés à Bogota parce qu’ils fuyaient le régime d’Hitler.
Pas que les allemands, d’ailleurs, les italiens, les japonais, et pour des raisons diverses, mais le plus souvent, bien sûr, à la suite de dénonciations de braves citoyens.
Le narrateur du roman, Gabriel Santoro, est journaliste et écrivain, et, dans un de ses livres, il raconte l’histoire d’un Allemande, juive, Sara Guterman,amie de sa famille qui a fui l’Allemagne juste à temps. Le père de Gabriel est, lui, une sorte d’autorité morale en Colombie, intellectuel connu , et après lecture du livre de son fils, il en fait une critique féroce dans le journal dans lequel il est critique littéraire.
On découvrira plus tard pourquoi, bien sûr.
Ca, ce sont les faits. Après, il y a l’interprétation des faits, par différents personnages, qui racontent- dénoncent- à Gabriel chacun leur propre vision de l’histoire. Et une vérité chasse l’autre…Pour aboutir, bien sûr, à un portrait complexe d’un homme , le père, qui a porté sa faute toute sa vie . Faut-il pour autant encore le « dénoncer » après sa mort . Gagne-t-on beaucoup à se vouloir exécuteur public des œuvres de justice , alors qu’il s’agit de faits si anciens? Quelles sont les réelles motivations des « dénonciateurs » qui se succèdent? Et en particulier du fils?
"Je l’avais utilisé : j’avais récupéré à mon profit, pour mes propres fins exhibitionnistes ou égocentriques, la chose la plus terrible qui lui était arrivée dans la vie .. Divulguer le malheur de mon père n’était qu’une trahison subtile et renouvelée ."
C’est un beau roman,complexe, dans lequel l’intérêt réside dans la diversité du nombre des points de vue. Un acte , et ses conséquences, innombrables pour les générations suivantes. Et on sait, bien sûr, que certaines choses ne se rattrapent pas. Ne s'expliquent même pas..
"Jamais tu ne laveras de ce que tu as fait là-bas; tu ne pourras assez parler pour cela.
Qui veut prendre la parole?
Qui veut incriminer le passé?
Qui veut garantir l'avenir?"
(Démosthène- Sur la couronne)
Roman à nombreux tiroirs, Les dénonciateurs se base sur un fait historique : en 1943, au moment de la rupture de la Colombie avec les puissances de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon), des listes noires furent dressées et les Allemands résidant sur place furent sans distinction enfermés dans un camp, alors que beaucoup s’étaient justement réfugiés à Bogota parce qu’ils fuyaient le régime d’Hitler.
Pas que les allemands, d’ailleurs, les italiens, les japonais, et pour des raisons diverses, mais le plus souvent, bien sûr, à la suite de dénonciations de braves citoyens.
Le narrateur du roman, Gabriel Santoro, est journaliste et écrivain, et, dans un de ses livres, il raconte l’histoire d’un Allemande, juive, Sara Guterman,amie de sa famille qui a fui l’Allemagne juste à temps. Le père de Gabriel est, lui, une sorte d’autorité morale en Colombie, intellectuel connu , et après lecture du livre de son fils, il en fait une critique féroce dans le journal dans lequel il est critique littéraire.
On découvrira plus tard pourquoi, bien sûr.
Ca, ce sont les faits. Après, il y a l’interprétation des faits, par différents personnages, qui racontent- dénoncent- à Gabriel chacun leur propre vision de l’histoire. Et une vérité chasse l’autre…Pour aboutir, bien sûr, à un portrait complexe d’un homme , le père, qui a porté sa faute toute sa vie . Faut-il pour autant encore le « dénoncer » après sa mort . Gagne-t-on beaucoup à se vouloir exécuteur public des œuvres de justice , alors qu’il s’agit de faits si anciens? Quelles sont les réelles motivations des « dénonciateurs » qui se succèdent? Et en particulier du fils?
"Je l’avais utilisé : j’avais récupéré à mon profit, pour mes propres fins exhibitionnistes ou égocentriques, la chose la plus terrible qui lui était arrivée dans la vie .. Divulguer le malheur de mon père n’était qu’une trahison subtile et renouvelée ."
C’est un beau roman,complexe, dans lequel l’intérêt réside dans la diversité du nombre des points de vue. Un acte , et ses conséquences, innombrables pour les générations suivantes. Et on sait, bien sûr, que certaines choses ne se rattrapent pas. Ne s'expliquent même pas..
Avant la lecture : une amie me l'a conseillé. Je ne connais ni le titre ni l'auteur.
Le livre en lui même : un roman tout blanc de chez Seuil, de bonne facture. La typo et les pages sont agréables. Le livre de 185 pages est léger. La quatrième décortique le livre, je ne comprendrais jamais...
Pendant la lecture : une grosse heure de lecture fort plaisante. L'écriture est descriptive et imagée, la lecture aisée. Le récit aborde son thème et y reste fidèle sans détour. Le sujet (la caricature) est d'actualité ce qui rajoute un fort intérêt à ce roman.
Après la lecture : j'ai apprécié l’écriture et l’accessibilité du texte.Il est sobre mais pas dépouillé. Toutefois je n'en garderais pas un souvenir vivace. Je lirais les autres œuvres de cet auteur avec plaisir.
Les + : la rédaction
les - : le manque d'émotion
Le livre en lui même : un roman tout blanc de chez Seuil, de bonne facture. La typo et les pages sont agréables. Le livre de 185 pages est léger. La quatrième décortique le livre, je ne comprendrais jamais...
Pendant la lecture : une grosse heure de lecture fort plaisante. L'écriture est descriptive et imagée, la lecture aisée. Le récit aborde son thème et y reste fidèle sans détour. Le sujet (la caricature) est d'actualité ce qui rajoute un fort intérêt à ce roman.
Après la lecture : j'ai apprécié l’écriture et l’accessibilité du texte.Il est sobre mais pas dépouillé. Toutefois je n'en garderais pas un souvenir vivace. Je lirais les autres œuvres de cet auteur avec plaisir.
Les + : la rédaction
les - : le manque d'émotion
Je ne sais pas vraiment quoi penser de ce roman. Si le style est soigné, le contenu me laisse perplexe. Je ne sais pas si c'est le personnage central qui m'indispose ou la fin que je trouve un peu trop mystérieuse, mais j'ai le sentiment d'être restée sur ma faim. Pourtant, la réflexion ici développée par Vasquez est brulante d'actualité : la caricature comme message politique, les réputations qui se font et se défont, la presse qui relaie les informations sans souci des dégâts (tant pour l'entourage des personnes incriminées que pour leurs victimes), le cynisme teinté de mépris de ceux qui sont autorisés à nous dire ce que l'on doit penser, etc. Tous sujets vraiment passionnants qui obligent chacun à se pencher sur son rapport à la presse, à l'information, à sa tendance au voyeurisme.
Javier Mallarino, caricaturiste colombien, reçoit une distinction pour l'ensemble de son œuvre. A cette occasion, il est approché par une jeune femme, Samantha, qui se dit journaliste et à qui il donne rendez-vous le lendemain pour une interview. Il s'avère qu'elle est en fait une ancienne camarade de sa fille et que, lors de la cérémonie de la veille, des images lui sont revenues qui ont fait surgir de lointains souvenirs qu'elle veut explorer avec lui.
C'est, encore une fois, très bien écrit, avec des allers-retours dans la vie professionnelle et affective de Javier. On le voit évoluer dans sa perception d'une nouvelle réalité qui n'est finalement qu'une prise de conscience de son propre narcissisme - la dénonciation de faits sociaux ou d'hommes politiques ne servant que sa propre gloire. Javier Mallarino n'est donc pas un homme bien sympathique et peut-être ai-je besoin de développer un peu d'empathie envers les personnages pour adhérer au propos. Et même si sa part d'humanité se dévoile peu à peu à travers un questionnement sur la responsabilité, cela intervient bien tard...
Javier Mallarino, caricaturiste colombien, reçoit une distinction pour l'ensemble de son œuvre. A cette occasion, il est approché par une jeune femme, Samantha, qui se dit journaliste et à qui il donne rendez-vous le lendemain pour une interview. Il s'avère qu'elle est en fait une ancienne camarade de sa fille et que, lors de la cérémonie de la veille, des images lui sont revenues qui ont fait surgir de lointains souvenirs qu'elle veut explorer avec lui.
C'est, encore une fois, très bien écrit, avec des allers-retours dans la vie professionnelle et affective de Javier. On le voit évoluer dans sa perception d'une nouvelle réalité qui n'est finalement qu'une prise de conscience de son propre narcissisme - la dénonciation de faits sociaux ou d'hommes politiques ne servant que sa propre gloire. Javier Mallarino n'est donc pas un homme bien sympathique et peut-être ai-je besoin de développer un peu d'empathie envers les personnages pour adhérer au propos. Et même si sa part d'humanité se dévoile peu à peu à travers un questionnement sur la responsabilité, cela intervient bien tard...
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Juan Gabriel Vásquez
Lecteurs de Juan Gabriel Vásquez (557)Voir plus
Quiz
Voir plus
Mario
Comment s'appelle l'héros du jeu vidéo?
Luigi
Mario
Peach
Bowser
6 questions
20 lecteurs ont répondu
Thèmes :
jeux vidéoCréer un quiz sur cet auteur20 lecteurs ont répondu