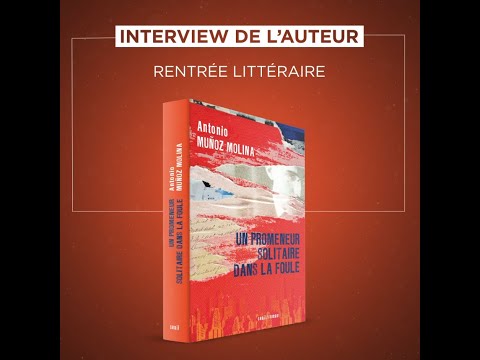Nationalité : Espagne
Né(e) à : Úbeda, Andalousie , le 10/01/1956
Ajouter des informations
Né(e) à : Úbeda, Andalousie , le 10/01/1956
Biographie :
Antonio Muñoz Molina est un écrivain espagnol.
Ses parents sont des enfants d'agriculteurs. Son père a dû quitter l'école très jeune pour aider à la ferme et sa mère n'a jamais été scolarisée. Enfant et adolescent de la période franquiste, Antonio s'évade par les livres notamment Borges, Faulkner qui influenceront son œuvre même s'il va développer un monde et un style qui lui sont entièrement propres.
Il étudie l'histoire de l'art à l'université de Grenade puis le journalisme à Madrid. Au début des années 80, il entre comme fonctionnaire à la municipalité de Grenade. Parallèlement, il écrit des articles pour le quotidien "Ideal", qui seront réunis et publiés sous le titre "El Robinson urbano" en 1984.
Il publie en 1986 son premier récit, "Beatus Ille", entamant une carrière brillante d'écrivain couronné par de nombreuses récompenses littéraires. Son deuxième roman, "L'Hiver à Lisbonne" ("El invierno en Lisboa"), paru en 1987, reçoit le Prix de la Critique et le Prix national de littérature narrative 1988, et est un hommage aux romans noirs américains, à ses héros et au jazz.
En 1991, il commence à écrire pour le quotidien "El Pais". En 1996, il est nommé membre de la Real Academia de Letras (siège de la lettre u).
"Le Royaume des voix" ("El jinete polaco"), paru en 1991, reçoit le Prix Planeta. "Pleine Lune" ("Plenilunio"), un deuxième roman noir publié en 1997, remporte le Prix Femina étranger en 1998.
Publié en 2009, "Dans la grande nuit des temps" ("La noche de los tiempos") est lauréat en France du Prix Méditerranée étranger 2012. "Un promeneur solitaire dans la foule" ("Un andar solitario entre la gente", 2018) obtient le Prix Médicis étranger 2020.
En 2013, Antonio Muñoz Molina a reçu le prix Princesse des Asturies pour son "engagement littéraire" et le prix Jérusalem pour la liberté des individus dans la société.
Père de trois enfants, Antonio Muñoz Molina est marié à Elvira Lindo (1962), écrivaine et journaliste espagnole.
Il vit entre Madrid et New York où il a dirigé l'Institut Cervantès de 2004 à 2006.
site officiel : https://antoniomuñozmolina.es/
+ Voir plusAntonio Muñoz Molina est un écrivain espagnol.
Ses parents sont des enfants d'agriculteurs. Son père a dû quitter l'école très jeune pour aider à la ferme et sa mère n'a jamais été scolarisée. Enfant et adolescent de la période franquiste, Antonio s'évade par les livres notamment Borges, Faulkner qui influenceront son œuvre même s'il va développer un monde et un style qui lui sont entièrement propres.
Il étudie l'histoire de l'art à l'université de Grenade puis le journalisme à Madrid. Au début des années 80, il entre comme fonctionnaire à la municipalité de Grenade. Parallèlement, il écrit des articles pour le quotidien "Ideal", qui seront réunis et publiés sous le titre "El Robinson urbano" en 1984.
Il publie en 1986 son premier récit, "Beatus Ille", entamant une carrière brillante d'écrivain couronné par de nombreuses récompenses littéraires. Son deuxième roman, "L'Hiver à Lisbonne" ("El invierno en Lisboa"), paru en 1987, reçoit le Prix de la Critique et le Prix national de littérature narrative 1988, et est un hommage aux romans noirs américains, à ses héros et au jazz.
En 1991, il commence à écrire pour le quotidien "El Pais". En 1996, il est nommé membre de la Real Academia de Letras (siège de la lettre u).
"Le Royaume des voix" ("El jinete polaco"), paru en 1991, reçoit le Prix Planeta. "Pleine Lune" ("Plenilunio"), un deuxième roman noir publié en 1997, remporte le Prix Femina étranger en 1998.
Publié en 2009, "Dans la grande nuit des temps" ("La noche de los tiempos") est lauréat en France du Prix Méditerranée étranger 2012. "Un promeneur solitaire dans la foule" ("Un andar solitario entre la gente", 2018) obtient le Prix Médicis étranger 2020.
En 2013, Antonio Muñoz Molina a reçu le prix Princesse des Asturies pour son "engagement littéraire" et le prix Jérusalem pour la liberté des individus dans la société.
Père de trois enfants, Antonio Muñoz Molina est marié à Elvira Lindo (1962), écrivaine et journaliste espagnole.
Il vit entre Madrid et New York où il a dirigé l'Institut Cervantès de 2004 à 2006.
site officiel : https://antoniomuñozmolina.es/
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (91)
Voir plusAjouter une vidéo
Citations et extraits (509)
Voir plus
Ajouter une citation
« Je suis européen parce que m’importent la liberté tout autant que la justice, parce que j’aime partager plusieurs identités, parce que je défends passionnément la raison et crois à la compatibilité de l’intransigeance et de la modération : l’intransigeance qui ne tolère ni censure, ni abus, ni injustice; la modération qui sait que les choses sont difficiles à résoudre et requièrent patience et longueur de temps, et qu’il n’y a pas de paradis terrestres, et qu’ils ne sont même pas souhaitables. »
(Le Monde, entrevue du 05/05/2019)
(Le Monde, entrevue du 05/05/2019)
Il regardait sans beaucoup d’attention les vitrines des boutiques et se rappelait l’étonnement de Socrate devant la profusion du marché d’Athènes : « Tant de choses existent dont je n’ai pas besoin. »
La poésie d'une nouvelle ville court le risque de s'évanouir sans laisser de trace dès lors qu'on doit s'y installer.
Dans beaucoup de sociétés, disparues ou non, la notion d'heures et de minutes n'existe pas, et les langues de certaines cultures primitives n'ont pas de termes pour mesurer les années. Personne ne connait son âge.
Le niveau de tolérance face à l'incertitude, la conscience de la fragilité de sa propre vie et du provisoire de toutes choses est plus faible en Amérique du Nord que n'importe où ailleurs : les Européens d'un certain âge se rappellent que leur civilisation fut détruite en peu de temps par le totalitarisme et la guerre et que les villes les plus belles peuvent se transformer du soir au matin en un paysage de ruines [...].
Toutes ces années, j'ai acheté plus de livres que je ne pouvais en lire. Je devais parfois me contenter du métro ou d'une salle d'attente, quelques minutes avant un rendez-vous, furtivement comme on s'empresse de tirer sur une cigarette. Maintenant les ouvrages sont prêts et disponibles pour moi et pour Cecilia quand elle sera là. Je suis capable d'identifier ceux que nous avons achetés chacun de notre côté et ceux que nous nous sommes offerts l'un à l'autre et, dans la plupart des cas, je me rappelle même où et quand. Ce mélange nous garantit une diversité qui nous épargnera l'ennui, à l'image d'une sélection d'aliments non périssables préservant longtemps leur saveur et leurs qualités nutritives. S'il le faut, en cas de catastrophe, je pourrai passer le restant de ma vie sans mettre les pieds dans une librairie.
Tu changes de ville, de chambre, de visage, de ville, d'amour, mais même quand tu te dépouilles de tout, il reste toujours quelque chose de permanent, qui réside en toi depuis que tu es doué de mémoire et depuis bien avant que tu aies atteint l'âge de raison, le noyau ou la moelle de ce que tu es, de ce qui jamais ne s'est éteint, non pas une conviction ni un désir, mais un sentiment, parfois amorti comme la braise du feu de la veille cachée sous les cendres, mais presque toujours très vif, qui palpite dans tes actions et qui colore les choses d'un éloignement durable dans le temps; tu as le sentiment d'être déraciné, étranger, de ne jamais être tout à fait nulle part, de ne pas partager les certitudes d'appartenance qui pour d'autres semblent si naturelles ou faciles, ni l'assurance avec laquelle beaucoup d'entre eux s'accommodent ou possèdent, ou bien tiennent pour acquises la solidité du sol où ils marchent, la fermeté de leurs idées, la durée future de leur vie.
Elle a tout doucement fermé la porte et elle est sortie sans faire de bruit comme lorsqu'on quitte, à minuit, un malade qui vient de s'endormir. J'ai écouté ses pas s'éloigner lentement dans le couloir, redoutant ou désirant qu'elle revienne, au dernier moment, poser sa valise au pied au pied de mon lit et s'y asseoir avec un air de renoncement ou de lassitude, comme si déjà elle rentrait de ce voyage qu'avant ce soir elle n'a jamais pu faire. Quand la porte s'est refermée, ma chambre a été plongée dans l'obscurité, et seul m'éclaire encore un mince rayon de lumière venu du couloir, qui se glisse jusqu'à mon lit; mais dans l'embrasure de la fenêtre le ciel est bleu sombre, et les volets ouverts laissent entrer un air de nuit d'été tout proche, une nuit déchirée, au loin, par le sifflet des express qui suivent la livide vallée du Guadalquivir (...).
(Incipit)
(Incipit)
La lecture est compatible avec l’attente. Lire est un acte paresseux sans monotonie. Ce n’est qu’en cessant de travailler que j’ai découvert avec étonnement le vaste royaume de liberté que me garantissaient les matinées de la semaine. Si j’en ai envie, je peux m’asseoir et lire après avoir fait la vaisselle du petit déjeuner et ramené Luria de sa promenade. Lorsque je sors, j’emporte un livre avec moi. Les rares fois où je vais au restaurant, je lis en attendant mon plat, en buvant mon café ou en finissant mon verre de vin. Le vendredi midi, je lis au Mascote do Sacramento, à deux pas de chez moi, où on sert le meilleur bacalhau a bras de la ville. Je déniche une petite place silencieuse avec un banc, sous un des immenses acacias protecteurs qu’on trouve à Lisbonne, et je m’y installe pour lire un moment.
La lecture trompe, écourte le temps de l’attente, un élément à prendre en considération dans cette ville où tout peut se dérouler à un rythme très lent. Quand je lis, le temps est suspendu.
La lecture trompe, écourte le temps de l’attente, un élément à prendre en considération dans cette ville où tout peut se dérouler à un rythme très lent. Quand je lis, le temps est suspendu.
Il voyait autour de lui des visages inconnus qui s'agglutinaient devant le bar et autour des tables voisines avec leurs classeurs et leurs manteaux qui semblaient les protéger avec la même efficacité de l'hiver et du moindre soupçon de peur, plein d'assurance dans l'air chaud et la brume de tabac et des voix, bien fermes sur leurs noms, leur avenir choisi, ignorant la sourde présence parmi eux des émissaires de la tyrannie, aussi irrévocablement qu'ils ignorent, ces fils de l'oubli, que les pinèdes et les briques rouges qu'ils viennent de traverser ont été, il y a trente ans, un champ de bataille.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Antonio Muñoz Molina
Lecteurs de Antonio Muñoz Molina (1012)Voir plus
Quiz
Voir plus
Quand les aliments portent des noms insolites ou pas...
Les cheveux d'ange se mangent-ils ?
Oui
Non
10 questions
157 lecteurs ont répondu
Thèmes :
nourriture
, fruits et légumes
, fromages
, manger
, bizarreCréer un quiz sur cet auteur157 lecteurs ont répondu