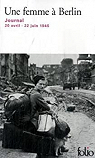Critiques de Marta Hillers (89)
C’est dur, c’est insupportable parfois. 400 pages de l’enfer vécu par une jeune Berlinoise à l’entrée des troupes Russes dans la capitale du Reich. On découvre cette vie misérable, dans la crasse, la faim, le froid, mais surtout la peur… Des bombardements, de la soif de vengeance des troupes de l’armée rouge : vols, viols, exécutions sommaires… ou comment passer entre les goutes d’une mort quasi certaine.
A la lecture de cet essai bouleversant, je me suis pausé de nombreuses questions. Les citoyens Allemands savaient-ils ? participaient-ils aux exactions commises au nom du Reich ? Et quand bien même étaient-ils tous des monstres, était-il nécessaire d’être aussi inhumain que celui qui a été inhumain ? J’imagine que ces propos, 65 ans après, n’ont pas vraiment de sens, et peuvent, sans nul doute, être considérés comme ridicules… Un sentiment étrange, triste et froid comme cette sombre période de l’histoire de l’humanité.
Lien : http://testivore.com/une-fem..
A la lecture de cet essai bouleversant, je me suis pausé de nombreuses questions. Les citoyens Allemands savaient-ils ? participaient-ils aux exactions commises au nom du Reich ? Et quand bien même étaient-ils tous des monstres, était-il nécessaire d’être aussi inhumain que celui qui a été inhumain ? J’imagine que ces propos, 65 ans après, n’ont pas vraiment de sens, et peuvent, sans nul doute, être considérés comme ridicules… Un sentiment étrange, triste et froid comme cette sombre période de l’histoire de l’humanité.
Lien : http://testivore.com/une-fem..
Témoignage d'une jeune femme qui vit la chute de Berlin et son invasion par l'Armée rouge.
Bien écrit, ce journal nous plonge dans le quotidien des civils allemands qui se battent pour leur survie et subissent le passage des troupes soviétiques. Lutte contre la faim, travaux forcés et viols sont leur quotidien.
J'avais une appréhension quant à la description des viols mais l'auteure a su ne pas s'apesantir sur les détails tout en restituant leur violence.
Elle a su également décrire la nature humaine dans ces moments particuliers.
Un témoignage à lire absolument pour qui s'intéresse à la période.
Bien écrit, ce journal nous plonge dans le quotidien des civils allemands qui se battent pour leur survie et subissent le passage des troupes soviétiques. Lutte contre la faim, travaux forcés et viols sont leur quotidien.
J'avais une appréhension quant à la description des viols mais l'auteure a su ne pas s'apesantir sur les détails tout en restituant leur violence.
Elle a su également décrire la nature humaine dans ces moments particuliers.
Un témoignage à lire absolument pour qui s'intéresse à la période.
Objectivité, véracité, lucidité, dignité, cynisme et humour.
On a tout cela dans ce livre poignant, et bien plus...
On a tout cela dans ce livre poignant, et bien plus...
Une femme raconte leur quotidien, lourd, en la capitale, après la guerre. Nous parlons beaucoup de ce que les pays envahis ont subi, mais beaucoup moins de ce que les pays perdants ont subi.
En temps de guerre, ce sont toujours les femmes qui paient les conséquences du conflit. Ici, dans ce livre, nous pouvons constater que c'est encore une fois le cas. Un journal, difficile à lire en tant que femme, sur le quotidien de ces Berlinoises qui ont vécu la suite de la guerre, avec les soldats victorieux qui pensaient pouvoir se servir à leur aise.
Lien : https://youtu.be/ouGLkd9ZOME
En temps de guerre, ce sont toujours les femmes qui paient les conséquences du conflit. Ici, dans ce livre, nous pouvons constater que c'est encore une fois le cas. Un journal, difficile à lire en tant que femme, sur le quotidien de ces Berlinoises qui ont vécu la suite de la guerre, avec les soldats victorieux qui pensaient pouvoir se servir à leur aise.
Lien : https://youtu.be/ouGLkd9ZOME
L'histoire vraie d'une jeune habitante de Berlin en 1940. Ceci est son journal, et on revit à travers ses mots les événements de l'époque. Instructif et passionnant. Parfois dur cependant. Ce n'est certes pas un livre pour jeunes adolescents. Mais un livre à lire absolument, pour que tous comprennent ce que c'est que la guerre...
Lien : https://joy369.unblog.fr/
Lien : https://joy369.unblog.fr/
Lecture très bouleversante. Les derniers jours de la guerre à Berlin. Jours de terreur, jours de malheur, jours de tristesse. Des actes inhumains. L'impensable. L'insoutenable. L'improbable. Comme toute cette guerre d'ailleurs. L'Homme devra un jour répondre de ces actes. Une lecture nécessaire, même si elle est triste, même si elle est cruelle, pour que plus jamais de telles choses se produisent. Pour ne pas oublier. Pour ne plus souffrir.
Un témoignage passionnant!
L’avenir s’étale devant nous comme une chape de plomb
Fin de guerre, un monde dévasté (voir L’Europe en ruines, Solin Actes sud, 1995). Des bombardements, mais pas sur les voies d’accès à Auschwitz. Le troisième Reich s’effondre. La guerre.
Le récit sec, distancé d’une femme, d’une témoin. La survie de tous les jours, la recherche de nourriture, la quête d’eau, le chacun-e pour soi.
« Un homme qui tirait une charrette à bras, sur la charrette une femme morte, raide comme une planche. Mèches grises soulevées par le vent, tablier de cuisine bleu ; les longues jambes maigres, dans des bas gris, dépassaient comme des piques à l’arrière de la charrette. Personne ou presque ne prêtait attention . Comme avant, pour l’enlèvement des ordures ménagères ».
Loin des images sans mort-e-s, sans vie, d’une guerre qui n’était pas qu’une guerre entre le « bien » et le « mal », entre la « démocratie » et la « barbarie ». Une guerre entre États, entre soldats, une guerre pour se défendre, mais pas seulement, contre les armées nazies…
Contre l’écriture de cette barbarie du seul point de vue des armées de vainqueurs ( qui n’hésitèrent pas à recycler des nazis pour leurs guerres futures ). Contre les visions désincarnées et sans civil-e-s, contre l’oubli aussi, un récit d’une femme, là…
Les États se font la guerre, les hommes enrôlés, font aussi leurs guerres. Si les homme ont eu le privilège de mourir soi-disant pour leur patrie, « aujourd’hui, nous, les femmes, nous partageons ce privilège ». L’armée russe avance. Mais les armées ne sont pas impersonnelles.
Des viols, des viols de masse, « Cette forme collective de viol massif est aussi surmontée de manière collective. Chaque femme aide l’autre en en parlant, dit ce qu’elle a sur le cœur, donne à l’autre l’occasion de dire à son tour ce qu’elle a sur le cœur, de cracher le sale morceau », la guerre poursuivie contre les femmes, pour la simple raison qu’elles sont femmes. « Nous sommes déchues de nos droits, nous sommes devenues des proies, de la merde ».
L’auteure dit, énonce « Et moi, je suis restée frigide durant tous ces accouplements. Il ne peut en être autrement, il ne doit pas en être autrement, car je veux demeurer morte et insensible, aussi longtemps que je suis traitée comme une proie ».
Les viols et les recherches de protection, de nourriture, d’un loup contre les loups en « échange » de l’accès au corps, à son corps… « Or, tout ça ne répond pas encore à la question de savoir si je mérite le nom de putain ou non, puisque je vis pour ainsi dire de mon corps et que je l’offre en échange de nourriture ».
La guerre contre les femmes, ici à Berlin, là en ex-Yougoslavie, ici et là en Asie ou en Afrique. Ce silence assourdissant des bordels militaires, de la prostitution institutionnalisée pour militaires et ces viols, viols, viols…
Fin de guerre, un monde dévasté (voir L’Europe en ruines, Solin Actes sud, 1995). Des bombardements, mais pas sur les voies d’accès à Auschwitz. Le troisième Reich s’effondre. La guerre.
Le récit sec, distancé d’une femme, d’une témoin. La survie de tous les jours, la recherche de nourriture, la quête d’eau, le chacun-e pour soi.
« Un homme qui tirait une charrette à bras, sur la charrette une femme morte, raide comme une planche. Mèches grises soulevées par le vent, tablier de cuisine bleu ; les longues jambes maigres, dans des bas gris, dépassaient comme des piques à l’arrière de la charrette. Personne ou presque ne prêtait attention . Comme avant, pour l’enlèvement des ordures ménagères ».
Loin des images sans mort-e-s, sans vie, d’une guerre qui n’était pas qu’une guerre entre le « bien » et le « mal », entre la « démocratie » et la « barbarie ». Une guerre entre États, entre soldats, une guerre pour se défendre, mais pas seulement, contre les armées nazies…
Contre l’écriture de cette barbarie du seul point de vue des armées de vainqueurs ( qui n’hésitèrent pas à recycler des nazis pour leurs guerres futures ). Contre les visions désincarnées et sans civil-e-s, contre l’oubli aussi, un récit d’une femme, là…
Les États se font la guerre, les hommes enrôlés, font aussi leurs guerres. Si les homme ont eu le privilège de mourir soi-disant pour leur patrie, « aujourd’hui, nous, les femmes, nous partageons ce privilège ». L’armée russe avance. Mais les armées ne sont pas impersonnelles.
Des viols, des viols de masse, « Cette forme collective de viol massif est aussi surmontée de manière collective. Chaque femme aide l’autre en en parlant, dit ce qu’elle a sur le cœur, donne à l’autre l’occasion de dire à son tour ce qu’elle a sur le cœur, de cracher le sale morceau », la guerre poursuivie contre les femmes, pour la simple raison qu’elles sont femmes. « Nous sommes déchues de nos droits, nous sommes devenues des proies, de la merde ».
L’auteure dit, énonce « Et moi, je suis restée frigide durant tous ces accouplements. Il ne peut en être autrement, il ne doit pas en être autrement, car je veux demeurer morte et insensible, aussi longtemps que je suis traitée comme une proie ».
Les viols et les recherches de protection, de nourriture, d’un loup contre les loups en « échange » de l’accès au corps, à son corps… « Or, tout ça ne répond pas encore à la question de savoir si je mérite le nom de putain ou non, puisque je vis pour ainsi dire de mon corps et que je l’offre en échange de nourriture ».
La guerre contre les femmes, ici à Berlin, là en ex-Yougoslavie, ici et là en Asie ou en Afrique. Ce silence assourdissant des bordels militaires, de la prostitution institutionnalisée pour militaires et ces viols, viols, viols…
Une femme à Berlin. La jeune Berlinoise qui a rédigé ce journal, du 20 avril 1945- les soviétiques sont aux portes-jusqu'au 22 juin, à voulu rester anonyme, lors de la 1ère publication du livre en 1954, et après.
⏹J'ai vraiment aimé l'aspect journal intime, cet effort de retracer les événements de la journée. On plonge dans la chute du 3ème Reich, l'univers c'est Berlin sous les décombres avec les allés retour des russes dans les habitations, les viols des femmes. Certaines jeunes filles étaient cachées dans ses conditions très difficiles pour qu'elles ne soient approchées.
⏹Un récit immersif, les relations entre les femmes Berlinoises et les soldats soviétiques est au cœur de la lecture. Il y a eu viols, meurtres, pillages, mais aussi liaisons et amourettes. Parmi eux : des rustres, des barbares mais aussi des hommes protecteurs et empathiques. Il fallait parfois se dépatouiller, savoir dire non si c'était possible et acquiescer pour éviter le pire où être nourrie où protégée (si c'était possible) en échange. Cela a durer un temps, ensuite les soldats n'étaient plus autorisés à entrer dans les demeures allemandes comme bon leur semble.
⏹J'ai été fortement agacée par le comportement récurrent de la veuve amie de l'auteur, ayant eut un rapport avec un soldat de l'armée Rouge, qui ne cessait de vanter les propos du jeune homme, qui, après l'acte sexuel lui dit :" Femme ukrainienne (fait avec sa main le signe de zéro), toi comme ça:👌".
Je ne juge pas, mais mon agacement m'a fait grincer des dents à le lire autant de fois que cette femme l'a raconté à qui voulait l'entendre (et pas toujours), en riant...
Les femmes étaient livrées à elles mêmes et leur regard sur les hommes allemands à changé :" Ils nous font pitié, nous apparaissent faibles, misérables. Le monde nazi dominé par les hommes, glorifiant l'homme fort, vacille-et avec lui le mythe de" l'Homme".
⏹J'ai vraiment aimé l'aspect journal intime, cet effort de retracer les événements de la journée. On plonge dans la chute du 3ème Reich, l'univers c'est Berlin sous les décombres avec les allés retour des russes dans les habitations, les viols des femmes. Certaines jeunes filles étaient cachées dans ses conditions très difficiles pour qu'elles ne soient approchées.
⏹Un récit immersif, les relations entre les femmes Berlinoises et les soldats soviétiques est au cœur de la lecture. Il y a eu viols, meurtres, pillages, mais aussi liaisons et amourettes. Parmi eux : des rustres, des barbares mais aussi des hommes protecteurs et empathiques. Il fallait parfois se dépatouiller, savoir dire non si c'était possible et acquiescer pour éviter le pire où être nourrie où protégée (si c'était possible) en échange. Cela a durer un temps, ensuite les soldats n'étaient plus autorisés à entrer dans les demeures allemandes comme bon leur semble.
⏹J'ai été fortement agacée par le comportement récurrent de la veuve amie de l'auteur, ayant eut un rapport avec un soldat de l'armée Rouge, qui ne cessait de vanter les propos du jeune homme, qui, après l'acte sexuel lui dit :" Femme ukrainienne (fait avec sa main le signe de zéro), toi comme ça:👌".
Je ne juge pas, mais mon agacement m'a fait grincer des dents à le lire autant de fois que cette femme l'a raconté à qui voulait l'entendre (et pas toujours), en riant...
Les femmes étaient livrées à elles mêmes et leur regard sur les hommes allemands à changé :" Ils nous font pitié, nous apparaissent faibles, misérables. Le monde nazi dominé par les hommes, glorifiant l'homme fort, vacille-et avec lui le mythe de" l'Homme".
UNE FEMME À BERLIN est le témoignage d'une jeune anonyme trentenaire, écrit lors de l'entrée des Soviétiques dans la capitale allemande. Écrit quotidiennement entre le 20 avril et le 22 juin 1945, dans des cahiers d'écolier, dans une cave, à la lueur d'une bougie, ce journal a permis à l'auteur de survivre et de ne pas sombrer dans le désespoir et la folie.
L'HISTOIRE DU LIVRE
L'histoire du livre en elle-même est déjà extraordinaire, car ce texte est resté dans l'oubli pendant plus de 40 ans. L'auteure, anonyme, travaillait dans la presse, comme photographe semble-t-il, et ne s'est jamais fourvoyée avec les nazis. Elle avait comme contact un journaliste et critique allemand, réhabilité après la guerre et vivant aux Etats-Unis. C'est à lui qu'elle remis ses cahiers. Il mit des années à la persuader de les publier. Un éditeur américain le publie en 1954 en version américaine avec avec des traductions norvégienne, italienne, danoise, japonaise, espagnol, française et Finnoise. Il fallut attendre cinq autres années pour que l'original Allemand voit le jour.
Le public féminin allemand n'était pas supposé témoigner de la réalité des viols. Les hommes allemands n'étaient pas censés apparaître comme des spectateurs impuissants devant les vainqueurs russes qui s'emparaient de leurs femmes comme d'un butin de guerre ( plus de 100.000 Berlinoises furent victimes de viols massifs, collectifs et quotidiens, soit 80% des femmes âgées entre 16 et 60 ans.) Le livre ne rencontre à l'époque silence et hostilité.
Dans les années 70, un éditeur allemand tente de rééditer Une femme à Berlin. Après maintes péripéties, il découvre que l'anonyme ne souhaitait pas voir son livre réédié en Allemagne tant qu'elle était en vie, à cause du mauvais accueil à sa sortie. Finalement en 2001 elle décède et le livre est enfin publié en allemand en 2002 est en 2006 aux éditions Gallimard.
LE RÉCIT.
Une femme à Berlin raconte la vie quotidienne des femmes dans Berlin dévasté au moment où les Russes pénètrent dans ce côté de la ville. Elle décrit les nombreux viols dont elle est victime et témoin. Elle raconte la faim, la recherche quotidienne de nourriture. Berlin et ses morts. Berlin coupé du monde, sans eau, gaz, électricité. Sans journaux, sans radio, sans nouvelles. Et puis, du jour au lendemain, le nettoyage de la ville par les femmes. Leur souffrances morales et leurs douleurs physiques au quotidien. Un témoignage poignant mais dénudé de haine. Un témoignage capital, unique et bouleversant, vu par l'autre côté de la lorgnette. Un témoignage humain.
Aujourd'hui encore, comme dans les années 60, lors de sa parution, on refuse d'entendre les souffrances des allemands. On refuse de reconnaître que les femmes, neutres dans ce conflit, ont été des victimes traitées comme des objets de victoire. Comme le dit l'ami de l'auteure : " il est trop facile de jouer les juges quand on est soi-même en sécurité" .
L'HISTOIRE DU LIVRE
L'histoire du livre en elle-même est déjà extraordinaire, car ce texte est resté dans l'oubli pendant plus de 40 ans. L'auteure, anonyme, travaillait dans la presse, comme photographe semble-t-il, et ne s'est jamais fourvoyée avec les nazis. Elle avait comme contact un journaliste et critique allemand, réhabilité après la guerre et vivant aux Etats-Unis. C'est à lui qu'elle remis ses cahiers. Il mit des années à la persuader de les publier. Un éditeur américain le publie en 1954 en version américaine avec avec des traductions norvégienne, italienne, danoise, japonaise, espagnol, française et Finnoise. Il fallut attendre cinq autres années pour que l'original Allemand voit le jour.
Le public féminin allemand n'était pas supposé témoigner de la réalité des viols. Les hommes allemands n'étaient pas censés apparaître comme des spectateurs impuissants devant les vainqueurs russes qui s'emparaient de leurs femmes comme d'un butin de guerre ( plus de 100.000 Berlinoises furent victimes de viols massifs, collectifs et quotidiens, soit 80% des femmes âgées entre 16 et 60 ans.) Le livre ne rencontre à l'époque silence et hostilité.
Dans les années 70, un éditeur allemand tente de rééditer Une femme à Berlin. Après maintes péripéties, il découvre que l'anonyme ne souhaitait pas voir son livre réédié en Allemagne tant qu'elle était en vie, à cause du mauvais accueil à sa sortie. Finalement en 2001 elle décède et le livre est enfin publié en allemand en 2002 est en 2006 aux éditions Gallimard.
LE RÉCIT.
Une femme à Berlin raconte la vie quotidienne des femmes dans Berlin dévasté au moment où les Russes pénètrent dans ce côté de la ville. Elle décrit les nombreux viols dont elle est victime et témoin. Elle raconte la faim, la recherche quotidienne de nourriture. Berlin et ses morts. Berlin coupé du monde, sans eau, gaz, électricité. Sans journaux, sans radio, sans nouvelles. Et puis, du jour au lendemain, le nettoyage de la ville par les femmes. Leur souffrances morales et leurs douleurs physiques au quotidien. Un témoignage poignant mais dénudé de haine. Un témoignage capital, unique et bouleversant, vu par l'autre côté de la lorgnette. Un témoignage humain.
Aujourd'hui encore, comme dans les années 60, lors de sa parution, on refuse d'entendre les souffrances des allemands. On refuse de reconnaître que les femmes, neutres dans ce conflit, ont été des victimes traitées comme des objets de victoire. Comme le dit l'ami de l'auteure : " il est trop facile de jouer les juges quand on est soi-même en sécurité" .
Livre témoignage d'une époque importante du 20e siècle rn Europe. Si la lecture de ce livre est fascinante, il laisse tout de même un arrière goût amer par le point de vie quasi sans concession, et guère critique du nazisme. Probablement a ne pas mettre entre toutes les mains.
Etrange, cet ouvrage anonyme bien écrit, étrange et dérangeant ce récit des quelques semaines qui séparent la fin du régime nazi de l’installation des troupes russes à Berlin.
Sous la forme d’un journal, c’est une réalité rarement évoquée en France par le cinéma ou la littérature, qui nous est présentée. La crudité du propos sur les viols perpétrés par ces militaires de l’Armée Rouge privés de femmes mais aussi pour certains animés par l’esprit de vengeance, bouleverse.
Plus bouleversant encore, peut-être, c’est la vie de privations qui s’étale sous nos yeux, les artifices pour trouver de quoi se nourrir, s’abriter, vivre simplement.
Les références à Knut Hamsun sont présentes, elles rappellent le moteur et la prison que peut constituer la faim.
La lâcheté obligée, la domination éprouvée, sont tant d’éléments qui banalisent les viols dont la portée n’est pas encore mesurée par les victimes elles-mêmes ; trop tôt ou déjà trop tard…
Le sentiment, quelle que soit sa forme, est présent durant ces quelques jours et les « Ivan » apparaissent parfois attendrissants. Ce peuple allemand, dominateur, rejoint vite la position du dominé. Loi du Talion ou bêtise humaine offerte grand à nos yeux. Ce journal est aussi l’illustration de la passivité, devant le régime nazi d’abord et annoncée déjà avec la domination soviétique qui s’installe pour 45 ans, on le sait. C’est aussi cette passivité du quotidien qui heurte une sensibilité engagée parce qu’elle démontre que même écrasé, l’Homme trouve en lui toujours ce ressort… étonnant… inqualifiable.
Sous la forme d’un journal, c’est une réalité rarement évoquée en France par le cinéma ou la littérature, qui nous est présentée. La crudité du propos sur les viols perpétrés par ces militaires de l’Armée Rouge privés de femmes mais aussi pour certains animés par l’esprit de vengeance, bouleverse.
Plus bouleversant encore, peut-être, c’est la vie de privations qui s’étale sous nos yeux, les artifices pour trouver de quoi se nourrir, s’abriter, vivre simplement.
Les références à Knut Hamsun sont présentes, elles rappellent le moteur et la prison que peut constituer la faim.
La lâcheté obligée, la domination éprouvée, sont tant d’éléments qui banalisent les viols dont la portée n’est pas encore mesurée par les victimes elles-mêmes ; trop tôt ou déjà trop tard…
Le sentiment, quelle que soit sa forme, est présent durant ces quelques jours et les « Ivan » apparaissent parfois attendrissants. Ce peuple allemand, dominateur, rejoint vite la position du dominé. Loi du Talion ou bêtise humaine offerte grand à nos yeux. Ce journal est aussi l’illustration de la passivité, devant le régime nazi d’abord et annoncée déjà avec la domination soviétique qui s’installe pour 45 ans, on le sait. C’est aussi cette passivité du quotidien qui heurte une sensibilité engagée parce qu’elle démontre que même écrasé, l’Homme trouve en lui toujours ce ressort… étonnant… inqualifiable.
Ce journal, témoignage autobiographe écrit entre avril et juin 45, raconte le vie quotidienne d'une femme, berlinoise, depuis que la ville est prise pas les soviétiques. Elle y raconte, avec beaucoup de finesse et de cynisme, la vie de son immeuble, la vie des ces femmes, et ses hommes, la misère et la peur.
Dans un immeuble de Berlin ravagé par les bombardements russes, une jeune femme tient son journal entre le 20 avril et le 22 juin 1945.
.Les bombes qui tombent aveuglement, les longues nuits dans les abris, l'arrivée des Russes, les viols, les pillages, les tickets de rationnement, la recherche de nourriture, l'ordinaire d'une ville bombardée puis occupée où les hommes détournent la tête quand leur femme ou leurs filles sont violées. L'auteure avance coûte que coûte et tourne la page quand elle veut oublier, elle cherche surtout à vivre et à manger, elle parle russe et parfois en profite, pas toujours. C'est une question de survie et qui lui jetterait la pierres. Qu'aurions nous fait dans la même situation ? Elle affiche un mélange de dignité, de cynisme et d'humour. Les Allemands n'étaient pas prêts à lire ce genre de témoignages. Les contemporains de l'auteure ont préféré oublier jusqu'à ce que leurs enfants leur demandent des comptes. "Elle observe froidement le comportement de ses compatriotes avant et après la chute du régime et inflige un cinglant camouflet à l'auto compassion et à l'amnésie de l'après-guerre. Il n'est donc pas étonnant que le livre n'ait rencontré que silence et hostilité. Ce n'est que dans les années 70' que les copies du texte ont recommencé à circuler".
.Les bombes qui tombent aveuglement, les longues nuits dans les abris, l'arrivée des Russes, les viols, les pillages, les tickets de rationnement, la recherche de nourriture, l'ordinaire d'une ville bombardée puis occupée où les hommes détournent la tête quand leur femme ou leurs filles sont violées. L'auteure avance coûte que coûte et tourne la page quand elle veut oublier, elle cherche surtout à vivre et à manger, elle parle russe et parfois en profite, pas toujours. C'est une question de survie et qui lui jetterait la pierres. Qu'aurions nous fait dans la même situation ? Elle affiche un mélange de dignité, de cynisme et d'humour. Les Allemands n'étaient pas prêts à lire ce genre de témoignages. Les contemporains de l'auteure ont préféré oublier jusqu'à ce que leurs enfants leur demandent des comptes. "Elle observe froidement le comportement de ses compatriotes avant et après la chute du régime et inflige un cinglant camouflet à l'auto compassion et à l'amnésie de l'après-guerre. Il n'est donc pas étonnant que le livre n'ait rencontré que silence et hostilité. Ce n'est que dans les années 70' que les copies du texte ont recommencé à circuler".
Contrairement à "Rien où poser sa tête" qui est également le témoignage d'une femme durant la Seconde Guerre mondiale, ce récit a la qualité d'un roman. C'est en quelque sorte un véritable livre d'histoire sur la guerre, mais du point de vu de ses acteurs anonymes et non combattants. Ce livre dénonce aussi la condition féminine, même si ce n'est peut-être pas son but, ce qui est d'ailleurs assez étrange, mais soulève aussi de nombreuses questions existentielles et philosophiques.
La bataille de Berlin, ultime combat entre les Alliés et la Wehrmacht, se déroule du 16 avril au 2 mai 1945 et se termine par la capitulation de l’Allemagne et l’entrée des troupes soviétiques dans la capitale. Plusieurs millions de civils sont pris au piège et se réfugient dans les caves pour échapper aux bombardements, puis doivent supporter l’entrée d’une armée de vainqueurs.
Une journaliste trentenaire, intelligente et cultivée, commence alors un journal, quelques notes au jour le jour sur un cahier retrouvé, qu’elle va tenir pendant deux mois. Non dans un but de témoignage (même si, au final, c’en est un, et de premier ordre !), mais tout simplement pour survivre à la violence et à la terreur du quotidien, pour les mettre à distance.
Nous suivons au jour le jour la débâcle allemande : les bombardements, le choc de l’entrée des Russes dans Berlin, leur installation et les viols systématiques des femmes, puis leur départ et le calme étrange qui s’ensuit, la faim obsédante, la découverte de la ville déserte et en ruines et l’espèce de perte générale de repères.
Comme la narratrice possède plusieurs langues et suffisamment de russe pour pouvoir dialoguer avec les occupants et servir d’interprète à ses voisins, elle réalise son statut particulier. «Pour la première fois aussi, je prends conscience de ma qualité de témoin» écrit-elle.
Femme de tête, elle décide, avec un certain panache, de se mettre sous la protection d’un officier, de façon à ne plus être violée par le premier venu. Elle «recrute» tout d’abord Anatol, un lieutenant aussi mal dégrossi que ses hommes ; puis un major, cultivé et bien élevé, qui possède un certain raffinement.
Son journal, par-delà l’intérêt qu’il présente en tant que document historique, est aussi remarquable pour les réflexions émises par son auteure, sa liberté de pensée, son analyse lucide des ressorts humains, notamment la mesquinerie et l’égoïsme des vaincus et le comportement humiliant de beaucoup des vainqueurs ; mais aussi une comparaison entre les Allemands, habitués au confort, et les Russes, plutôt rustres et vivant plus rudimentairement, entre le statut des femmes russes, des camarades comme les autres, et celui des femmes allemandes ; une remarque féministe avant-gardiste sur le comportement des hommes berlinois, glorifiés par le nazisme, qui paraissent bien faibles pendant la chute du IIIème Reich – elle estime que les femmes les valent bien et qu’il n’y a plus ni sexe fort, ni sexe faible ; le renversement de l’opinion publique sur Hitler, la phrase tant de fois prononcée avec gratitude est désormais ironique et lourde de ressentiment , «C’est au Führer que nous devons tout cela» ; et même une méditation morale : est-ce que le fait d’échanger des faveurs sexuelles contre de la nourriture fait d’elle une prostituée ?
Son hymne à la vie : «Une chose est certaine : vaincre la mort rend plus fort».
Un témoignage sidérant par son authenticité brute et son absence de pathos. Une femme qu’on aurait aimé connaître…
Une journaliste trentenaire, intelligente et cultivée, commence alors un journal, quelques notes au jour le jour sur un cahier retrouvé, qu’elle va tenir pendant deux mois. Non dans un but de témoignage (même si, au final, c’en est un, et de premier ordre !), mais tout simplement pour survivre à la violence et à la terreur du quotidien, pour les mettre à distance.
Nous suivons au jour le jour la débâcle allemande : les bombardements, le choc de l’entrée des Russes dans Berlin, leur installation et les viols systématiques des femmes, puis leur départ et le calme étrange qui s’ensuit, la faim obsédante, la découverte de la ville déserte et en ruines et l’espèce de perte générale de repères.
Comme la narratrice possède plusieurs langues et suffisamment de russe pour pouvoir dialoguer avec les occupants et servir d’interprète à ses voisins, elle réalise son statut particulier. «Pour la première fois aussi, je prends conscience de ma qualité de témoin» écrit-elle.
Femme de tête, elle décide, avec un certain panache, de se mettre sous la protection d’un officier, de façon à ne plus être violée par le premier venu. Elle «recrute» tout d’abord Anatol, un lieutenant aussi mal dégrossi que ses hommes ; puis un major, cultivé et bien élevé, qui possède un certain raffinement.
Son journal, par-delà l’intérêt qu’il présente en tant que document historique, est aussi remarquable pour les réflexions émises par son auteure, sa liberté de pensée, son analyse lucide des ressorts humains, notamment la mesquinerie et l’égoïsme des vaincus et le comportement humiliant de beaucoup des vainqueurs ; mais aussi une comparaison entre les Allemands, habitués au confort, et les Russes, plutôt rustres et vivant plus rudimentairement, entre le statut des femmes russes, des camarades comme les autres, et celui des femmes allemandes ; une remarque féministe avant-gardiste sur le comportement des hommes berlinois, glorifiés par le nazisme, qui paraissent bien faibles pendant la chute du IIIème Reich – elle estime que les femmes les valent bien et qu’il n’y a plus ni sexe fort, ni sexe faible ; le renversement de l’opinion publique sur Hitler, la phrase tant de fois prononcée avec gratitude est désormais ironique et lourde de ressentiment , «C’est au Führer que nous devons tout cela» ; et même une méditation morale : est-ce que le fait d’échanger des faveurs sexuelles contre de la nourriture fait d’elle une prostituée ?
Son hymne à la vie : «Une chose est certaine : vaincre la mort rend plus fort».
Un témoignage sidérant par son authenticité brute et son absence de pathos. Une femme qu’on aurait aimé connaître…
"Oui, c'est bien la guerre qui déferle sur Berlin. Hier encore ce n'était qu'un grondement lointain., aujourd'hui c'est un roulement continu. On respire les détonations. L'oreille est assourdie, l'ouïe ne perçoit plus que le feu des gros calibres. Plus moyen de s'orienter. Nous vivons dans un cercle de canons d'armes braquées sur nous, et il se resserre d'heure en heure".
L'auteur, qui écrit ses première lignes le vendredi 20 avril 1945 à 16 heures, est une jeune femme de trente ans, journaliste et appartenant à la bourgeoisie prussienne. Elle a voyagé dans toute l'Europe et a vécu à Moscou, Londres et Paris. Alors que Berlin est à feu et à sang, encerclée par l'armée soviétique, que la population se terre dans des abris de fortune, que la mort, la misère - tant morale que matérielle - est le lot de chaque berlinois, cette jeune femme qui a voulu garder l'anonymat a conscience de sa qualité de témoin direct des événements.
L'auteur, qui écrit ses première lignes le vendredi 20 avril 1945 à 16 heures, est une jeune femme de trente ans, journaliste et appartenant à la bourgeoisie prussienne. Elle a voyagé dans toute l'Europe et a vécu à Moscou, Londres et Paris. Alors que Berlin est à feu et à sang, encerclée par l'armée soviétique, que la population se terre dans des abris de fortune, que la mort, la misère - tant morale que matérielle - est le lot de chaque berlinois, cette jeune femme qui a voulu garder l'anonymat a conscience de sa qualité de témoin direct des événements.
Le 20 avril 1945, l’auteur dont nous ignorons l’identité débute l’écriture d’un journal. Elle cessera d’écrire le 22 juin de la même année.
Le 20 avril, Berlin connaissait le summum de la guerre ; bombardements aériens américains et terrestres des orgues de Staline russes. Les troupes russes allaient envahir et prendre la ville détruite.
La plupart des hommes allemands étaient soit encore soldats, soit prisonniers, soit morts. Restaient dans la ville des gosses et des vieux déguisés en militaires et dans les caves des bâtiments en ruine des femmes, des enfants et des vieillards apeurés et affamés.
Et dès l’arrivée des troupes soviétiques, ce furent pillages et viols.
L’auteur sera violée, plusieurs fois, ainsi que toute femme allemande, les soldats s’installèrent dans leurs appartements qui leur servaient de « repos du guerrier ». Elle écrit pour elle-même, pour ne pas devenir folle, pour rester en vie et ne pas se suicider comme beaucoup. Pour se prémunir, elle banalisera ce qu’elle subit, aucune haine n’apparaît dans ce récit, elle raconte et rend témoignage du vécu.
Le 22 juin, le récit s’arrête, les combats cessent, la vie reprend lentement. Les survivants ont de vraies préoccupations : trouver de l’eau, de la nourriture, rechercher des connaissances, oublier.
Un document effroyable, d’autant plus effroyable que, face à ce qu’elle vit, à ce que toutes vivent, l’auteur reste calme, aucun débordement dans l’écriture, aucun cri, elle subit en silence.
Ces mots, elle les a écrits pour elle.
Ce livre ne parut en Allemand et selon sa volonté qu’à son décès, quarante ans plus tard.
Le 20 avril, Berlin connaissait le summum de la guerre ; bombardements aériens américains et terrestres des orgues de Staline russes. Les troupes russes allaient envahir et prendre la ville détruite.
La plupart des hommes allemands étaient soit encore soldats, soit prisonniers, soit morts. Restaient dans la ville des gosses et des vieux déguisés en militaires et dans les caves des bâtiments en ruine des femmes, des enfants et des vieillards apeurés et affamés.
Et dès l’arrivée des troupes soviétiques, ce furent pillages et viols.
L’auteur sera violée, plusieurs fois, ainsi que toute femme allemande, les soldats s’installèrent dans leurs appartements qui leur servaient de « repos du guerrier ». Elle écrit pour elle-même, pour ne pas devenir folle, pour rester en vie et ne pas se suicider comme beaucoup. Pour se prémunir, elle banalisera ce qu’elle subit, aucune haine n’apparaît dans ce récit, elle raconte et rend témoignage du vécu.
Le 22 juin, le récit s’arrête, les combats cessent, la vie reprend lentement. Les survivants ont de vraies préoccupations : trouver de l’eau, de la nourriture, rechercher des connaissances, oublier.
Un document effroyable, d’autant plus effroyable que, face à ce qu’elle vit, à ce que toutes vivent, l’auteur reste calme, aucun débordement dans l’écriture, aucun cri, elle subit en silence.
Ces mots, elle les a écrits pour elle.
Ce livre ne parut en Allemand et selon sa volonté qu’à son décès, quarante ans plus tard.
Quelques semaines dans la vie d'une Berlinoise à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La fin de celle-ci? Pas vraiment, en tout cas pas pour les Berlinois... et surtout les Berlinoises. Cette fois la guerre est là et bien là!
Commencé avec les bombardements de la capitale allemande, ce journal éclaire un aspect de la guerre trop souvent ignoré et occulté, la population civile et surtout féminine face aux soldats, face à l'occupation. La guerre est une affaire d'hommes, et pourtant quel meilleur moyen pour acter une victoire que de soumettre la femme de l'ennemi?
C'est un récit brut sur le quotidien des occupants d'un quartier, d'un immeuble, d'une femme dans les bombardements puis face à l'Armée rouge. Après la destruction et l'annihilation on voit peu à peu la vie reprendre ses droits et son cours pour la survie.
Un récit dérangeant sur la survie d'une femme allemande. L'anonymat s'explique par la volonté de livrer sans tabou une tranche de vie pénible et gênante. Qu'il soit véridique ou non, peut importe. Même romancé, il n'en reste pas moins un témoignage allemand sur un passé trop souvent oublié et mis de côté. Merci et bravo à l'auteure.
Commencé avec les bombardements de la capitale allemande, ce journal éclaire un aspect de la guerre trop souvent ignoré et occulté, la population civile et surtout féminine face aux soldats, face à l'occupation. La guerre est une affaire d'hommes, et pourtant quel meilleur moyen pour acter une victoire que de soumettre la femme de l'ennemi?
C'est un récit brut sur le quotidien des occupants d'un quartier, d'un immeuble, d'une femme dans les bombardements puis face à l'Armée rouge. Après la destruction et l'annihilation on voit peu à peu la vie reprendre ses droits et son cours pour la survie.
Un récit dérangeant sur la survie d'une femme allemande. L'anonymat s'explique par la volonté de livrer sans tabou une tranche de vie pénible et gênante. Qu'il soit véridique ou non, peut importe. Même romancé, il n'en reste pas moins un témoignage allemand sur un passé trop souvent oublié et mis de côté. Merci et bravo à l'auteure.
Témoignage dur, froid et émouvant de cette femme qui pendant 2 mois relate son quotidien sous les bombardements alliés à Berlin et la prise de la ville par les troupes russes.
Cette femme, cultivée ( travaille dans l’édition ) et qui a beaucoup voyagé en Europe, écrit comme elle le dit pour survivre à toutes les épreuves qu’elle traverse.
On retrouve cette nécessité dans les témoignages d’écrivains qui ont vu la mort les frôler dans les camps de concentration pendant la 2nde Guerre Mondiale .
Comme a pu le dire “ Jorge Semprun “ dans “ L’écriture ou la vie “ il faut écrire pour ne pas mourir “ . Jorge Semprun montre dans ce texte que l'homme ne se réduit pas à son corps, à ses fonctions biologiques, mais qu'il se définit essentiellement par sa dimension spirituelle.
L’écriture permet à cette auteure inconnue de réfléchir et de retrouver une dimension humaine. En écrivant elle reste une créature pensante et spirituelle en dépit de tout.
Le reste de son temps physique , c’est pour survivre, à la faim , à la peur et aux coups et viols des assaillants russes. Toute son énergie n’est plus consacrée qu’à cela, parcourir Berlin chaque jour pour trouver un peu de nourriture ( à base de pommes de terre presque pourries ou de beurre rance souvent ) . Ses instincts primaires sont les seuls à fonctionner pendant ce temps là .
Et puis il y a la pause , l’évasion et la respiration de l’ écriture qui permet de rester “debout “ dans sa tête, de continuer à penser comme un être humain ordinaire . “ J’écris tout ce qui se bouscule dans ma tête et mon cœur … “ page 103 .
“ Je m’étonne moi-même de l’obstination avec laquelle je veux fixer ce temps intemporel “ page 213 .
“ Résister consiste à continuer à être “ Comme dans l'avant-propos de “ L'espèce humaine “ de “ Robert Antelme “ .
Elle reste tout le temps lucide car il faut survivre à tout prix : dans un 1 er temps se protéger des bombes qui pleuvent régulièrement sur son immeuble puis trouver à manger chaque jour et enfin essayer d’échapper aux russes qui cherchent des femmes .
Ce témoignage important et poignant nous emporte et nous vivons Berlin au jour le jour avec l’ auteure , accompagnés de la peur et de la faim omniprésentes .Nous souffrons avec elle .
Ce journal se rapproche d' autres récits d’ hommes et de femmes plongés dans l’enfer de la guerre ou dans l’horreur des camps d’extermination, “ Zalmen Gradowski “ “ Au cœur de l’ enfer “ par exemple .
Bien sûr ici on est du côté de l’oppresseur dans cette guerre mais on s’aperçoit que la souffrance est la même pour tous les civils, dés que le conflit est à leur porte .
La guerre est la pire des choses pour l’ humanité !
Cette femme, cultivée ( travaille dans l’édition ) et qui a beaucoup voyagé en Europe, écrit comme elle le dit pour survivre à toutes les épreuves qu’elle traverse.
On retrouve cette nécessité dans les témoignages d’écrivains qui ont vu la mort les frôler dans les camps de concentration pendant la 2nde Guerre Mondiale .
Comme a pu le dire “ Jorge Semprun “ dans “ L’écriture ou la vie “ il faut écrire pour ne pas mourir “ . Jorge Semprun montre dans ce texte que l'homme ne se réduit pas à son corps, à ses fonctions biologiques, mais qu'il se définit essentiellement par sa dimension spirituelle.
L’écriture permet à cette auteure inconnue de réfléchir et de retrouver une dimension humaine. En écrivant elle reste une créature pensante et spirituelle en dépit de tout.
Le reste de son temps physique , c’est pour survivre, à la faim , à la peur et aux coups et viols des assaillants russes. Toute son énergie n’est plus consacrée qu’à cela, parcourir Berlin chaque jour pour trouver un peu de nourriture ( à base de pommes de terre presque pourries ou de beurre rance souvent ) . Ses instincts primaires sont les seuls à fonctionner pendant ce temps là .
Et puis il y a la pause , l’évasion et la respiration de l’ écriture qui permet de rester “debout “ dans sa tête, de continuer à penser comme un être humain ordinaire . “ J’écris tout ce qui se bouscule dans ma tête et mon cœur … “ page 103 .
“ Je m’étonne moi-même de l’obstination avec laquelle je veux fixer ce temps intemporel “ page 213 .
“ Résister consiste à continuer à être “ Comme dans l'avant-propos de “ L'espèce humaine “ de “ Robert Antelme “ .
Elle reste tout le temps lucide car il faut survivre à tout prix : dans un 1 er temps se protéger des bombes qui pleuvent régulièrement sur son immeuble puis trouver à manger chaque jour et enfin essayer d’échapper aux russes qui cherchent des femmes .
Ce témoignage important et poignant nous emporte et nous vivons Berlin au jour le jour avec l’ auteure , accompagnés de la peur et de la faim omniprésentes .Nous souffrons avec elle .
Ce journal se rapproche d' autres récits d’ hommes et de femmes plongés dans l’enfer de la guerre ou dans l’horreur des camps d’extermination, “ Zalmen Gradowski “ “ Au cœur de l’ enfer “ par exemple .
Bien sûr ici on est du côté de l’oppresseur dans cette guerre mais on s’aperçoit que la souffrance est la même pour tous les civils, dés que le conflit est à leur porte .
La guerre est la pire des choses pour l’ humanité !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Se battre comme une femme
PrettyYoungCat
100 livres

Berlin
bookworm23
37 livres
Auteurs proches de Marta Hillers
Quiz
Voir plus
Le seigneur des Anneaux
Quel est le métier de Sam ?
cuisinier
ébéniste
jardinier
tavernier
15 questions
5596 lecteurs ont répondu
Thème : Le Seigneur des anneaux de
J.R.R. TolkienCréer un quiz sur cet auteur5596 lecteurs ont répondu