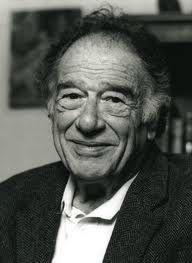Citations de Philippe Beaussant (73)
que faut-il à un roi de gloire et qui se veut soleil, sinon d'abord une reine qui puisse briller autant que lui et que peut-on répondre, si ce n'est que Louis XIV ne l'a pas eu .
sa relation avec les femmes, toutes celles qui vont se succéder et même coexister au long de sa vie, et de son règne, est incompréhensible si l'on n'a pas senti d'abord seulement que, cette présence en creux, cette présence absence d'une reine qui n'a su ni par son physique, ni par son intelligence, ni, pas qu'on dise, par sa bonté, ni par son goût, ni par son sens artistique, ni même parfois, on vient de le voir, par sa simple présence, remplir son rôle. Elle a eu 6 enfants. Un seul survécut. cela suffit pour faire un dauphin mais est ce à cela que se limite le rôle d'une reine de France! comment allier un roi soleil et une potiche? on n'a pas tout dit quand on explique les amours du roi par son tempérament par son appétit par sa boulimie par son égocentrisme. Le choix des femmes qu'i l a désirées est clair par lui-même. durant toute sa vie, et durant tout ce temps de règne, il s'est cherché une reine de substitution.
sa relation avec les femmes, toutes celles qui vont se succéder et même coexister au long de sa vie, et de son règne, est incompréhensible si l'on n'a pas senti d'abord seulement que, cette présence en creux, cette présence absence d'une reine qui n'a su ni par son physique, ni par son intelligence, ni, pas qu'on dise, par sa bonté, ni par son goût, ni par son sens artistique, ni même parfois, on vient de le voir, par sa simple présence, remplir son rôle. Elle a eu 6 enfants. Un seul survécut. cela suffit pour faire un dauphin mais est ce à cela que se limite le rôle d'une reine de France! comment allier un roi soleil et une potiche? on n'a pas tout dit quand on explique les amours du roi par son tempérament par son appétit par sa boulimie par son égocentrisme. Le choix des femmes qu'i l a désirées est clair par lui-même. durant toute sa vie, et durant tout ce temps de règne, il s'est cherché une reine de substitution.
mais de plus en plus on verra le roi dans les grandes compositions héroïques ou mythologiques Renaud, Alexandre, Cyrus, puis Jupiter, Neptune, le soleil, ou son double, Apollon. l'évolution est donc parfaitement claire et parle d'elle-même. dans ce ballet où il danse, dans le spectacle dont il est le centre, Louis XIV s'identifie progressivement à une représentation chorégraphique de sa propre Majesté. Et s'il jouait quand il dansait un filou ivre ou un gitan ,quand il danse Apollon, il est lui-même et c'est lui-même qu'il expose au regard de l'assistance.(...) sa danse est alors une sorte de métaphore chorégraphique de son personnage solaire.
citation de Primo Visconti, ambassadeur :" me trouvant dans sa chambre avec d'autres courtisans, j'ai remarqué plusieurs fois que, si la porte vient par hasard à être ouverte, ou s'il sort, il compose aussitôt son attitude et prend une autre expression de figure, comme s'il devait paraître sur un théâtre; en somme il s'est bien faire le roi en tout."
J’ai acquis en vous écoutant la religion du bleu Chardin. Je buvais vos paroles. « Une parole, Pierre, comme n’importe quelle œuvre d’art, n’existe qu’à la mesure de celui qui l’écoute. Il y a autant de Cinquième Symphonie que d’auditeurs. Elle peut être grandiose ou ridiculement étriquée : Beethoven n’y peut rien. Le plus grand orateur du monde n’a jamais prononcé que les mots que la plus sotte des dévotes au pied de la chaire a pu comprendre. Le reste, c’est du vent. » Est-ce à moi que ces mots s’adressaient ? Qu’est-ce que je comprenais, quand vous parliez ? Vous me parliez de La Pourvoyeuse : oui, je voyais bien son tablier bleu. Et la robe bleue de La Jeune Maîtresse d’école devant laquelle vous m’avez tenu en haleine si longtemps, cet après-midi d’hiver triste où nous grelottions à la National Gallery. Vous étiez lyrique. Mais de quoi ? Lyrique du bleu Chardin ? C’est ce que je croyais. Vous me racontiez le dialogue du bleu et du brun profond. « Comment est-ce possible ? », disiez-vous. « Et ce blanc, qui n’est pas du blanc, mais l’apparition, la révélation (et dans votre élan lyrique, vous disiez en grec « l’épiphanie ») de toutes les couleurs secrètes qui, ailleurs, sont saturées d’elles-mêmes. Dieu a inventé le blanc, et Chardin est son prophète. »
— Vous rendez-vous compte, Pierre, de ce qu’était Florence cette année-là ?
Quelques secondes de silence, quelques volutes de fumée, quelques vagues sur le canal et c’était comme si on s’embarquait sur une gondole.
— Botticelli avait vingt-cinq ans. Ghirlandaio en avait vingt. Filippino Lippi en avait dix-neuf. Léonard de Vinci, dix-huit : et leur maître à tous, Laurent de Médicis, en avait vingt aussi. Quelle jeunesse ! Laurent parlait philosophie avec Marsile Ficin et composait des sonnets pour la belle Lucrezia Donati, qui en avait… combien ? Vingt-deux ou vingt-trois. Le monde était tout jeune, Pierre. Ou plutôt, je crois qu’à Florence, il s’était mis à rajeunir. Il y a des moments de l’Histoire où tout le monde est jeune, et d’autres qui ne sont peuplés que de vieillards, et où les événements se mettent à bégayer et à radoter. À Florence, cette année-là, une jeune femme débarque au milieu de la jeunesse du monde, et voilà que tout Florence tombe amoureux d’elle. Tout le monde : Laurent, Julien son frère, toute la cour, les pauvres gens dans les rues, les boutiquiers, les vieillards, les musiciens, les peintres, les moines dans leurs couvents, tout le monde. Elle avait seize ans et le monde se mettait à tout faire pour lui ressembler. Ne trouvez-vous pas cela étonnant, Pierre ? Une jeune fille de seize ans qui, sans rien faire d’autre que d’être ce qu’elle est, belle, aimable, douce, oui, cela absolument, gracieuse, savante, façonne une ville, ordonne la vie des gens, conduit la pensée des peintres et des poètes : simplement par ce qu’elle est. Et vous voyez, Pierre, ce qui est le plus étonnant, ce n’est pas elle, c’est justement ce qui naît.
Quelques secondes de silence, quelques volutes de fumée, quelques vagues sur le canal et c’était comme si on s’embarquait sur une gondole.
— Botticelli avait vingt-cinq ans. Ghirlandaio en avait vingt. Filippino Lippi en avait dix-neuf. Léonard de Vinci, dix-huit : et leur maître à tous, Laurent de Médicis, en avait vingt aussi. Quelle jeunesse ! Laurent parlait philosophie avec Marsile Ficin et composait des sonnets pour la belle Lucrezia Donati, qui en avait… combien ? Vingt-deux ou vingt-trois. Le monde était tout jeune, Pierre. Ou plutôt, je crois qu’à Florence, il s’était mis à rajeunir. Il y a des moments de l’Histoire où tout le monde est jeune, et d’autres qui ne sont peuplés que de vieillards, et où les événements se mettent à bégayer et à radoter. À Florence, cette année-là, une jeune femme débarque au milieu de la jeunesse du monde, et voilà que tout Florence tombe amoureux d’elle. Tout le monde : Laurent, Julien son frère, toute la cour, les pauvres gens dans les rues, les boutiquiers, les vieillards, les musiciens, les peintres, les moines dans leurs couvents, tout le monde. Elle avait seize ans et le monde se mettait à tout faire pour lui ressembler. Ne trouvez-vous pas cela étonnant, Pierre ? Une jeune fille de seize ans qui, sans rien faire d’autre que d’être ce qu’elle est, belle, aimable, douce, oui, cela absolument, gracieuse, savante, façonne une ville, ordonne la vie des gens, conduit la pensée des peintres et des poètes : simplement par ce qu’elle est. Et vous voyez, Pierre, ce qui est le plus étonnant, ce n’est pas elle, c’est justement ce qui naît.
Comment faire pour regarder, pour écouter les œuvres du passé avec à la fois cette vue perspective que nous donne la connaissance de l’évolution des choses et avec la candeur de ceux qui découvraient une nouveauté dont auparavant ils n’avaient pas même l’idée, et dont ils ne savaient pas où elle les mènerait?
Nous nous permettons même de les nommer. Nous appelons ceci «Renaissance», cela «Baroque». On classe, on catalogue, on étiquette, on range
Ce que nous appelons, avec généralement un léger mouvement de vanité involontaire, « le recul des siècles», nous l’imaginons comme une sorte de longue-vue ou de télescope géant, capable de distinguer tous les détails d’un lointain passé, d’en discerner les mouvements et les révolutions, de les dessiner comme des constellations et d’en éliminer les trous noirs. Nous sommes convaincus que cette « distance » nous permet de comprendre les mouvements de la pensée et de l’art, mieux que ceux qui en étaient les acteurs.
Il y a des princes secrets. Rien ne filtre de ce qu’ils savent ou de ce qu’ils veulent. Chez certains, peut-être chez tous, c’est la marque d’une secrète faiblesse, d’une timidité, d’une crainte. Ainsi fut Napoléon III. C’est probablement chez tous la marque, et le résultat, d’une grande souffrance.
Le véritable esprit consiste à en faire venir aux autres. Faire un jeu sur les mots ou une pointe légère, cela n'est pas grand-chose. Mais créer le climat qui va mettre l'autre en situation d'en faire lui-même, c'est cela le grand art du jeu de l'esprit.
4/RM : Croyez-vous que la musique baroque peut encore donner du rêve à la jeunesse ?
PB : Peut être pas toute la jeunesse, car il faudrait pour cela que leurs oreilles soient mieux formées. Malheureusement, on déforme les oreilles des jeunes avec des bruits infâmes. Je n’ai rien contre la musique rock, pop, sauf qu’elle fait trop de bruit. A cette réserve près, je pense que la musique baroque n’a pas fini de faire parler d’elle.
* Signalons au passage que M. Bulteau est le Délégué général des Rencontres en Pays de Bray du magnifique projet de la création en milieu rural du développement de l’enseignement musical.
Le 4 janvier 2008 par Monique Parmentier / Res Musica
PB : Peut être pas toute la jeunesse, car il faudrait pour cela que leurs oreilles soient mieux formées. Malheureusement, on déforme les oreilles des jeunes avec des bruits infâmes. Je n’ai rien contre la musique rock, pop, sauf qu’elle fait trop de bruit. A cette réserve près, je pense que la musique baroque n’a pas fini de faire parler d’elle.
* Signalons au passage que M. Bulteau est le Délégué général des Rencontres en Pays de Bray du magnifique projet de la création en milieu rural du développement de l’enseignement musical.
Le 4 janvier 2008 par Monique Parmentier / Res Musica
3/RM : A Versailles c’est d’abord le lieu de fêtes qui semble vous fasciner. Pensez – vous à ce premier parc, le parc baroque qui a malheureusement disparu lorsque vous vous promenez dans les allées du parc ?
PB : Le parc baroque est progressivement restitué, on s’y emploie. Oui, quand on se promène dans ce parc, on pense forcément à cette période du parc, de même que l’on pense forcément à Marie-Antoinette lorsqu’on se promène à Trianon. Oui, j’aimerais tellement par exemple pouvoir entendre l’orgue d’eau de la Grotte de Thétis.
RM : Vous avez créé le CMBV il y a 20 ans, avec beaucoup d’enthousiasme, aujourd’hui ses actions contribuent à faire connaître et entendre la musique baroque française, que peut faire aujourd’hui le Cmbv pour l’avenir de la musique baroque ?
PB : Soulignons qu’il fait admirablement son travail. Il est sûr qu’avec plus de moyens, il pourrait en faire plus, oui c’est clair. Il a trois missions essentielles : faire de la recherche et de la publication, il le fait admirablement. L’atelier de recherche du centre est unique au monde dans son genre. Par ailleurs, il a un rôle essentiel de formation. La meilleure preuve de la réussite de cette mission est de voir aujourd’hui à quel point des enfants formés de 10 à 15 ans au centre depuis 20 ans, ont rayonné à travers tout le pays. Il est époustouflant de voir des chefs de chœur, des animateurs musicaux, des chanteurs, etc… issus de Versailles partout dans le pays, comme par exemple François Bulteau qui est dans le Pays de Bray, qui est un vieil ami et qui a été administrateur du Centre de Musique Baroque et s’est occupé du Théâtre baroque de France *. Enfin, le Cmbv organise une saison musicale.
PB : Le parc baroque est progressivement restitué, on s’y emploie. Oui, quand on se promène dans ce parc, on pense forcément à cette période du parc, de même que l’on pense forcément à Marie-Antoinette lorsqu’on se promène à Trianon. Oui, j’aimerais tellement par exemple pouvoir entendre l’orgue d’eau de la Grotte de Thétis.
RM : Vous avez créé le CMBV il y a 20 ans, avec beaucoup d’enthousiasme, aujourd’hui ses actions contribuent à faire connaître et entendre la musique baroque française, que peut faire aujourd’hui le Cmbv pour l’avenir de la musique baroque ?
PB : Soulignons qu’il fait admirablement son travail. Il est sûr qu’avec plus de moyens, il pourrait en faire plus, oui c’est clair. Il a trois missions essentielles : faire de la recherche et de la publication, il le fait admirablement. L’atelier de recherche du centre est unique au monde dans son genre. Par ailleurs, il a un rôle essentiel de formation. La meilleure preuve de la réussite de cette mission est de voir aujourd’hui à quel point des enfants formés de 10 à 15 ans au centre depuis 20 ans, ont rayonné à travers tout le pays. Il est époustouflant de voir des chefs de chœur, des animateurs musicaux, des chanteurs, etc… issus de Versailles partout dans le pays, comme par exemple François Bulteau qui est dans le Pays de Bray, qui est un vieil ami et qui a été administrateur du Centre de Musique Baroque et s’est occupé du Théâtre baroque de France *. Enfin, le Cmbv organise une saison musicale.
2/RM : En 2006, vous avez publié un livre la Malscène, comme un cri de colère face à des productions qui dénaturaient les œuvres que nous aimions. Cet hiver deux productions avec le même metteur en scène, Benjamin Lazar, Il Sant’Alessio sous la direction artistique de William Christie et Cadmus et Hermione sous la direction artistique de Vincent Dumestre, vous redonnent-elles l’espoir d’un renouveau ?
PB : Philippe Lénaël, il y a 20 ans, avait tenté la même expérience que Benjamin Lazar, mais à l’époque il n’y avait pas le public pour cela. Aujourd’hui, sur la plupart des grandes scènes nationales, le public siffle le metteur en scène. Il se montre exigeant, il est demandeur. Mais cela dépendra surtout des directeurs de théâtre. Mon expérience du Théâtre baroque de France a été un échec, contrairement au Cmbv dans la mesure où il était totalement à contre-courant. Jamais un représentant du Ministère de la Culture de ces années là ne s’y est intéréssé. Un certain nombre de spectacles à venir semble nous annoncer une éclaircie, mais sera-t-elle durable, les directeurs de théâtre entendront-ils les attentes des spectateurs ? Il est certain en tout cas que le public baroque est là et de plus en plus large.
RM : Vous avez connu et accompagné la première renaissance du baroque ? La génération actuelle c’est un peu vos enfants ?
PB : « Mes petits-enfants » vous voulez dire. J’ai eu la chance de connaître toutes les générations qui ont fait le renouveau baroque. Celui qui m’a le plus marqué, c’est bien sûr Jean- Claude Malgoire. Un jour, j’entre durant une répétition d’Alceste dans l’Eglise de Saint-Maximin. Cela a été le choc de ma vie. Et j’insiste, cette rencontre avec Lully et Malgoire a vraiment été le choc de ma vie. Cela dit tous les « anciens » méritent d’être cités : de Jordi Savall à Herreweghe de Leonhardt à Christie en passant par Jacobs et Minkowski.
La génération actuelle est inventive. Elle a retrouvé quelque chose de spécifique au baroque, sa diversité, sa vivacité. Elle ne s’arrête pas aux grands noms du baroque et souhaite redécouvrir tous les baroques.
RM : Quels territoires baroques restent-ils à explorer selon vous ?
PB : Plein. On n’a pas entendu tout Lully. Je m’étonne et m’émerveille aussi de cette Europe Baroque. Schutz fait le voyage de Venise pour entendre Monteverdi et suivre son enseignement. En retour, il transpose dans son austère pensée luthérienne ce que l’Italie catholique plus expansive lui avait appris. Et puis, il y a Telemann qui a écrit plus d’ouvertures à la française que tous les compositeurs français de son époque.
Il y a également l’influence du baroque espagnol via l’Italie.
RM : L’ingrédient secret qui rend vos livres si fluides à la lecture ?
PB : Je n’écris que sur des choses que j’aime. Je suis un vieux prof. Une de mes anciennes élèves (de 4e /3e, vous voyez cela ne date pas d’hier), m’a dit un jour qu’à l’époque où j’étais son professeur, elle sentait la différence entre les cours où je parlais de ce que j’aimais et ceux où je m’ennuyais. Je parle et j’écris ce que j’aime et j’aime ce que j’écris.
RM : Qu’est-ce qui vous a intéressé dans l’Orfeo de Monteverdi ?
PB : Il est celui que je ressens en ce moment, celui dont je me sens le plus proche
RM : Vous avez beaucoup écrit sur Louis XIV et lors du colloque sur le Prince et la Musique, à Versailles cet automne, je vous ai senti presque déçu, lorsque les orateurs disaient que le goût du Roi, ne révélait en rien sa personnalité ? Pourquoi ce roi ? Quel secret cache-t-il ?
PB : Je vais essayer de résumer cela en quelques mots. Il faut souligner tout d’abord qu’il ne s’est guère trompé, contrairement à ce qu’on peut croire, dans ses choix. Je prends un ou deux exemples. Tout le monde adorait Thomas Corneille et Philippe Quinault mais Louis préférait Pierre Corneille et Racine. Ce n’est pas une erreur et il en est de même dans beaucoup d’autres domaines. Que ce soit son goût personnel ou lorsqu’il agit en position de chef d’état, qui a de bons conseillers, ce qui somme toute est parfaitement normal pour un chef d’état, il y a certainement un lien entre son goût personnel et l’influence de ses conseillers. Par ailleurs, il accompagne malgré tout l’évolution du goût de son temps. Ce qui a l’air contradictoire avec ce que je viens de dire, mais en fait ne l’est qu’à moitié. Les arts, tous les arts évoluent, changent. Quant on est un personnage qui règne jusqu’à l’âge de 75 ans, il est normal que l’on bouge. Ce que je veux dire par là, c’est que le jeune Louis XIV de 20 ans qui danse des ballets de cour est exactement dans le goût de ses contemporains, de son temps. Il n’a pas beaucoup pratiqué les arts à quelques détails prêts : la guitare et la danse. Mais, tout laisse supposer qu’il a été un virtuose de la danse et lorsqu’en 1670, il arrête de danser, il a 35 ans, l’âge de la retraite dans ce « métier » là. Il aime le ballet de cour quand il a 20 ans, il aime l’opéra quand il en a 35/40, il aime la tragédie et plus tard il va aimer François Couperin (c’est ce dernier qui l’écrit dans une préface), qui jouera le dimanche dans la chambre du Roi. Louis XIV accompagne l’évolution de l’art de son temps.
Enfin, il faut souligner qu’en ce qui concerne la danse et ce que l’on sait de sa manière de jouer de la guitare, il était bon. Louis XIV artiste, je le crois profondément. Trouvez-moi une grave erreur dans ce qu’il a fait dans ses choix, concernant les arts de son temps. Construire Versailles, était-ce une erreur ? Rire avec Molière puis se passionner pour Racine (et Esther), était-ce une erreur ? A mon avis, non !
Il y a bien une ombre au soleil, il faut bien qu’il y en ait une que je subodore sans pouvoir aller jusqu’au bout, j’en parle au début de Louis XIV, artiste. Il est curieux de voir que Molière que Louis XIV a adoré et soutenu profondément, y compris dans l’épisode de Tartuffe ce qui n’était pas évident … On a l’impression que dans sa dernière année, il l’a complètement délaissé. Louis XIV ne lui fait aucune commande en 73, le Malade Imaginaire ne sera pas représenté à Versailles du vivant de Molière. Il me semble que Molière meurt assez désespéré de cette sorte d’abandon et ce sera exactement la même chose avec Lully. Et le plus étrange, c’est que celle que l’on a accusé d’être parfois responsable de l’abandon de la fête à Versailles, Mme de Maintenon, ramènera Louis XIV à son goût pour la tragédie, chrétienne certes, avec Esther de Racine.
PB : Philippe Lénaël, il y a 20 ans, avait tenté la même expérience que Benjamin Lazar, mais à l’époque il n’y avait pas le public pour cela. Aujourd’hui, sur la plupart des grandes scènes nationales, le public siffle le metteur en scène. Il se montre exigeant, il est demandeur. Mais cela dépendra surtout des directeurs de théâtre. Mon expérience du Théâtre baroque de France a été un échec, contrairement au Cmbv dans la mesure où il était totalement à contre-courant. Jamais un représentant du Ministère de la Culture de ces années là ne s’y est intéréssé. Un certain nombre de spectacles à venir semble nous annoncer une éclaircie, mais sera-t-elle durable, les directeurs de théâtre entendront-ils les attentes des spectateurs ? Il est certain en tout cas que le public baroque est là et de plus en plus large.
RM : Vous avez connu et accompagné la première renaissance du baroque ? La génération actuelle c’est un peu vos enfants ?
PB : « Mes petits-enfants » vous voulez dire. J’ai eu la chance de connaître toutes les générations qui ont fait le renouveau baroque. Celui qui m’a le plus marqué, c’est bien sûr Jean- Claude Malgoire. Un jour, j’entre durant une répétition d’Alceste dans l’Eglise de Saint-Maximin. Cela a été le choc de ma vie. Et j’insiste, cette rencontre avec Lully et Malgoire a vraiment été le choc de ma vie. Cela dit tous les « anciens » méritent d’être cités : de Jordi Savall à Herreweghe de Leonhardt à Christie en passant par Jacobs et Minkowski.
La génération actuelle est inventive. Elle a retrouvé quelque chose de spécifique au baroque, sa diversité, sa vivacité. Elle ne s’arrête pas aux grands noms du baroque et souhaite redécouvrir tous les baroques.
RM : Quels territoires baroques restent-ils à explorer selon vous ?
PB : Plein. On n’a pas entendu tout Lully. Je m’étonne et m’émerveille aussi de cette Europe Baroque. Schutz fait le voyage de Venise pour entendre Monteverdi et suivre son enseignement. En retour, il transpose dans son austère pensée luthérienne ce que l’Italie catholique plus expansive lui avait appris. Et puis, il y a Telemann qui a écrit plus d’ouvertures à la française que tous les compositeurs français de son époque.
Il y a également l’influence du baroque espagnol via l’Italie.
RM : L’ingrédient secret qui rend vos livres si fluides à la lecture ?
PB : Je n’écris que sur des choses que j’aime. Je suis un vieux prof. Une de mes anciennes élèves (de 4e /3e, vous voyez cela ne date pas d’hier), m’a dit un jour qu’à l’époque où j’étais son professeur, elle sentait la différence entre les cours où je parlais de ce que j’aimais et ceux où je m’ennuyais. Je parle et j’écris ce que j’aime et j’aime ce que j’écris.
RM : Qu’est-ce qui vous a intéressé dans l’Orfeo de Monteverdi ?
PB : Il est celui que je ressens en ce moment, celui dont je me sens le plus proche
RM : Vous avez beaucoup écrit sur Louis XIV et lors du colloque sur le Prince et la Musique, à Versailles cet automne, je vous ai senti presque déçu, lorsque les orateurs disaient que le goût du Roi, ne révélait en rien sa personnalité ? Pourquoi ce roi ? Quel secret cache-t-il ?
PB : Je vais essayer de résumer cela en quelques mots. Il faut souligner tout d’abord qu’il ne s’est guère trompé, contrairement à ce qu’on peut croire, dans ses choix. Je prends un ou deux exemples. Tout le monde adorait Thomas Corneille et Philippe Quinault mais Louis préférait Pierre Corneille et Racine. Ce n’est pas une erreur et il en est de même dans beaucoup d’autres domaines. Que ce soit son goût personnel ou lorsqu’il agit en position de chef d’état, qui a de bons conseillers, ce qui somme toute est parfaitement normal pour un chef d’état, il y a certainement un lien entre son goût personnel et l’influence de ses conseillers. Par ailleurs, il accompagne malgré tout l’évolution du goût de son temps. Ce qui a l’air contradictoire avec ce que je viens de dire, mais en fait ne l’est qu’à moitié. Les arts, tous les arts évoluent, changent. Quant on est un personnage qui règne jusqu’à l’âge de 75 ans, il est normal que l’on bouge. Ce que je veux dire par là, c’est que le jeune Louis XIV de 20 ans qui danse des ballets de cour est exactement dans le goût de ses contemporains, de son temps. Il n’a pas beaucoup pratiqué les arts à quelques détails prêts : la guitare et la danse. Mais, tout laisse supposer qu’il a été un virtuose de la danse et lorsqu’en 1670, il arrête de danser, il a 35 ans, l’âge de la retraite dans ce « métier » là. Il aime le ballet de cour quand il a 20 ans, il aime l’opéra quand il en a 35/40, il aime la tragédie et plus tard il va aimer François Couperin (c’est ce dernier qui l’écrit dans une préface), qui jouera le dimanche dans la chambre du Roi. Louis XIV accompagne l’évolution de l’art de son temps.
Enfin, il faut souligner qu’en ce qui concerne la danse et ce que l’on sait de sa manière de jouer de la guitare, il était bon. Louis XIV artiste, je le crois profondément. Trouvez-moi une grave erreur dans ce qu’il a fait dans ses choix, concernant les arts de son temps. Construire Versailles, était-ce une erreur ? Rire avec Molière puis se passionner pour Racine (et Esther), était-ce une erreur ? A mon avis, non !
Il y a bien une ombre au soleil, il faut bien qu’il y en ait une que je subodore sans pouvoir aller jusqu’au bout, j’en parle au début de Louis XIV, artiste. Il est curieux de voir que Molière que Louis XIV a adoré et soutenu profondément, y compris dans l’épisode de Tartuffe ce qui n’était pas évident … On a l’impression que dans sa dernière année, il l’a complètement délaissé. Louis XIV ne lui fait aucune commande en 73, le Malade Imaginaire ne sera pas représenté à Versailles du vivant de Molière. Il me semble que Molière meurt assez désespéré de cette sorte d’abandon et ce sera exactement la même chose avec Lully. Et le plus étrange, c’est que celle que l’on a accusé d’être parfois responsable de l’abandon de la fête à Versailles, Mme de Maintenon, ramènera Louis XIV à son goût pour la tragédie, chrétienne certes, avec Esther de Racine.
1/ Philippe Beaussant vient d’être élu à l’Académie Française, à 77 ans. Ecrivain et musicologue enthousiaste, il a su dans l’ensemble de ses œuvres nous révéler la jeunesse et la genèse de la musique et de l’art baroque.
De ses essais consacrés à la musique baroque (Lully ou le musicien du soleil ; Vous avez dit Baroque ? ; Le chant d’Orphée selon Monteverdi…), à ses biographies consacrées à certains des grands compositeurs baroques (Lully, Couperin, mais également Monteverdi), à ses romans (Louis XIV artiste ; Le Roi Soleil se lève aussi, …) et enfin à ses guides (Mangez baroque et restez mince …) il nous a offert depuis son entrée en musique et littérature toutes les gourmandises, les saveurs, les parfums, les sonorités d’un monde qui nous parle aujourd’hui plus que jamais de valeurs humaines et humanistes et qui savent nous atteindre, au plus profond de nos cœurs.
« Je ne me fais pas encore à l’idée. »
ResMusica : Philippe Beaussant, vous venez d’être élu à l’Académie Française, comment recevez vous cette reconnaissance de votre œuvre ? La musique baroque trouvera t-elle sa place à l’Académie Française ?
Philippe Beaussant : C’est très impressionnant. Je ne me fais pas encore à l’idée, mais je suis submergé par les lettres et les réponses à faire. Sur l’un des courriers que j’ai reçu, j’ai trouvé un post-it « Félicitations M. Beaussant ». Ce petit mot était de mon facteur et m’a beaucoup touché. L’épée je n’y ai pas encore songé, mais cela va venir.
Je commence toutefois à comprendre. Mon éditeur à qui j’annonçais un nouveau roman m’a dit que ce ne serait pas pour tout de suite. Oui, je compte bien faire en sorte que la musique baroque trouve sa place à l’Académie.
RM : JF Deniau, au fauteuil duquel vous succédez aimait les voyages et écrivit : « qu’il suffit de rencontrer sa voix » pour décider d’une vie, quand avez – vous rencontrer votre voix/voie ?
PB : Ma voix cela fait plus de 30 ans que je l’entends à la radio ! Ma voie, probablement tout au long de ma vie. J’ai eu une vie avec tellement de voies. J’ai été professeur de Lettres classiques en Suisse à l’Institut International, et puis j’en ai eu assez et je suis parti à Adélaïde en Australie exercer ce métier. Puis je suis revenu en France où j’ai d’abord été chargé de la culture des jeunes ouvriers de l’Arsenal de Toulon, j’ai dirigé l’équipe pédagogique d’une entreprise d’Ingenierie, la SODETEG, puis j’ai créé l’Institut de danse et musique ancienne, puis le Centre de musique baroque de Versailles (Cmbv) et enfin le Théâtre baroque de France.
RM : D’où vous est venu ce goût pour la musique et Versailles?
PB : Ma mère me jouait du Bach et mon arrière grand-père habitait Versailles.
De ses essais consacrés à la musique baroque (Lully ou le musicien du soleil ; Vous avez dit Baroque ? ; Le chant d’Orphée selon Monteverdi…), à ses biographies consacrées à certains des grands compositeurs baroques (Lully, Couperin, mais également Monteverdi), à ses romans (Louis XIV artiste ; Le Roi Soleil se lève aussi, …) et enfin à ses guides (Mangez baroque et restez mince …) il nous a offert depuis son entrée en musique et littérature toutes les gourmandises, les saveurs, les parfums, les sonorités d’un monde qui nous parle aujourd’hui plus que jamais de valeurs humaines et humanistes et qui savent nous atteindre, au plus profond de nos cœurs.
« Je ne me fais pas encore à l’idée. »
ResMusica : Philippe Beaussant, vous venez d’être élu à l’Académie Française, comment recevez vous cette reconnaissance de votre œuvre ? La musique baroque trouvera t-elle sa place à l’Académie Française ?
Philippe Beaussant : C’est très impressionnant. Je ne me fais pas encore à l’idée, mais je suis submergé par les lettres et les réponses à faire. Sur l’un des courriers que j’ai reçu, j’ai trouvé un post-it « Félicitations M. Beaussant ». Ce petit mot était de mon facteur et m’a beaucoup touché. L’épée je n’y ai pas encore songé, mais cela va venir.
Je commence toutefois à comprendre. Mon éditeur à qui j’annonçais un nouveau roman m’a dit que ce ne serait pas pour tout de suite. Oui, je compte bien faire en sorte que la musique baroque trouve sa place à l’Académie.
RM : JF Deniau, au fauteuil duquel vous succédez aimait les voyages et écrivit : « qu’il suffit de rencontrer sa voix » pour décider d’une vie, quand avez – vous rencontrer votre voix/voie ?
PB : Ma voix cela fait plus de 30 ans que je l’entends à la radio ! Ma voie, probablement tout au long de ma vie. J’ai eu une vie avec tellement de voies. J’ai été professeur de Lettres classiques en Suisse à l’Institut International, et puis j’en ai eu assez et je suis parti à Adélaïde en Australie exercer ce métier. Puis je suis revenu en France où j’ai d’abord été chargé de la culture des jeunes ouvriers de l’Arsenal de Toulon, j’ai dirigé l’équipe pédagogique d’une entreprise d’Ingenierie, la SODETEG, puis j’ai créé l’Institut de danse et musique ancienne, puis le Centre de musique baroque de Versailles (Cmbv) et enfin le Théâtre baroque de France.
RM : D’où vous est venu ce goût pour la musique et Versailles?
PB : Ma mère me jouait du Bach et mon arrière grand-père habitait Versailles.
"Tout à l'heure, mon petit, quand tu sortiras, tu regarderas le tableau de Giambattista Vanni [...]. J'ai connu aussi la femme qui lui a servi de modèle. Elle était bonne et douce, mais très sotte. [...] Je te montrerai aussi le dessin qu'il a fait pour préparer ce tableau [...]. Comme il ne pouvait pas la rendre vive et éveillée, il s'est servi de sa sottise pour augmenter sa douceur et sa bonté. Ainsi, il n'a pas fait le portrait d'une femme, mais d'une âme, rêveuse et tendre. Tu verras. Tu verras. Le dessin d'abords, puis le tableau. On passe de l'un à l'autre, on quitte la femme, on entre dans l'âme. [...] C'est le miracle de l'art. [...] Que crois-tu donc que nous soyons, nous autres chanteurs, [...] ? Nous sommes de pauvres gens à qui dieu a donné le privilège [...] de prendre toute chose et de la transformer en beauté."
Pouvez-vous imaginer quel déchirement il y a de passer du sorcier khmer au danseur arabe ? Ils s'excluent l'un l'autre. Ils sont nés de mondes qui s'ignoraient, où les questions n'étaient pas les mêmes, dont les mystères étaient inconciliables. Et moi, je m'exténuais à les réunir, à tenter de communier avec l'un, puis avec l'autre, remontés l'un et l'autre de la nuit des temps et de l'obscurité de l'oubli. Mais on ne peut pas. On ne peut pas, Docteur. On s'efforce. On veut se remplir d'un autre et l'on se vide de soi-même.
Voyez-vous cela ? Un monde qui ne cesse d'inventer, de raffiner, de perfectionner, de compliquer, de créer, de fabriquer, et qui, de ce fait même, peu à peu dépouille les hommes de leur identité. Un monde qui se renouvelle sans cesse, et qui, de fait même, leur interdit de se regarder dans l'avenir sans diminuer en eux-mêmes l'image qui leur est nécessaire pour se faire hommes, et qui à mesure qu'il leur donne des objets pour mieux vivre, les plonge dans un désespoir dont ils ne savent d'où il vient.
Est-ce que l'amour est capable de vous rendre ainsi sensible à quelque chose à quoi l'on n'aurait pas pensé, dont on n'aurait pas cru devoir être ému? Ou bien, lorsqu'on tombe amoureux, est-ce nécessairement de la personne dont on ignorait qu'elle allait mettre en mouvement ce fond secret qu'on portait en soi sans le savoir? Devine-t-on de qui on doit tomber amoureux parce que c'est celui-là, celle-là, qui va vous faire être ce que vous vouliez être?
Une grande œuvre d'art, je veux parler de celles qui ne mourront jamais, celles qui sont pour toujours le petit trésor que l'homme aura donné du monde, une grande œuvre d'art est celle qui présente sous sa forme la plus belle, la plus juste image du temps où elle est née.
Je n'aime pas m'endormir sans avoir terminé mon chapitre. C'est une impolitesse envers l'auteur qui s'est donné du mal pou conclure.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Philippe Beaussant
Quiz
Voir plus
Sur la piste des homonymes
pioche et veste
brouette
manche
poche
truelle
13 questions
278 lecteurs ont répondu
Thèmes :
lexique
, homonymeCréer un quiz sur cet auteur278 lecteurs ont répondu