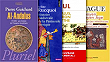Les religions sont à l'origine des conflits ? Mènent-elles à la violence, ou bien pacifient-elles les rapports humains ? Font-elles plus de bien que de mal ?
Ce débat oppose Pierre Conesa agrégé d'histoire, ancien administrateur civil au ministère de la Défense, auteur de nombreux essais sur les fondamentalismes religieux, et Rémi Brague philosophe et historien de la philosophie, membre de l'Institut de France.
Les toiles qui servent de décor à cet échange font partie de l'exposition Stat Crux du peintre François-Xavier de Boissoudy.
Chapitrage
0:00 : Introduction
1:56 : Les radicalismes religieux
11:50 : La violence dans les textes sacrés
27:17 : Articulation du politique et du religieux
40:50 : Idéologie VS radicalisation
57:52 : Religions, vecteurs de pacification
+ Lire la suite

Nous avons l'habitude de dire que l'Europe doit à Athènes pour la philosophie grecque et à Jérusalem pour le christianisme et rien à ces frustes romains qui n'ont fait que transmettre : le christanisme, la cultue hellénique, mais encore l'architecture (étrusque), le droit (moyen-Orient), etc. Faux répond Rémi Brague, les romains ont transmis deux choses essentielles qui ont excité l'esprit européen sans lesquelles ils ne serait pas ce qu'il est : le sentiment d'infériorité (ils avaient conscience de la supériorité de la culture et de la langue grecque) et celui de devoir apporter ces connaissances aux autres populations. Comme les romains, les européens ont hérité d'un savoir qu'ils n'ont pas produit et qui les a rendus humbles, mais désireux de s'élever à la hateur du prestige grec. En somme, de devenir des grecs. Cette impulsion les a incités à conserver les textes anciens, pour les admirer, mais surtout pour les redécouvrir. De là les nombreuses Renaissances (carolingiennes, xii-xiiième siècle, humaniste, des Lumières, etc). Le drame, c'est que les européens ont fini par devenir des grecs... En créant leur propre science et leur propre culture, mais surtout en la tenant pour supérieure et comme leur appartenant en propre, ils ont éliminé à la fois le sentiment d'infériorité et la volonté de communiquer le savoir qu'ils jugeaient prestigieux... Comme pour les grecs, et au contraire des romains, les européens considèrent que leur civilisation leur appartient et la défendent bec et ongles, pour eux-mêmes... Le risque ? Le repli, l'atrophie. On sait ce qui est arrivé aux grecs. La raison de ce changement ? Peut-être l'abandon des humanités qui ne permet plus la prise de distance par rapport au monde quotidien. Les méthodes pour changer ? Un peu d'humilité, un peu plus d'humanité dans l'instruction, un peu plus d'universalisme...

Il est bon aussi de rappeler d'où l'Europe a tiré les sucs nourriciers dont elle s'est engraissée. La réponse est simple : elle les a pris en dehors d'elle. Elle les a empruntés au monde gréco-romain qui l'a précédée, puis au monde de culture arabe qui s'est développé en parallèle avec elle, enfin au monde byzantin. C'est du monde arabe, en particulier, que sont venus les textes arabes d'Aristote, de Galien, et de bien d'autres, qui, traduits en latin, ont nourri la Renaissance du XIIe siècle. C'est du monde byzantin que vinrent les originaux de ces mêmes textes, qui en permirent une étude plus précise et alimentèrent la floraison scholastique du XIIIe siècle. Que serait Thomas d'Aquin s'il n'avait trouvé en Averroès un adversaire à sa mesure ? Que serait Duns Scott s'il n'avait trouvé en Avicenne, pour reprendre la formule de Gilson, un "point de départ" ? Et bien des textes dont l'Europe s'est nourrie lui sont venues par l'intermédiaire des traducteurs juifs. L'Europe doit ainsi prendre conscience de l'immensité de la dette culturelle qu'elle a envers ces truchements (c'est d'ailleurs un mot arabe...) : envers les Juifs, en dehors d'elle comme en son intérieur, ainsi qu'envers le monde de culture arabe, chrétiens comme musulmans.

J'ai dit que les Arabes avaient traduit, et beaucoup traduit. Cela veut dire d'une part qu'ils ont transmis l'héritage grec à l'Occident, dans tous les domaines : médecine, mathématiques, philosophie, à tel point que celui-ci a contracté envers le monde arabe une dette culturelle énorme ... Cette dette était encore reconnue (à tous les sens du mot « reconnaissance ») par le Moyen Age de Gerbert d'Aurillac, de Roger Bacon, de Frédéric II de Sicile... L'admiration pour le trésor de réflexion et de savoir venu des Arabes n'empêchait d'ailleurs pas une polémique ferme sur la doctrine... Quoi qu'il en soit, rappeler l'importance des traductions arabes ne veut en aucun cas dire que les Arabes se seraient contentés de transmettre passivement des livres dont le contenu leur serait demeuré scellé. Tout au contraire, ils on également été des créateurs. Ils ont prolongé, parfois très loin, le savoir qu'ils recevaient ...La reprise d'un contact direct avec l'héllénisme byzantin entraina un court-circuit culturel : on pouvait sauter par dessus les intermédiaires arabes ...Tout est en place pour que se développe une dénégation systématique et globale de l'héritage arabe ... La conscience d'une dette resta cependant encore claire pour les grands orientalistes de la Renaissance et du XVII, Postel, Pococke, ou Fontialis. Mais elle a été refoulée des mémoires à l'époque des Lumières, puis au XIXe siècle ... Pour le dire en passant, l'Occident n'a de la sorte que la monnaie de sa pièce quand on veut lui faire accroire, par une exagération inverse, que les Arabes ont tout inventé.

La capacité que l'homme possède de se sacrifier montre qu'il est capable de faire passer le Bien avant l'Être. Le sacrifice dont il est question ici est tout autre chose que le suicide. Celui-ci supprime l'être faute de voir qu'il ouvre sur le Bien. Ici, il s'agit au contraire de comprendre qu'il y a un Bien qui nous est accessible au-delà de la simple existence.
Ce bien, nous pouvons le vouloir ; voire c'est dans et par la volonté qu'il devient accessible. Ce rapport au Bien qui s'établit dans la volonté est la foi. On peut peut-être transposer ce qui vient d'être dit du sacrifice à ce « sacrifice de l'intellect » qu'est la foi. Avant qu'on ne se récrie, rappelons d'abord, contre un contresens fréquent, que l'expression doit s'entendre comme un génitif subjectif traduisant l'expression paulinienne de logikè latreia : l'intellect est le sacrificateur, non la victime ; il doit offrir un sacrifice et surtout pas se nier soi-même en s'abîmant dans la sottise.
Le christianisme est la religion qui n’est qu’une religion, et rien d’autre. Le judaïsme est une religion et un peuple ; le bouddhisme une religion et une sagesse ; l’islam est une religion et une loi. (Religion et politique en islam, Académie des sciences morales et politiques, Séance du lundi 21 septembre 2015)
Le vrai problème n'est pas celui du monothéisme exclusif dans son opposition au culte d'autres dieux rabaissés au rang d'idoles. Il est celui du rapport idolâtrique au divin, tel qu'il fait de celui-ci le miroir du désir humain et, le cas échéant, de ses perversions.
La vérité n'aurait d'autre lieu que la science, conçue sur le modèle de la physique classique. En conséquence, le terme de « métaphysique » devient dans la rhétorique néopositiviste, au même titre que « mysticisme », « mauvaise poésie » et quelques autres gentillesses, une des poubelles chargées d'accueillir tout énoncé non scientifique. La métaphysique est d'ailleurs rejetée en même temps que tout énoncé normatif, moral ou esthétique. Elle ne décrit nullement la réalité, mais exprime un sentiment de la vie. De façon intéressante, Carnap ne nie pas la légitimité de ce besoin d'expression. C'est ainsi qu'il met au crédit de Nietzsche que lui, au moins, n'ait pas cherché à exprimer sa métaphysique autrement que dans un style poétique. […] Ce scientisme n'est plus guère répandu chez les chercheurs de pointe. En revanche, il reste fréquent chez les vulgarisateurs et dans l'opinion publique.
Maintenant, ce qu'il faut sauver, ce n'est plus un système politique particulier, ni même une civilisation déterminée. C'est l'humanité toute entière, l'animal qui parle, l'animal qui entretient une conversation, qui doute de sa propre légitimité et qui a besoin de raisons pour vouloir mener plus loin l'aventure humaine.
Depuis lors, le terme "séculier" est devenu un de ses mots qui expriment la (bonne) conscience de soi de la Modernité éclairée, satisfaite d'avoir laissé derrière elle tout ce pour quoi elle trouve divers noms, parmi lesquels le terme de " Moyen-âge", qui suffit à déconsidérer tout ce qui en relève. Pourtant, le terme est d'origine chrétienne, et il s'enracine plus précisément dans le droit canonique où il désigne celui qui, au sein de l'Église, vit dans le "siècle", à la différence de celui qui est soumis à une règle monastique. Cette révolution sémantique n'est pas sans parallèle. Ainsi, l'adjectif "laïc", qui a pris le sens de "extérieur à l'Église", désignait à l'origine un statut précis à l'intérieur de l'Église, celui du baptisé qui n'a pas de fonction cléricales.
P. 131
À la suite de la réduction de l'être à l'existence brute, le désir de l'être prend un aspect nouveau. Il était désir de l'Être comme convertible avec le Bien ; il devient simple désir de persévérer dans une existence devenue moralement neutre. Parallèlement, et peut-être non sans quelque rapport souterrain, la physique moderne, au moins depuis Galilée, change sa façon de comprendre le mouvement. Pour Aristote, il était une façon pour les éléments de faire force vers leur lieu naturel, où il atteignent la forme parfaite de ce qu'ils sont. La physique d'après Galilée suppose les corps lancés dans un déplacement qui se perpétue indéfiniment, sous le simple effet de l'inertie.