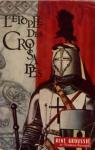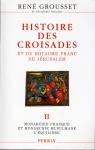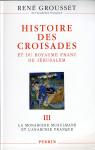Nationalité : France
Né(e) à : Aubais , le 05/09/1885
Mort(e) à : Paris , le 12/09/1952
Ajouter des informations
Né(e) à : Aubais , le 05/09/1885
Mort(e) à : Paris , le 12/09/1952
Biographie :
René Grousset (5 septembre 1885 à Aubais - 12 septembre 1952 à Paris) est un historien français, spécialiste de l'Asie, et membre de l'Académie française.
René Grousset fait ses études à Montpellier. Il est engagé pendant la Première Guerre mondiale, puis devient professeur d’histoire et de géographie à l’école des Langues orientales. Il est chargé de cours à l’École des sciences politiques, conservateur au Musée du Louvre, conservateur au Musée Guimet à partir de 1929, puis directeur du Musée Cernuschi à partir de 1933. Il est secrétaire du Journal asiatique et membre du Conseil des musées nationaux.
Avec Ernest Seillière, Jean Tharaud, Octave Aubry et Robert d'Harcourt, il est une des cinq personnes élues le 14 février 1946 à l'Académie française lors de la première élection groupée de cette année visant à combler les très nombreuses places vacantes laissées par la période de l'Occupation. Il est reçu le 30 janvier 1947 par Henry Bordeaux au fauteuil d'André Bellessort.
L’Épopée des Croisades et l'Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, constamment réédités depuis sa mort, comptent encore aujourd'hui parmi les ouvrages de référence sur les Croisades, tant par leur richesse que par la beauté classique de leur style.
Le médiéviste Pierre Aubé écrit de lui : « Cet historien, qui a su s'appuyer sur le meilleur des plus grands orientalistes de son temps, dont l'érudition est d'une rare solidité quand il s'agit d'établir des faits, est très orienté quand il s'agit de les interpréter. Son angle de vision est très marqué par l'utopie colonialiste qui avait cours dans les années 1920-1930 où il a construit son opus magnum. » (Un croisé contre Saladin, Renaud de Châtillon, Fayard, 2007, p. 82, n. 1.)
+ Voir plusRené Grousset (5 septembre 1885 à Aubais - 12 septembre 1952 à Paris) est un historien français, spécialiste de l'Asie, et membre de l'Académie française.
René Grousset fait ses études à Montpellier. Il est engagé pendant la Première Guerre mondiale, puis devient professeur d’histoire et de géographie à l’école des Langues orientales. Il est chargé de cours à l’École des sciences politiques, conservateur au Musée du Louvre, conservateur au Musée Guimet à partir de 1929, puis directeur du Musée Cernuschi à partir de 1933. Il est secrétaire du Journal asiatique et membre du Conseil des musées nationaux.
Avec Ernest Seillière, Jean Tharaud, Octave Aubry et Robert d'Harcourt, il est une des cinq personnes élues le 14 février 1946 à l'Académie française lors de la première élection groupée de cette année visant à combler les très nombreuses places vacantes laissées par la période de l'Occupation. Il est reçu le 30 janvier 1947 par Henry Bordeaux au fauteuil d'André Bellessort.
L’Épopée des Croisades et l'Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, constamment réédités depuis sa mort, comptent encore aujourd'hui parmi les ouvrages de référence sur les Croisades, tant par leur richesse que par la beauté classique de leur style.
Le médiéviste Pierre Aubé écrit de lui : « Cet historien, qui a su s'appuyer sur le meilleur des plus grands orientalistes de son temps, dont l'érudition est d'une rare solidité quand il s'agit d'établir des faits, est très orienté quand il s'agit de les interpréter. Son angle de vision est très marqué par l'utopie colonialiste qui avait cours dans les années 1920-1930 où il a construit son opus magnum. » (Un croisé contre Saladin, Renaud de Châtillon, Fayard, 2007, p. 82, n. 1.)
Ajouter des informations
étiquettes
Citations et extraits (81)
Voir plus
Ajouter une citation
Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, tome 2 : 1131-1187 L'équilibre
René Grousset
René Grousset
Ainsi, même sous un pauvre adolescent lépreux - quand Baudouin IV remporta cette victoire insigne, il n'avait que dix-sept ans et son mal empirait chaque jour - même dans des circonstances extérieures presque désespérées, face à un Islam unifié de la Nubie à Hama, la dynastie française de Jérusalem continuait à accomplir son œuvre salvatrice, son œuvre capétienne. La journée de Tell al-Safiya ou de Montgisard - quel que soit le nom qu'on lui donne, selon qu'on suit Abu Shama ou Ernoul - avait la valeur de notre Bouvines. (p. 629-630).
Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, tome 1 : 1095-1130 L'anarchie musulmane
René Grousset
René Grousset
Le mardi 7 juin 1099, l'armée franque tout entière arriva devant Jérusalem. Les chroniqueurs même tardifs nous disent en termes émouvants l'allégresse qui souleva les pèlerins en apercevant au sud de Lifta, à hauteur de l'actuel mausolée de Sheik Bedr, les dômes de la ville sainte : "Quand il ouïrent nommer Jérusalem, lors commencèrent à pleurer..." (page 213).
Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, tome 3 : 1188-1291 L'anarchie franque
René Grousset
René Grousset
Le grand maître du Temple, Guillaume de Beaujeu s'empressa d'alerter les gens d'Acre, mais, ceux-ci, avec l'aveuglement stupide des peuples que Zeus veut perdre, répondirent à Guillaume comme les Athéniens à Démosthène, "et ne le vostrent croire". (p.735)
Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, tome 3 : 1188-1291 L'anarchie franque
René Grousset
René Grousset
Il est vrai que Venise, qui avait tant de responsabilités secrètes ou avouées dans la chute de Tripoli, adopa pour la défense de Saint-Jean-d'Acre une attitude nettement loyaliste, attitude qui se comprend du reste car, si Tripoli avait été dans la clientèle génoise, Acre, qu'il s'agissait maintenant de sauver, était dans la clientèle vénitienne. (page 732)
Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem, tome 3 : 1188-1291 L'anarchie franque
René Grousset
René Grousset
La chute de Tripoli ne réveilla pas l'Europe.
[1279, chute de la dynastie Song du sud]
C'était la première fois que la Chine tout entière, Sud compris, tombait aux mains d'un conquérant turco-mongol. Ce que ni les Turcs T'o-pa du V°s, ni les Tongous Djürchät du XII° n'avaient pu obtenir, Khoubilaï y était enfin parvenu. Il réalisait le rêve obscurément poursuivi depuis dix siècles par "tout ce qui vivait sous une tente de feutre", à travers d'innombrables générations de nomades. Avec lui, les pâtres errants de la steppe, "tous les fils du Loup Gris et de la Biche", devenaient enfin maîtres de la Chine, c'est-à-dire de la plus compacte agglomération de cultivateurs sédentaires de l'Asie. Seulement la conquête avait été assez lente pour que les résultats les plus dangereux en fussent comme amortis. Dans la personne de Khoubilaï, en effet, si le petit-fils des nomades a conquis la Chine, il a été lui-même conquis à la civilisation chinoise. Il put alors réaliser le constant objectif de sa politique personnelle : devenir un véritable Fils du Ciel, faire de l'Empire mongol un Empire chinois. A cet égard, la voie était libre. Les Song une fois disparus, il devenait le maître légitime de l'empire quinze fois centenaire. Sa dynastie, qui prit le nom de dynastie Yuan (1280-1368), n'aspira plus qu'à continuer les quelque XXII dynasties chinoises du temps passé. Signe visible de cette sinisation : Khoubilaï, même après avoir arraché Qaraqorum à Arïq-bögä, ne vint jamais y habiter. Dès 1256-1257, il avait fait choix, comme résidence d'été, du site de Chang-tou, ou K'ai-p'ing, près du Dolon-nor, dans l'actuel Tchakhar oriental, où il fit construire un ensemble de palais. En 1260, il établit sa capitale à Pékin. En 1267, il commença à construire au nord-ouest de l'ancienne agglomération pékinoise une ville nouvelle qu'il appela T'ai-tou, "Grande capitale" et qui fut également connue sous le nom de Ville du Khan, Khanbaligh, la "Canbaluc" des voyageurs occidentaux.
pp. 406-407
C'était la première fois que la Chine tout entière, Sud compris, tombait aux mains d'un conquérant turco-mongol. Ce que ni les Turcs T'o-pa du V°s, ni les Tongous Djürchät du XII° n'avaient pu obtenir, Khoubilaï y était enfin parvenu. Il réalisait le rêve obscurément poursuivi depuis dix siècles par "tout ce qui vivait sous une tente de feutre", à travers d'innombrables générations de nomades. Avec lui, les pâtres errants de la steppe, "tous les fils du Loup Gris et de la Biche", devenaient enfin maîtres de la Chine, c'est-à-dire de la plus compacte agglomération de cultivateurs sédentaires de l'Asie. Seulement la conquête avait été assez lente pour que les résultats les plus dangereux en fussent comme amortis. Dans la personne de Khoubilaï, en effet, si le petit-fils des nomades a conquis la Chine, il a été lui-même conquis à la civilisation chinoise. Il put alors réaliser le constant objectif de sa politique personnelle : devenir un véritable Fils du Ciel, faire de l'Empire mongol un Empire chinois. A cet égard, la voie était libre. Les Song une fois disparus, il devenait le maître légitime de l'empire quinze fois centenaire. Sa dynastie, qui prit le nom de dynastie Yuan (1280-1368), n'aspira plus qu'à continuer les quelque XXII dynasties chinoises du temps passé. Signe visible de cette sinisation : Khoubilaï, même après avoir arraché Qaraqorum à Arïq-bögä, ne vint jamais y habiter. Dès 1256-1257, il avait fait choix, comme résidence d'été, du site de Chang-tou, ou K'ai-p'ing, près du Dolon-nor, dans l'actuel Tchakhar oriental, où il fit construire un ensemble de palais. En 1260, il établit sa capitale à Pékin. En 1267, il commença à construire au nord-ouest de l'ancienne agglomération pékinoise une ville nouvelle qu'il appela T'ai-tou, "Grande capitale" et qui fut également connue sous le nom de Ville du Khan, Khanbaligh, la "Canbaluc" des voyageurs occidentaux.
pp. 406-407
"Aucune civilisation n'est détruite du dehors sans s'être tout d'abord ruinée elle-même, aucun empire n'est conquis de l'extérieur qu'il ne se soit préalablement suicidé. Et une société, une civilisation ne se détruisent de leurs propres mains que quand elles ont cessé de comprendre leur raison d'être, quand l'idée dominante autour de laquelle elles étaient naguère organisées leur est devenue comme étrangère..."
Si vous êtes tués, c'est la couronne du martyre; si vous êtes vainqueurs, une gloire immortelle. Quant à vouloir fuir, inutile : la France est trop loin!
Les préférences de Khoubilaï pour le bouddhisme ne l’avaient nullement empêché de montrer de la sympathie pour le nestorianisme. Aux grandes solennités chrétiennes, à l’exemple de ses prédécesseurs, il se laissait présenter par les prêtres nestoriens attachés à son ordou les évangiles qu’il encensait et baisait pieusement.
[La fin de Tamerlan]
L'empereur Yong-lo (1403-1424), frère et deuxième successeur de Hong-wou, venait de monter sur le trône quand Tamerlan annonça l'intention d'aller conquérir la Chine pour convertir ce pays à l'islamisme et commença dans ce but à réunir une immense armée à Otrâr.
Ce fut sans doute là un des plus graves périls qu'ait jamais connus la civilisation chinoise, car cette fois il ne s'agissait plus de l'invasion d'un Khoubilaï, respectueux du bouddhisme, du confucéisme et désireux de devenir un véritable Fils du Ciel, mais de l'irruption d'un musulman fanatique qui, en islamisant le pays, eût vraiment détruit la civilisation chinoise et dénationalisé la société chinoise. Sans doute Yong-lo, le plus guerrier des empereurs Ming, aurait été un adversaire non négligeable, mais le péril était grave, lorsque Tamerlan tomba malade à Otrâr et décéda à l'âge de soixante et onze ans, le 19 janvier 1405.
(...)
Châh Rokh [quatrième fils de Tamerlan] fut le plus remarquable des Timourides. Bon capitaine et vaillant soldat, mais d'humeur plutôt pacifique, humain, modéré, fort épris de lettres persanes, grand constructeur, protecteur des poètes et des artistes, ce fils du terrible Tamerlan fut un des meilleurs souverains de l'Asie. Même évolution que de Gengis-Khan à Khoubilaï. Son long règne de 1407 à 1447, fut décisif pour ce qu'on a appelé, dans le domaine culturel, la renaissance timouride, âge d'or de la littérature et de l'art persans. Hérât dont il avait fait sa capitale, Samarqand, résidence de son fils Olough-beg (il avait chargé celui-ci du gouvernement de la Transoxiane) devinrent les foyers les plus brillants de cette renaissance. Par un de ces paradoxes si fréquents en histoire, les fils du massacreur turc qui avait ruiné Ispahan et Chîrâz allaient devenir les plus actifs protecteurs de la culture iranienne.
pp. 619 et 621
L'empereur Yong-lo (1403-1424), frère et deuxième successeur de Hong-wou, venait de monter sur le trône quand Tamerlan annonça l'intention d'aller conquérir la Chine pour convertir ce pays à l'islamisme et commença dans ce but à réunir une immense armée à Otrâr.
Ce fut sans doute là un des plus graves périls qu'ait jamais connus la civilisation chinoise, car cette fois il ne s'agissait plus de l'invasion d'un Khoubilaï, respectueux du bouddhisme, du confucéisme et désireux de devenir un véritable Fils du Ciel, mais de l'irruption d'un musulman fanatique qui, en islamisant le pays, eût vraiment détruit la civilisation chinoise et dénationalisé la société chinoise. Sans doute Yong-lo, le plus guerrier des empereurs Ming, aurait été un adversaire non négligeable, mais le péril était grave, lorsque Tamerlan tomba malade à Otrâr et décéda à l'âge de soixante et onze ans, le 19 janvier 1405.
(...)
Châh Rokh [quatrième fils de Tamerlan] fut le plus remarquable des Timourides. Bon capitaine et vaillant soldat, mais d'humeur plutôt pacifique, humain, modéré, fort épris de lettres persanes, grand constructeur, protecteur des poètes et des artistes, ce fils du terrible Tamerlan fut un des meilleurs souverains de l'Asie. Même évolution que de Gengis-Khan à Khoubilaï. Son long règne de 1407 à 1447, fut décisif pour ce qu'on a appelé, dans le domaine culturel, la renaissance timouride, âge d'or de la littérature et de l'art persans. Hérât dont il avait fait sa capitale, Samarqand, résidence de son fils Olough-beg (il avait chargé celui-ci du gouvernement de la Transoxiane) devinrent les foyers les plus brillants de cette renaissance. Par un de ces paradoxes si fréquents en histoire, les fils du massacreur turc qui avait ruiné Ispahan et Chîrâz allaient devenir les plus actifs protecteurs de la culture iranienne.
pp. 619 et 621
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

En vert et contre tous
moravia
54 livres

La bibliothèque de Sylvain Tesson
Joad
105 livres
Auteurs proches de René Grousset
Quiz
Voir plus
Blanc, Noir... ou bien Gris ?
Jack London a écrit :
Croc-Blanc
Croc-Noir
Croc-Gris
20 questions
2620 lecteurs ont répondu
Thèmes :
noir et blanc
, couleur
, humour
, littérature
, contrairesCréer un quiz sur cet auteur2620 lecteurs ont répondu