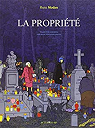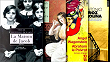Samedi 6 août 2022, dans le cadre du banquet du livre d'été « Demain la veille » qui s'est déroulé du 5 au 12 août 2022, Rosie Pinhas-Delpuech tenait une conférence intitulée : Demain/La Veille, une fonction grammaticale vitale en hebreu.
« Il y a quelques mois, j'ai publie une sorte de roman sur la naissance incertaine et balbutiante de l'hebreu moderne. A travers la traduction et l'ecriture, ma vie est liee au destin de cette langue et de la societe qui la parle depuis cent ans seulement. A travers les deux – une langue, une communaute humaine – je m'interroge tous les matins sur qui je suis, qui nous sommes tous ensemble dans le monde. Ce tout petit pays et sa langue sont pour moi comme un prototype d'humanite, une petite scene ou se jouent nos destins petits et grands. Periodiquement, j'y retourne, j'ecoute, je regarde, de toutes petites choses, des modeles en miniature. de la Bible aux auteurs modernes que je choisis de faire passer en francais, de la traduction a l'ecriture, qu'est-ce qui dans l'hebreu, langue ancienne-nouvelle, m'interroge en permanence sur ce qui fut et ce qui sera, sur une utopie peut-etre encore en cours, bancale, dissonante, precaire ? »
+ Lire la suite
Un jour, il y a longtemps, les hommes ont voulu être aussi fort que Dieu et construire une tour qui aille jusqu’au ciel, mais Dieu a décidé de les punir de leur orgueil et a mélangé leurs langues. Les gens ne se comprenaient plus, l’un demandait du mortier, on lui apportait de l’eau, l’autre demandait une pierre, on lui apportait un seau, ils ont empilé n’importe quoi et, badaboum, la tour s’est effondrée. On l’a appelée la tour de Babel, dit la grand-mère, parce que Babel veut dire mélange.
p.29
Dans les quartiers, le nettoyage de Pâques des Éthiopiens relève d’une entreprise cosmique. Ils soulèvent tout, ils chassent partout le moindre grain de poussière susceptible de contenir du levain.On les sent capables d’aller épousseter la voûte céleste et ses lampadaires.
p.161
(Jérusalem)
Le soir....C'était sur la terrasse, la mer était plongée dans le noir, on l'entendait respirer.
p.123
À défaut d'en voir un, l'Arabe était entré dans le tableau comme l'ennemi abstrait d'un manuel d'histoire. Sans haine, sans parti pris, des fusils de part et d'autres d'un lac, d'une colline, d'un mur de barbelés.Un pays ensoleillé, effervescent. en guerre avec un peuple invisible.C'etait en 1966, j'avais aperçu la queue de la comète, les derniers éclats d'un projet humain , fabriqué avec des rêves fous. L'été suivant en 1967, les frontières de l'utopie voleraient en éclats, la figure de l'autre ferait violemment irruption dans l'image.
p.62
(Un pays =Israel)

Si je me posais toutes ces questions à cette heure-là de la nuit, c’était parce que je me demandais par quel obscur et illisible destin, après maints allers-retours entre deux continents, entre le Levant et le Ponant, je me trouvais dans ce petit train de Bourgogne, à côté de l’Orient-Express qui m’avait transportée d’Istanbul en France en 1965, sans tapis rouge ni pont de la rivière Kwaï. Le train reliait Istanbul à Milan – et plus au-delà à Vienne – en passant par Sofia, Belgrade, Ljubljana, Trieste et Venise. À l’époque, les voyages en avion étaient chers, les bagages limités, et je partais étudier à Grenoble avec des livres et des vêtements pour un long hiver. J’étais inscrite en propédeutique de lettres, le mot m’était encore inconnu, aujourd’hui je l’aime autant que celui de prolégomènes. Sous leurs apparences pédantes, tous deux signifient l’humble préparation à un savoir. Nous avions quitté la gare de Sirkeci par un après-midi d’automne à la lumière rasante. Les parents, les mouettes, la mer, les navires étaient restés le long du quai qui longe le port et nous avions fait cap vers le soleil couchant, vers l’Occident. Depuis, j’ai maintes fois éprouvé la nature fatidique et quasi vengeresse des mots. Tôt ou tard, ils vous rattrapent au collet et vous rappellent leur pouvoir obscur sur votre destin. Car chacun sait que l’Orient-Express avait été conçu à l’origine pour transporter en Orient les Occidentaux épris d’orientalisme, et non les Orientaux assoiffés des Lumières de l’Europe. Parti de Londres, Paris ou Vienne à destination de Constantinople-Istanbul, il déchargeait une partie de sa cargaison au pied du sérail des sultans et, faisant traverser le Bosphore en quelques coups de rame à ceux qui voulaient pousser plus loin l’exotisme, les déposait à la somptueuse gare de Haydarpaşa d’où le TaurusExpress les conduisait jusqu’à Alexandrie en Égypte. Le train traversait alors une région tourmentée, l’ancienne Palestine ottomane, appelée Terre sainte par les pèlerins chrétiens, et Eretz Israël par les Amants de Sion, ces jeunes révolutionnaires russes, barbus et chevelus, amoureux de l’hébreu, qui prônaient la vie communautaire et l’égalité des sexes sur la terre de leurs ancêtres. Sans le savoir, par mille détours aveugles du destin, c’est en fait vers eux que je m’acheminerais un jour, en commençant par leur tourner le dos.

Il n’y a pas longtemps, j’étais à la gare de Bercy. J’attendais le train de 22h38 pour Sens dans l’Yonne. Bercy est une annexe de la gare de Lyon, elle ne dessert que quelques gares en Bourgogne et, plus récemment, en Auvergne. Pendant un temps, elle a hébergé aussi les trains pour Milan, Venise et Rome. Sur le modeste tableau d’affichage, le TER pour Laroche-Migennes côtoyait le Stendhal et le Palatino. Entre comices agricoles et Chartreuse de Parme, ça faisait rire et rêver. Aujourd’hui, dans le hall venteux, on croise des hommes de sécurité avec leurs chiens muselés, parfois des jeunes encapuchonnés, et quelques voyageurs pas tout à fait provinciaux ni tout à fait banlieusards. Construit sur une plateforme au-dessus de la rue, c’est un espace atypique, intime malgré son isolement, le train que je prends aussi, à peine quelques wagons où il fait bon lire, somnoler. On traverse quelques gares de campagne, les voyageurs disparaissent dans l’obscurité, je reste un peu seule, j’ai un peu peur, mais j’aime ce voyage nocturne, ce dernier train. Parfois, quand il fait encore jour, je m’installe dans le premier wagon avec vue plongeante sur les rails à travers la cloison de verre et par-dessus l’épaule du conducteur. Il y a ce moment où, en quittant la gare, on passe devant des espèces de miradors, comme dans les prisons ou dans les camps. Puis le train traverse un certain nombre de nœuds ferroviaires. Il pourrait sinuer et aller plutôt vers la droite, vers la gauche, vers le milieu. L’observateur ne le sait pas jusqu’au dernier moment. Le train s’engage, choisit, jusqu’à l’embranchement suivant. Et on se dit que c’est comme dans la vie, un rien vous fait basculer d’un côté ou de l’autre.
Parfois, quand il écrit le mot "gurbet", sa gorge se noue. "Gurbet", c'est le lointain douloureux et étranger, la terre inhospitalière, le déracinement, le mal du pays, l'étrangeté. Ça vient de "garip", qui désigne l'étranger, celui qui a quitté son foyer, le sol natal, un être à part, marginal, déraciné. Le mot revient souvent dans les lettres qu'il lit, comme dans celles qu'il écrit. Et il s'étonne parfois que le simple tracé de ces six lettres ravive avec une telle force la douleur des heures, des jours et des années passées au loin : "Comme c'est étrange, dit-il, comme c'est "garip", les mots."
« […] "ariri" signifie "désenfanté", écrit-il en traduisant par le mot français du XIe siècle dans son commentaire en hébreu. Mais "ariri" vient aussi de "er", dit Rachi, qui signifie lucide, vigilant. Je vais, je marche, comme tu me l'as ordonné et j'ai acquis de la lucidité, je vois ce qui se passe. Le mot "ariri", poursuit Rachi, signifie aussi "ruine", "destruction". Et aussi "ébranlement". Je suis lucide et ma lucidité me ruine et m'ébranle. Je suis proche de la mort, lucide et stérile. » (p. 224)
L'oreille de l'enfant associe par parenté sonore le turc et le français, l'armée, "ordu", et l'"ordre" dont cette même armée se porte garante. Dans son lit, elle croit que l'armée, "ordu", s'est brusquement déchaînée et que, devenue "horde" désordonnée, elle s'est déversée dans la rue.
J’ignore jusqu’à aujourd’hui la cause de cet amour fou pour cette orthographe, de cette jubilation enfantine à conquérir l’arbitraire souverain de la langue. Peut-être que l’écriture phonétique du turc me paraissait d’une facilité enfantine et que la difficulté du français était à la mesure de celle de grandir ?