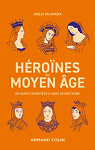Armand Colin est une maison d`édition française. Elle a été créée en 1870 par Auguste Armand Colin , et s`est spécialisée dans les ouvrages scolaires et le milieu universitaire. Ses collections les plus renommées sont la collection "U" créée en 1968, la collection "Cursus" ou encore la collection "128".
Livres populaires
voir plus
Dernières parutions

Sur la piste des Jeux antiques: Olympie, Delphes, Némée, Isthmia... en 100 infographies
Anne Martinetti
Collections de Armand Colin
Dernières critiques
Cet ouvrage est assurément de la belle œuvre ! Grand merci à Babelio et aux éditions Armand Colin de m'avoir permis de le compulser dans le cadre de l'opération Masse Critique.
L'auteur, cartographe et scientifique anglais, se veut couvrir un ensemble de sujets concernant l'Antarctique aussi vaste que le continent lui-même. Il y parvient en 73 planches minutieusement détaillées regroupées en 9 chapitres : géographie, glace, territoire, atmosphère, mers, faune, présence humaine, explorations et avenir. Et c'est passionnant, du moins pour qui s'intéresse à ce continent du bout du Monde. J'en fais partie, à ceci plusieurs raisons : la lecture des remarquables aventures des MM Shackleton, Scott et Admunsen, mais aussi la chance d'avoir pu frôler ce pôle depuis le bout de l'Afrique et la Patagonie, de quoi éveiller une curiosité tenace sur ces étendues d'eau et de glace pour le moins inhospitalières.
Je me dois cependant de resituer cet ouvrage dans sa finalité : il s'agit d'une somme d'informations très détaillées et structurées qui, selon moi, néophyte que je suis et que je reste, doivent être complétées par d'autres approches de ce monde glaciaire. L'ouvrage ne comporte par exemple qu'une quinzaine de photos qui me paraissent bien insuffisantes pour prendre la mesure, visuellement, de cet univers. Je ne puis que conseiller de compléter cette lecture par un ouvrage plus visuel, comme par exemple « Peninsula » de Thierry Suzan paru chez National Geographic. Par ailleurs, la lecture de « Un monde au-delà des hommes » de Catherine Hermary-Vieille sur Scott et Admunsen, ou de « l'Incroyable voyage de Shackleton » d' Alfred Lansing donneront une idée de la façon dont un continent de glace peut devenir un enfer pour ceux qui tentent de l'amadouer.
L'auteur, cartographe et scientifique anglais, se veut couvrir un ensemble de sujets concernant l'Antarctique aussi vaste que le continent lui-même. Il y parvient en 73 planches minutieusement détaillées regroupées en 9 chapitres : géographie, glace, territoire, atmosphère, mers, faune, présence humaine, explorations et avenir. Et c'est passionnant, du moins pour qui s'intéresse à ce continent du bout du Monde. J'en fais partie, à ceci plusieurs raisons : la lecture des remarquables aventures des MM Shackleton, Scott et Admunsen, mais aussi la chance d'avoir pu frôler ce pôle depuis le bout de l'Afrique et la Patagonie, de quoi éveiller une curiosité tenace sur ces étendues d'eau et de glace pour le moins inhospitalières.
Je me dois cependant de resituer cet ouvrage dans sa finalité : il s'agit d'une somme d'informations très détaillées et structurées qui, selon moi, néophyte que je suis et que je reste, doivent être complétées par d'autres approches de ce monde glaciaire. L'ouvrage ne comporte par exemple qu'une quinzaine de photos qui me paraissent bien insuffisantes pour prendre la mesure, visuellement, de cet univers. Je ne puis que conseiller de compléter cette lecture par un ouvrage plus visuel, comme par exemple « Peninsula » de Thierry Suzan paru chez National Geographic. Par ailleurs, la lecture de « Un monde au-delà des hommes » de Catherine Hermary-Vieille sur Scott et Admunsen, ou de « l'Incroyable voyage de Shackleton » d' Alfred Lansing donneront une idée de la façon dont un continent de glace peut devenir un enfer pour ceux qui tentent de l'amadouer.
Emmanuel Thiébot est historien et responsable du mémorial des civils à Falaise dans le Calvados. Ce Normand est un grand collectionneur de documents qui traitent de la Seconde Guerre mondiale. (il est spécialiste de cette période.)
Débarquement, libération : des préparations aux commémorations, est son neuvième et dernier ouvrage qui vient de sortir chez Armand Colin. (Dunod)
Il va surtout nous faire le récit des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, des préparations du débarquement à la capitulation du Japon en septembre 1945.
Comme il le note dans l'avant-propos : « Cette approche historique propose de se pencher sur 50 dates ou événements en s'appuyant sur un document inédit ou une photo plus célèbre présentée dans son contexte d'origine. » Cela peut être une affiche, un dessin, une carte postale, des photos d'époque, des articles de presse, des objets divers et variés…
Et grâce à toutes ces illustrations, cela rend la lecture de ce livre beaucoup plus ludique. Donc il y a 50 thèmes qui vont être abordés sur quatre pages à chaque fois. Trois pages de textes et une image pour mettre en lumière le sujet. C'est écrit de façon chronologique, mais je trouve qu'il est tout à fait possible de se référer plus particulièrement à un thème si on veut l'approfondir ou si on veut se remettre en mémoire un événement.
D'emblée, avant de me plonger dans sa lecture, je suis allée rechercher des informations sur des sujets que je connaissais bien, comme le massacre d'Oradour-sur-Glane (lieu où je suis allée), ou le pillage et la spoliation des oeuvres d'art(ayant vu un film sur le sujet). Et cela ne m'en a pas rendu la lecture plus difficile.
C'est une véritable encyclopédie qui va à l'essentiel et qui est abordable pour tout public que l'on s'y connaisse ou non en histoire. L'écriture reste simple pour une bonne compréhension, ce qui en fait sa force.
J'ai vraiment apprécié cette approche et j'ai eu beaucoup de plaisir de le lire. Je ne peux que le recommander.
Petite précision, il y a des notes, une table des sigles utilisés et une bibliographie indicative à la fin de l'ouvrage.
Je remercie Babélio et les éditions Armand Colin (Dunod) pour cette découverte fort intéressante.
Débarquement, libération : des préparations aux commémorations, est son neuvième et dernier ouvrage qui vient de sortir chez Armand Colin. (Dunod)
Il va surtout nous faire le récit des derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, des préparations du débarquement à la capitulation du Japon en septembre 1945.
Comme il le note dans l'avant-propos : « Cette approche historique propose de se pencher sur 50 dates ou événements en s'appuyant sur un document inédit ou une photo plus célèbre présentée dans son contexte d'origine. » Cela peut être une affiche, un dessin, une carte postale, des photos d'époque, des articles de presse, des objets divers et variés…
Et grâce à toutes ces illustrations, cela rend la lecture de ce livre beaucoup plus ludique. Donc il y a 50 thèmes qui vont être abordés sur quatre pages à chaque fois. Trois pages de textes et une image pour mettre en lumière le sujet. C'est écrit de façon chronologique, mais je trouve qu'il est tout à fait possible de se référer plus particulièrement à un thème si on veut l'approfondir ou si on veut se remettre en mémoire un événement.
D'emblée, avant de me plonger dans sa lecture, je suis allée rechercher des informations sur des sujets que je connaissais bien, comme le massacre d'Oradour-sur-Glane (lieu où je suis allée), ou le pillage et la spoliation des oeuvres d'art(ayant vu un film sur le sujet). Et cela ne m'en a pas rendu la lecture plus difficile.
C'est une véritable encyclopédie qui va à l'essentiel et qui est abordable pour tout public que l'on s'y connaisse ou non en histoire. L'écriture reste simple pour une bonne compréhension, ce qui en fait sa force.
J'ai vraiment apprécié cette approche et j'ai eu beaucoup de plaisir de le lire. Je ne peux que le recommander.
Petite précision, il y a des notes, une table des sigles utilisés et une bibliographie indicative à la fin de l'ouvrage.
Je remercie Babélio et les éditions Armand Colin (Dunod) pour cette découverte fort intéressante.
Sur la piste des Jeux antiques: Olympie, Delphes, Némée, Isthmia... en 100 infographies
Anne Martinetti
Anne Martinetti
Merci @babelio_ et @dunod_editeur pour l'envoi 🤗
🏃
Histoire, mythologie et sport, ça permet un beau programme. Deux choses dont je suis fan et la troisième... Avec laquelle j'ai une relation compliquée 😂 je vous laisse deviner
J'ai été tentée par ce livre par pas mal de raisons 😅 Armand Colin l'éditeur déjà, souvenirs de manuel d'histoire que je devorais quand je m'ennuyais en cours... ; la grèce antique, une des civilisations où on a encore tellement a apprendre; et en infographies, un système que je trouve vraiment top pour apprendre, ayant une mémoire assez visuelle.
La sortie de ce livre tombe pile poil à temps avec l'arrivée des JO à Paris. Et je parle de l'événement sportif ici et non de toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour.
On en apprend beaucoup plus sur l'origine de ces jeux, la dimension très religieuse qui s'y attachait à l'époque, l'Organisation et tout ce qui en a découlé.
Vous saviez qu'il y avait en réalité quatre grandes sortes de jeux ? Qu'il y avait des jeux réservés aux femmes ? Que Néron a gagné les jeux juste en disant qu'il y participait ? Que les Égyptiens avaient aussi eu les leurs ?
Oui j'ai appris un sacré paquet de truc ! C'est un sujet sur lequel je ne m'etais pas forcément attardé, n'étant pas la plus passionnée, mais ce livre vous permet d'en apprendre très vite en peu de temps. On a en plus de grandes images descriptives d'Olympie et Delphes a l'époque, nous permettant de mieux visualiser l'importance de cet événement.
Par contre, on a aussi des listes qui m'ont totalement laissée de marbre ( marbre, antiquité 😂) . La liste des stades avec la dimension, le nombre de personnes, les gymnases ou les magistrats, clairement ce n'est pas la tasse de thé.. Et c'est quelque chose que je ne retiendrais pas 😅.
Il y a du bon, même très bon et du moins bon dans ce livre. On a entre 50 et 100 infographies ( selon les syndicats ou la police) , ma fiche descriptive en écrivant 50 , le livre 100 😅 mais vous avez 90 pages bien fournies sur l'histoire d'un rassemblement qui a encore lieu aujourd'hui. Alors si ça vous tente n'hésitez pas à le découvrir 😊
#booksta #bookstagramfrance #jo #jeuxolympiques #antiquite
🏃
Histoire, mythologie et sport, ça permet un beau programme. Deux choses dont je suis fan et la troisième... Avec laquelle j'ai une relation compliquée 😂 je vous laisse deviner
J'ai été tentée par ce livre par pas mal de raisons 😅 Armand Colin l'éditeur déjà, souvenirs de manuel d'histoire que je devorais quand je m'ennuyais en cours... ; la grèce antique, une des civilisations où on a encore tellement a apprendre; et en infographies, un système que je trouve vraiment top pour apprendre, ayant une mémoire assez visuelle.
La sortie de ce livre tombe pile poil à temps avec l'arrivée des JO à Paris. Et je parle de l'événement sportif ici et non de toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour.
On en apprend beaucoup plus sur l'origine de ces jeux, la dimension très religieuse qui s'y attachait à l'époque, l'Organisation et tout ce qui en a découlé.
Vous saviez qu'il y avait en réalité quatre grandes sortes de jeux ? Qu'il y avait des jeux réservés aux femmes ? Que Néron a gagné les jeux juste en disant qu'il y participait ? Que les Égyptiens avaient aussi eu les leurs ?
Oui j'ai appris un sacré paquet de truc ! C'est un sujet sur lequel je ne m'etais pas forcément attardé, n'étant pas la plus passionnée, mais ce livre vous permet d'en apprendre très vite en peu de temps. On a en plus de grandes images descriptives d'Olympie et Delphes a l'époque, nous permettant de mieux visualiser l'importance de cet événement.
Par contre, on a aussi des listes qui m'ont totalement laissée de marbre ( marbre, antiquité 😂) . La liste des stades avec la dimension, le nombre de personnes, les gymnases ou les magistrats, clairement ce n'est pas la tasse de thé.. Et c'est quelque chose que je ne retiendrais pas 😅.
Il y a du bon, même très bon et du moins bon dans ce livre. On a entre 50 et 100 infographies ( selon les syndicats ou la police) , ma fiche descriptive en écrivant 50 , le livre 100 😅 mais vous avez 90 pages bien fournies sur l'histoire d'un rassemblement qui a encore lieu aujourd'hui. Alors si ça vous tente n'hésitez pas à le découvrir 😊
#booksta #bookstagramfrance #jo #jeuxolympiques #antiquite

Etiquettes
voir plus